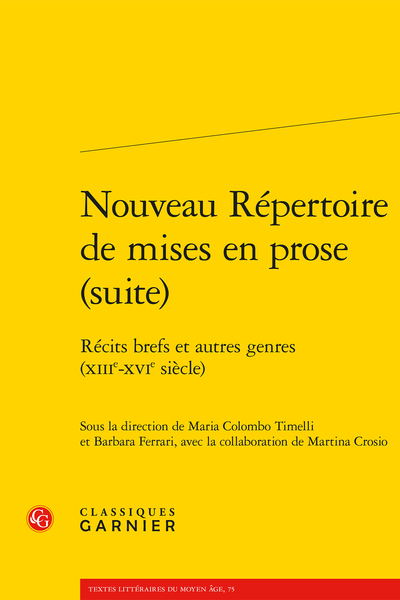
Avant-propos
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Nouveau Répertoire de mises en prose (suite). Récits brefs et autres genres (xiiie-xvie siècle)
- Auteurs : Colombo Timelli (Maria), Crosio (Martina), Ferrari (Barbara)
- Pages : 7 à 11
- Collection : Textes littéraires du Moyen Âge, n° 75
- Série : Mises en prose, n° 11
- Thème CLIL : 3438 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moyen Age
- EAN : 9782406157960
- ISBN : 978-2-406-15796-0
- ISSN : 2261-0804
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15796-0.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 30/04/2024
- Langue : Français
Avant-propos
Conçu pour être le complément du Répertoire de mises en prose publié en 2014 dans cette même collection, et constituant l’objectif principal d’un projet PRIN financé par le Ministère de l’Université italien en 2017, ce second volume a pour objet les réécritures en prose d’anciens poèmes exclues dans l’étude fondatrice de Georges Doutrepont (1939). Comme l’on sait, l’attention du savant belge s’était concentrée sur les deux genres les plus représentés dans ce domaine : « épopées » et « romans chevaleresques », comme le spécifie son titre même. Quelques sondages partiels menés au cours des années 2010 avaient en effet conforté notre hypothèse que le phénomène de l’adaptation en prose ne se basait pas sur le « genre » des poèmes-sources, mais touchait de manière beaucoup plus générale le goût des lecteurs de la fin du Moyen Âge d’une part et, de l’autre, la volonté des auteurs, et de leurs commanditaires, de préserver toute une tradition littéraire autochtone en en modernisant et la forme et la langue.
Deux premières enquêtes, de Barbara Ferrari et de Paola Cifarelli, avaient d’ailleurs confirmé l’existence d’un corpus d’œuvres hagiographiques d’une part, de récits brefs de l’autre, qui méritaient d’être considérés au sein d’un même corpus (Barbara Ferrari, « Réécritures en prose de poèmes hagiographiques français. Premier recensement », in Pour un nouveau répertoire des mises en prose. Roman, chanson de geste, autres genres, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 151-163 ; Paola Cifarelli, « Récits brefs et mise en prose », in Raconter en prose, xive-xvie siècle, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 303-324). C’est sur la base de ces résultats préliminaires qu’un noyau de titres a pu être établi, noyau qui s’est ensuite élargi à d’autres domaines – matière ovidienne, encyclopédies, livres bibliques, « miracles » – jusqu’à fournir la matière pour ce volume.
L’accueil que la communauté scientifique avait réservé au premier nous a confirmé que l’organisation interne pouvait en être conservée ; sans 8entrer dans les détails – pour lesquels nous renvoyons à l’Avant-propos de 2014 – on trouvera donc ici non seulement la même présentation par ordre alphabétique des titres, mais aussi la même structure interne des notices : (A) la prose ; (B) la source ; (C) histoire de la prose ; (D) bibliographie. Des index (Œuvres, auteurs, traducteurs ; Artisans du livre manuscrit et imprimé ; Imprimeurs, libraires et éditeurs anciens ; Noms propres ; Manuscrits) et une Bibliographie ont aussi été prévus, cette dernière ne comprenant que les quelques titres et les sites très fréquemment cités dans les notices et qui constituent des références incontournables ; en contrepartie, nous avons décidé d’exclure deux outils que tout médiéviste consulte quotidiennement et dont l’indication pour chacun de nos titres aurait été redondante et, somme toute, superflue : le Dictionnaire des Lettres françaises – Le Moyen Âge (Paris, Pochothèque, 1992) et le site Arlima. Dans la mesure du possible nous avons indiqué l’existence des numérisations disponibles en ligne, que ce soit pour les Catalogues des bibliothèques, pour les manuscrits, ou pour les éditions anciennes : tout à fait conscientes que ces données sont vite périmées, il nous aurait néanmoins semblé dommage d’y renoncer.
La différence majeure par rapport au Répertoire de 2014 porte sur l’empan chronologique considéré, nettement élargi par rapport au premier, et qui a été imposé par les textes mêmes : le xiiie siècle s’est en effet révélé riche en réécritures, principalement mais non exclusivement pour ce qui concerne l’hagiographie. À l’autre bout de la fourchette temporelle, notre dépouillement a confirmé deux aspects : d’une part, la continuité fondamentale entre « Moyen Âge » et xvie siècle, ce dernier ayant réservé un accueil important à la production littéraire médiévale, d’autre part le passage à l’imprimé pour la plupart de nos titres. C’est d’ailleurs là, dans la prise en compte de cette absence de fracture et de la nouvelle diffusion permise et encouragée par l’édition, que se situe un des domaines de recherche les plus prometteurs, que d’autres projets continuent de fouiller : qu’il nous soit permis de signaler, parmi ceux qui sont en cours au sein de notre PRIN même, la base de données EMAF15-16 (« Éditer le Moyen Âge Français aux xve et xvie siècle »), dirigée par Anne Schoysman de l’Université de Sienne et abritée sur le site Mirabile de la Fondazione Ezio Franceschini de Florence.
Le déséquilibre apparent entre certaines notices, qui pourrait surprendre le lecteur, découle de fait des œuvres elles-mêmes, dont la diversité 9a parfois imposé des écarts dans les sous-entrées, amplifiées ici, réduites voire supprimées ailleurs. Plutôt que de poursuivre une uniformisation à tout prix, nous avons souhaité conserver cette diversité – à imputer parfois aux Auteur.e.s mêmes, à leur sensibilité ou à leur formation – en la considérant un enrichissement de l’ensemble.
Un mot enfin sur les manuscrits contenant des textes hagiographiques : les petites flèches (→) renvoyant d’un titre à l’autre ne sont pas sans révéler de menues divergences qui peuvent dépendre des sources utilisées ou de l’attention réservée par chaque Auteur.e à un aspect de détail.
Nous tenons aussi à exprimer notre reconnaissance aux nombreux auteurs qui ont accepté la tâche, parfois ingrate, de s’atteler à un travail d’équipe et de se soumettre à ses contraintes et à ses délais ; en ordre alphabétique : Antonella Amatuzzi (IsopetIII de Paris), Elisabetta Barale (Miracles de Nostre Dame de Jean le Conte ; Miracles de Notre Dame de Jean Miélot I et II), Hélène Bellon-Méguelle (Grantz Geanz), Anders Bengtsson (Vie de sainte Geneviève), Marc Boriosi (Vie de saint François d’Assise), Stefania Cerrito (Ovide moralisé, versions « angevine » et « brugeoise », Pyrame et Thisbé), Paola Cifarelli (Ordene de chevalerie), Olivier Collet (Hystore de Julius Cesar de Jean de Thuin), Martina Crosio (Chastelaine de Vergi, L’Erberie, Mantheau mal taillé, Nouvelles dites de Sens, Songe du Vieil Pèlerin de Philippe de Mézières, Vie de saint Jacques le Majeur, Vie de saint Martin de Tours), Olivier Delsaux (Chemin de long estude de Jean Chaperon, Vigiles des morts de Jean Miélot), Sandra Ducruet Ancey (Vie de saint Julien l’Hospitalier), Barbara Ferrari (Conception Nostre Dame, Vie de saint Jean-Baptiste, Vie de sainte Marie l’Égyptienne, Vie des Trois Maries de Jean Drouyn), Adélaïde Lambert (Barlaam et Josaphat), Margherita Lecco (Vie de saint Édouard le Confesseur), Marco Maulu (Livre des Sept sages de Rome version « A », Roman des Sept sages de Rome version « D »), Anne-Laure Metzger-Rambach (Nef des folz du monde de Jean Drouyn), Amandine Mussou (Échecs amoureux moralisés d’Évrart de Conty), Yunhao Na (Vie de saint Fiacre), Pierre Nobel (Bible : Ancien Testament, Genèse, Macchabées), Ilaria Rota (Vie de saint Jean Paulus), Simone Sari (Vie des Trois Maries de Jean Drouyn), Christine Silvi (Agregacion des secrés de nature, Image du monde de Gossuin de Metz), Alessandro Turbil (Empereur Constant, Quinze signes du Jugement dernier).
10Ce deuxième volume nous permet aussi de remplir une lacune du premier et de proposer une version entièrement refondue de deux notices. Il s’agit notamment du Roman de la Rose anonyme (seule la version de Jean Molinet figure dans le vol. I), dont la notice a été établie par Jean Devaux ; de Gérard du Frattre, par Adélaïde Lambert et François Suard ; et du Galien en prose, dont deux rédactions différentes sont maintenant reconnues : le Galien Restoré conservé par un manuscrit et des éditions parisiennes, et une une version « lyonnaise » à partir de l’édition de Claude Nourry (1525) (notices de Maria Colombo Timelli et de Bernard Guidot). Contrevenant à l’ordre alphabétique annoncé, ces quatre notices trouvent place en fin de volume.
C’est encore avec plaisir que nous exprimons nos plus vifs remerciements aux collègues et amis dont le nom n’apparaît pas toujours dans les pages qui suivent, mais dont la générosité, la disponibilité et le savoir ont été irremplaçables : Sergio Cappello (Université d’Udine), Nathalie Coilly (BnF), Graziella Pastore (BnF), Stéphanie Rambaud (BnF), Anne Schoysman (Université de Siena), Mary Beth Winn (University of New York) ; ainsi que les nombreux conservateurs et conservatrices d’autres bibliothèques, françaises et britanniques surtout, qui nous ont transmis des reproductions ou nous ont fourni des informations de première main pendant les mois marqués par la pandémie où nos déplacements n’étaient même pas envisageables.
À côté des deux Répertoires sur papier, le site « lavieenproses », abrité par l’Université de Milan, continue d’être accessible : seules les données « brutes » de chaque mise en prose y sont déversées, mais la bibliographie y est constamment mise à jour.
Reste à exprimer le souhait que, tout comme le premier, ce deuxième volume offre à nos collègues, surtout aux plus jeunes, des pistes pour continuer, voire entamer, un projet de recherche dans l’un ou l’autre des aspects abordés dans nos notices ; sur le plan philologique, les « proses » inédites demeurent nombreuses ; sur le plan littéraire et/ou linguistique, les études ne peuvent qu’être encouragées par la possibilité de collationner des versions différentes du même texte (vers et prose, certes, mais aussi modifications successives introduites dans la même prose) ; et encore, la prise en compte de l’histoire des œuvres sur une durée plus ou moins longue, sans coupure entre tradition manuscrite et imprimée, permettra de s’interroger sur les raison du succès, ou de l’échec, de certains titres.
11« L’autrui avoir ne enrichist homme », écrivait Jean Miélot dans son recueil de proverbes ; ce volume se voudrait bien la preuve du contraire. Si le livre de Georges Doutrepont était bien le résultat d’une entreprise individuelle, notre époque impose en quelque sorte le travail d’équipe, où l’avoir des uns – leur savoir – enrichist bien les autres.
Maria Colombo Timelli,
Martina Crosio,
Barbara Ferrari