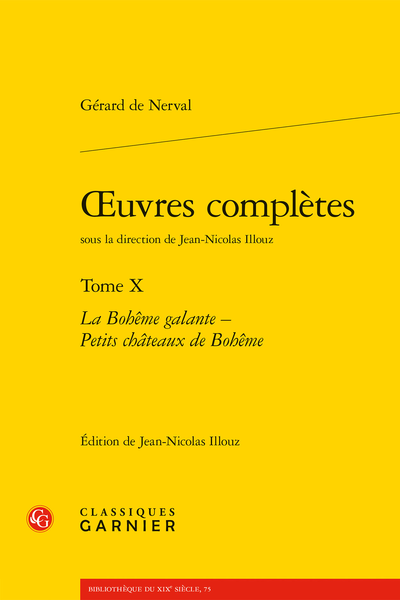
Note sur l’établissement, l’histoire et la composition des textes
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Œuvres complètes. Tome X. La Bohême galante - Petits châteaux de Bohême
- Pages : 29 à 32
- Collection : Bibliothèque du xixe siècle, n° 75
- Thème CLIL : 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN : 9782406094425
- ISBN : 978-2-406-09442-5
- ISSN : 2258-8825
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-09442-5.p.0029
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 18/03/2020
- Langue : Français
Note sur l’établissement,
l’histoire et la composition
des textes
Pour La Bohême galante, nous suivons le feuilleton de L’Artiste publié du 1er juillet au 15 décembre 1852, en indiquant, par l’insertion d’une étoile noire, la séparation des différentes livraisons.
En annexe (p. 207-218), nous publions le facsimile de huit folios manuscrits (avec leur transcription) appartenant au fonds Lovenjoul (D 741, fos 36-43). Ce manuscrit correspond à une première version de l’évocation du Doyenné qui lance La Bohême galante et les Petits châteaux de Bohême. On y voit Arsène Houssaye intervenir directement sur le manuscrit, de façon à se donner le rôle d’initiateur dans l’invention de la vie de bohème. Nerval réduira la part des interventions de Houssaye ; mais, comme il l’avait fait un an auparavant pour le feuilleton des Faux Saulniers adressé au directeur du National, il conserve le tour dialogique que la commande d’Arsène Houssaye, directeur de L’Artiste, confère à son écriture, – tirant ainsi de sa situation de sujétion par rapport à un directeur de presse une liberté de manière, qui est tout sienne. Par ailleurs, le manuscrit fait apparaître une écriture en continu, sans divisions en chapitres qui ne viendront qu’à un stade ultérieur de l’élaboration du récit ; ce trait, qui apparaît aussi dans les manuscrits d’Aurélia1, signale un mode d’écriture en quelque sorte « musical », où tout se presse dès les premières « mesures », sans guère de ratures, et s’ordonne ensuite par associations ; les divisions, qui monnayent la matière selon les contingences de la publication, ne viennent que dans un second temps.
Au reste, le récit tout entier procède par associations. Ces associations prennent la forme d’un montage de textes antérieurement publiés : 30La Bohême galante est un patchwork, où Nerval, au fil des livraisons, « recoud » ensemble – son Introduction au Choix des poésies de Ronsard […] qui remonte à 1830 (chap. v et vi), – des odelettes qu’il a publiées entre 1831 et 1835 (chap. vii), – des pièces en vers empruntées à deux opéras-comiques (Piquillo, Les Monténégrins) ou au Faust (chap. viii), – de larges morceaux découpés des récents Faux Saulniers (chap. ix à xiv), – eux-mêmes interrompus par une reprise de l’article sur les Vieilles Ballades françaises déjà publié trois fois depuis 1842 (chap. x et xi), – enfin le conte de « La Reine des poissons » issu d’un compte rendu critique sur les livres d’enfants paru à la fin de l’année 1850 (chap. xv). Cette bigarrure textuelle compose avec la variété des formes (vers et prose mêlés dans le genre renouvelé du prosimètre), mais aussi avec la variété des tons et des modes énonciatifs, puisque Nerval mêle le récit (de souvenirs ou de promenades), la poésie lyrique recueillie dans une anthologie personnelle, et l’essai critique quand il s’agit de réfléchir sur l’apport de la poésie de la Renaissance, sur les réformes du drame wagnérien, ou sur la valeur des chansons populaires.
Les contraintes de la publication en feuilleton servent ainsi d’étayage à l’invention d’une manière rhapsodique très singulière : le sujet s’y donne à lire en ligne de fuite, selon la perspective qu’il instaure entre son histoire personnelle, l’histoire de sa génération, et l’histoire de la poésie universelle, tout au long de la série de masques ou avatars qui l’ont fait tour à tour poète bohème, faiseur dramatique, versificateur de l’école de Ronsard, traducteur de la poésie allemande, promeneur rousseauiste, et enfant du Valois, dépositaire d’une parole poétique immémoriale aussi bien qu’historiquement située.
Pour les Petits châteaux de Bohême, nous suivons le texte de l’édition originale parue chez Didier en 1853 (la Bibliographie de la France enregistre le volume au titre de l’année 1852).
On peut s’étonner que Nerval reprenne à si peu de temps de distance le récit de sa bohème (la dernière livraison de La Bohême galante remonte au 15 décembre 1852). En réalité, on peut considérer La Bohême galante comme le maillon d’une chaîne plus grande qui relie des textes antérieurs à des textes encore à venir, puisque les fragments de cette première anthologie personnelle vont essaimer dans les Petits châteaux de Bohême, puis dans Les Filles du feu. Dans tous les cas, la reprise n’est pas une 31répétition pure et simple ; mais un déplacement et un réajustement, en même temps qu’une réappropriation de plus en plus subjective d’une matière textuelle préexistante.
L’architecture des Petits châteaux de Bohême est certes plus marquée : le « vagabondage poétique » de La Bohême galante se change en « petits mémoires littéraires2 », où la division en « château », seulement esquissée au début de La Bohême galante, devient un motif structurant, qui balise un parcours symbolique, fait de stases initiatiques. La manière dont Nerval réajuste ses propres textes consiste en un art de la dispositio : c’est la place des fragments qui fait leur sens et qui les révèle. En témoigne par exemple le déplacement que Nerval fait subir à deux de ses poèmes : « Les Cydalises » (et non plus « Ni bonjour, ni bonsoir ») referme le « Premier Château », conférant au deuil de Cydalise une portée plus générale, tandis que « La Sérénade (d’Uhland) », jadis transcrite dans un Album amicorum à Cydalise (sous le titre « La Malade »), referme maintenant le « Troisième Château », – signe que la mort de Cydalise, redoublée entretemps par la mort de Jenny Colon (« Ma cydalise, à moi, perdue, à jamais perdue3 ! »), vaut désormais comme une allégorie du deuil de toute dame aimée et perdue, – prémonition d’un Destin, qui se déploiera dans Aurélia.
Cependant, le nouvel ensemble ainsi constitué n’a rien lui-même de stable ni de définitif. Si le « Premier Château » se déleste de l’excroissance que formait l’Introduction du Choix des poésies de Ronsard […], le « Second Château » en inclut une autre, qui produit un nouveau déséquilibre, lequel appelle des réajustements ultérieurs. Nerval y réemploie en effet une pièce de théâtre, Corilla, qui y est significativement présentée comme une pièce de substitution, venue remplacer une défunte Reine de Saba « tombée dans le troisième dessous4 » : tout se passe comme si une pièce tenait lieu d’une autre, de la même façon que, en abyme dans Corilla, la bouquetière remplace la prima donna, et de la même façon que, au Doyenné, le « Seigneur poète » quitte « la proie pour l’ombre5 ». La substitution (à partir d’une origine perdue) enclenche un déplacement sans fin ; et le déplacement des textes fait des recueils nervaliens autant 32de châteaux de cartes ou châteaux en Espagne, dans lesquels tout agencement ne produit qu’une construction provisoire, – éphémère autant que somptueuse. Il en est de même pour le « Troisième château », qui est d’ailleurs moins le dernier de trois, que le troisième d’un ensemble virtuel de sept, puisque Nerval le situe aussitôt, ironiquement, dans la série des Sept Châteaux de Nodier et de son roi de Bohême6. L’effet de clôture est délégué aux vers d’opéra que Nerval rassemble dans la section « Lyrisme », bien accordée à l’ethos du poète bohème posé au début de l’œuvre ; mais, chemin faisant, Nerval, dans la section « Mysticisme », a esquissé un premier groupement des sonnets qui se fondront bientôt dans Les Chimères, rejoignant alors un autre recueil : celui des Filles du feu, lui-même travaillé par ces déséquilibres dynamiques, inhérents à la logique de l’œuvre fragmentaire et au mode d’engendrement du Livre-Chimère7.
1 Voir Aurélia, OC XIII, p. 142-146. Le manuscrit fait clairement apparaître que les divisions en chapitres sont surajoutées (voir facsimile, ill. 2 et 5) dans un ensemble écrit d’abord en continu.
2 La Bohême galante, p. 140 ; et Petits châteaux de Bohême, p. 173.
3 Petits châteaux de Bohême, p. 194.
4 Petits châteaux de Bohême, p. 172.
5 Ibid., p. 157.
6 Petits châteaux de Bohême, p. 194.
7 Voir notre préface, « Œuvre fragmentaire et livre-chimère : note sur la composition des Filles du feu », dans OC XI, Les Filles du feu, p. 9-24.