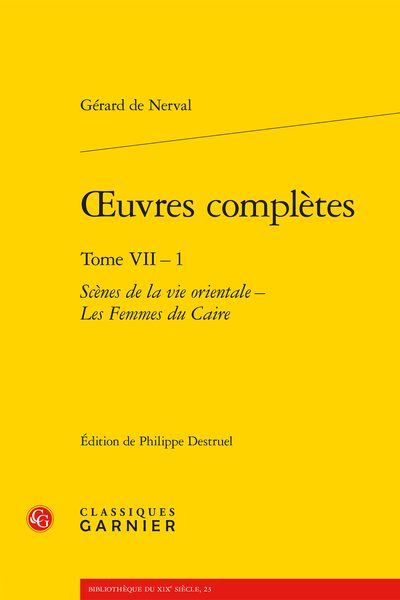
Note sur l’établissement du texte
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Œuvres complètes. Tome VII – 1. Scènes de la vie orientale – Les Femmes du Caire
- Pages : 9 à 10
- Collection : Bibliothèque du xixe siècle, n° 23
- Thème CLIL : 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN : 9782812412738
- ISBN : 978-2-8124-1273-8
- ISSN : 2258-8825
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-1273-8.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 14/11/2017
- Langue : Français
Note sur l’établissement du texte
L’édition que nous proposons reproduit l’exemplaire de la Bibliothèque Nationale de France ; cote 8. 02. 174 (1), 8. 02. 174 (2)1. Le tome I présente, en tête, la page de titre de l’édition Souverain (1850), avec un tampon indiquant « Bibliothèque Nationale R. F.2 », et celle de Sartorius (1848), sur laquelle est tamponné « Bibliothèque Royale3 » (avec une couronne et la précision « I »).
Outre des détails typographiques, qu’il nous arrivera parfois de noter, on remarque que le titre du premier chapitre de l’« Introduction » (en caractères minorés, plus petits, et romains) : « L’Archipel », est en grandes majuscules, et que ce sera le titre courant (en pages paires) de cette « Introduction », en alternance avec le titre de chaque chapitre, en pages impaires4. Le corps de ce premier tome aura ensuite pour titre courant « Les Femmes du Caire ».
L’Appendice (du t. I) qui commence à la page 347 est en caractères minorés.
La page de titre du t. II est celle de Souverain (1850) et le sous-titre est « Les Femmes du Liban ».
La première section, « Un Prince du Liban », porte pour titre courant (en pages paires) « les maronites », la deuxième « Le Prisonnier » « les druses », le titre de la troisième section : « Les Akkals. – L’Anti-Liban » est distribué en deux titres courants : « les akkals » (pour les pages impaires), « l’anti-liban » (pour les paires).
L’Appendice est en caractères réduits comme dans le t. I. L’« Épilogue », à la suite, est en caractères normaux.
La confection et la distribution du second tome appellent des remarques. Des pages 1 à 268, est donné le récit du séjour libanais, puis en caractères minorés5 un Appendice de 42 pages (269 à 300) qui ne termine pas le volume, car un « Épilogue » de 34 pages suit, qui se rapporte au récit de voyage, et pour lequel réapparaissent les caractères normaux6. Le t. II a pu être imprimé peu après le t. I, et s’achever avec l’Appendice, mais les difficultés de l’édition après la Révolution de Février 1848 s’ajoutant à celles de Sartorius l’auraient empêché de paraître tout de suite après sa fabrication ; il aurait été conservé en feuilles, ou broché, mais non relié… Ce qui expliquerait que l’« Épilogue » a pu être ajouté plus tard, au moment de la publication effective, en 18507.
Pour ce qui est des propres notes de Nerval, l’appel dans le corps du texte original se présentait sous la forme d’un chiffre en parenthèses, que l’on retrouvait ainsi en bas de page. Elles apparaissent bien sûr dans cette édition que nous proposons, et signalées comme étant de Nerval, mais alignées avec nos propres notes critiques.
Le foliotage originel sera signalé dans le texte saisi entre crochets (dans l’Introduction, il ne s’agit pas de chiffres arabes : [i], [ii], [iii], etc.).
Le texte des Scènes de la vie orientale dont nous avons retracé l’histoire est ici republié, pour la première fois depuis la mort de Nerval8 mais avec, pour répondre à des exigences éditoriales, certaines corrections.
1 Le texte est visible et lisible sur le site Gallica. Les Femmes du Caire ; identifiant : ark :/12148/bpt 6k 1092280 – Les Femmes du Liban ; identifiant : ark :/12148/bpt 6k109229c – Relation (pour les 2 vol.) http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36040305k
2 Ce tampon se trouve au bas de la p. 97 du t. II, et à la dernière page (334) de ce dernier.
3 La dernière page (352) présente le même sceau.
4 La page iij a pour titre courant « la traversÉe ».
5 Comme l’appendice du t. I.
6 Les cahiers du tome II comptent tous huit pages, sauf le trente-huitième, qui n’en compte que six. Dans ce cahier, se trouvent les premières pages de l’« Épilogue ». Le t. II renferme quarante et un cahiers de huit pages et ce cahier de six pages, soit 334 pages. Le cahier litigieux commence à la p. 297, dans l’« Appendice ». Page 300, c’est la fin de l’« Appendice », et p. 301, le début de l’« Épilogue » : « À Timothée 0’Neddy. ». Les pages 301 et 302 de l’« Épilogue » appartiennent au trente-huitième cahier, le trente-neuvième cahier commençant à la page 303. Dans le tome I, les cahiers sont numérotés toutes les seize pages, il y a vingt-deux cahiers, soit 352 p.
7 Contrairement à ce que laisserait entendre un prospectus de la Revue pittoresque… Voir H. Mizuno, « Quand a paru le deuxième tome des Scènes de la vie orientale de G. de N. ? », Bulletin du bibliophile, 2007, no 1, p. 151-158.
8 Une traduction a paru en 1929, intitulée The Women of Cairo [sic !]. Scenes of Life in the Orient with an introduction by Conrad Elphinstone, London, George Routlege & Sons, 2 vol. in-8o, xiii-283-402 p. Cette éd. reproduit en fait le texte du Voyage en Orient de 1851, mais amputé de toute son « Introduction ». Ce qui fait que le texte s’ouvre sur « Les Mariages cophtes ». Il n’y a pas d’appendice.