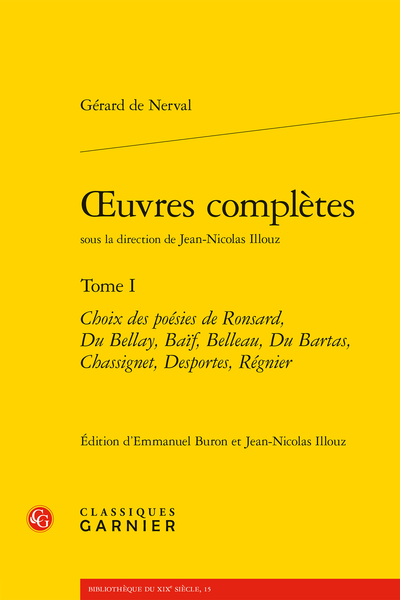
Principes de la présente édition
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Œuvres complètes. Tome I. Choix des poésies de Ronsard, Du Bellay, Baïf, Belleau, Du Bartas, Chassignet, Desportes, Régnier
- Pages : 63 à 66
- Collection : Bibliothèque du xixe siècle, n° 15
- Thème CLIL : 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN : 9782812441561
- ISBN : 978-2-8124-4156-1
- ISSN : 2258-8825
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4156-1.p.0063
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 05/01/2012
- Langue : Français
Principes
de la présente édition
La présente édition est la première édition critique du Choix des poésies de Ronsard, Dubellay, Baïf, Belleau, Dubartas, Chassignet, Desportes, Régnier, précédé d’une introduction par M. Gérard, paru à Paris, Imprimerie de Béthune, dans la collection de la « Bibliothèque choisie » en 1830. Le livre est enregistré à la Bibliographie de la France le 30 octobre 1830. Il n’avait pas été republié depuis, du moins dans son intégralité.
La nouvelle édition des Œuvres complètes de Nerval dans la Bibliothèque de la Pléiade (1984-1891), placée sous la direction de Jean Guillaume et Claude Pichois, ne recueillait, grâce aux soins de Jacques Bony et de Jean Céard, que l’« Introduction » de Nerval (NPl I, p. 281-301). Les morceaux choisis des poètes eux-mêmes en étaient exclus, conformément au principe général que cette édition formulait dans sa préface : publier « Nerval, tout Nerval, seulement Nerval » (NPl I p. xi). Il est vrai que Jean Céard avait toutefois examiné en détail le choix lui-même des poètes du xvie siècle, et, dans une étude parue en 1989 dans la RHLF et dédiée à la mémoire de Claude Faisant, il avait identifié les principales éditions anciennes ou anthologies modernes à partir desquelles Gérard avait fait œuvre de seiziémiste1.
Nous nous sommes appuyés sur ces travaux ; et nous avons nous-mêmes vérifié et complété les sources de Nerval en reconstituant, pour chaque auteur de l’anthologie et pour chaque poème, la table de travail de l’écrivain en inventoriant tous les livres qu’il a eus ou pu avoir eu sous les yeux lorsqu’il entreprit, après Sainte-Beuve, de participer à la redécouverte de « l’École de Ronsard ».
Mais notre projet était aussi d’une autre nature. Tout en éditant pour elles-mêmes les pièces du xvie siècle recueillies par Gérard, avec
tous les éclaircissements nécessaires pour un lecteur d’aujourd’hui, il s’agissait pour nous de justifier la publication intégrale de ce Choix dans les Œuvres de Nerval en considérant que ce Choix lui-même participait pleinement de la création nervalienne, même lorsque Nerval se dissimule derrière les œuvres des autres et même lorsqu’il n’apparaît que dans le quasi anonymat de la position accordée à l’anthologiste. Car, si discrète que soit a priori l’intervention de l’anthologiste, elle n’en est pas moins décisive, puisque celui-ci choisit (et exclut), combine ses sources, remanie quelquefois, et surtout déplace les œuvres qu’il édite d’un contexte à un autre, – du xvie siècle au xixe siècle, – modifiant ainsi leur portée première en leur conférant une vie nouvelle – et extraordinairement féconde – dans le romantisme de 1830. Nos notices et annotations tendent à saisir cette signification nouvelle que revêtent les poésies du xvie siècle lorsqu’elles sont relues et rassemblées par Gérard en 1830. En reconstituant les divers relais éditoriaux et critiques – des éditions anciennes aux anthologies récentes, des commentaires de Nodier à ceux de Sainte-Beuve, etc. – à partir desquels Nerval prend connaissance des œuvres qu’il édite, qu’il transcrit ou quelquefois même qu’il recompose, nous avons dégagé les raisons de ses choix et les effets que les œuvres retenues produisent d’une part lorsqu’elles reparaissent dans le contexte (littéraire et politique) de 1830, d’autre part lorsqu’elles s’inscrivent dans le projet poétique de Nerval lui-même. Pour le dire autrement, le geste philologique que nous avons accompli ici porte, non pas tant sur un acte d’écriture, que sur un acte – plus immatériel – de lecture, dans la mesure où Nerval est pleinement présent dans l’attention qu’il porte aux œuvres des autres, et dans la mesure où cette attention est déjà celle d’un poète, et non pas seulement celle d’un critique et historien de la littérature. En ce sens, redisons-le, le Choix, en même temps qu’il reflète les préoccupations du romantisme, vaut comme un des principaux foyers de la création ultérieure de Nerval. Ce faisant, nous touchons à un geste poétique qui ne cessera d’être celui de Nerval, puisque son œuvre, débordant le principe de l’identité et de la propriété littéraires, s’invente largement à travers les œuvres des autres, – dans la traduction, le plagiat, l’adaptation, l’écriture en collaboration, la citation ou l’autocitation, la compilation, la transcription, ou la simple lecture. – Mais qui ne
sait que tout ce que Nerval touche devient part de lui-même ?, suggérait déjà Jean-Pierre Richard2.
Le texte de l’édition de 1830 comporte un nombre important de bizarreries orthographiques. Celles-ci, pour une part, sont sans doute le résultat de la précipitation dans laquelle Gérard compose son anthologie avant, pendant et après la Révolution de Juillet. Quand il s’agit de coquilles manifestes qui nuisent à la compréhension littérale du texte, nous corrigeons, en signalant notre intervention en note. Dans tous les autres cas, même lorsque les graphies sont en apparence aberrantes, ou lorsque les leçons suivies divergent par rapport à l’édition originale, nous conservons. Cela pour plusieurs raisons : d’abord parce que certaines leçons, quand elles ne sont pas le fait de Nerval mais de la source qu’il utilise, permettent précisément de confirmer l’identité du livre dans lequel Nerval a prélevé tel ou tel extrait et de saisir à travers quels prismes Nerval aborde les textes qu’il collationne (pour mieux signaler l’écart, nous indiquons alors en note le texte de l’édition originale) ; ensuite parce que Nerval, que nous imaginons volontiers sensible à ce moment de la littérature où l’orthographe n’était pas encore totalement fixée, hésite lui-même entre le choix de moderniser les graphies ou au contraire le choix de les conserver dans leur état premier ; quelquefois même, il invente lui-même des graphies archaïsantes, qui signalent un goût pour le « faux ancien », bien dans la manière, au demeurant, de la « restauration » de la renaissance par le romantisme. En même temps qu’une œuvre de Nerval, c’est donc aussi un livre de 1830 que nous republions, avec ses bizarreries signifiantes dans le contexte qui fut le sien.
Mais cette édition est aussi un livre d’aujourd’hui, – presqu’un essai, puisque l’établissement et l’annotation du texte, en tant que nous le présentons comme un texte de 1830 et comme un texte de Nerval autant que comme un ensemble d’extraits de poètes du xvie siècle, ne pouvaient pas ne pas résulter d’une interprétation, – qui engage notre capacité de
lecture, notre capacité à entendre les échos d’un siècle à l’autre, notre capacité à saisir les possibles relèves de la poésie de la renaissance dans la poésie et la poétique de Nerval.
Bref, ici, la philologie la plus scrupuleuse invente une œuvre de Nerval, c’est-à-dire, au sens étymologique, la découvre, – telle qu’elle se dérobait à une philologie se réclamant d’un historicisme intégral qui ne permettait pas cependant de saisir l’historicité plus profonde des œuvres ni la singularité d’un processus créatif d’appropriation.
Ce faisant, notre travail témoigne de la vie des œuvres dans le temps : de la renaissance dans le romantisme ; des poètes du xvie siècle à Nerval ; et de Nerval, aujourd’hui, pour l’avenir.
Nous remercions chaleureusement M. Yasuhiro Ogura qui a bien voulu nous aider à saisir une partie du texte.
Emmanuel Buron et Jean-Nicolas Illouz,
Dieppe, septembre 2011
1 Jean Céard, « Nerval et les poètes français du xvie siècle. Le Choix de 1830 », RHLF, no 84, 1989, p. 1033-1048.
2 Jean-Pierre Richard, Poésie et profondeur, Seuil, 1955, coll. « Points », 1976, p. 75 : « L’œuvre ne possède aucun droit de propriété. Tel morceau a paru sous forme d’article avant d’être inséré dans une nouvelle ; tel autre se retrouve, plus ou moins déguisé ou éclaté, dans plusieurs livres différents. Rien de plus inextricable que la bibliographie nervalienne, si ce n’est le catalogue de ses sources. Nerval vit de plagiats plus ou moins avoués, mais l’auteur qu’il préfère plagier, c’est encore lui-même ».