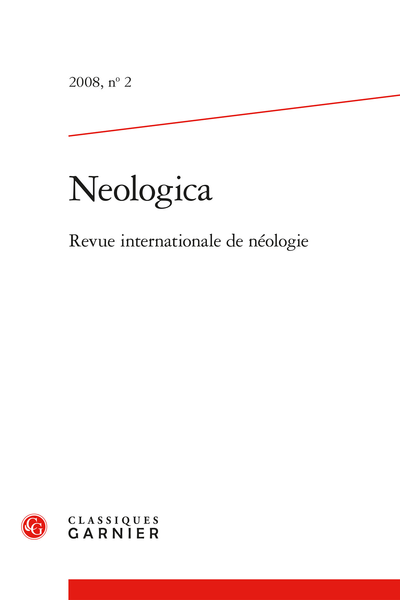
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Neologica
2008, n° 2. Revue internationale de néologie - Auteurs : Fourment-Berni Canani (Michèle), Jacquet-Pfau (Christine), Humbley (John), Petit (Gérard)
- Pages : 215 à 237
- Revue : Neologica
- Thème CLIL : 3147 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage
- EAN : 9782812442285
- ISBN : 978-2-8124-4228-5
- ISSN : 2262-0354
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4228-5.p.0219
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/07/2010
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
219
COMPTES RENDUS
ADAMO Giovanni et DELLA VALLE Valeria (2006), Che fine fanno i neologismi ?, Firenze, Leo S. Olschki
Depuis des années l'innovation lexicale est au centre des recherches de Giovanni Adamo et Valeria Della Valle qui coordonnent l'Osservatorio neologico della lingua italiana (Iliesi-Cnr) et ont déjà publié deux ouvrages recensant les néologismes (Neologismi quotidiani. Un dizionario a cavallo del millennio 1998- 2003, Firenze, Leo S. Olschki, 2003) et mots nouveaux de la langue italienne (2006 parole nuove, Milano, Sperling & Kupfer, 2005).
Si l'intérêt pour les mots nouveaux n'est pas récent et a suscité de nombreux débats entre puristes et partisans de l'innovation, force est de reconnaître qu'il com~ai~ depuis quelques décennies un renouveau d'attention dû à l'irruption dans nos langues d'une quantité croissante de néologismes résultant des innovations constantes dans les domaines scientifique, technique et social, le développement massif des échanges interlinguistiques et des communications de masse dans la société de l'information.
C'est pour tenter de faire le point de la situation que les deux chercheurs ont réuni à Rome des spécialistes italiens, français et espagnols dont les interventions sont réunies dans le volume Che fine fanno i neologismi ? (Firenze, Leo S. Olschki,
2006).
La filiation avec le grand lexicographe italien Alfredo Panzini (1863-1939) est revendiquée par les éditeurs dès le sous-titre A cento anni dalla pubblicazione del « Dizionario moderno » di Alfredo Panzini et réaffirmée dans l'article de Luca Serianni Panzini lessicografo tra parole e cose. Plus que comme un véritable dictionnaire l'ouvrage de Panzini se présente comme un « voyage »dans l'Italie des années de la première moitié du 20e siècle dominées par l'idéologie fasciste qui, comme tout régime autoritaire, entendait intervenir sur la langue. Si Panzini ne pouvait être que proche du régime en vigueur puisqu'il fut membre de l'Accademia d'Italia de 1929 jusqu'à sa mort, il refuse toutefois tout dirigisme dans ce domaine. Pour lui, la priorité doit être donnée à l'usage qu'il enregistre scrupuleusement tout en le commentant Ainsi signale-t-il les très nombreux gallicismes en vogue à l'époque (les anglicismes ne constituant pas encore un phénomène marquant) qu'il considère comme manifestations d'un snobisme de la part de la bourgeoisie, alors que, dit-il, c'est dans les dialectes et régionalismes que l'on trouve la véritable expression du peuple. De la même façon rejette-t-il les technicismes et tous les termes en —isme, qu'il commente ironiquement. L'intérêt de l'ouvrage est qu'il constitue, à travers les ajouts et les suppressions effectués au fur et à mesure des
Neologica, 2, 2008, p.215-237
220 différentes éditions, un témoignage précieux de l'évolution de l'italien contemporain et un document qui permet d'évaluer la part du lexique régional qui, au cours du siècle passé, a survécu et a dépassé les frontières originelles pour faire partie à plein titre de la langue nationale.
C'est également dans une perspective historique et plus particulièrement en étudiant les activités de 1 Accademia d'Italia que Sergio Raffaelli aborde les vicissitudes des néologismes. L'Académie, dont l'activité se déroula entre 1926 et 1943, avait été constituée pour « la préservation et la conservation » de l'italien et avait pour tâche l'élaboration de dictionnaires On retrouve parmi ses membres Alfredo Panzini qui, grâce à l'autorité dont il jouissait en tant que lexicographe, en influença largement les travaux et les décisions. Réglementer l'usage de la langue faisait partie des prérogatives du régime en place (ce qui explique la méfiance actuelle des Italiens à l'égard de toute intervention venant du haut dans ce domaine) qui, d'une part, entendait en préserver la pureté, mais, d'autre part, en appelait à la modernité. Ce qui frappe, dans tous les documents préparatoires ou les déclarations officielles, c'est l'absence de critères généraux rigoureux pour l'acceptation ou le refus de tel ou tel mot, étranger ou non, et pour la création de termes nouveaux. On perçoit une oscillation constante entre une volonté conservatrice, attachée à l'italianité de la langue et donc fermée à tout apport de l'étranger et un souci d'efficacité. L'incertitude méthodologique due à la fragilité des principes de base et à l'hétérogénéité des informations conduisit à des solutions non systématiques, à des choix au cas par cas. Il est intéressant de constater que les débats concernant, entre autres, l'introduction, l'adaptation ou la substitution de vocables étrangers ne sont pas très éloignés de ceux que l'on rencontre aujourd'hui dans certaines communautés linguistiques. Ainsi, on peut proposer tassi (naturalisation de "taxi" au moyen de deux s et un accent), mais, peut-on lire dans une déclaration, « sport, tram, stop, auto, film etc. peuvent être acceptés sans italiques ni s pour former le pluriel. Au moins, ces petits mots brefs serviront de contrepoids à certains néologismes horriblement longs et difficiles de notre production ». À côté de cela des propositions d'adaptation graphique comme caucciù (pour « caoutchouc ») sont passées dans l'usage courant. Mais c'est la substitution (comme pagologia pour « folklore ») qui semble avoir eu le moins de succès. Peut-on affirmer qu'elles ont disparu en même temps que le régime qui les avait inspirées ? Pour Raffaelli la question reste ouverte.
Bernard Quemada choisit d'interpréter la question posée en titre Che fine fanno i neologismi ? (littéralement « que deviennent les néologismes ? ») en « À quoi servent les néologismes ? ». Malgré l'intérêt porté aux néologismes au cours du dernier demi-siècle, le statut scientifique de la néologie reste fragile et la discipline peine à trouver son autonomie au sein de la lexicologie et par rapport à la terminologie scientifique et technique. Ceci est probablement dû en partie au caractère empirique de l'identification des néologismes qui s'appuie essentiellement « sur le sentiment néologique des chercheurs engagés dans la chasse aux premières attestations ». Toutefois le développement de logiciels spéciaux permettant un repérage automatique dans des corpus représentatifs ouvre des perspectives intéressantes. Comment et pourquoi forge-t-on des mots nouveaux ?Leur création peut être soit spontanée ou naturelle, soit volontaire ou dirigée et doit satisfaire à des conditions bien précises pour avoir des chances de s'implanter dans la langue
exploiter les ressources du code, être bref, favoriser la fécondité, privilégier un
221
caractère imagé, etc. Quant à leurs finalités, elles sont de trois ordres :idéologiques, linguistiques et esthétiques. Les premières visent à construire une certaine image de la langue et à en préserver les qualités que la société lui attribue. Les deuxièmes, d'une part, trouvent des applications en lexicologie puisque l'étude des néologismes permet d'établir une typologie et de fournir aux normalisateurs des modèles à forte acceptabilité, d'autre part, alimentent la production dictionnairique soucieuse d'enregistrer le plus grand nombre possible de mots nouveaux Enfin les inventions à caractère ludique sont largement exploitées en littérature mais aussi, de plus en plus, dans le domaine de la publicité. Il est clair que, face à une tradition puriste et à une conception centralisatrice et normative de la langue bien ancrée en France, Quemada se pose en partisan résolu de la néologie, moteur et gage d'avenir pour la langue, tout en précisant que « son statut demande pourtant à être encore affermi, ses objectifs mieux définis, ses stratégies linguistiques et extralinguistiques mieux assurées ».
La démarche de Tullio De Mauro prend le contre-pied de la question posée et se demande où naissent les néologismes. Ce qui peut apparaître comme une boutade, « tous les mots naissent comme néologismes » , souligne le caractère relatif de la notion de néologie toujours liée à une époque donnée et pose le problème de l'obsolescence (signalons au passage que Littré enregistre l'adjectif obsolète accompagné de la mention « néologisme » !). De Mauro considère lui aussi que la production de néologismes relève de la physiologie linguistique et non de la pathologie et offre un bel exemple d'innovation linguistique avec neosemie, désignant par là les nouveaux sens qu'acquièrent les mots au cours de leur histoire.
Mais que reste-t-il de ce foisonnement d'innovations et de créations ? Beaucoup sont éphémères et ne vivent qu'une saison. Vittorio Coletti dans Un secolo di parole mancate s'intéresse à ce qu'il nomme les mots perdus, les occasions manquées, les morts-nés, les faux départs. Si on laisse de côté la production littéraire et poétique, ce sont les domaines de la politique et des faits de société qui sont sans doute les plus productifs, mais aussi ceux où les vies sont les plus brèves ! Formés à partir de noms propres, la plupart vite oubliés, d'habitudes des classes dirigeantes souvent tournées en dérision ou de phénomènes de société temporaires, beaucoup de créations ne franchissent même pas le cap d'une édition de dictionnaire Rappelons que le système des suffixes particulièrement riche de la langue italienne et les nombreuses possibilités combinatoires se prêtent à des productions souvent colorées et très efficaces. Beaucoup de créations ont été lancées comme des ballons d'essai et auraient pu s'implanter dans la langue puisque les phénomènes qui les ont engendrées sont encore d'actualité, tels corridoista (de corridoio, « couloir », pour désigner ceux qui bavardent dans les couloirs au lieu de travailler) ou espressista (de espresso, le café express, en référence aux grands consommateurs de café au bar), bestsellerizzare (fabriquer un bestseller), riminizzare (de la ville de Rimini symbole en Italie de la spéculation immobilière), etc. Pourtant ils n'apparaissent maintenant que comme des curiosités. Ce qui fait conclure à Coletti que le sort des néologismes est impossible à prévoir.
Manuel Alvar Ezquerra, pour sa part, traque depuis des années la présence de mots nouveaux dans la presse écrite espagnole qui, dit-il, constitue le catalyseur et la vitrine idéale de differents types de langue dans les contextes les plus variés politique, économie, sport, sciences, techniques, loisirs, etc. L'observation suivie de ce matériel lui permet de déceler les procédés les plus prolifiques dans la formation
222 des néologismes. Il est intéressant de constater —comme on le voit dans la contribution qui clôt le volume— que les procédés qu'il décrit sont également ceux qui sont les plus productifs dans les autres langues considérées au cours du Colloque. Ainsi, pour n'en citer que quelques uns, la dérivation, à l'aide de suffixes à partir de substantifs, de verbes, d'adjectifs et de noms propres ; la composition qui utilise en abondance des préfixes étroitement liés au monde qui nous entoure comme auto, ciber, eco, euro, tecno, video, web etc. ;les emprunts de l'anglais, du français, de l'italien, du japonais, du russe, de l'arabe, eux aussi, dictés par l'actualité.
Dans le dernier article du volume Tendenze nella formazione di parole nuove dalla stampa italiana contemporanea G. Adamo et V. Della Valle exposent à leur tour quelques-uns des phénomènes qui, au vu des dépouillements massifs qu'ils effectuent depuis des années, illustrent les tendances les plus représentatives dans la formation des néologismes italiens actuels. L'ajout d'affixes, et en particulier du préfixe anti- non seulement devant les adjectifs mais aussi précédant des substantifs et même des noms propres, apparaît particulièrement productif. De même les suffixes -oso et -aro continuent de donner naissance à de nombreux termes le plus souvent péjoratifs tels dolcevitoso (qui s'adonne à la « dolcevita ») ou manoscrittaro (qui envoie son manuscrit aux maisons d'édition dans l'espoir de se voir publier). Les mots composés connaissent également une grande vogue. La cherté de la vie se faisant de plus en plus sentir aussi en Italie, l'adjectif taro a servi à former une cinquantaine de néologismes enregistrés depuis 1998. Ce sont, entre autres, le caro- affitto (l'augmentation des loyers), le taro-benzina (l'augmentation de l'essence), le taro-ombrellone (l'augmentation de la location du parasol sur la plage), le caro- tazzina (l'augmentation du prix du café express au bar), etc. Beaucoup de ces néologismes ne seront sans doute pas appelés à survivre et iront grossir le lot de ce que les auteurs appellent, à la suite de Bruno Migliorini, les « néologismes capricieux ». Les emprunts et les calques de l'anglais constituent bien sûr une partie importante des nouvelles formations :l'adjectif etico (éthique) caractérise désormais un large éventail de produits et d'activités (finanza etica, tassa etica, etc.). Certains calques formels s'insèrent si parfaitement dans la langue d'accueil qu'ils ne sont généralement pas perçus comme tels : c'est le cas par exemple de discriminazione positiva (qui, on le sait, connaît également en français un grand succès) de l'anglais « positive discrimination ». Quant aux calques du français comme la sinistra al caviale (littéralement « la gauche au caviar »), ils sont beaucoup moins nombreux et conservent un caractère élitiste.
Si, au bout du compte, la question posée dans le titre ne trouve pas de réelle réponse, l'ensemble des contributions témoigne d'une tonicité de nos langues, bien loin de la décadence à laquelle certains esprits chagrins voudraient nous faire croire.
Michèle FOURMENT-BERNI CANAIVI
223 BERTRAND Olivier (2004), Du vocabulaire religieux à la théorie politique en France au XIVe siècle :Les néologismes chez les traducteurs de Charles V, Connaissances et Savoirs, 442 p.- ISBN 2-7539-0017-5.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire... L'ouvrage d'Olivier Bertrand, publié en 2004, Du vocabulaire religieux à la théorie politique en France au XIVe siècle : Les néologismes chez les traducteurs de Charles V, ne semble pas avoir trouvé auprès des linguistes une réception aussi large qu'il le méritait. L'une des raisons qui l'ont maintenu jusqu'à présent un peu à l'écart est sans doute l'originalité du champ scientifique. Le double champ disciplinaire dans lequel il s'inscrit, relevant de la linguistique et de l'histoire, constitue en effet un domaine encore trop peu exploré. Rappelons toutefois le premier ouvrage consacré au lexicographe Maurice Lachâtre', publié à la suite d'un colloque organisé par François Gaudin et l'université de Rouen et qui réunissait, en 2003, de manière novatrice et fructueuse, historiens et linguistes.
Reposant sur un travail imposant et érudit dans les deux domaines scientifiques, l'ouvrage d'Olivier Bertrand nous permet de suivre pas à pas un phénomène d'émergence néologique : il devrait faire référence dans la littérature et les recherches sur cet ample sujet. Olivier Bertrand, alors maître de conférences à l'École Polytechnique et chercheur au laboratoire CNRS/ATII,F, conduit ses recherches en lexicologie historique, s'intéressant plus précisément à l'évolution sémantique du lexique politique français.
L'objectif de cette recherche est clairement défini : « comprendre de quelle manière s'est formé un lexique spécialisé —celui de la théorie politique — en français pendant une période donnée —celle du règne de Charles V ». Le XIVe siècle marque en effet une frontière importante dans l'évolution de la langue : il s'est attaché à traduire sans relâche les oeuvres qui appartiennent à la conscience collective et représentent en quelque sorte le patrimoine culturel de l'humanité, jusqu'alors réservé à une élite intellectuelle. L'utilisation de la langue vernaculaire, amorcée dès le XIIIe siècle mais avec une nette accélération au XIVe siècle pour rendre accessibles des domaines réservés jusqu'alors au latin (oeuvres de philosophie, de philosophie politique, de théologie notamment), à la demande des monarques Jean le Bon (1350-1364) et surtout Charles V (1364-1380), oblige les translateurs à créer un nombre très important de néologismes. Cette activité néologique s'inscrit dans un contexte très particulier puisqu'il s'agit pour les traducteurs « d'offrir à leurs lecteurs et d'introduire dans la langue un lexème nouveau qu'il faudra bien comprendre pour que les textes français soient intelligibles. »C'est précisément à cette période qu'émerge et se développe le lexique de la science politique, qu'il est nécessaire, pour en permettre la compréhension, de ne pas dissocier de l'histoire des conceptions religieuses qui en a influencé la constitution.
Pour étudier la constitution de ce lexique particulier, Olivier Bertrand « [évalue] les différents procédés de formation du vocabulaire français de la science politique durant la période du règne de Charles V et la mise en évidence de
Pour mener à bien cette analyse, Olivier Bertrand a choisi un corpus restreint dont il définit très précisément la justification et les caractéristiques. Deux séries de préoccupations ont guidé l'auteur dans son choix : d'une part la délimitation géographique et culturelle (la Cour de Charles V), ainsi que chronologique de ce vocabulaire (entre 1364 et 1380), d'autre part des considérations d'ordre historique
l'influence des conceptions religieuses. Le corpus est composé essentiellement de deux textes des premiers grands traducteurs : la première traduction en français, par Raoul de Presles, du De Civitate Dei de saint Augustin et la première traduction en français, par Denis Foulechat, du Policraticus de Jean de Salisbury. Ces deux oeuvres, très différentes par leur origine et leur date, ont comme points communs d'avoir été traduites au même moment, entre 1371 et 1375, et d'être toutes deux porteuses d'une problématique unique, la suprématie du pouvoir spirituel du pape sur le pouvoir temporel des rois. À ce corpus s'ajoute la traduction des Politiques d'Aristote par Nicole Oresme.
Afin d'évaluer avec une extrême précision et une réelle rigueur scientifique l'influence du vocabulaire religieux dans la théorisation politique, l'auteur a sélectionné dans ce corpus cinquante-trois lexèmes —essentiellement des verbes et des substantifs auxquels s'ajoutent quelques adjectifs —autour de notions conceptuelles telles que l'honneur, la vertu, la faute, le pouvoir. Il ne s'agit donc pas d'un recensement exhaustif, mais d'un échantillon représentatif qui va permettre d'évaluer l'influence des concepts qu'ils véhiculent sur les idées politiques de l'époque. L'auteur, dans une longue et bien utile introduction (p. 23-67), précise le contexte historique et l'évolution de ce vocabulaire, depuis l'Antiquité tardive où le christianisme s'impose peu à peu comme religion d'État : en effet « les traductions du XIVe siècle ne peuvent être compréhensibles qu'avec la connaissance de la pensée même générée par les textes originels des Pères de l'Église tout autant que par ceux des penseurs —souvent ecclésiastiques d'ailleurs —qui luttèrent contre la suprématie de l'Église sur les affaires publiques de l'État. »
Partant donc du postulat que « l'évolution sémantique du lexique latin sous l'influence du vocabulaire religieux dans le domaine politique a donné naissance, parmi d'autres, à un nouveau lexique français de la théorie politique dans les traductions vernaculaires du XIVe siècle », Olivier Bertrand organise son ouvrage en quatre parties. La première (« Vocabulaire religieux et enjeux politiques au XIVe siècle :évolution sémantique », p. 69-148), établit que la naissance de ces lexèmes correspond au passage du latin tardif au latin médiéval et qu'il com~ai~ une évolution sémantique dans les domaines religieux et politique ;les néologismes du XIVe siècle intègrent le sémantigme des mots latins ainsi obtenus. La question que se propose ici de résoudre l'auteur est de savoir « comment les néologismes français de la science politique intègrent le sémantigme des mots latins affectés par l'intrusion de la religion dans le champ politique ». La deuxième partie (« Étude
225 paradigmatique de la néologie lexicale : la création du mot », p. 151-222) analyse la formation morphologique des néologismes ainsi créés et qui sont en voie de lexicalisation, en distinguant la néologie formelle, qui crée un nouveau signe (dérivation et composition, emprunt) et la néologie sémantique, qui donne une acception nouvelle à une unité lexicale déjà existante (transfert et extension du sens). Dans la troisième partie (« Étude syntagmatique de la néologie lexicale : la mise en phrase du mot », p. 225-265), est analysée la phase d'intégration du lexique à travers les procédés utilisés par les traducteurs pour faire comprendre ces néologismes (gloses périphrastiques, doublets synonymiques) ainsi que le recours à la compétence linguistique des lecteurs. Enfin, la dernière et quatrième partie est consacrée à une étude diachronique des phénomènes de « Néologisme, vulgarisation et lexicalisation » (p. 267-364), dans laquelle l'auteur retrace le destin des néologismes apparus à la fin du XIVe siècle, étape qui va lui permettre d'élaborer une synthèse théorique de la lexicalisation en prenant soin de la distinguer de la grammaticalisation, analysant les étapes de la lexicalisation, sémantique et formelle, ainsi que les types de lexicalisation, institutionnelle (le dictionnaire) vs populaire. Sur les cinquante-trois lexèmes sélectionnés dans le corpus, onze, « néologismes éphémères », ne survivront pas (certaineté, irrétractable, bienheureté...) et n'entreront jamais dans le dictionnaire Les autres, trente-huit, finiront par trouver leur place dans le lexique, huit en trouvant un ancrage sémantique (commixtion, condigne, confutation...) et trente avec un élargissement lexical (abstraction, champion, coherence, college...), ce que n'indique pas une erreur d'intitulé dans le tableau de la page 311. Un index alphabétique des lexèmes du corpus et des notions (p. 411-415) ainsi qu'une bibliographie très riche (p. 419-442) complètent cette excellente publication qui devra faire date et être intégrée dans toute réflexion sur la néologie. Les traductions françaises du XIVe siècle constituent un terrain de recherche et d'édition encore relativement peu exploré, mais dont l'apport nous apparaît aujourd'hui, grâce aux travaux d'Olivier Bertrand, incontestable. Nous ne pouvons que souhaiter avec lui le développement d'une « recherche théorique plus approfondie sur la lexicalisation [qui] permettra peut-être de définir avec plus de nuances la formation d'un lexique en général à travers les siècles, ses évolutions et ses constantes. »Gageons qu'il a déjà suscité et continuera à susciter des vocations qui prendront appui sur des fondements maintenant solidement posés.
Christine JACQUET-PFAU (Collège de France)
CHANG, Youngick (2005), Anglizismen in der deutschen Fachsprache der Computertechnik. Franl~ort. Peter Lang. 201 p. Série 21, linguistique. Vol. 280.
En Allemagne, les études sur les emprunts fournissent des sujets de thèses et de dissertations, souvent préparées par des étrangers qui poursuivent des recherches doctorales en Europe. C'est le cas du présent ouvrage, issu d'une thèse soutenue à l'Université de Bochum, qui est connue entre autres pour les recherches sur les internationalismes, auxquelles l'auteur fait d'ailleurs allusion. Il porte sur les
226 anglicismes relevés dans des textes informatiques allemands de la fin des années
1990.
L'étude présente de nombreuses qualités, dont le choix du sujet : en effet, l'informatique a déjà fait l'objet de plusieurs enquêtes en matière d'anglicisation en allemand comme en français, et il est intéressant de pouvoir comparer les résultats et de constater des évolutions. En outre, le corpus qui constitue le point de départ de la thèse est à la fois homogène et représentatif :homogène dans la mesure où il s'agit d'articles tirés d'une même revue qui vise un lectorat de spécialistes (il ne s'agit donc pas a priori de discours de vulgarisation) et représentatif puisque la revue en question (qui a pour titre c't) serait une publication de référence au sein de la communauté des informaticiens allemands.
Le lecteur francophone appréciera particulièrement la première partie qui présente de façon détaillée l'état de la question en matière d'études d'emprunts surtout dans le domaine de l'informatique. Ilrelèvera en particulier l'étude de Liang de 1985 sur les anglicismes dans l'allemand de l'informatique, qui est solide d'un point de vue méthodologique et qui sert de point d'appui pour la comparaison des évolutions, ainsi que deux études comparatives portant sur le français aussi bien que sur l'allemand. Celle de Kaltz (1988) constate un bien plus fort taux d'anglicisation en allemand qu'en français, grâce aux efforts d'aménagement linguistique ;ces conclusions sont un peu nuancées par l'étude de Seebald (1992), quoique cette dernière ne porte que sur le français. En termes plus généraux, on constate en allemand comme en français que l'avènement de la micro-informatique a accéléré le mouvement vers la germanisation dans un cas, vers la francisation dans l'autre, mais l'appui d'une politique linguistique semble porter ses fruits. Il semble par ailleurs que le taux d'anglicisation soit en assez forte augmentation dans l'allemand de l'informatique :l'auteur attribue cette augmentation à une tendance encore plus forte à employer des sigles, presque tous de langue anglaise, mais il constate également que les auteurs renoncent bien souvent à rechercher l'équivalent allemand d'un terme anglais.
La présentation de la méthode comme celle des résultats est bien systématique : on apprécie à ce titre les organigrammes, qui indiquent, par exemple,
comment on distingue un emprunt indirect (Lehnübersetzung ou Lehnübertragung)
d'une forme qui n'aurait pas subi l'influence de l'anglais. Mais il serait erroné de conclure que le découpage de la détermination des critères en étapes discrètes résolve le problème de la typologie d'un phénomène qui est souvent plus scalaire que discret, et il est dommage que l'auteur ne fasse pas part de difficultés de classement qu'il aurait rencontrées et qui auraient éclairé le processus qu'il souhaite décrire. L'étude aurait bénéficié d'une discussion en plus d'une exposition. Quant aux résultats, le lecteur francophone reste sur sa faim, même si certains aspects sont bien traités : les questions d'orthographe, de siglaison, de morphèmes de liaison, d'attribution de genre pour les substantifs et surtout la typologie exhaustive des types de composés. L'auteur présente bien les classes d'emprunts, munies de statistiques, et réalise de ce point de vue un portrait partiel du vocabulaire anglicisé de l'informatique en allemand. Mais il est dommage de ne jamais comparer les concurrents dans le détail, et de ne pas expliquer au lecteur si tel ou tel anglicisme intégral est plus ou moins courant que son équivalent allemand. Quelques trop rares exemples d'analyse textuelle mettent l'eau à la bouche : on nous dit par exemple que tel ou tel terme anglais est cité entre parenthèses pour expliquer une traduction qui
227 est employée dans le texte, mais on ne nous dit pas si, dans le reste de l'article, c'est l'emprunt direct ou son équivalent allemand (qu'il appelle pseudo-natij~ qui est employé, et on ne dispose pas de statistiques sur les pourcentages de ce terme dans le reste du corpus. On a du mal par ailleurs à savoir si les emprunts directs se comportent différemment des pseudo-natifs ou si les emprunts directs influencent la morphologie lexicale en général.
On peut s'interroger par ailleurs sur certains choix éditoriaux :pourquoi, par exemple, répéter la bibliographie du corpus dans le corps de l'ouvrage, comme celle des ouvrages d'informatique consultés, lorsque ceux-ci figurent également dans la bibliographie générale. De même, les tableaux de statistiques des types d'emprunts relevés apportent relativement peu et aurait pu être remplacés par une discussion des résultats. Pour une thèse de linguistique de corpus, on peut également se demander si la référence (par ailleurs tout à fait justifiée) à L. Hoffmann suffit pour en étayer les bases méthodologiques.
Malgré ces critiques relatives à une limite de la portée de cette recherche — qui s'inscrit dans une problématique étrangère à celle de l'aménagement linguistique, vis-à-vis de laquelle les germanophones restent au mieux sceptiques — on doit saluer un travail qui permet de mesurer l'évolution de l'anglais dans un domaine spécialisé.
John HUMBLEY Paris 7, LDI
CISLARU Georgia, GUERIN Olivia, MORIN Katia, NEE Emilie, PAGNIER Thierry, VENIARD Marie (eds.), L'acte de nommer. Une dynamique entre langue et discours, Presses de la Sorbonne Nouvelle (PSN), 2007, Paris, 237 p.
Cet ouvrage présente une synthèse de travaux récents menés sur la
nomination par deux équipes de recherches appartenant respectivement à l'EA SYLED (Systèmes Linguistiques, Enonciation et Discursivité) de l'Université Paris III Sorbonne Nouvelle, à laquelle sont affiliés les coordinateurs précités, l'autre à l'UMR Praxiling de L'Université Paul Valéry (Montpellier III), pour qui la nomination représente depuis longtemps un champ important dans le paysage de la Praxématique.
L'axe général de réflexion retenu par les coordinateurs consiste à envisager la nomination comme une procédure d'assignation référentielle à l'interface entre lexique et discours. De ce fait elle est instituée contre la dénomination, impartie au seul lexique et contre une forme de variation qui serait nécessairement imputable au vocable (unité de discours dont le statut lexical est dépourvu de pertinence) qui ne constitue pas dans une telle perspective un objet de recherche en soi. Les travaux collectés dans le recueil s'inscrivent dans une tradition commune à la Praxématique (Paul Siblot) et à l'Analyse du discours à entrée lexicale telle qu'elle a pu être menée par le CEDISCOR sous l'impulsion de Marie-Françoise Mortureux, Geneviève Petiot et Sophie Moirand. Elle s'oppose également à une lexicologie et à une lexicographie décontextualisées, tout comme à des analyses discursives ignorant le poids du lexique dans les stratégies argumentatives. En perspective, le langage est
228 replacé entre l'homme et la société, comme agent d'interaction et de persuasion toute mise en verbe procède d'une stratégie et les manières de nommer les êtres, les choses, les situations, les actes, les qualités etc. n'est pas transparente mais procède de prérequis inscrits dans l'histoire. Ce sont eux que les auteurs cherchent à débusquer, à expliciter pour restituer au discours son opacité lexicale, condition de son faire.
Après une introduction de Paul Siblot consacrée à« l'importance du point de vue dans la nomination et la composante déictique des catégories lexicales » l'ouvrage se répartit en trois parties, abordant chacun un des aspects de la problématique
- Formes de nomination en situation provoquée
- Pratiques dénominatives et enjeux politiques et commerciaux
- Nommer des objets sociaux
La première partie regroupe des contributions relatives au traitement de certaines formes d'aphasie (Thi Mai Tran :Problèmes de dénomination et relations dénominatives : l'exemple de l'aphasie), et à des nominations provoquées lors d'enquêtes de satisfaction auprès d'usagers (Gaëlle Delepaut, Danièle Dubois, Myriam Mzali et Sylvie Guerrand :Dénominations et représentations sémantiques du trajet en train). Ces deux recherches s'appuient sur la partition établie par G. HIeiber en 1984 (voir plus bas) entre dénomination et désignation. T. M. Tran s'intéresse à la question du « manque du mot » et compare la configuration que cette situation revêt chez un locuteur ordinaire et chez un sujet atteint d'aphasie auquel des tâches de dénomination sont proposées dans le cadre d'un suivi de remédiation. L'auteure dresse une typologie des procédures et des mécanismes mis en place par le patient dans ce qui s'avère être une véritable quête lexicale du nom et un ajustement parfois désespéré de la visée référentielle. G. Delepaut, D. Dubois, M. Mzali et S. Guerrand analysant des enquêtes de satisfaction menées par la SNCF auprès de ses usagers, remarquent l'existence d'un partage fonctionnel inattendu entre dénomination et désignation :lorsque les usagers expriment leur satisfaction, ils ont préférentiellement recours à des procédures dénominatives, c'est-à-dire convoquent des items lexicalisés et les emploient conformément à leur valeur dénominative. En revanche, lorsqu'ils expriment un mécontentement, ces mêmes locuteurs ont tendance à privilégier la désignation, à avoir recours à des formules grammaticalisées, àdes périphrases et à ne pas recourir à la dénomination pour assurer la visée référentielle. De ce fait apparais un usage inédit, imprévisible et injustifiable linguistiquement de la dénomination, qui sert à exprimer des jugements positifs et de la désignation, qui se voit impartie aux jugements négatifs. Les auteures émettent l'hypothèse que les jugements positifs sont perçus par les locuteurs comme moins porteurs de subjectivité et justifient donc un recours préférentiel à des catégorisations dénominatives. Les jugements négatifs sont perçus comme impliquant davantage la subjectivité et s'accommoderaient préférentiellement d'une visée grammaticalisée, signalétique dans sa construction même de l'élaboration d'un point de vue.
La seconde partie est consacrée aux enjeux politiques et commerciaux de la dénomination. Ainsi sont abordés respectivement : la valeur sémantique du nom propre prototypique dans sa relation avec son correspondant le nom de marque déposée (Bénédicte Laurent et Montserrat Rangel Vicente), les questions relatives à la dénomination des couleurs dans l'industrie des cosmétiques (Céline Caumon) et
229
les pratiques de redénomination des rues à Vitrolles durant la municipalité MNR (Jeanne Gonac'h). Après avoir relevé la difficulté représentée par le champ des couleurs tant pour l'établissement de la catégorisation référentielle, pour la définition lexicale que pour la dénomination, C. Caumon insiste sur la dimension éminemment culturelle de la perception et de l'expression des couleurs ainsi que sur les contraintes que cette caractéristique implique dans le domaine commercial. De fait, des références culturelles doivent être recherchées par les créateurs publicitaires afin non pas tant de dénommer et d'assurer une visée référentielle dépourvue de toute ambiguïté, qu'au contraire de suggérer des valeurs au sein de l'imaginaire du consommateur en fonction de représentations communes à une cible commerciale prédéfinie. La dénomination se voit ainsi détournée de sa fonction linguistique première pour ne plus être qu'un vecteur culturel de suggestions à visée perlocutoire, puisque sa finalité, à l'instar de celle du discours publicitaire, est de conduire le client à l'achat. Elle partage cette propriété avec le nom de marque déposée :tous deux n'ont pas pour objet de subsumer des propriétés référentielles mais de construire des configurations à l'intérieur d'un univers culturel dans lequel ils invitent le consommateur à se projeter. La dénomination ici fait appel à une mémoire discursive, mais aussi à une mémoire lexicale : les dénominations sont retenues du fait qu'elles disposent d'une charge mémorielle, qu'elles gardent en elles-mêmes la trace des conditions de leur production. Les convoquer consiste alors à raviver cette mémoire ainsi que la connotation qu'elle imprime à la dénomination. L'analyse de la séquence Rose Lolita par l'auteure est à cet égard convaincante. Dans une perspective très proche J. Gonac'h étudie les redénominations de certaines rues à Vitrolles pendant les années où la municipalité a été assurée par l'extrême- droite. Après avoir précisé la cadre juridique des dénominations de voies et lieux publics et celles des changements de dénominations, J. Gonac'h se livre à une enquête de terrain au cours de laquelle elle montre comment des dénominations instanciant des noms de défenseurs des droits de l'homme, de militants contre la ségrégation ou tout simplement de personnalités non françaises ont été l'objet d'une forme de censure. Centralement c'est la signification du nom propre qui est mise en cause en ce qu'elle ne s'articule pas sur un concept structuré de propriétés critériales, mais sur des valeurs culturelles et variables (cf. entre autres Kripke 1972). L'exemple choisi par l'auteure et l'analyse qu'elle en produit montrent qu'à ces déterminations s'y ajoute, en contexte politique, un réinvestissement produit par un univers discursif, lequel active des facettes spécifiques qu'il construit lui-même, notamment
« être un étranger », « être de gauche »... (p. ex. Savador Allende, Nelson Mandela, Martin Luther King) assorties d'un coefficient négatif dans l'idéologie de l'extrême-droite ;
« être français », « être provençal »... (p.ex. Marseille, Marguerite de Provence, cabasson, cantonnier, tambourinaire), même remarque, mais du côté du positif.
Le choix des redénominations montre que la renégociation sémantique n'affecte pas que les noms propres, elle concerne également les noms communs, lesquels se voient dénommer en fonction non pas de leurs propriétés référentielles, mais de la charge connotative que crée leur inscription dans un discours politique spécifique.
230
La troisième partie est consacrée à la dimension polémique et argumentai de la dénomination. Il ne nous est pas possible ici de détailler l'ensemble des contributions qu'il regroupe. Deux retiendront particulièrement l'attention, consacrées respectivement aux questions relatives à la dénomination du voile islamique dans la polémique qui a accompagné la loi sur le port de signes religieux dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire. L'autre s'intéresse à la recatégorisation opérée dans le discours colonial en passant de la notion de progrès civilisateur à celle de développement. Laura Cabresse (« Quels objets de discours se dissimulent sous la dénomination le voile ? ») inscrit son étude dans la continuation de celles menées il y a quelques années par Geneviève Petiot (notamment 1995) sur le même sujet. L'étude porte sur un phénomène de polydénomination (dénomination d'une même entité par plusieurs unités lexicales concurrentes, ici voile, foulard, hidjeb, tchador) et adopte donc une perspective onomasiologique. L'analyse du corpus révèle qu'en synchronie et sous la poussée d'événements moteurs (p. ex. la loi précitée) la polydénomination tend à se résorber et des zones de stabilité à appara ?tre, limitant ainsi le paradigme des candidats. Si tchador et hidjeb ont disparu, voile et foulard se sont maintenus avec une prééminence nette pour le premier. Tous les coréférentiels stabilisés ne sont donc pas sémiotiquement identiques, mais comportent à des degrés divers des zones de fragilité. Sur un plan plus sémasiologique, l'auteure note que l'emploi de voile autorise des jeux de mots où verbe (voiler) et nom (voile) se sémantisent au point de charger le second de valeurs sociopolitiques et de faire de lui par métonymie l'emblème de la pratique religieuse musulmane. Le mot se voit ainsi chargé d'une force évocatrice importante, qu'il doit aux conditions de sa circulation discursive. Cette force d'évocation en fait un mot-événement au sens de Moirand (2007) : il renvoie à un événement et « sert de déclencheur mémoriel de ce qu'on sait, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a retenu de cet événement » (ibid.). Dans le cadre théorique de la Praxématique, Françoise Dufour s'intéresse, elle aussi dans un aller et retour entre onomasiologie et sémasiologie, au glissement opéré par les discours colonialistes et néocolonialistes entre progrès civilisateur et développement. Ici encore, une étude diachronique, montre que l'appellation n'est pas innocente et que le glissement terminologique opéré ces dernières décennies n'est qu'un artifice qui vise à proposer un habillage différent pour une réalité que l'on cherche à travestir afin d'en atténuer l'identité. Plus fondamentalement l'étude proposée interroge la permanence (ou non) de la référence malgré sa prise en charge par des dénominations différentes et le niveau de sa détermination (le réel etralinguistique ou sa conceptualisation par le lexique) : en l'occurrence le parti pris par l'auteure est celui de la permanence malgré les différences de valeurs sémantiques et de référence imparties aux deux items (progrès civilisateur et développement). Sur un plan linguistique et lexical rien n'autorise a priori un tel rapprochement. Toutefois, ici encore, la mise en regard des énoncés du corpus tend à accréditer la thèse de la variation (les deux expressions ne sont que des variables indexées différemment et différentiellement). Toutefois la question reste posée (cf. plus bas) de savoir si l'on doit où non distinguer ce qui ressortit au lexical de ce qui appartient en propre à l'instanciation discursive.
L'ouvrage se clôt sur deux contributions isolées : l'une de R. Huygue (Qu'appelle-t-on un lieu ?) dans une rubrique « Contrepoint », et celle de Sandrine Reboul-Toure (« Dénomination » en discours : un terrain métalinguistique).
231
R. Huygue s'intéresse à la valeur dénominative de trois items :lieu, place et endroit. Une analyse distributionnelle démontre que les trois unités ne se comportent pas de manière identique. Partant du constat qu'il n'existe pas de continuité ontologique des lieux aux choses, du moins tels que sont traitées dans la langue les unités qui y renvoient, l'auteur aboutit au constat que ces trois termes ne dénomment pas mais fonctionnent comme des désignateurs qui disposent d'un sens localisateur. Ils « désignent des objets du monde, en les présentant comme supports dans des relations de localisation, potentielles ou actuelles ». Loin de constituer les étiquettes stables et récurrentes d'un certain nombre de référents, ces unités exprimeraient un point de vue et auraient donc à cet égard une valeur prédicative. S. Reboul-Toure propose quant à elle une forme de synthèse de l'ouvrage en revenant sur les différentes acceptions du concept de dénomination dans l'histoire à partir du XVIIie siècle. La conclusion à laquelle elle aboutit fournit un point d'appui fort utile à la discussion sur la pertinence d'une partition entre nomination et dénomination.
En effet, S. Reboul-Toure, dont les travaux sur la désignation (notamment les paradigmes désignationnels) sont connus, remarque que le choix du terme nomination dans un certain nombre des contributions de l'ouvrage semble procéder davantage d'un souci de cohérence à l'intérieur d'un appareil théorique que de l'observation réelle de comportements linguistiques. En effet, contrairement à ce qui est parfois soutenu, le parti d'opter pour (la nomination et pour) nomination, qui disposerait seule d'une interprétation processuelle, contre la dénomination (et dénomination), qui serait résultative ne se justifie pas d'un point de vue linguistique. Nomination et dénomination, comme tous les noms en —tion du français, sont susceptibles de recevoir aussi bien une interprétation processuelle que résultative. Nier le fait reviendrait à contredire une propriété impartie à la morphologie de la langue. Un autre axe de partage est également dessiné entre les deux concepts : la nomination serait davantage d'application discursive, la dénomination restant adossée à une propriété lexicale. Ce second partage présente l'intérêt indéniable de conduire à une hiérarchisation des unités qui dès lors ne sont plus considérés comme cohyponymes, mais intégrées à une relation de subordination. Si l'on admet que la dénomination est une procédure (un acte) d'assignation qui associe une unité lexicalisée à un segment de réalité, force est de reconnaître que la nomination, qui ne com~ai~ pas les mêmes contraintes au regard du lexique, est une procédure superordonnée qui consiste à assigner un nom, que celui-là soit ou non lexicalisé, à un segment de réalité. À titre d'exemple, la néologie est exclue par définition du champ de la dénomination mais certainement pas de celui de la nomination, à la réalisation duquel elle participe centralement. À ce titre, la nomination restera plus proche de pratiques discursives que la dénomination, qui impliquera en supplément la prise en compte de la stabilisation lexicosémantique des unités de la langue.
Nous ajouterons deux observations, qui s'imposent à l'évidence à la lecture des articles regroupés dans l'ouvrage
- les auteurs réalisent diversement ces deux axes de partage. Chez certains, les concepts de dénomination et de nomination demeurent fréquemment synonymes et entrent davantage en relation de variantes stylistiques que d'opposition sémantique et référentielle. De la sorte, dans certaines contributions, il ne semble pas qu'une spécificité de la nomination sur la dénomination (ou sur toute autre pratique référentielle) se dégage toujours clairement. Par contrecoup c'est la justification même du titre de l'ouvrage qui risque de s'en trouver hypothéquée
232 (l'acte de nommer semble ne plus se différencier de l'acte de dénommer). L'entreprise menée autour de cet axe qu'est la nomination s'inscrit pourtant dans un renouvellement de la réflexion sémantique et nominale (voir à cet égard également le premier numéro de la revue Neologica) ;l'opposition entre nomination et dénomination, instituée explicitement par ce nouveau courant, vient reconfigurer un paradigme institué par G. HIeiber en 1984 (dénomination vs désignation in "Dénomination et relations dénominatives" Langages n°76) en en déplaçant le centre de gravité. Certains auteurs, dont Paul Siblot, exploitent la reconfiguration en cherchant à mettre en lumière son intérêt pour la réflexion lexicale et sémantique. D'autres en revanche, parce qu'ils s'en tiennent à l'opposition précitée, instituée par G. HIeiber, rendent dénomination et nomination indiscernables ;
- le lestage théorique de la réflexion hérite des difficultés inhérentes au positionnement du concept de dénomination dans l'appareil théorique et méthodologique de la sémantique lexicale. Que l'on ne s'y trompe pas, la responsabilité n'en est pas imputable aux auteurs mais au stade préthéorique de la conceptualisation de la dénomination en linguistique actuellement. D'où le recours fréquent à l'article de G. HIeiber (1984) et non pas aux rectifications qu'il a apportées ultérieurement. Dans ce contexte il peut appara ?tre hasardeux que la dénomination fournisse un contrepoint pour l'élaboration d'une réflexion sur la nomination.
Ces difficultés ne doivent toutefois pas être surestimées ni masquer le mérite très appréciable de l'entreprise menée dans cet ouvrage :associer la réflexion sur la (dé)nomination aux conditions sociales, politiques et culturelles d'exercice du langage et de la référence Ainsi se voient réinvestis dans le champ de la réflexion des paramètres que l'analyse lexicale avait tendance à ne plus prendre en compte. Bien plus, il montre que ces valeurs ne sont pas uniquement des effets discursifs, mais qu'elles constituent une mémoire sémantique à long terme et stabilisée, donc de nature à intéresser la valeur sémantique en langue des unités. Autre intérêt, insister sur le fait que l'indexation lexicale en discours (et son corollaire en langue), ne sont pas des pratiques transparentes mais relèvent de stratégies dont les tenants ne sont pas nécessairement mai"trisés par les locuteurs. Enfin, et surtout, l'ouvrage vient rappeler le fait que (dé)nommer, appeler « les choses », leur donner un nom, ne répond pas seulement à un besoin d'identification, de classement et d'échange, mais ressortit à une activité dont la finalité plus ou moins avouée est argumentative et perlocutoire.
Gérard PETIT Université Paris X
JANSEN, Silke (2005), Sprachliches Lehngut im world Ovide web. Neologismen in der franz~sischen und spanischen Internetterminologie. Tübingen. Ganter Narr Verlag. 412p. Tübinger Beitri3ge zur Linguistik 484.
Comme la contribution la plus significative à la théorie des emprunts depuis trente ans est sans doute celle d'un Allemand, Gerd Tesch (1978), qui place fermement l'emprunt lexical dans le cadre de l'interférence, au niveau descriptif, le nombre d'études réalisées outre-Rhin sur les emprunts dans différentes langues, y compris en français, n'a pas fléchi. Le rôle de l'emprunt dans les langues de
233
spécialité fait l'objet d'une attention particulière, mais la langue générale n'est pas négligée pour autant. Le dictionnaire européen des anglicismes (G~rlach 2001, 2002a,b), qui exclut en principe tout vocable spécialisé, a été réalisé depuis l'Université de Cologne, et l'Allemagne reste le centre des études sur le phénomène de l'anglicisation. Malgré cette productivité et la qualité de la description, préalable à toute étude sérieuse, les avancées sur le plan théorique sont relativement modestes. C'est pourquoi le livre de Silke Jansen est particulièrement significatif. Le titre laisse penser qu'il s'agit d'une description de l'état de la pénétration de l'anglais dans le français et l'espagnol de l'Internet. De fait, l'ouvrage ne déçoit pas au niveau de la qualité de la description, que nous examinerons en détail plus bas, mais il comporte par ailleurs de nombreuses autres qualités, à commencer par un souci théorique. Puisque son intérêt primaire est l'emprunt interne, largement décrit dans les années 50,1'auteure consulte les études classiques pour se rendre compte que les modèles qui servent depuis cinquante ans sous différentes formes sont en fait inadéquats pour expliquer le phénomène de l'emprunt. Elle en analyse les raisons et elle propose un autre modèle, fondé sur deux ou trois principes linguistiques qu'elle justifie explicitement. L'apport théorique de ce livre est donc significatif. Au niveau de la description, les qualités sont également nombreuses : en bonne romaniste, Jansen ne se contente pas d'étudier une seule langue, elle en examine deux, le français et l'espagnol, permettant ainsi des comparaisons éclairantes. Ensuite, elle prend très au sérieux les critères de l'exhaustivité d'analyse dans les limites qu'elle s'impose. Elle s'en tient aux termes recommandés officiellement en français par le Dispositif d'enrichissement de la langue française, ainsi qu'à leurs concurrents en français, et leurs équivalents en espagnol. Le choix de ce corpus contribue de façon utile au débat déjà très nourri dans les pays francophones sur l'évaluation de l'impact des arrêtés de terminologie. À en juger par ce livre, enfin, les thèses allemandes sont encore imprégnées d'érudition : l'auteure a une connaissance approfondie d'une importante quantité d'ouvrages publiés dans une multitude de langues, qu'elle cite abondamment. De nombreuses citations, par ailleurs, sont suivies de renvois vers d'autres auteurs qui expriment des vues semblables à celles qu'elle cite textuellement, de telle sorte que le livre donne accès à une bonne partie de la recherche sur le sujet, un vrai bonheur.
Le livre est divisé en deux grandes parties, l'une théorique, l'autre empirique. Ceux qui s'intéressent à la théorie des emprunts peuvent se contenter de la première partie, mais ce serait renoncer aux plaisirs de la démonstration, qui est magistrale. L'exposé théorique comporte trois parties :l'état de la recherche sur les emprunts depuis 1949, l'analyse des critères retenus par les différents auteurs, et la mise en perspective des critiques ainsi dégagées et la suggestion d'une nouvelle typologie de l'emprunt linguistique. La partie empirique commence par une discussion de l'emprunt interne et de son identification ;ensuite, l'auteure examine le rôle de la métaphore dans le vocabulaire de l'Internet en langue anglaise, puis elle se focalise sur la politique française de remplacement des anglicismes, en analysant les termes de substitution proposés, avant de les comparer aux dénominations des mêmes concepts relevés dans un corpus de presse serai-spécialisée. La partie consacrée à l'espagnol est plus succincte, en partie du fait de l'absence de politique linguistique comparable, mais la même démarche est suivie, puisque les différentes formes de dénomination relevées à l'intérieur puis à l'extérieur du corpus sont présentées ainsi que les indices de lexicalisation. Le tout dernier chapitre est un résumé de la
234
démarche et une discussion des résultats. Les annexes sont bien utiles : une bibliographie fournie, quoiqu'un tout petit peu vieillie la liste des revues dépouillées, les arrêtés de terminologie, la liste des termes étudiés dans les trois langues, ainsi qu'un glossaire des termes de l'internet.
La partie théorique devrait être intégrée à un prochain manuel sur l'emprunt linguistique :avec 134 pages, elle dépasse largement la taille d'un Que sais je ? Le premier chapitre expose les différentes théories de l'emprunt, surtout de l'emprunt indirect, dont les grands promoteurs sont, par ordre chronologique, Betz, Haugen et Weinreich. Leurs théories telles qu'ils les exposent eux-mêmes, et telles qu'elles ont été reçues depuis, font l'objet d'une analyse approfondie, qui débouche sur une discussion tout aussi détaillée par catégorie (mot d'emprunt, emprunt hybride, emprunt sémantique, création lexicale sous impulsion d'une langue étrangère, calque littéral, calque libre : le caractère quelque peu insolite de ces catégories en français montre que la terminologie de Betz, dont elles sont issues pour l'essentiel, n'est guère employée dans les pays francophones, comme Jansen le fait remarquer (Jansen 2005 : 122). Sa critique de toutes les catégories proposées antérieurement est à la fois pratique et théorique : pratique dans la mesure où les catégories dégagées par les différents auteurs se chevauchent et ne permettent pas une classification objective, préalable à toute analyse sérieuse ;théorique sur le plan de l'adéquation par rapport à la théorie saussurienne du signe linguistique. Les différentes explications de l'emprunt interne défont le signe, séparent signifiant et signifié : on emprunte le signifié sans emprunter le signifiant, dit-on, faisant ainsi fi de sa nature, indivisible par définition. Une seconde faiblesse de la plupart des études antérieures résulte d'une distinction insuffisamment réalisée entre synchronie et diachronie, entre parole et langue. L'emprunt —événement — au moment où il se produit, est un phénomène d'interférence, donc de parole. Il peut par la suite être lexicalisé, entrant ainsi dans la langue. Faire une même classification des deux phénomènes, comme le font implicitement la plupart des auteurs, fausse complètement le jeu. Jansen exploite très astucieusement la catégorie intermédiaire de la norme telle qu'elle est proposée par Coseriu dans son célèbre Sistema, norma y habla, pour rendre compte de cette phase cruciale. Il ne faut pas conclure que Jansen fait table rase des théories précédentes : en réalité, malgré les chevauchements, ces théories comportent des traits communs qui se révèlent compatibles, une fois qu'on fait les distinctions qui s'imposent entre langue et parole et entre synchronie et diachronie. En outre, il est normal que les appareils critiques, élaborés dans des buts très différents (l'influence lexicale du latin sur l'allemand, pour Betz, l'explication des phénomènes d'interférence à l'oral pour Haugen) divergent sensiblement. Le modèle proposé doit correspondre aux buts recherchés. Le résultat, la typologie que Jansen propose, est bien plus simple que la plupart des systèmes antérieurs, puisqu'elle postule un modèle d'interférence focalisé sur des individus bilingues qui sont les vecteurs des emprunts, internes ou directs. Elle postule trois grands cas de néologie lexicale induite par une situation de contact (Jansen 2005 :331-332) : le premier aurait son origine dans une manifestation d'alternance Iodique et aboutirait à l'adoption d'un signe d'une autre langue : c'est l'emprunt direct classique. Le deuxième cas serait la traduction faite par une personne bilingue aboutissant à des inflexions induites par interférence : c'est l'emprunt indirect, calque ou emprunt sémantique. Le troisième sera la mise en évidence d'une lacune lexicale par comparaison avec une langue donnée, lacune comblée par un élément qui n'a rien à
235
voir avec l'unité lexicale de l'autre langue :dans ce dernier cas (connu sous le terme de Lehnschdpfung), il ne s'agit pas en fait d'emprunt, mais de néologie autonome.
Le lecteur apprécie la démarche très claire et systématique qui, dans cette première partie, reprend les catégories traditionnelles et les replace dans un contexte théorique épuré, permettant ainsi de comprendre les nouvelles catégories par rapport aux anciennes. Les tableaux qui figurent à la fin de cette partie facilitent encore plus la compréhension.
Le renouveau méthodologique permet des avancées significatives : il permet par exemple de tordre le cou à la notion de « rétrécissement sémantique »qui serait le propre de l'emprunt. Cette vision des choses correspond à une analyse insuffisante de la nature du signe linguistique. Par ailleurs, elle montre clairement (Jansen 2005 :3) que la plupart des « hybrides » ne font en principe pas partie des emprunts, car il s'agit d'une exploitation d'un élément étranger intégré pour former une nouvelle unité lexicale composée, même si une traduction peut aboutir à l'occasion à une forme hybride. La répartition entre connaissances linguistiques et encyclopédiques dans l'évaluation de la motivation linguistique est également originale et utile.
La seconde partie, empirique, ouvre sur des considérations méthodologiques. Fidèle à l'ancrage de son analyse dans la parole, Jansen met l'accent sur l'oral. On peut se demander si l'insistance sur le niveau oral du contact linguistique est pleinement justifiée compte tenu de la situation actuelle par rapport à l'anglais, le vecteur écrit paraissant déterminant. Le rôle de la métaphore dans la composition du vocabulaire de l'internet est présenté dans un chapitre qui contribue au débat sur la question, particulièrement nourri ces dernières années Non que le sujet soit vierge
Jansen (2002) elle-même s'est déjà exprimée sur le sujet, mais son rôle dans le transfert de concepts dans le cadre de l'emprunt linguistique a rarement été évoqué. Elle arrive à la conclusion que la plupart des métaphores facilitent la traduction et permettent ainsi de se passer d'un emprunt direct, sauf dans le cas des métaphores spécifiques à une culture donnée (comme spam, cookie).
La présentation de la politique officielle française n'est guère flatteuse : la motivation serait essentiellement politique et relèverait davantage d'un anti- américanisme que d'un désir de faciliter la communication entre francophones. Elle examine les arrêtés du 2.12.1997 (termes relatifs au courrier électronique), du 16.03.1999 (vocabulaire de l'informatique et de l'internet), du 1.9.2000 (vocabulaire de l'internet), et en analyse les termes, d'abord du point de vue de leur forme en anglais, accordant une attention particulière aux métaphores, puis de celui de la forme des substituts proposés. Elle obtient (Jansen 2005 : 225) les pourcentages suivants • 65% seraient des traductions (Lehnübersetzungen), 21% des néologismes indépendants, 11% une combinaison de traductions et de néologismes indépendants ou emprunts directs, 2% emprunts directs et 1% de cas douteux.
Le chapitre sur l'évaluation du corpus journalistique permet une comparaison des termes officiels et des pratiques constatées. Elle relève une assez grande concordance entre les deux et un emploi réel des termes officiels, mais la proportion des emprunts directs est bien plus forte : dans les 30%. Fidèle à sa méthodologie, elle examine séparément les manifestations des emprunts dans les textes et les tendances de lexicalisation, catégorie par catégorie.
La partie sur l'espagnol est plus brève, mais elle comporte également des surprises. Jansen examine deux corpus journalistiques, l'un espagnol d'Espagne,
236 l'autre mexicain. Elle s'attendait à ce que le corpus européen soit moins influencé par l'anglais que l'américain, mais en réalité les chiffres sont très comparables. Elle constate par ailleurs, en comparaison par rapport au français, que l'espagnol, malgré l'absence d'instance d'officialisation, n'emploie pas plus d'anglicismes —c'est-à- dire d'emprunts directs —que le français, voire plutôt moins, confirmant ainsi l'étude de Céline Ahronian (2005), qui arrive à des statistiques tout-à-fait comparables à partir d'un corpus établi indépendamment.
L'ouvrage de Jansen est précieux en ce qu'il donne accès à des pans entiers de recherche effectués dans les pays de langues romanes et germaniques. Inévitablement quelques études qui auraient pu enrichir le débat manquent à l'appel. On se demande pourquoi elle est restée en si bon chemin lorsqu'elle propose un schéma tripartite de l'analyse sémiotique alors que Peter Koch (2005) invoque un modèle multidimensionnel pour rendre compte de la motivation sémantique, qui s'apparente à la néologie d'emprunt, surtout interne. Pour l'étude des tendances inhérentes au français qui seraient renforcées par l'influence de l'anglais, elle aurait pu très utilement convoquer Michael Picone (1996). De même, le programme de recherche sur la métaphore comme outil de conception aurait apporté un cadre théorique plus affirmé à cet aspect de la néologie. Également absents les nombreux écrits et études de l'Union Latine, organisme qui oeuvre pour le rapprochement des terminologies des langues latines : l'auteure connaît-elle ces études, ou estime-t-elle qu'elles n'apportent rien à la question ?Plus généralement, on a l'impression que la recherche de fond a été effectuée dans les années 90 et que la bibliographie n'a pas été mise à jour. Ce retard a des répercussions sur les données, par exemple celles sur la présence des différentes langues sur l'Internet, qui datent pour la plupart des années 1990, et qui ont certainement évolué depuis.
Au niveau des réserves, on peut regretter que les relations à l'intérieur de la francophonie ne soient pas vraiment prises en compte : la place précaire qu'occupe le français en Amérique du Nord interdit des comparaisons trop directes avec la situation en Europe. L'organisation internationale de l'aménagement linguistique des langues romanes ne semble pas beaucoup intéresser l'auteure, car le rôle de l'Union Latine n'est pas évoqué, pas plus que les coopérations francophones entre instances officielles, bien que les termes diffusés par l'Office de la langue française (depuis 2002 Office québécois de la langue française) soient cités systématiquement. De même les réseaux RTTERM et REALTTER ne sont pas mentionnés non plus.
On peut s'interroger également sur la prise en compte du caractère terminologique du vocabulaire examiné :les termes sont des mots qui sont sujets à une plus forte régulation que les mots de la langue générale. Bien entendu, dans le contexte qui nous intéresse, il s'agit de termes très largement vulgarisés, aspect pris en charge par l'emploi des métaphores. Quelques erreurs se sont aussi glissées dans l'ouvrage :aspirateur (de site) n'est pas l'équivalent de access provider, et fouineur est plutôt un engin de recherche qu'un hacker (Jansen 2005 :255).
Malgré ces quelques réserves, on peut recommander sans réserve un livre qui renouvelle plusieurs aspects de l'étude des emprunts. Nous formulons le voeu que la prochaine publication de l'auteure sera le nouveau manuel sur l'emprunt linguistique, qui se fait attendre depuis une cinquantaine d'années.
John HUMBLEY Paris 7, LDI
237
BIBLIOGRAPHIE
AHRONIAN Céline (2005) :Les noms composés anglais en français et en espagnol du domaine d'Intemet : traduction des composés anglais en français et en espagnol. Thèse de l'Université Lumière Lyon 2.
G~RLACH Manfred éd. (2001) A Dictionary of European Anglicisms, Oxford University Press.
— (2002a) : English in Europe, Oxford University Press.
— (2002b) : An annotated bibliography of European Anglicisms, Oxford University Press.
JANSEN Silke (2002) : « Metaphem im Sprachkontakt – anhand von Beispielen aus franzüsischen und spanischen Intemetwortschatz » , Metaphorik de 03/2002, p. 44-74 www.metaphorik.de/03/jansen.htm
KOCH Peter (2005) : « Aspects cognitifs d'une typologie lexicale synchronique. Les hiérarchies conceptuelles en français et dans d'autres langues », Langue française
145, p. 11-33.
PICONE Michael (1996) : « Anglicisms, neologisms and dynamic French » , Lingvisticae
investigationes supplementa 18, Amsterdam/Phildelphia, John Benjamin.
TESCH Gerd (1978) Linguale Interferenz : Theoretische, terminologische und
methodologische Grundfragen zu ihrer Erforschung. Tübingen, Gunter Narr
Verlag.
STEUCKARDT, Agnès et Jean-Paul HONORÉ (éd.) (2006), L'emprunt et sa glose. Mots. Les langages du politique, 82,133 p. http://edition.cens.cnrs.fr/revue/mlp/
Le numéro de Mots de novembre 2006 est consacré en grande partie à l'emprunt linguistique. En effet, trois articles abordent d'autres sujets, que nous n'évoquerons pas ici. Fidèles à leur orientation métalinguistique, déjà illustrée dans Le mot et sa glose, les rédacteurs présentent une série de cinq articles, ainsi qu'une introduction qui situent les enjeux, visant à déterminer les attitudes des locuteurs à l'égard des emprunts telles qu'elles sont manifestées dans les discours métalinguistiques associés. L'analyse de ces « boucles réflexives du dire », pour employer le terme d'Authier-Revuz, une des linguistes qui, ces dernières années, ont mis au point une méthode d'analyse de ces phénomènes, constitue une des ambitions de ce recueil.
Les rédacteurs constatent que les gloses sont nombreuses lorsqu'un mot apparaît -que ce soit un emprunt ou tout autre néologisme - mais que celles-ci disparaissent lorsqu'il est assimilé. Beaucoup d'entre elles sont d'ordre explicatif l'auteur cherche à préciser le sens d'un mot supposé inconnu du lecteur. D'autres gloses sont plutôt évaluatives :l'auteur souhaite se positionner par rapport au mot d'emprunt. Dans « L'anglicisme politique dans la seconde moitié du 18e siècle. De la glose d'accueil à l'occultation », Agnès Steuckardt rappelle d'entrée de jeu l'attitude quelque peu ambiguë non pas des locuteurs ou des scripteurs de son corpus, mais des linguistes français. Si la plupart s'interdisent expressément tout jugement de valeur au sujet des anglicismes, certains se montrent réservés, lorsqu'ils mettent en garde contre l'emploi abusif de ce type d'emprunt, comme Rey-Debove qui parle de « l'emprunt à l'anglais [qui] apparaît comme une véritable menace pour la langue nationale ». Un sondage récent réalisé dans Europresse révèle que l'image
238 des anglicismes véhiculée par la presse est encore plus négative :dans 81,75% des cas, l'emploi du mot anglicisme est classé comme péjoratif (associé à des adjectifs comme hideux, obscur, barbare...). Aux temps des Lumières, selon Steuckardt, la situation était bien différente. Les penseurs de cette époque contournaient les réticences bien connues de l'Académie pour emprunter sous différentes formes des mots qui témoignaient des aspects de la vie britannique, surtout du domaine institutionnel. En effet, les emprunts à l'anglais connaissent un bond à partir de la seconde moitié du 18e siècle. Steuckardt constate, pour la première partie de sa période, que les emprunts sont accompagnés de mélioratifs (des plus beaux, des plus estimables, auguste, privilège...). Elle explique en outre comment les gloses participent au processus d'intégration des emprunts dans la mesure où ils entrent dans l'esprit des Lumières. La Révolution change la donne :l'Angleterre est vue comme l'ennemi, le rival, et les commentaires sont de plus en plus négatifs et les « lexicographes ont jeté le voile sur le fait d'emprunt ». Steuckardt estime d'ailleurs que cet interdit est encore perceptible dans la lexicologie d'aujourd'hui.
La deuxième contribution de ce recueil est également historique, bien que la période soit plus proche de nous. Dans « Un Français à la cour du Morho Naba », Olivia Guérin explique à travers une analyse praxématique comment l'écrivain Albert Londres intègre des mots d'emprunt dans le récit d'un voyage qu'il a effectué en 1927 dans une cour africaine traditionnelle. Il en ressort que l'emploi des gloses bien plus que celui des emprunts est révélateur de l'attitude de l'écrivain. « Si [le] procédé de nomination [c'est-à-dire l'emploi des emprunts] semble, au premier chef, permettre de rendre compte des caractéristiques sociopolitiques de la société décrite, la manière dont est construit en discours l'accès au sémantisme des termes empruntés tend à déterritorialiser les concepts et représentations qui leur sont liés » (page 33). En effet, les explications que fournit Londres ramènent les réalités de la structure de la société africaine à des pratiques européennes, aboutissant ainsi à des représentations réductrices et dévalorisantes ;l'écrivain parait bien proche des attitudes colonialistes qu'il dénonce par ailleurs.
Les trois derniers articles se situent dans un contexte chronologique plus strictement contemporain. Aïno Niklas-Salminen, dans « Le xénisme français la'icité en finnois contemporain », analyse non seulement les gloses qui accompagnent ce phénomène peu compris relevant de l'exception française, mais aussi les différentes formulations finnoises susceptibles de rendre tel ou tel aspect du concept. Les journalistes finlandais se trouvent effectivement mal armés pour rendre compte d'une attitude sociale qui ne trouve pas d'équivalent dans leur propre société. Fait supplémentaire assez remarquable, un sondage effectué dans un plus petit corpus de journaux de langue suédoise de Finlande et de Suède indique qu'il s'agit d'une attitude qui est davantage nationale que linguistique, les journaux suédois exprimant une attitude plutôt critique. En effet, la Suède, contrairement à la Finlande, connaît un très fort taux d'immigration ; elle a coupé les liens qui reliaient l'État à la religion luthérienne, et de ce fait la différence entre les sociétés suédoise et française est moins forte.
Geneviève Petiot et Sandrine Reboul-Touré abordent à leur tour un autre aspect de la laïcité, celui des signes extérieurs d'appartenance religieuse, dans un article intitulé : « Le hidjab. Un emprunt autour duquel on glose ». Elles soulignent en effet le changement de paradigme que cette lexie a subi : d'un couvre-chef exotique il devient en effet un signe religieux, et se trouve ainsi en codistribution
239 avec croix, kippa, turban... Elles invoquent le concept de modalisation autonymique (l'« arrêt sur mot » d'Authier-Revuz) pour rendre compte des variations orthographiques et phonétiques du mot, ainsi que des gloses, connotées, épinglées comme étranger, arabe..., bref, un marqueur de discours polémique.
Sarah Leroy, dans un article présenté comme plutôt méthodologique « Glasnost et perestroika. Les pérégrinations de deux russismes dans la presse française », examine non seulement ces deux emprunts au russe, mais aussi les concepts de xénisme et de pérégrinisme. Les deux mots cités ont connu un fort taux d'emploi vers la fin des années 80 et au début des années 90, pour retomber rapidement à un niveau bas mais assez constant depuis. Bien que maintenue dans le dictionnaire de Dubois et al (1994) la distinction entre ces deux concepts (le premier un mot étranger pour un concept non seulement étranger mais inconnu, le second pour un mot étranger pour un concept toujours étranger mais connu dans le pays de référence) avaient tendance à s'estomper. Leroy tente d'en montrer la pertinence, d'après les gloses qu'elle analyse. Elles indiqueraient que les deux mots ne s'intègrent que très peu dans le lexique français et gardent de ce fait un statut à part, mais au fur et à mesure que les gloses disparaissent, ils passent du xénisme au pérégrinisme.
À une exception près, tous les articles sur les emprunts focalisent sur le phénomène du xénisme. Ce terme, presque tombé en désuétude et pour lequel tous les auteurs ne donnent pas la même définition, semble renvoyer à des références, voire des non dits d'ordre culturel, qui sont exprimés, de façon parfois indirecte, par les gloses. Il est permis de penser, toutefois, que d'autres types d'emprunts, tels que ceux qui désignent des innovations technologiques (l'exemple de tuner, de Mortureux, est pertinent ici), appellent également des gloses, comme n'importe quel autre mot technique (voir Beciri, « Néologismes et définition en contexte :pour une typologie des indices intreprétatifs formels », Le mot et sa glose, Steuckardt A. et Nicolas-Salmiens (eds.), Presses de l'Université de Provence, 2003, p. 41-56). C'est plutôt l'orientation politique de la publication Mots qui expliquerait ce choix, car plus orientée vers les aspects culturels du lexique.
L'emprunt est généralement considéré, par définition, comme relevant de la néologie. Même si les auteurs de ces articles ne font pas de rapprochement explicite à d'autres manifestations de la néologie, à part la glose, certains peuvent être signalés : une instabilité désignationnelle (surtout pour les équivalents finnois de la'icité, mais aussi pour glasnost et perestroika, car même l'équivalent `canonique' se trouve contesté), instabilité orthographique (pour hijab en particulier),
À quand le numéro : le néologisme et sa glose ?
John HUMBLEY Paris 7, LDI
WETZLER, Daginar (2006), Mit Hyperspeed ins Intemet Zur Funktion und zum Verstiindnis von Anglizismen in der Sprache der Werbung der Deutschen Telekom, Franl~urt am Main. Peter Lang. Europ~ische Hochschuleschriften. Reine XIV. 370 p.
Le nombre d'études consacrées à l'influence de l'anglais sur l'allemand d'aujourd'hui est impressionnant, et la dernière en date -dont on pourrait traduire le titre comme « Highspeed vous connecte à l'Internet : sur la fonction et la
240 compréhension d'anglicismes dans le langage de la publicité de Deutsche Telekom » -est issue, comme très souvent en Allemagne, d'une thèse de doctorat. L'idée principale est de vérifier si les anglicismes que Deutsche Telekom emploie à profusion sont compris des clients potentiels et plus généralement comment ils sont perçus.
Comme les meilleures thèses allemandes, cette étude est basée sur une analyse approfondie des très nombreux travaux déjà réalisés en Allemagne sur les anglicismes et sur l'évaluation de leur réception en particulier, de telle sorte que les premiers chapitres font le point sur la recherche effectuée ces dernières années et constituent pour le lecteur un résumé de l'état de la question, à la fois en termes de domaines couverts (langue générale et langues de spécialité), buts poursuivis et méthodes utilisées, ainsi qu'une réflexion sur les études d'emprunts en général. L'auteure se permet un « Exkurs » sur le purisme en allemand actuel et décrit les actions de l'association Verein Deutsche Sprache, qu'elle voit sous une lumière très négative.
Deutsche Telekom est connu en Allemagne pour son fréquent emploi d'anglicismes —l'association Verein Deutsche Sprache l'a déjà « primé » pour son anglomanie. L'entreprise l'explique par son étendue mondiale : elle se définit expressément comme un « global player », statut qui se reflète dans la langue. Il existe aussi des études sur la compréhension des anglicismes employés dans la publicité, que Wetzler analyse. Les résultats sont quelque peu paradoxaux : d'un côté certaines études laissent penser que les clients potentiels qui ne comprennent pas certains anglicismes en retirent une impression négative, tandis que d'autres indiqueraient que l'effet global de l'emploi de l'anglais est plutôt positif, se situant essentiellement sur le plan de la connotation. Cet aspect fera l'objet d'un examen attentif lors des entretiens que Wetzler mène.
Après des sections sur le langage de la publicité et les méthodes statistiques employées dans les enquêtes sociolinguistiques concernant le lexique, l'auteure présente son expérience. Elle a recueilli vingt anglicismes employés dans les publicités Deutsche Telekom, dix de la langue générale, et dix qui relèvent plutôt du langage des télécommunications. Elle a ensuite construit un questionnaire en fonction d'une vingtaine d'hypothèses qu'elle a formulées sur les rapports entre les données sur les informateurs et leurs attitudes par rapport aux anglicismes de la publicité et l'influence de l'anglais en allemand en général. Le questionnaire tient donc compte d'abord de l'âge, du sexe, du niveau d'instruction (connaissance des langues en particulier), des habitudes de consommation des médias (magazines, télévision) des interviewés. Ensuite, les cent interviewés ont été priés de prononcer l'anglicisme, de l'évaluer sur différentes échelles (compréhensibilité, complexité, modernité, artificialité, nécessité, neutralité) et d'en donner un équivalent ou une explication en allemand. Les résultats sont présentés en détail, mot à mot, et synthétisés à la fin.
L'enquête montre que la compréhension des anglicismes des publicités de la Deutsche Telecom est très variable. Si certains sont compris de tous (Handy, `pseudo-anglicisme' pour téléphone portable, par exemple), d'autres sont très peu compris : by call n'est correctement interprété que par trois informants, et la très grande majorité a mal compris Citygesprcich. Contrairement aux hypothèses de l'auteure, le sexe de l'informant a joué un rôle :les hommes font un meilleur score que les femmes. Le niveau de connaissance de l'anglais, ainsi que l'âge et le niveau
241 d'études, sont encore plus déterminants. Le facteur crucial, toutefois, est le degré de technicité :les mots de la langue courante sont généralement bien compris, ceux du domaine des télécommunications beaucoup moins. C'est pour cette raison sans doute que les hommes ont mieux réussi que les femmes, les jeunes que les vieux.
Les publicitaires comptent sur l'aura de l'anglais et sa supposée modernité pour faire passer le message, même si tous les mots ne sont pas compris. Or, Wetzler montre que l'informant qui ne comprend pas un anglicisme a une attitude plutôt négative à son égard. En même temps, elle découvre que les mots parfaitement compris n'ont quasiment pas d'impact sur la plupart des interviewés, ce qui doit pousser les publicitaires à rechercher des formules de plus en plus insolites, et à utiliser davantage d'éléments anglais.
On comprend que la grande force de cette étude est son assise sociolinguistique. L'auteure a bien pris au sérieux la maxime de Weinreich, qui prétend que celui qui n'étudie pas le contexte sociologique des emprunts, laisse son étude en l'air. Dans une certaine mesure, cependant, cette focalisation sur la réception se fait aux dépens de l'analyse des éléments du corpus. Les vingt termes choisis dans les publicités de la Deutsche Telecom sont peut-être tous des anglicismes, car ils comportent des éléments anglais, mais il ne s'agit pas pour autant d'emprunts dans tous les cas. Handy, déjà mentionné, est un `pseudo- emprunt', comme l'auteure le reconnaît. Mais un pseudo-emprunt, du moins de ce type, n'est pas un emprunt du tout. Le modèle dans l'autre langue n'existe pas. Il s'agit d'un radical qui est le même en anglais et en allemand, auquel on a ajouté un « suffixe » déjà connu pour figurer dans de nombreux emprunts courants en allemand : happy. Il n'est donc pas étonnant que tous le comprennent. À l'inverse, Citygesprcich, qui est également un pseudo-emprunt, forgé par DT, d'autant plus facilement que City figure déjà dans tous les dictionnaires allemands et employé au niveau le plus officiel. Pourtant, il n'est pas compris, parce qu'il est mal motivé. DT l'a inventé pour le différencier de Ortsgesprcich, communication locale, mais avec un sens plus large : or, en allemand, City c'est le centre d'affaires d'une ville. Le problème de la motivation ici ne concerne pas du tout l'anglais. Wetzler n'a visiblement pas eu l'occasion de prendre connaissance de l'ouvrage de Silke Jansen (2005), qui l'aurait mieux orientée. Il est visiblement temps de publier un manuel enfin à jour de l'emprunt linguistique qui tienne compte des évolutions des trente dernières années.
John HUMBLEY Paris 7, LDI
ADAMO Giovanni et DELLA VALLE Valeria (2006), Che fine fanno i neologismi ?, Firenze, Leo S. Olschki
Depuis des années l'innovation lexicale est au centre des recherches de Giovanni Adamo et Valeria Della Valle qui coordonnent l'Osservatorio neologico della lingua italiana (Iliesi-Cnr) et ont déjà publié deux ouvrages recensant les néologismes (Neologismi quotidiani. Un dizionario a cavallo del millennio 1998- 2003, Firenze, Leo S. Olschki, 2003) et mots nouveaux de la langue italienne (2006 parole nuove, Milano, Sperling & Kupfer, 2005).
Si l'intérêt pour les mots nouveaux n'est pas récent et a suscité de nombreux débats entre puristes et partisans de l'innovation, force est de reconnaître qu'il com~ai~ depuis quelques décennies un renouveau d'attention dû à l'irruption dans nos langues d'une quantité croissante de néologismes résultant des innovations constantes dans les domaines scientifique, technique et social, le développement massif des échanges interlinguistiques et des communications de masse dans la société de l'information.
C'est pour tenter de faire le point de la situation que les deux chercheurs ont réuni à Rome des spécialistes italiens, français et espagnols dont les interventions sont réunies dans le volume Che fine fanno i neologismi ? (Firenze, Leo S. Olschki,
La filiation avec le grand lexicographe italien Alfredo Panzini (1863-1939) est revendiquée par les éditeurs dès le sous-titre A cento anni dalla pubblicazione del « Dizionario moderno » di Alfredo Panzini et réaffirmée dans l'article de Luca Serianni Panzini lessicografo tra parole e cose. Plus que comme un véritable dictionnaire l'ouvrage de Panzini se présente comme un « voyage »dans l'Italie des années de la première moitié du 20e siècle dominées par l'idéologie fasciste qui, comme tout régime autoritaire, entendait intervenir sur la langue. Si Panzini ne pouvait être que proche du régime en vigueur puisqu'il fut membre de l'Accademia d'Italia de 1929 jusqu'à sa mort, il refuse toutefois tout dirigisme dans ce domaine. Pour lui, la priorité doit être donnée à l'usage qu'il enregistre scrupuleusement tout en le commentant Ainsi signale-t-il les très nombreux gallicismes en vogue à l'époque (les anglicismes ne constituant pas encore un phénomène marquant) qu'il considère comme manifestations d'un snobisme de la part de la bourgeoisie, alors que, dit-il, c'est dans les dialectes et régionalismes que l'on trouve la véritable expression du peuple. De la même façon rejette-t-il les technicismes et tous les termes en —isme, qu'il commente ironiquement. L'intérêt de l'ouvrage est qu'il constitue, à travers les ajouts et les suppressions effectués au fur et à mesure des
Neologica, 2, 2008, p.215-237
220 différentes éditions, un témoignage précieux de l'évolution de l'italien contemporain et un document qui permet d'évaluer la part du lexique régional qui, au cours du siècle passé, a survécu et a dépassé les frontières originelles pour faire partie à plein titre de la langue nationale.
C'est également dans une perspective historique et plus particulièrement en étudiant les activités de 1 Accademia d'Italia que Sergio Raffaelli aborde les vicissitudes des néologismes. L'Académie, dont l'activité se déroula entre 1926 et 1943, avait été constituée pour « la préservation et la conservation » de l'italien et avait pour tâche l'élaboration de dictionnaires On retrouve parmi ses membres Alfredo Panzini qui, grâce à l'autorité dont il jouissait en tant que lexicographe, en influença largement les travaux et les décisions. Réglementer l'usage de la langue faisait partie des prérogatives du régime en place (ce qui explique la méfiance actuelle des Italiens à l'égard de toute intervention venant du haut dans ce domaine) qui, d'une part, entendait en préserver la pureté, mais, d'autre part, en appelait à la modernité. Ce qui frappe, dans tous les documents préparatoires ou les déclarations officielles, c'est l'absence de critères généraux rigoureux pour l'acceptation ou le refus de tel ou tel mot, étranger ou non, et pour la création de termes nouveaux. On perçoit une oscillation constante entre une volonté conservatrice, attachée à l'italianité de la langue et donc fermée à tout apport de l'étranger et un souci d'efficacité. L'incertitude méthodologique due à la fragilité des principes de base et à l'hétérogénéité des informations conduisit à des solutions non systématiques, à des choix au cas par cas. Il est intéressant de constater que les débats concernant, entre autres, l'introduction, l'adaptation ou la substitution de vocables étrangers ne sont pas très éloignés de ceux que l'on rencontre aujourd'hui dans certaines communautés linguistiques. Ainsi, on peut proposer tassi (naturalisation de "taxi" au moyen de deux s et un accent), mais, peut-on lire dans une déclaration, « sport, tram, stop, auto, film etc. peuvent être acceptés sans italiques ni s pour former le pluriel. Au moins, ces petits mots brefs serviront de contrepoids à certains néologismes horriblement longs et difficiles de notre production ». À côté de cela des propositions d'adaptation graphique comme caucciù (pour « caoutchouc ») sont passées dans l'usage courant. Mais c'est la substitution (comme pagologia pour « folklore ») qui semble avoir eu le moins de succès. Peut-on affirmer qu'elles ont disparu en même temps que le régime qui les avait inspirées ? Pour Raffaelli la question reste ouverte.
Bernard Quemada choisit d'interpréter la question posée en titre Che fine fanno i neologismi ? (littéralement « que deviennent les néologismes ? ») en « À quoi servent les néologismes ? ». Malgré l'intérêt porté aux néologismes au cours du dernier demi-siècle, le statut scientifique de la néologie reste fragile et la discipline peine à trouver son autonomie au sein de la lexicologie et par rapport à la terminologie scientifique et technique. Ceci est probablement dû en partie au caractère empirique de l'identification des néologismes qui s'appuie essentiellement « sur le sentiment néologique des chercheurs engagés dans la chasse aux premières attestations ». Toutefois le développement de logiciels spéciaux permettant un repérage automatique dans des corpus représentatifs ouvre des perspectives intéressantes. Comment et pourquoi forge-t-on des mots nouveaux ?Leur création peut être soit spontanée ou naturelle, soit volontaire ou dirigée et doit satisfaire à des conditions bien précises pour avoir des chances de s'implanter dans la langue
exploiter les ressources du code, être bref, favoriser la fécondité, privilégier un
221
caractère imagé, etc. Quant à leurs finalités, elles sont de trois ordres :idéologiques, linguistiques et esthétiques. Les premières visent à construire une certaine image de la langue et à en préserver les qualités que la société lui attribue. Les deuxièmes, d'une part, trouvent des applications en lexicologie puisque l'étude des néologismes permet d'établir une typologie et de fournir aux normalisateurs des modèles à forte acceptabilité, d'autre part, alimentent la production dictionnairique soucieuse d'enregistrer le plus grand nombre possible de mots nouveaux Enfin les inventions à caractère ludique sont largement exploitées en littérature mais aussi, de plus en plus, dans le domaine de la publicité. Il est clair que, face à une tradition puriste et à une conception centralisatrice et normative de la langue bien ancrée en France, Quemada se pose en partisan résolu de la néologie, moteur et gage d'avenir pour la langue, tout en précisant que « son statut demande pourtant à être encore affermi, ses objectifs mieux définis, ses stratégies linguistiques et extralinguistiques mieux assurées ».
La démarche de Tullio De Mauro prend le contre-pied de la question posée et se demande où naissent les néologismes. Ce qui peut apparaître comme une boutade, « tous les mots naissent comme néologismes » , souligne le caractère relatif de la notion de néologie toujours liée à une époque donnée et pose le problème de l'obsolescence (signalons au passage que Littré enregistre l'adjectif obsolète accompagné de la mention « néologisme » !). De Mauro considère lui aussi que la production de néologismes relève de la physiologie linguistique et non de la pathologie et offre un bel exemple d'innovation linguistique avec neosemie, désignant par là les nouveaux sens qu'acquièrent les mots au cours de leur histoire.
Mais que reste-t-il de ce foisonnement d'innovations et de créations ? Beaucoup sont éphémères et ne vivent qu'une saison. Vittorio Coletti dans Un secolo di parole mancate s'intéresse à ce qu'il nomme les mots perdus, les occasions manquées, les morts-nés, les faux départs. Si on laisse de côté la production littéraire et poétique, ce sont les domaines de la politique et des faits de société qui sont sans doute les plus productifs, mais aussi ceux où les vies sont les plus brèves ! Formés à partir de noms propres, la plupart vite oubliés, d'habitudes des classes dirigeantes souvent tournées en dérision ou de phénomènes de société temporaires, beaucoup de créations ne franchissent même pas le cap d'une édition de dictionnaire Rappelons que le système des suffixes particulièrement riche de la langue italienne et les nombreuses possibilités combinatoires se prêtent à des productions souvent colorées et très efficaces. Beaucoup de créations ont été lancées comme des ballons d'essai et auraient pu s'implanter dans la langue puisque les phénomènes qui les ont engendrées sont encore d'actualité, tels corridoista (de corridoio, « couloir », pour désigner ceux qui bavardent dans les couloirs au lieu de travailler) ou espressista (de espresso, le café express, en référence aux grands consommateurs de café au bar), bestsellerizzare (fabriquer un bestseller), riminizzare (de la ville de Rimini symbole en Italie de la spéculation immobilière), etc. Pourtant ils n'apparaissent maintenant que comme des curiosités. Ce qui fait conclure à Coletti que le sort des néologismes est impossible à prévoir.
Manuel Alvar Ezquerra, pour sa part, traque depuis des années la présence de mots nouveaux dans la presse écrite espagnole qui, dit-il, constitue le catalyseur et la vitrine idéale de differents types de langue dans les contextes les plus variés politique, économie, sport, sciences, techniques, loisirs, etc. L'observation suivie de ce matériel lui permet de déceler les procédés les plus prolifiques dans la formation
222 des néologismes. Il est intéressant de constater —comme on le voit dans la contribution qui clôt le volume— que les procédés qu'il décrit sont également ceux qui sont les plus productifs dans les autres langues considérées au cours du Colloque. Ainsi, pour n'en citer que quelques uns, la dérivation, à l'aide de suffixes à partir de substantifs, de verbes, d'adjectifs et de noms propres ; la composition qui utilise en abondance des préfixes étroitement liés au monde qui nous entoure comme auto, ciber, eco, euro, tecno, video, web etc. ;les emprunts de l'anglais, du français, de l'italien, du japonais, du russe, de l'arabe, eux aussi, dictés par l'actualité.
Dans le dernier article du volume Tendenze nella formazione di parole nuove dalla stampa italiana contemporanea G. Adamo et V. Della Valle exposent à leur tour quelques-uns des phénomènes qui, au vu des dépouillements massifs qu'ils effectuent depuis des années, illustrent les tendances les plus représentatives dans la formation des néologismes italiens actuels. L'ajout d'affixes, et en particulier du préfixe anti- non seulement devant les adjectifs mais aussi précédant des substantifs et même des noms propres, apparaît particulièrement productif. De même les suffixes -oso et -aro continuent de donner naissance à de nombreux termes le plus souvent péjoratifs tels dolcevitoso (qui s'adonne à la « dolcevita ») ou manoscrittaro (qui envoie son manuscrit aux maisons d'édition dans l'espoir de se voir publier). Les mots composés connaissent également une grande vogue. La cherté de la vie se faisant de plus en plus sentir aussi en Italie, l'adjectif taro a servi à former une cinquantaine de néologismes enregistrés depuis 1998. Ce sont, entre autres, le caro- affitto (l'augmentation des loyers), le taro-benzina (l'augmentation de l'essence), le taro-ombrellone (l'augmentation de la location du parasol sur la plage), le caro- tazzina (l'augmentation du prix du café express au bar), etc. Beaucoup de ces néologismes ne seront sans doute pas appelés à survivre et iront grossir le lot de ce que les auteurs appellent, à la suite de Bruno Migliorini, les « néologismes capricieux ». Les emprunts et les calques de l'anglais constituent bien sûr une partie importante des nouvelles formations :l'adjectif etico (éthique) caractérise désormais un large éventail de produits et d'activités (finanza etica, tassa etica, etc.). Certains calques formels s'insèrent si parfaitement dans la langue d'accueil qu'ils ne sont généralement pas perçus comme tels : c'est le cas par exemple de discriminazione positiva (qui, on le sait, connaît également en français un grand succès) de l'anglais « positive discrimination ». Quant aux calques du français comme la sinistra al caviale (littéralement « la gauche au caviar »), ils sont beaucoup moins nombreux et conservent un caractère élitiste.
Si, au bout du compte, la question posée dans le titre ne trouve pas de réelle réponse, l'ensemble des contributions témoigne d'une tonicité de nos langues, bien loin de la décadence à laquelle certains esprits chagrins voudraient nous faire croire.
Michèle FOURMENT-BERNI CANAIVI
223 BERTRAND Olivier (2004), Du vocabulaire religieux à la théorie politique en France au XIVe siècle :Les néologismes chez les traducteurs de Charles V, Connaissances et Savoirs, 442 p.- ISBN 2-7539-0017-5.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire... L'ouvrage d'Olivier Bertrand, publié en 2004, Du vocabulaire religieux à la théorie politique en France au XIVe siècle : Les néologismes chez les traducteurs de Charles V, ne semble pas avoir trouvé auprès des linguistes une réception aussi large qu'il le méritait. L'une des raisons qui l'ont maintenu jusqu'à présent un peu à l'écart est sans doute l'originalité du champ scientifique. Le double champ disciplinaire dans lequel il s'inscrit, relevant de la linguistique et de l'histoire, constitue en effet un domaine encore trop peu exploré. Rappelons toutefois le premier ouvrage consacré au lexicographe Maurice Lachâtre', publié à la suite d'un colloque organisé par François Gaudin et l'université de Rouen et qui réunissait, en 2003, de manière novatrice et fructueuse, historiens et linguistes.
Reposant sur un travail imposant et érudit dans les deux domaines scientifiques, l'ouvrage d'Olivier Bertrand nous permet de suivre pas à pas un phénomène d'émergence néologique : il devrait faire référence dans la littérature et les recherches sur cet ample sujet. Olivier Bertrand, alors maître de conférences à l'École Polytechnique et chercheur au laboratoire CNRS/ATII,F, conduit ses recherches en lexicologie historique, s'intéressant plus précisément à l'évolution sémantique du lexique politique français.
L'objectif de cette recherche est clairement défini : « comprendre de quelle manière s'est formé un lexique spécialisé —celui de la théorie politique — en français pendant une période donnée —celle du règne de Charles V ». Le XIVe siècle marque en effet une frontière importante dans l'évolution de la langue : il s'est attaché à traduire sans relâche les oeuvres qui appartiennent à la conscience collective et représentent en quelque sorte le patrimoine culturel de l'humanité, jusqu'alors réservé à une élite intellectuelle. L'utilisation de la langue vernaculaire, amorcée dès le XIIIe siècle mais avec une nette accélération au XIVe siècle pour rendre accessibles des domaines réservés jusqu'alors au latin (oeuvres de philosophie, de philosophie politique, de théologie notamment), à la demande des monarques Jean le Bon (1350-1364) et surtout Charles V (1364-1380), oblige les translateurs à créer un nombre très important de néologismes. Cette activité néologique s'inscrit dans un contexte très particulier puisqu'il s'agit pour les traducteurs « d'offrir à leurs lecteurs et d'introduire dans la langue un lexème nouveau qu'il faudra bien comprendre pour que les textes français soient intelligibles. »C'est précisément à cette période qu'émerge et se développe le lexique de la science politique, qu'il est nécessaire, pour en permettre la compréhension, de ne pas dissocier de l'histoire des conceptions religieuses qui en a influencé la constitution.
Pour étudier la constitution de ce lexique particulier, Olivier Bertrand « [évalue] les différents procédés de formation du vocabulaire français de la science politique durant la période du règne de Charles V et la mise en évidence de
1 Le monde perdu de Maurice Lachâtre (1814-1900) : actes du colloque organisé paz François GAUDIN et Yannick MAREC, laboratoires DYALANG (UMR 6065 du CNRS) et GRHIS Maison de l'Université, Université de Rouen 16 et 17 septembre 2003, Paris, Honoré Champion, 2006.
224 l'influence des conceptions religieuses sur les théories politiques » .Mais, au-delà de cette approche que l'on pourrait qualifier de « microlinguistique », l'auteur vise un enjeu linguistique plus ambitieux, adoptant alors une démarche « macrolinguistique », pour reprendre ici sa terminologie : « cerner les enjeux de toute création lexicale dans une langue et [d'] en prévoir (ou non) les régularités ainsi [qu'] évaluer le degré de prédictibilité (ou non) de l'intégration d'un néologisme dans le lexique ». Ce processus même de lexicalisation sera traité dans la dernière partie de l'étude.Pour mener à bien cette analyse, Olivier Bertrand a choisi un corpus restreint dont il définit très précisément la justification et les caractéristiques. Deux séries de préoccupations ont guidé l'auteur dans son choix : d'une part la délimitation géographique et culturelle (la Cour de Charles V), ainsi que chronologique de ce vocabulaire (entre 1364 et 1380), d'autre part des considérations d'ordre historique
l'influence des conceptions religieuses. Le corpus est composé essentiellement de deux textes des premiers grands traducteurs : la première traduction en français, par Raoul de Presles, du De Civitate Dei de saint Augustin et la première traduction en français, par Denis Foulechat, du Policraticus de Jean de Salisbury. Ces deux oeuvres, très différentes par leur origine et leur date, ont comme points communs d'avoir été traduites au même moment, entre 1371 et 1375, et d'être toutes deux porteuses d'une problématique unique, la suprématie du pouvoir spirituel du pape sur le pouvoir temporel des rois. À ce corpus s'ajoute la traduction des Politiques d'Aristote par Nicole Oresme.
Afin d'évaluer avec une extrême précision et une réelle rigueur scientifique l'influence du vocabulaire religieux dans la théorisation politique, l'auteur a sélectionné dans ce corpus cinquante-trois lexèmes —essentiellement des verbes et des substantifs auxquels s'ajoutent quelques adjectifs —autour de notions conceptuelles telles que l'honneur, la vertu, la faute, le pouvoir. Il ne s'agit donc pas d'un recensement exhaustif, mais d'un échantillon représentatif qui va permettre d'évaluer l'influence des concepts qu'ils véhiculent sur les idées politiques de l'époque. L'auteur, dans une longue et bien utile introduction (p. 23-67), précise le contexte historique et l'évolution de ce vocabulaire, depuis l'Antiquité tardive où le christianisme s'impose peu à peu comme religion d'État : en effet « les traductions du XIVe siècle ne peuvent être compréhensibles qu'avec la connaissance de la pensée même générée par les textes originels des Pères de l'Église tout autant que par ceux des penseurs —souvent ecclésiastiques d'ailleurs —qui luttèrent contre la suprématie de l'Église sur les affaires publiques de l'État. »
Partant donc du postulat que « l'évolution sémantique du lexique latin sous l'influence du vocabulaire religieux dans le domaine politique a donné naissance, parmi d'autres, à un nouveau lexique français de la théorie politique dans les traductions vernaculaires du XIVe siècle », Olivier Bertrand organise son ouvrage en quatre parties. La première (« Vocabulaire religieux et enjeux politiques au XIVe siècle :évolution sémantique », p. 69-148), établit que la naissance de ces lexèmes correspond au passage du latin tardif au latin médiéval et qu'il com~ai~ une évolution sémantique dans les domaines religieux et politique ;les néologismes du XIVe siècle intègrent le sémantigme des mots latins ainsi obtenus. La question que se propose ici de résoudre l'auteur est de savoir « comment les néologismes français de la science politique intègrent le sémantigme des mots latins affectés par l'intrusion de la religion dans le champ politique ». La deuxième partie (« Étude
225 paradigmatique de la néologie lexicale : la création du mot », p. 151-222) analyse la formation morphologique des néologismes ainsi créés et qui sont en voie de lexicalisation, en distinguant la néologie formelle, qui crée un nouveau signe (dérivation et composition, emprunt) et la néologie sémantique, qui donne une acception nouvelle à une unité lexicale déjà existante (transfert et extension du sens). Dans la troisième partie (« Étude syntagmatique de la néologie lexicale : la mise en phrase du mot », p. 225-265), est analysée la phase d'intégration du lexique à travers les procédés utilisés par les traducteurs pour faire comprendre ces néologismes (gloses périphrastiques, doublets synonymiques) ainsi que le recours à la compétence linguistique des lecteurs. Enfin, la dernière et quatrième partie est consacrée à une étude diachronique des phénomènes de « Néologisme, vulgarisation et lexicalisation » (p. 267-364), dans laquelle l'auteur retrace le destin des néologismes apparus à la fin du XIVe siècle, étape qui va lui permettre d'élaborer une synthèse théorique de la lexicalisation en prenant soin de la distinguer de la grammaticalisation, analysant les étapes de la lexicalisation, sémantique et formelle, ainsi que les types de lexicalisation, institutionnelle (le dictionnaire) vs populaire. Sur les cinquante-trois lexèmes sélectionnés dans le corpus, onze, « néologismes éphémères », ne survivront pas (certaineté, irrétractable, bienheureté...) et n'entreront jamais dans le dictionnaire Les autres, trente-huit, finiront par trouver leur place dans le lexique, huit en trouvant un ancrage sémantique (commixtion, condigne, confutation...) et trente avec un élargissement lexical (abstraction, champion, coherence, college...), ce que n'indique pas une erreur d'intitulé dans le tableau de la page 311. Un index alphabétique des lexèmes du corpus et des notions (p. 411-415) ainsi qu'une bibliographie très riche (p. 419-442) complètent cette excellente publication qui devra faire date et être intégrée dans toute réflexion sur la néologie. Les traductions françaises du XIVe siècle constituent un terrain de recherche et d'édition encore relativement peu exploré, mais dont l'apport nous apparaît aujourd'hui, grâce aux travaux d'Olivier Bertrand, incontestable. Nous ne pouvons que souhaiter avec lui le développement d'une « recherche théorique plus approfondie sur la lexicalisation [qui] permettra peut-être de définir avec plus de nuances la formation d'un lexique en général à travers les siècles, ses évolutions et ses constantes. »Gageons qu'il a déjà suscité et continuera à susciter des vocations qui prendront appui sur des fondements maintenant solidement posés.
Christine JACQUET-PFAU (Collège de France)
CHANG, Youngick (2005), Anglizismen in der deutschen Fachsprache der Computertechnik. Franl~ort. Peter Lang. 201 p. Série 21, linguistique. Vol. 280.
En Allemagne, les études sur les emprunts fournissent des sujets de thèses et de dissertations, souvent préparées par des étrangers qui poursuivent des recherches doctorales en Europe. C'est le cas du présent ouvrage, issu d'une thèse soutenue à l'Université de Bochum, qui est connue entre autres pour les recherches sur les internationalismes, auxquelles l'auteur fait d'ailleurs allusion. Il porte sur les
226 anglicismes relevés dans des textes informatiques allemands de la fin des années
1990.
L'étude présente de nombreuses qualités, dont le choix du sujet : en effet, l'informatique a déjà fait l'objet de plusieurs enquêtes en matière d'anglicisation en allemand comme en français, et il est intéressant de pouvoir comparer les résultats et de constater des évolutions. En outre, le corpus qui constitue le point de départ de la thèse est à la fois homogène et représentatif :homogène dans la mesure où il s'agit d'articles tirés d'une même revue qui vise un lectorat de spécialistes (il ne s'agit donc pas a priori de discours de vulgarisation) et représentatif puisque la revue en question (qui a pour titre c't) serait une publication de référence au sein de la communauté des informaticiens allemands.
Le lecteur francophone appréciera particulièrement la première partie qui présente de façon détaillée l'état de la question en matière d'études d'emprunts surtout dans le domaine de l'informatique. Ilrelèvera en particulier l'étude de Liang de 1985 sur les anglicismes dans l'allemand de l'informatique, qui est solide d'un point de vue méthodologique et qui sert de point d'appui pour la comparaison des évolutions, ainsi que deux études comparatives portant sur le français aussi bien que sur l'allemand. Celle de Kaltz (1988) constate un bien plus fort taux d'anglicisation en allemand qu'en français, grâce aux efforts d'aménagement linguistique ;ces conclusions sont un peu nuancées par l'étude de Seebald (1992), quoique cette dernière ne porte que sur le français. En termes plus généraux, on constate en allemand comme en français que l'avènement de la micro-informatique a accéléré le mouvement vers la germanisation dans un cas, vers la francisation dans l'autre, mais l'appui d'une politique linguistique semble porter ses fruits. Il semble par ailleurs que le taux d'anglicisation soit en assez forte augmentation dans l'allemand de l'informatique :l'auteur attribue cette augmentation à une tendance encore plus forte à employer des sigles, presque tous de langue anglaise, mais il constate également que les auteurs renoncent bien souvent à rechercher l'équivalent allemand d'un terme anglais.
La présentation de la méthode comme celle des résultats est bien systématique : on apprécie à ce titre les organigrammes, qui indiquent, par exemple,
d'une forme qui n'aurait pas subi l'influence de l'anglais. Mais il serait erroné de conclure que le découpage de la détermination des critères en étapes discrètes résolve le problème de la typologie d'un phénomène qui est souvent plus scalaire que discret, et il est dommage que l'auteur ne fasse pas part de difficultés de classement qu'il aurait rencontrées et qui auraient éclairé le processus qu'il souhaite décrire. L'étude aurait bénéficié d'une discussion en plus d'une exposition. Quant aux résultats, le lecteur francophone reste sur sa faim, même si certains aspects sont bien traités : les questions d'orthographe, de siglaison, de morphèmes de liaison, d'attribution de genre pour les substantifs et surtout la typologie exhaustive des types de composés. L'auteur présente bien les classes d'emprunts, munies de statistiques, et réalise de ce point de vue un portrait partiel du vocabulaire anglicisé de l'informatique en allemand. Mais il est dommage de ne jamais comparer les concurrents dans le détail, et de ne pas expliquer au lecteur si tel ou tel anglicisme intégral est plus ou moins courant que son équivalent allemand. Quelques trop rares exemples d'analyse textuelle mettent l'eau à la bouche : on nous dit par exemple que tel ou tel terme anglais est cité entre parenthèses pour expliquer une traduction qui
227 est employée dans le texte, mais on ne nous dit pas si, dans le reste de l'article, c'est l'emprunt direct ou son équivalent allemand (qu'il appelle pseudo-natij~ qui est employé, et on ne dispose pas de statistiques sur les pourcentages de ce terme dans le reste du corpus. On a du mal par ailleurs à savoir si les emprunts directs se comportent différemment des pseudo-natifs ou si les emprunts directs influencent la morphologie lexicale en général.
On peut s'interroger par ailleurs sur certains choix éditoriaux :pourquoi, par exemple, répéter la bibliographie du corpus dans le corps de l'ouvrage, comme celle des ouvrages d'informatique consultés, lorsque ceux-ci figurent également dans la bibliographie générale. De même, les tableaux de statistiques des types d'emprunts relevés apportent relativement peu et aurait pu être remplacés par une discussion des résultats. Pour une thèse de linguistique de corpus, on peut également se demander si la référence (par ailleurs tout à fait justifiée) à L. Hoffmann suffit pour en étayer les bases méthodologiques.
Malgré ces critiques relatives à une limite de la portée de cette recherche — qui s'inscrit dans une problématique étrangère à celle de l'aménagement linguistique, vis-à-vis de laquelle les germanophones restent au mieux sceptiques — on doit saluer un travail qui permet de mesurer l'évolution de l'anglais dans un domaine spécialisé.
John HUMBLEY Paris 7, LDI
CISLARU Georgia, GUERIN Olivia, MORIN Katia, NEE Emilie, PAGNIER Thierry, VENIARD Marie (eds.), L'acte de nommer. Une dynamique entre langue et discours, Presses de la Sorbonne Nouvelle (PSN), 2007, Paris, 237 p.
Cet ouvrage présente une synthèse de travaux récents menés sur la
nomination par deux équipes de recherches appartenant respectivement à l'EA SYLED (Systèmes Linguistiques, Enonciation et Discursivité) de l'Université Paris III Sorbonne Nouvelle, à laquelle sont affiliés les coordinateurs précités, l'autre à l'UMR Praxiling de L'Université Paul Valéry (Montpellier III), pour qui la nomination représente depuis longtemps un champ important dans le paysage de la Praxématique.
L'axe général de réflexion retenu par les coordinateurs consiste à envisager la nomination comme une procédure d'assignation référentielle à l'interface entre lexique et discours. De ce fait elle est instituée contre la dénomination, impartie au seul lexique et contre une forme de variation qui serait nécessairement imputable au vocable (unité de discours dont le statut lexical est dépourvu de pertinence) qui ne constitue pas dans une telle perspective un objet de recherche en soi. Les travaux collectés dans le recueil s'inscrivent dans une tradition commune à la Praxématique (Paul Siblot) et à l'Analyse du discours à entrée lexicale telle qu'elle a pu être menée par le CEDISCOR sous l'impulsion de Marie-Françoise Mortureux, Geneviève Petiot et Sophie Moirand. Elle s'oppose également à une lexicologie et à une lexicographie décontextualisées, tout comme à des analyses discursives ignorant le poids du lexique dans les stratégies argumentatives. En perspective, le langage est
228 replacé entre l'homme et la société, comme agent d'interaction et de persuasion toute mise en verbe procède d'une stratégie et les manières de nommer les êtres, les choses, les situations, les actes, les qualités etc. n'est pas transparente mais procède de prérequis inscrits dans l'histoire. Ce sont eux que les auteurs cherchent à débusquer, à expliciter pour restituer au discours son opacité lexicale, condition de son faire.
Après une introduction de Paul Siblot consacrée à« l'importance du point de vue dans la nomination et la composante déictique des catégories lexicales » l'ouvrage se répartit en trois parties, abordant chacun un des aspects de la problématique
- Formes de nomination en situation provoquée
- Pratiques dénominatives et enjeux politiques et commerciaux
- Nommer des objets sociaux
La première partie regroupe des contributions relatives au traitement de certaines formes d'aphasie (Thi Mai Tran :Problèmes de dénomination et relations dénominatives : l'exemple de l'aphasie), et à des nominations provoquées lors d'enquêtes de satisfaction auprès d'usagers (Gaëlle Delepaut, Danièle Dubois, Myriam Mzali et Sylvie Guerrand :Dénominations et représentations sémantiques du trajet en train). Ces deux recherches s'appuient sur la partition établie par G. HIeiber en 1984 (voir plus bas) entre dénomination et désignation. T. M. Tran s'intéresse à la question du « manque du mot » et compare la configuration que cette situation revêt chez un locuteur ordinaire et chez un sujet atteint d'aphasie auquel des tâches de dénomination sont proposées dans le cadre d'un suivi de remédiation. L'auteure dresse une typologie des procédures et des mécanismes mis en place par le patient dans ce qui s'avère être une véritable quête lexicale du nom et un ajustement parfois désespéré de la visée référentielle. G. Delepaut, D. Dubois, M. Mzali et S. Guerrand analysant des enquêtes de satisfaction menées par la SNCF auprès de ses usagers, remarquent l'existence d'un partage fonctionnel inattendu entre dénomination et désignation :lorsque les usagers expriment leur satisfaction, ils ont préférentiellement recours à des procédures dénominatives, c'est-à-dire convoquent des items lexicalisés et les emploient conformément à leur valeur dénominative. En revanche, lorsqu'ils expriment un mécontentement, ces mêmes locuteurs ont tendance à privilégier la désignation, à avoir recours à des formules grammaticalisées, àdes périphrases et à ne pas recourir à la dénomination pour assurer la visée référentielle. De ce fait apparais un usage inédit, imprévisible et injustifiable linguistiquement de la dénomination, qui sert à exprimer des jugements positifs et de la désignation, qui se voit impartie aux jugements négatifs. Les auteures émettent l'hypothèse que les jugements positifs sont perçus par les locuteurs comme moins porteurs de subjectivité et justifient donc un recours préférentiel à des catégorisations dénominatives. Les jugements négatifs sont perçus comme impliquant davantage la subjectivité et s'accommoderaient préférentiellement d'une visée grammaticalisée, signalétique dans sa construction même de l'élaboration d'un point de vue.
La seconde partie est consacrée aux enjeux politiques et commerciaux de la dénomination. Ainsi sont abordés respectivement : la valeur sémantique du nom propre prototypique dans sa relation avec son correspondant le nom de marque déposée (Bénédicte Laurent et Montserrat Rangel Vicente), les questions relatives à la dénomination des couleurs dans l'industrie des cosmétiques (Céline Caumon) et
229
les pratiques de redénomination des rues à Vitrolles durant la municipalité MNR (Jeanne Gonac'h). Après avoir relevé la difficulté représentée par le champ des couleurs tant pour l'établissement de la catégorisation référentielle, pour la définition lexicale que pour la dénomination, C. Caumon insiste sur la dimension éminemment culturelle de la perception et de l'expression des couleurs ainsi que sur les contraintes que cette caractéristique implique dans le domaine commercial. De fait, des références culturelles doivent être recherchées par les créateurs publicitaires afin non pas tant de dénommer et d'assurer une visée référentielle dépourvue de toute ambiguïté, qu'au contraire de suggérer des valeurs au sein de l'imaginaire du consommateur en fonction de représentations communes à une cible commerciale prédéfinie. La dénomination se voit ainsi détournée de sa fonction linguistique première pour ne plus être qu'un vecteur culturel de suggestions à visée perlocutoire, puisque sa finalité, à l'instar de celle du discours publicitaire, est de conduire le client à l'achat. Elle partage cette propriété avec le nom de marque déposée :tous deux n'ont pas pour objet de subsumer des propriétés référentielles mais de construire des configurations à l'intérieur d'un univers culturel dans lequel ils invitent le consommateur à se projeter. La dénomination ici fait appel à une mémoire discursive, mais aussi à une mémoire lexicale : les dénominations sont retenues du fait qu'elles disposent d'une charge mémorielle, qu'elles gardent en elles-mêmes la trace des conditions de leur production. Les convoquer consiste alors à raviver cette mémoire ainsi que la connotation qu'elle imprime à la dénomination. L'analyse de la séquence Rose Lolita par l'auteure est à cet égard convaincante. Dans une perspective très proche J. Gonac'h étudie les redénominations de certaines rues à Vitrolles pendant les années où la municipalité a été assurée par l'extrême- droite. Après avoir précisé la cadre juridique des dénominations de voies et lieux publics et celles des changements de dénominations, J. Gonac'h se livre à une enquête de terrain au cours de laquelle elle montre comment des dénominations instanciant des noms de défenseurs des droits de l'homme, de militants contre la ségrégation ou tout simplement de personnalités non françaises ont été l'objet d'une forme de censure. Centralement c'est la signification du nom propre qui est mise en cause en ce qu'elle ne s'articule pas sur un concept structuré de propriétés critériales, mais sur des valeurs culturelles et variables (cf. entre autres Kripke 1972). L'exemple choisi par l'auteure et l'analyse qu'elle en produit montrent qu'à ces déterminations s'y ajoute, en contexte politique, un réinvestissement produit par un univers discursif, lequel active des facettes spécifiques qu'il construit lui-même, notamment
« être un étranger », « être de gauche »... (p. ex. Savador Allende, Nelson Mandela, Martin Luther King) assorties d'un coefficient négatif dans l'idéologie de l'extrême-droite ;
« être français », « être provençal »... (p.ex. Marseille, Marguerite de Provence, cabasson, cantonnier, tambourinaire), même remarque, mais du côté du positif.
Le choix des redénominations montre que la renégociation sémantique n'affecte pas que les noms propres, elle concerne également les noms communs, lesquels se voient dénommer en fonction non pas de leurs propriétés référentielles, mais de la charge connotative que crée leur inscription dans un discours politique spécifique.
230
La troisième partie est consacrée à la dimension polémique et argumentai de la dénomination. Il ne nous est pas possible ici de détailler l'ensemble des contributions qu'il regroupe. Deux retiendront particulièrement l'attention, consacrées respectivement aux questions relatives à la dénomination du voile islamique dans la polémique qui a accompagné la loi sur le port de signes religieux dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire. L'autre s'intéresse à la recatégorisation opérée dans le discours colonial en passant de la notion de progrès civilisateur à celle de développement. Laura Cabresse (« Quels objets de discours se dissimulent sous la dénomination le voile ? ») inscrit son étude dans la continuation de celles menées il y a quelques années par Geneviève Petiot (notamment 1995) sur le même sujet. L'étude porte sur un phénomène de polydénomination (dénomination d'une même entité par plusieurs unités lexicales concurrentes, ici voile, foulard, hidjeb, tchador) et adopte donc une perspective onomasiologique. L'analyse du corpus révèle qu'en synchronie et sous la poussée d'événements moteurs (p. ex. la loi précitée) la polydénomination tend à se résorber et des zones de stabilité à appara ?tre, limitant ainsi le paradigme des candidats. Si tchador et hidjeb ont disparu, voile et foulard se sont maintenus avec une prééminence nette pour le premier. Tous les coréférentiels stabilisés ne sont donc pas sémiotiquement identiques, mais comportent à des degrés divers des zones de fragilité. Sur un plan plus sémasiologique, l'auteure note que l'emploi de voile autorise des jeux de mots où verbe (voiler) et nom (voile) se sémantisent au point de charger le second de valeurs sociopolitiques et de faire de lui par métonymie l'emblème de la pratique religieuse musulmane. Le mot se voit ainsi chargé d'une force évocatrice importante, qu'il doit aux conditions de sa circulation discursive. Cette force d'évocation en fait un mot-événement au sens de Moirand (2007) : il renvoie à un événement et « sert de déclencheur mémoriel de ce qu'on sait, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a retenu de cet événement » (ibid.). Dans le cadre théorique de la Praxématique, Françoise Dufour s'intéresse, elle aussi dans un aller et retour entre onomasiologie et sémasiologie, au glissement opéré par les discours colonialistes et néocolonialistes entre progrès civilisateur et développement. Ici encore, une étude diachronique, montre que l'appellation n'est pas innocente et que le glissement terminologique opéré ces dernières décennies n'est qu'un artifice qui vise à proposer un habillage différent pour une réalité que l'on cherche à travestir afin d'en atténuer l'identité. Plus fondamentalement l'étude proposée interroge la permanence (ou non) de la référence malgré sa prise en charge par des dénominations différentes et le niveau de sa détermination (le réel etralinguistique ou sa conceptualisation par le lexique) : en l'occurrence le parti pris par l'auteure est celui de la permanence malgré les différences de valeurs sémantiques et de référence imparties aux deux items (progrès civilisateur et développement). Sur un plan linguistique et lexical rien n'autorise a priori un tel rapprochement. Toutefois, ici encore, la mise en regard des énoncés du corpus tend à accréditer la thèse de la variation (les deux expressions ne sont que des variables indexées différemment et différentiellement). Toutefois la question reste posée (cf. plus bas) de savoir si l'on doit où non distinguer ce qui ressortit au lexical de ce qui appartient en propre à l'instanciation discursive.
L'ouvrage se clôt sur deux contributions isolées : l'une de R. Huygue (Qu'appelle-t-on un lieu ?) dans une rubrique « Contrepoint », et celle de Sandrine Reboul-Toure (« Dénomination » en discours : un terrain métalinguistique).
231
R. Huygue s'intéresse à la valeur dénominative de trois items :lieu, place et endroit. Une analyse distributionnelle démontre que les trois unités ne se comportent pas de manière identique. Partant du constat qu'il n'existe pas de continuité ontologique des lieux aux choses, du moins tels que sont traitées dans la langue les unités qui y renvoient, l'auteur aboutit au constat que ces trois termes ne dénomment pas mais fonctionnent comme des désignateurs qui disposent d'un sens localisateur. Ils « désignent des objets du monde, en les présentant comme supports dans des relations de localisation, potentielles ou actuelles ». Loin de constituer les étiquettes stables et récurrentes d'un certain nombre de référents, ces unités exprimeraient un point de vue et auraient donc à cet égard une valeur prédicative. S. Reboul-Toure propose quant à elle une forme de synthèse de l'ouvrage en revenant sur les différentes acceptions du concept de dénomination dans l'histoire à partir du XVIIie siècle. La conclusion à laquelle elle aboutit fournit un point d'appui fort utile à la discussion sur la pertinence d'une partition entre nomination et dénomination.
En effet, S. Reboul-Toure, dont les travaux sur la désignation (notamment les paradigmes désignationnels) sont connus, remarque que le choix du terme nomination dans un certain nombre des contributions de l'ouvrage semble procéder davantage d'un souci de cohérence à l'intérieur d'un appareil théorique que de l'observation réelle de comportements linguistiques. En effet, contrairement à ce qui est parfois soutenu, le parti d'opter pour (la nomination et pour) nomination, qui disposerait seule d'une interprétation processuelle, contre la dénomination (et dénomination), qui serait résultative ne se justifie pas d'un point de vue linguistique. Nomination et dénomination, comme tous les noms en —tion du français, sont susceptibles de recevoir aussi bien une interprétation processuelle que résultative. Nier le fait reviendrait à contredire une propriété impartie à la morphologie de la langue. Un autre axe de partage est également dessiné entre les deux concepts : la nomination serait davantage d'application discursive, la dénomination restant adossée à une propriété lexicale. Ce second partage présente l'intérêt indéniable de conduire à une hiérarchisation des unités qui dès lors ne sont plus considérés comme cohyponymes, mais intégrées à une relation de subordination. Si l'on admet que la dénomination est une procédure (un acte) d'assignation qui associe une unité lexicalisée à un segment de réalité, force est de reconnaître que la nomination, qui ne com~ai~ pas les mêmes contraintes au regard du lexique, est une procédure superordonnée qui consiste à assigner un nom, que celui-là soit ou non lexicalisé, à un segment de réalité. À titre d'exemple, la néologie est exclue par définition du champ de la dénomination mais certainement pas de celui de la nomination, à la réalisation duquel elle participe centralement. À ce titre, la nomination restera plus proche de pratiques discursives que la dénomination, qui impliquera en supplément la prise en compte de la stabilisation lexicosémantique des unités de la langue.
Nous ajouterons deux observations, qui s'imposent à l'évidence à la lecture des articles regroupés dans l'ouvrage
- les auteurs réalisent diversement ces deux axes de partage. Chez certains, les concepts de dénomination et de nomination demeurent fréquemment synonymes et entrent davantage en relation de variantes stylistiques que d'opposition sémantique et référentielle. De la sorte, dans certaines contributions, il ne semble pas qu'une spécificité de la nomination sur la dénomination (ou sur toute autre pratique référentielle) se dégage toujours clairement. Par contrecoup c'est la justification même du titre de l'ouvrage qui risque de s'en trouver hypothéquée
232 (l'acte de nommer semble ne plus se différencier de l'acte de dénommer). L'entreprise menée autour de cet axe qu'est la nomination s'inscrit pourtant dans un renouvellement de la réflexion sémantique et nominale (voir à cet égard également le premier numéro de la revue Neologica) ;l'opposition entre nomination et dénomination, instituée explicitement par ce nouveau courant, vient reconfigurer un paradigme institué par G. HIeiber en 1984 (dénomination vs désignation in "Dénomination et relations dénominatives" Langages n°76) en en déplaçant le centre de gravité. Certains auteurs, dont Paul Siblot, exploitent la reconfiguration en cherchant à mettre en lumière son intérêt pour la réflexion lexicale et sémantique. D'autres en revanche, parce qu'ils s'en tiennent à l'opposition précitée, instituée par G. HIeiber, rendent dénomination et nomination indiscernables ;
- le lestage théorique de la réflexion hérite des difficultés inhérentes au positionnement du concept de dénomination dans l'appareil théorique et méthodologique de la sémantique lexicale. Que l'on ne s'y trompe pas, la responsabilité n'en est pas imputable aux auteurs mais au stade préthéorique de la conceptualisation de la dénomination en linguistique actuellement. D'où le recours fréquent à l'article de G. HIeiber (1984) et non pas aux rectifications qu'il a apportées ultérieurement. Dans ce contexte il peut appara ?tre hasardeux que la dénomination fournisse un contrepoint pour l'élaboration d'une réflexion sur la nomination.
Ces difficultés ne doivent toutefois pas être surestimées ni masquer le mérite très appréciable de l'entreprise menée dans cet ouvrage :associer la réflexion sur la (dé)nomination aux conditions sociales, politiques et culturelles d'exercice du langage et de la référence Ainsi se voient réinvestis dans le champ de la réflexion des paramètres que l'analyse lexicale avait tendance à ne plus prendre en compte. Bien plus, il montre que ces valeurs ne sont pas uniquement des effets discursifs, mais qu'elles constituent une mémoire sémantique à long terme et stabilisée, donc de nature à intéresser la valeur sémantique en langue des unités. Autre intérêt, insister sur le fait que l'indexation lexicale en discours (et son corollaire en langue), ne sont pas des pratiques transparentes mais relèvent de stratégies dont les tenants ne sont pas nécessairement mai"trisés par les locuteurs. Enfin, et surtout, l'ouvrage vient rappeler le fait que (dé)nommer, appeler « les choses », leur donner un nom, ne répond pas seulement à un besoin d'identification, de classement et d'échange, mais ressortit à une activité dont la finalité plus ou moins avouée est argumentative et perlocutoire.
Gérard PETIT Université Paris X
JANSEN, Silke (2005), Sprachliches Lehngut im world Ovide web. Neologismen in der franz~sischen und spanischen Internetterminologie. Tübingen. Ganter Narr Verlag. 412p. Tübinger Beitri3ge zur Linguistik 484.
Comme la contribution la plus significative à la théorie des emprunts depuis trente ans est sans doute celle d'un Allemand, Gerd Tesch (1978), qui place fermement l'emprunt lexical dans le cadre de l'interférence, au niveau descriptif, le nombre d'études réalisées outre-Rhin sur les emprunts dans différentes langues, y compris en français, n'a pas fléchi. Le rôle de l'emprunt dans les langues de
233
spécialité fait l'objet d'une attention particulière, mais la langue générale n'est pas négligée pour autant. Le dictionnaire européen des anglicismes (G~rlach 2001, 2002a,b), qui exclut en principe tout vocable spécialisé, a été réalisé depuis l'Université de Cologne, et l'Allemagne reste le centre des études sur le phénomène de l'anglicisation. Malgré cette productivité et la qualité de la description, préalable à toute étude sérieuse, les avancées sur le plan théorique sont relativement modestes. C'est pourquoi le livre de Silke Jansen est particulièrement significatif. Le titre laisse penser qu'il s'agit d'une description de l'état de la pénétration de l'anglais dans le français et l'espagnol de l'Internet. De fait, l'ouvrage ne déçoit pas au niveau de la qualité de la description, que nous examinerons en détail plus bas, mais il comporte par ailleurs de nombreuses autres qualités, à commencer par un souci théorique. Puisque son intérêt primaire est l'emprunt interne, largement décrit dans les années 50,1'auteure consulte les études classiques pour se rendre compte que les modèles qui servent depuis cinquante ans sous différentes formes sont en fait inadéquats pour expliquer le phénomène de l'emprunt. Elle en analyse les raisons et elle propose un autre modèle, fondé sur deux ou trois principes linguistiques qu'elle justifie explicitement. L'apport théorique de ce livre est donc significatif. Au niveau de la description, les qualités sont également nombreuses : en bonne romaniste, Jansen ne se contente pas d'étudier une seule langue, elle en examine deux, le français et l'espagnol, permettant ainsi des comparaisons éclairantes. Ensuite, elle prend très au sérieux les critères de l'exhaustivité d'analyse dans les limites qu'elle s'impose. Elle s'en tient aux termes recommandés officiellement en français par le Dispositif d'enrichissement de la langue française, ainsi qu'à leurs concurrents en français, et leurs équivalents en espagnol. Le choix de ce corpus contribue de façon utile au débat déjà très nourri dans les pays francophones sur l'évaluation de l'impact des arrêtés de terminologie. À en juger par ce livre, enfin, les thèses allemandes sont encore imprégnées d'érudition : l'auteure a une connaissance approfondie d'une importante quantité d'ouvrages publiés dans une multitude de langues, qu'elle cite abondamment. De nombreuses citations, par ailleurs, sont suivies de renvois vers d'autres auteurs qui expriment des vues semblables à celles qu'elle cite textuellement, de telle sorte que le livre donne accès à une bonne partie de la recherche sur le sujet, un vrai bonheur.
Le livre est divisé en deux grandes parties, l'une théorique, l'autre empirique. Ceux qui s'intéressent à la théorie des emprunts peuvent se contenter de la première partie, mais ce serait renoncer aux plaisirs de la démonstration, qui est magistrale. L'exposé théorique comporte trois parties :l'état de la recherche sur les emprunts depuis 1949, l'analyse des critères retenus par les différents auteurs, et la mise en perspective des critiques ainsi dégagées et la suggestion d'une nouvelle typologie de l'emprunt linguistique. La partie empirique commence par une discussion de l'emprunt interne et de son identification ;ensuite, l'auteure examine le rôle de la métaphore dans le vocabulaire de l'Internet en langue anglaise, puis elle se focalise sur la politique française de remplacement des anglicismes, en analysant les termes de substitution proposés, avant de les comparer aux dénominations des mêmes concepts relevés dans un corpus de presse serai-spécialisée. La partie consacrée à l'espagnol est plus succincte, en partie du fait de l'absence de politique linguistique comparable, mais la même démarche est suivie, puisque les différentes formes de dénomination relevées à l'intérieur puis à l'extérieur du corpus sont présentées ainsi que les indices de lexicalisation. Le tout dernier chapitre est un résumé de la
234
démarche et une discussion des résultats. Les annexes sont bien utiles : une bibliographie fournie, quoiqu'un tout petit peu vieillie la liste des revues dépouillées, les arrêtés de terminologie, la liste des termes étudiés dans les trois langues, ainsi qu'un glossaire des termes de l'internet.
La partie théorique devrait être intégrée à un prochain manuel sur l'emprunt linguistique :avec 134 pages, elle dépasse largement la taille d'un Que sais je ? Le premier chapitre expose les différentes théories de l'emprunt, surtout de l'emprunt indirect, dont les grands promoteurs sont, par ordre chronologique, Betz, Haugen et Weinreich. Leurs théories telles qu'ils les exposent eux-mêmes, et telles qu'elles ont été reçues depuis, font l'objet d'une analyse approfondie, qui débouche sur une discussion tout aussi détaillée par catégorie (mot d'emprunt, emprunt hybride, emprunt sémantique, création lexicale sous impulsion d'une langue étrangère, calque littéral, calque libre : le caractère quelque peu insolite de ces catégories en français montre que la terminologie de Betz, dont elles sont issues pour l'essentiel, n'est guère employée dans les pays francophones, comme Jansen le fait remarquer (Jansen 2005 : 122). Sa critique de toutes les catégories proposées antérieurement est à la fois pratique et théorique : pratique dans la mesure où les catégories dégagées par les différents auteurs se chevauchent et ne permettent pas une classification objective, préalable à toute analyse sérieuse ;théorique sur le plan de l'adéquation par rapport à la théorie saussurienne du signe linguistique. Les différentes explications de l'emprunt interne défont le signe, séparent signifiant et signifié : on emprunte le signifié sans emprunter le signifiant, dit-on, faisant ainsi fi de sa nature, indivisible par définition. Une seconde faiblesse de la plupart des études antérieures résulte d'une distinction insuffisamment réalisée entre synchronie et diachronie, entre parole et langue. L'emprunt —événement — au moment où il se produit, est un phénomène d'interférence, donc de parole. Il peut par la suite être lexicalisé, entrant ainsi dans la langue. Faire une même classification des deux phénomènes, comme le font implicitement la plupart des auteurs, fausse complètement le jeu. Jansen exploite très astucieusement la catégorie intermédiaire de la norme telle qu'elle est proposée par Coseriu dans son célèbre Sistema, norma y habla, pour rendre compte de cette phase cruciale. Il ne faut pas conclure que Jansen fait table rase des théories précédentes : en réalité, malgré les chevauchements, ces théories comportent des traits communs qui se révèlent compatibles, une fois qu'on fait les distinctions qui s'imposent entre langue et parole et entre synchronie et diachronie. En outre, il est normal que les appareils critiques, élaborés dans des buts très différents (l'influence lexicale du latin sur l'allemand, pour Betz, l'explication des phénomènes d'interférence à l'oral pour Haugen) divergent sensiblement. Le modèle proposé doit correspondre aux buts recherchés. Le résultat, la typologie que Jansen propose, est bien plus simple que la plupart des systèmes antérieurs, puisqu'elle postule un modèle d'interférence focalisé sur des individus bilingues qui sont les vecteurs des emprunts, internes ou directs. Elle postule trois grands cas de néologie lexicale induite par une situation de contact (Jansen 2005 :331-332) : le premier aurait son origine dans une manifestation d'alternance Iodique et aboutirait à l'adoption d'un signe d'une autre langue : c'est l'emprunt direct classique. Le deuxième cas serait la traduction faite par une personne bilingue aboutissant à des inflexions induites par interférence : c'est l'emprunt indirect, calque ou emprunt sémantique. Le troisième sera la mise en évidence d'une lacune lexicale par comparaison avec une langue donnée, lacune comblée par un élément qui n'a rien à
235
voir avec l'unité lexicale de l'autre langue :dans ce dernier cas (connu sous le terme de Lehnschdpfung), il ne s'agit pas en fait d'emprunt, mais de néologie autonome.
Le lecteur apprécie la démarche très claire et systématique qui, dans cette première partie, reprend les catégories traditionnelles et les replace dans un contexte théorique épuré, permettant ainsi de comprendre les nouvelles catégories par rapport aux anciennes. Les tableaux qui figurent à la fin de cette partie facilitent encore plus la compréhension.
Le renouveau méthodologique permet des avancées significatives : il permet par exemple de tordre le cou à la notion de « rétrécissement sémantique »qui serait le propre de l'emprunt. Cette vision des choses correspond à une analyse insuffisante de la nature du signe linguistique. Par ailleurs, elle montre clairement (Jansen 2005 :3) que la plupart des « hybrides » ne font en principe pas partie des emprunts, car il s'agit d'une exploitation d'un élément étranger intégré pour former une nouvelle unité lexicale composée, même si une traduction peut aboutir à l'occasion à une forme hybride. La répartition entre connaissances linguistiques et encyclopédiques dans l'évaluation de la motivation linguistique est également originale et utile.
La seconde partie, empirique, ouvre sur des considérations méthodologiques. Fidèle à l'ancrage de son analyse dans la parole, Jansen met l'accent sur l'oral. On peut se demander si l'insistance sur le niveau oral du contact linguistique est pleinement justifiée compte tenu de la situation actuelle par rapport à l'anglais, le vecteur écrit paraissant déterminant. Le rôle de la métaphore dans la composition du vocabulaire de l'internet est présenté dans un chapitre qui contribue au débat sur la question, particulièrement nourri ces dernières années Non que le sujet soit vierge
Jansen (2002) elle-même s'est déjà exprimée sur le sujet, mais son rôle dans le transfert de concepts dans le cadre de l'emprunt linguistique a rarement été évoqué. Elle arrive à la conclusion que la plupart des métaphores facilitent la traduction et permettent ainsi de se passer d'un emprunt direct, sauf dans le cas des métaphores spécifiques à une culture donnée (comme spam, cookie).
La présentation de la politique officielle française n'est guère flatteuse : la motivation serait essentiellement politique et relèverait davantage d'un anti- américanisme que d'un désir de faciliter la communication entre francophones. Elle examine les arrêtés du 2.12.1997 (termes relatifs au courrier électronique), du 16.03.1999 (vocabulaire de l'informatique et de l'internet), du 1.9.2000 (vocabulaire de l'internet), et en analyse les termes, d'abord du point de vue de leur forme en anglais, accordant une attention particulière aux métaphores, puis de celui de la forme des substituts proposés. Elle obtient (Jansen 2005 : 225) les pourcentages suivants • 65% seraient des traductions (Lehnübersetzungen), 21% des néologismes indépendants, 11% une combinaison de traductions et de néologismes indépendants ou emprunts directs, 2% emprunts directs et 1% de cas douteux.
Le chapitre sur l'évaluation du corpus journalistique permet une comparaison des termes officiels et des pratiques constatées. Elle relève une assez grande concordance entre les deux et un emploi réel des termes officiels, mais la proportion des emprunts directs est bien plus forte : dans les 30%. Fidèle à sa méthodologie, elle examine séparément les manifestations des emprunts dans les textes et les tendances de lexicalisation, catégorie par catégorie.
La partie sur l'espagnol est plus brève, mais elle comporte également des surprises. Jansen examine deux corpus journalistiques, l'un espagnol d'Espagne,
236 l'autre mexicain. Elle s'attendait à ce que le corpus européen soit moins influencé par l'anglais que l'américain, mais en réalité les chiffres sont très comparables. Elle constate par ailleurs, en comparaison par rapport au français, que l'espagnol, malgré l'absence d'instance d'officialisation, n'emploie pas plus d'anglicismes —c'est-à- dire d'emprunts directs —que le français, voire plutôt moins, confirmant ainsi l'étude de Céline Ahronian (2005), qui arrive à des statistiques tout-à-fait comparables à partir d'un corpus établi indépendamment.
L'ouvrage de Jansen est précieux en ce qu'il donne accès à des pans entiers de recherche effectués dans les pays de langues romanes et germaniques. Inévitablement quelques études qui auraient pu enrichir le débat manquent à l'appel. On se demande pourquoi elle est restée en si bon chemin lorsqu'elle propose un schéma tripartite de l'analyse sémiotique alors que Peter Koch (2005) invoque un modèle multidimensionnel pour rendre compte de la motivation sémantique, qui s'apparente à la néologie d'emprunt, surtout interne. Pour l'étude des tendances inhérentes au français qui seraient renforcées par l'influence de l'anglais, elle aurait pu très utilement convoquer Michael Picone (1996). De même, le programme de recherche sur la métaphore comme outil de conception aurait apporté un cadre théorique plus affirmé à cet aspect de la néologie. Également absents les nombreux écrits et études de l'Union Latine, organisme qui oeuvre pour le rapprochement des terminologies des langues latines : l'auteure connaît-elle ces études, ou estime-t-elle qu'elles n'apportent rien à la question ?Plus généralement, on a l'impression que la recherche de fond a été effectuée dans les années 90 et que la bibliographie n'a pas été mise à jour. Ce retard a des répercussions sur les données, par exemple celles sur la présence des différentes langues sur l'Internet, qui datent pour la plupart des années 1990, et qui ont certainement évolué depuis.
Au niveau des réserves, on peut regretter que les relations à l'intérieur de la francophonie ne soient pas vraiment prises en compte : la place précaire qu'occupe le français en Amérique du Nord interdit des comparaisons trop directes avec la situation en Europe. L'organisation internationale de l'aménagement linguistique des langues romanes ne semble pas beaucoup intéresser l'auteure, car le rôle de l'Union Latine n'est pas évoqué, pas plus que les coopérations francophones entre instances officielles, bien que les termes diffusés par l'Office de la langue française (depuis 2002 Office québécois de la langue française) soient cités systématiquement. De même les réseaux RTTERM et REALTTER ne sont pas mentionnés non plus.
On peut s'interroger également sur la prise en compte du caractère terminologique du vocabulaire examiné :les termes sont des mots qui sont sujets à une plus forte régulation que les mots de la langue générale. Bien entendu, dans le contexte qui nous intéresse, il s'agit de termes très largement vulgarisés, aspect pris en charge par l'emploi des métaphores. Quelques erreurs se sont aussi glissées dans l'ouvrage :aspirateur (de site) n'est pas l'équivalent de access provider, et fouineur est plutôt un engin de recherche qu'un hacker (Jansen 2005 :255).
Malgré ces quelques réserves, on peut recommander sans réserve un livre qui renouvelle plusieurs aspects de l'étude des emprunts. Nous formulons le voeu que la prochaine publication de l'auteure sera le nouveau manuel sur l'emprunt linguistique, qui se fait attendre depuis une cinquantaine d'années.
John HUMBLEY Paris 7, LDI
237
AHRONIAN Céline (2005) :Les noms composés anglais en français et en espagnol du domaine d'Intemet : traduction des composés anglais en français et en espagnol. Thèse de l'Université Lumière Lyon 2.
G~RLACH Manfred éd. (2001) A Dictionary of European Anglicisms, Oxford University Press.
— (2002a) : English in Europe, Oxford University Press.
— (2002b) : An annotated bibliography of European Anglicisms, Oxford University Press.
JANSEN Silke (2002) : « Metaphem im Sprachkontakt – anhand von Beispielen aus franzüsischen und spanischen Intemetwortschatz » , Metaphorik de 03/2002, p. 44-74 www.metaphorik.de/03/jansen.htm
KOCH Peter (2005) : « Aspects cognitifs d'une typologie lexicale synchronique. Les hiérarchies conceptuelles en français et dans d'autres langues », Langue française
145, p. 11-33.
investigationes supplementa 18, Amsterdam/Phildelphia, John Benjamin.
TESCH Gerd (1978) Linguale Interferenz : Theoretische, terminologische und
methodologische Grundfragen zu ihrer Erforschung. Tübingen, Gunter Narr
Verlag.
STEUCKARDT, Agnès et Jean-Paul HONORÉ (éd.) (2006), L'emprunt et sa glose. Mots. Les langages du politique, 82,133 p. http://edition.cens.cnrs.fr/revue/mlp/
Le numéro de Mots de novembre 2006 est consacré en grande partie à l'emprunt linguistique. En effet, trois articles abordent d'autres sujets, que nous n'évoquerons pas ici. Fidèles à leur orientation métalinguistique, déjà illustrée dans Le mot et sa glose, les rédacteurs présentent une série de cinq articles, ainsi qu'une introduction qui situent les enjeux, visant à déterminer les attitudes des locuteurs à l'égard des emprunts telles qu'elles sont manifestées dans les discours métalinguistiques associés. L'analyse de ces « boucles réflexives du dire », pour employer le terme d'Authier-Revuz, une des linguistes qui, ces dernières années, ont mis au point une méthode d'analyse de ces phénomènes, constitue une des ambitions de ce recueil.
Les rédacteurs constatent que les gloses sont nombreuses lorsqu'un mot apparaît -que ce soit un emprunt ou tout autre néologisme - mais que celles-ci disparaissent lorsqu'il est assimilé. Beaucoup d'entre elles sont d'ordre explicatif l'auteur cherche à préciser le sens d'un mot supposé inconnu du lecteur. D'autres gloses sont plutôt évaluatives :l'auteur souhaite se positionner par rapport au mot d'emprunt. Dans « L'anglicisme politique dans la seconde moitié du 18e siècle. De la glose d'accueil à l'occultation », Agnès Steuckardt rappelle d'entrée de jeu l'attitude quelque peu ambiguë non pas des locuteurs ou des scripteurs de son corpus, mais des linguistes français. Si la plupart s'interdisent expressément tout jugement de valeur au sujet des anglicismes, certains se montrent réservés, lorsqu'ils mettent en garde contre l'emploi abusif de ce type d'emprunt, comme Rey-Debove qui parle de « l'emprunt à l'anglais [qui] apparaît comme une véritable menace pour la langue nationale ». Un sondage récent réalisé dans Europresse révèle que l'image
238 des anglicismes véhiculée par la presse est encore plus négative :dans 81,75% des cas, l'emploi du mot anglicisme est classé comme péjoratif (associé à des adjectifs comme hideux, obscur, barbare...). Aux temps des Lumières, selon Steuckardt, la situation était bien différente. Les penseurs de cette époque contournaient les réticences bien connues de l'Académie pour emprunter sous différentes formes des mots qui témoignaient des aspects de la vie britannique, surtout du domaine institutionnel. En effet, les emprunts à l'anglais connaissent un bond à partir de la seconde moitié du 18e siècle. Steuckardt constate, pour la première partie de sa période, que les emprunts sont accompagnés de mélioratifs (des plus beaux, des plus estimables, auguste, privilège...). Elle explique en outre comment les gloses participent au processus d'intégration des emprunts dans la mesure où ils entrent dans l'esprit des Lumières. La Révolution change la donne :l'Angleterre est vue comme l'ennemi, le rival, et les commentaires sont de plus en plus négatifs et les « lexicographes ont jeté le voile sur le fait d'emprunt ». Steuckardt estime d'ailleurs que cet interdit est encore perceptible dans la lexicologie d'aujourd'hui.
La deuxième contribution de ce recueil est également historique, bien que la période soit plus proche de nous. Dans « Un Français à la cour du Morho Naba », Olivia Guérin explique à travers une analyse praxématique comment l'écrivain Albert Londres intègre des mots d'emprunt dans le récit d'un voyage qu'il a effectué en 1927 dans une cour africaine traditionnelle. Il en ressort que l'emploi des gloses bien plus que celui des emprunts est révélateur de l'attitude de l'écrivain. « Si [le] procédé de nomination [c'est-à-dire l'emploi des emprunts] semble, au premier chef, permettre de rendre compte des caractéristiques sociopolitiques de la société décrite, la manière dont est construit en discours l'accès au sémantisme des termes empruntés tend à déterritorialiser les concepts et représentations qui leur sont liés » (page 33). En effet, les explications que fournit Londres ramènent les réalités de la structure de la société africaine à des pratiques européennes, aboutissant ainsi à des représentations réductrices et dévalorisantes ;l'écrivain parait bien proche des attitudes colonialistes qu'il dénonce par ailleurs.
Les trois derniers articles se situent dans un contexte chronologique plus strictement contemporain. Aïno Niklas-Salminen, dans « Le xénisme français la'icité en finnois contemporain », analyse non seulement les gloses qui accompagnent ce phénomène peu compris relevant de l'exception française, mais aussi les différentes formulations finnoises susceptibles de rendre tel ou tel aspect du concept. Les journalistes finlandais se trouvent effectivement mal armés pour rendre compte d'une attitude sociale qui ne trouve pas d'équivalent dans leur propre société. Fait supplémentaire assez remarquable, un sondage effectué dans un plus petit corpus de journaux de langue suédoise de Finlande et de Suède indique qu'il s'agit d'une attitude qui est davantage nationale que linguistique, les journaux suédois exprimant une attitude plutôt critique. En effet, la Suède, contrairement à la Finlande, connaît un très fort taux d'immigration ; elle a coupé les liens qui reliaient l'État à la religion luthérienne, et de ce fait la différence entre les sociétés suédoise et française est moins forte.
Geneviève Petiot et Sandrine Reboul-Touré abordent à leur tour un autre aspect de la laïcité, celui des signes extérieurs d'appartenance religieuse, dans un article intitulé : « Le hidjab. Un emprunt autour duquel on glose ». Elles soulignent en effet le changement de paradigme que cette lexie a subi : d'un couvre-chef exotique il devient en effet un signe religieux, et se trouve ainsi en codistribution
239 avec croix, kippa, turban... Elles invoquent le concept de modalisation autonymique (l'« arrêt sur mot » d'Authier-Revuz) pour rendre compte des variations orthographiques et phonétiques du mot, ainsi que des gloses, connotées, épinglées comme étranger, arabe..., bref, un marqueur de discours polémique.
Sarah Leroy, dans un article présenté comme plutôt méthodologique « Glasnost et perestroika. Les pérégrinations de deux russismes dans la presse française », examine non seulement ces deux emprunts au russe, mais aussi les concepts de xénisme et de pérégrinisme. Les deux mots cités ont connu un fort taux d'emploi vers la fin des années 80 et au début des années 90, pour retomber rapidement à un niveau bas mais assez constant depuis. Bien que maintenue dans le dictionnaire de Dubois et al (1994) la distinction entre ces deux concepts (le premier un mot étranger pour un concept non seulement étranger mais inconnu, le second pour un mot étranger pour un concept toujours étranger mais connu dans le pays de référence) avaient tendance à s'estomper. Leroy tente d'en montrer la pertinence, d'après les gloses qu'elle analyse. Elles indiqueraient que les deux mots ne s'intègrent que très peu dans le lexique français et gardent de ce fait un statut à part, mais au fur et à mesure que les gloses disparaissent, ils passent du xénisme au pérégrinisme.
À une exception près, tous les articles sur les emprunts focalisent sur le phénomène du xénisme. Ce terme, presque tombé en désuétude et pour lequel tous les auteurs ne donnent pas la même définition, semble renvoyer à des références, voire des non dits d'ordre culturel, qui sont exprimés, de façon parfois indirecte, par les gloses. Il est permis de penser, toutefois, que d'autres types d'emprunts, tels que ceux qui désignent des innovations technologiques (l'exemple de tuner, de Mortureux, est pertinent ici), appellent également des gloses, comme n'importe quel autre mot technique (voir Beciri, « Néologismes et définition en contexte :pour une typologie des indices intreprétatifs formels », Le mot et sa glose, Steuckardt A. et Nicolas-Salmiens (eds.), Presses de l'Université de Provence, 2003, p. 41-56). C'est plutôt l'orientation politique de la publication Mots qui expliquerait ce choix, car plus orientée vers les aspects culturels du lexique.
L'emprunt est généralement considéré, par définition, comme relevant de la néologie. Même si les auteurs de ces articles ne font pas de rapprochement explicite à d'autres manifestations de la néologie, à part la glose, certains peuvent être signalés : une instabilité désignationnelle (surtout pour les équivalents finnois de la'icité, mais aussi pour glasnost et perestroika, car même l'équivalent `canonique' se trouve contesté), instabilité orthographique (pour hijab en particulier),
À quand le numéro : le néologisme et sa glose ?
John HUMBLEY Paris 7, LDI
WETZLER, Daginar (2006), Mit Hyperspeed ins Intemet Zur Funktion und zum Verstiindnis von Anglizismen in der Sprache der Werbung der Deutschen Telekom, Franl~urt am Main. Peter Lang. Europ~ische Hochschuleschriften. Reine XIV. 370 p.
Le nombre d'études consacrées à l'influence de l'anglais sur l'allemand d'aujourd'hui est impressionnant, et la dernière en date -dont on pourrait traduire le titre comme « Highspeed vous connecte à l'Internet : sur la fonction et la
240 compréhension d'anglicismes dans le langage de la publicité de Deutsche Telekom » -est issue, comme très souvent en Allemagne, d'une thèse de doctorat. L'idée principale est de vérifier si les anglicismes que Deutsche Telekom emploie à profusion sont compris des clients potentiels et plus généralement comment ils sont perçus.
Comme les meilleures thèses allemandes, cette étude est basée sur une analyse approfondie des très nombreux travaux déjà réalisés en Allemagne sur les anglicismes et sur l'évaluation de leur réception en particulier, de telle sorte que les premiers chapitres font le point sur la recherche effectuée ces dernières années et constituent pour le lecteur un résumé de l'état de la question, à la fois en termes de domaines couverts (langue générale et langues de spécialité), buts poursuivis et méthodes utilisées, ainsi qu'une réflexion sur les études d'emprunts en général. L'auteure se permet un « Exkurs » sur le purisme en allemand actuel et décrit les actions de l'association Verein Deutsche Sprache, qu'elle voit sous une lumière très négative.
Deutsche Telekom est connu en Allemagne pour son fréquent emploi d'anglicismes —l'association Verein Deutsche Sprache l'a déjà « primé » pour son anglomanie. L'entreprise l'explique par son étendue mondiale : elle se définit expressément comme un « global player », statut qui se reflète dans la langue. Il existe aussi des études sur la compréhension des anglicismes employés dans la publicité, que Wetzler analyse. Les résultats sont quelque peu paradoxaux : d'un côté certaines études laissent penser que les clients potentiels qui ne comprennent pas certains anglicismes en retirent une impression négative, tandis que d'autres indiqueraient que l'effet global de l'emploi de l'anglais est plutôt positif, se situant essentiellement sur le plan de la connotation. Cet aspect fera l'objet d'un examen attentif lors des entretiens que Wetzler mène.
Après des sections sur le langage de la publicité et les méthodes statistiques employées dans les enquêtes sociolinguistiques concernant le lexique, l'auteure présente son expérience. Elle a recueilli vingt anglicismes employés dans les publicités Deutsche Telekom, dix de la langue générale, et dix qui relèvent plutôt du langage des télécommunications. Elle a ensuite construit un questionnaire en fonction d'une vingtaine d'hypothèses qu'elle a formulées sur les rapports entre les données sur les informateurs et leurs attitudes par rapport aux anglicismes de la publicité et l'influence de l'anglais en allemand en général. Le questionnaire tient donc compte d'abord de l'âge, du sexe, du niveau d'instruction (connaissance des langues en particulier), des habitudes de consommation des médias (magazines, télévision) des interviewés. Ensuite, les cent interviewés ont été priés de prononcer l'anglicisme, de l'évaluer sur différentes échelles (compréhensibilité, complexité, modernité, artificialité, nécessité, neutralité) et d'en donner un équivalent ou une explication en allemand. Les résultats sont présentés en détail, mot à mot, et synthétisés à la fin.
L'enquête montre que la compréhension des anglicismes des publicités de la Deutsche Telecom est très variable. Si certains sont compris de tous (Handy, `pseudo-anglicisme' pour téléphone portable, par exemple), d'autres sont très peu compris : by call n'est correctement interprété que par trois informants, et la très grande majorité a mal compris Citygesprcich. Contrairement aux hypothèses de l'auteure, le sexe de l'informant a joué un rôle :les hommes font un meilleur score que les femmes. Le niveau de connaissance de l'anglais, ainsi que l'âge et le niveau
241 d'études, sont encore plus déterminants. Le facteur crucial, toutefois, est le degré de technicité :les mots de la langue courante sont généralement bien compris, ceux du domaine des télécommunications beaucoup moins. C'est pour cette raison sans doute que les hommes ont mieux réussi que les femmes, les jeunes que les vieux.
Les publicitaires comptent sur l'aura de l'anglais et sa supposée modernité pour faire passer le message, même si tous les mots ne sont pas compris. Or, Wetzler montre que l'informant qui ne comprend pas un anglicisme a une attitude plutôt négative à son égard. En même temps, elle découvre que les mots parfaitement compris n'ont quasiment pas d'impact sur la plupart des interviewés, ce qui doit pousser les publicitaires à rechercher des formules de plus en plus insolites, et à utiliser davantage d'éléments anglais.
On comprend que la grande force de cette étude est son assise sociolinguistique. L'auteure a bien pris au sérieux la maxime de Weinreich, qui prétend que celui qui n'étudie pas le contexte sociologique des emprunts, laisse son étude en l'air. Dans une certaine mesure, cependant, cette focalisation sur la réception se fait aux dépens de l'analyse des éléments du corpus. Les vingt termes choisis dans les publicités de la Deutsche Telecom sont peut-être tous des anglicismes, car ils comportent des éléments anglais, mais il ne s'agit pas pour autant d'emprunts dans tous les cas. Handy, déjà mentionné, est un `pseudo- emprunt', comme l'auteure le reconnaît. Mais un pseudo-emprunt, du moins de ce type, n'est pas un emprunt du tout. Le modèle dans l'autre langue n'existe pas. Il s'agit d'un radical qui est le même en anglais et en allemand, auquel on a ajouté un « suffixe » déjà connu pour figurer dans de nombreux emprunts courants en allemand : happy. Il n'est donc pas étonnant que tous le comprennent. À l'inverse, Citygesprcich, qui est également un pseudo-emprunt, forgé par DT, d'autant plus facilement que City figure déjà dans tous les dictionnaires allemands et employé au niveau le plus officiel. Pourtant, il n'est pas compris, parce qu'il est mal motivé. DT l'a inventé pour le différencier de Ortsgesprcich, communication locale, mais avec un sens plus large : or, en allemand, City c'est le centre d'affaires d'une ville. Le problème de la motivation ici ne concerne pas du tout l'anglais. Wetzler n'a visiblement pas eu l'occasion de prendre connaissance de l'ouvrage de Silke Jansen (2005), qui l'aurait mieux orientée. Il est visiblement temps de publier un manuel enfin à jour de l'emprunt linguistique qui tienne compte des évolutions des trente dernières années.
John HUMBLEY Paris 7, LDI