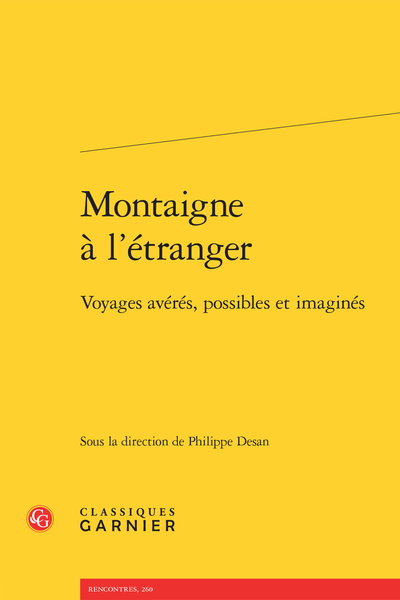
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Montaigne à l’étranger. Voyages avérés, possibles et imaginés
- Pages : 345 à 350
- Collection : Rencontres, n° 260
- Série : Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n° 92
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406059943
- ISBN : 978-2-406-05994-3
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-05994-3.p.0345
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 30/08/2016
- Langue : Français
Résumés
Jean Balsamo, « Le Journal du voyage de Montaigne dans la tradition littéraire du récit de voyage en Italie »
S’il existait bien des discours en français sur l’Italie vers 1580, il n’y avait pas alors de formes codifiées pour rendre compte d’un voyage privé en Italie, fréquent chez les membres de la noblesse. L’ouvrage auquel Montaigne se consacra pendant plusieurs mois, en reprenant un chantier ouvert par son secrétaire, ressortissait à un genre inchoatif, représenté aujourd’hui par une dizaine de textes analogues. Seule une perspective comparative permet de mettre en évidence son originalité.
Frédéric Tinguely, « Moments apodémiques dans le Journal de voyage de Montaigne »
Cet article s’attache à dégager, dans ses modalités et dans ses lieux privilégiés, l’expression d’une pensée du voyage dans le Journal de Montaigne. Il récuse ainsi l’idée selon laquelle ce texte fournirait seulement un matériau brut qu’il appartiendrait ensuite à l’essai, en particulier « De la vanité » (III, 9), d’interroger en profondeur. Dans la foulée, il plaide en faveur d’une conception élargie de l’apodémique qui ne se réduirait pas au seul genre de l’ars apodemica institué par Zwinger.
Philippe Desan et Carl Frayne, « Données quantitatives sur le Journal du voyage de Montaigne »
Le journal du voyage de Montaigne en Italie représente un périple de 5 100 kilomètres. Sur les 450 jours de voyage entre Mours et le retour au château de Montaigne, 126 consistent en déplacements à cheval et 324 en étapes et séjours dans des villes ou aux bains, dont 152 jours en résidence à Rome. Pour mieux comprendre les enjeux du Journal, cet article présente un ensemble de données quantitatives qui posent des questions qui dépassent les préoccupations littéraires liées au genre des récits de voyage.
Wolfgang Adam, « “Si grand plaisir à la visitation d’Allemaigne”. Montaigne en terres germaniques »
Montaigne décrit dans une lettre adressée à François Hotman, rédigée à Bolzano au moment où il quitte l’espace germanophone, ce qui le fascine tout particulièrement dans le mode de vie en Suisse et dans l’Ancien Empire. Il mentionne précisément : la commodité et le confort de la vie quotidienne, la courtoisie des habitants, l’organisation de vie commune par des normes juridiques et la sécurité qui règne dans les villes.
Jean-Étienne Caire, « Montaigne lecteur de Simler »
À partir de l’unique mention indirecte figurant dans le Journal de voyage de Montaigne, cet article examine comment et pourquoi Montaigne a acquis, lu, utilisé puis abandonné entre les mains des censeurs romains l’Histoire des Suisses de Josias Simler, premier historien de la Suisse, publiée en 1576 et traduite l’année suivante par Innocent Gentillet, protestant français.
Alain Legros, « Comme un désir de Grèce »
Montaigne aurait préféré gagner la Grèce plutôt que de descendre vers Rome. C’est du moins ce que nous dit son secrétaire dans le Journal de voyage. Pour aller où ? Par quelles routes ? Dans quelle intention ? La culture grecque de Montaigne n’était pas négligeable, loin de là. Ses allégations et ses livres en font foi, où il reproduit parfois, d’une main alerte, telle citation grecque. Sa curiosité pour la diversité humaine est sans limite. Offrons-lui donc ce voyage qu’il n’a pu faire.
Élisabeth Schneikert, « Montaigne et l’appel de la Pologne. Pourquoi Montaigne désirait-il aller à Cracovie ? »
Lors de l’étape de Rovereto, le secrétaire fait état du désir de Montaigne d’aller à Cracovie. Comment l’expliquer ? Trois hypothèses sont explorées : selon la première, Cracovie nourrirait un appel de l’imaginaire ; l’histoire même de Cracovie, en particulier le traitement de la question religieuse, serait une seconde piste ; enfin l’histoire immédiate, avec l’affaire d’Henri d’Anjou, est interrogée.
Concetta Cavallini, « “Alla bottega dei Giunti […] comprai un mazzo di Commedie”. Montaigne voyageur et bibliophile italianisant »
Lors de son voyage en Italie, la curiosité poussa Montaigne à la recherche de livres rares et précieux, quelquefois pour trouver une meilleure édition d’un livre qu’il possédait déjà. Cet article examine d’abord la rencontre de Montaigne avec Vincenzo Castellani da Fossombrone et la production de cet auteur. Ensuite sera étudié le « mazzo di commedie » que Montaigne dit avoir acheté à Florence, pour enfin s’interroger sur d’autres livres peut-être achetés à cette occasion.
François Rigolot, « Montaigne lecteur romain cosmopolite. Hasard et curiosité »
Lorsque Montaigne visite la bibliothèque Vaticane en 1581, les ouvrages qu’il consulte sont d’une diversité cosmopolite. Est-ce un assemblage hétéroclite ou peut-on déceler un projet cohérent dans les documents que le conservateur remet au visiteur ? Montaigne adopte-t-il à Rome le principe de « nonchalance » ? Il dit se désintéresser de la science et du savoir qu’il peut tirer des livres. Continue-t-il à se soumettre au hasard et se laisse-t-il toujours aller au gré de ses « fantasies » ?
Eric MacPhail, « Montaigne étudiant à l’étranger. Les leçons de Marc Antoine Muret sur Tacite et le tacitisme des Essais »
Montaigne séjourna à Rome lors des conférences de Marc Antoine Muret sur les Annales de Tacite à l’Université de Rome. Ces discours contribuèrent à lancer la mode de Tacite comme penseur politique et conseiller aux princes en Europe à l’âge de l’absolutisme. Profitant de cette mode, et de sa fréquentation de Muret, Montaigne fera une place de choix à Tacite dans ses Essais, où l’historien tend un miroir à une époque viciée par la persécution et l’intolérance.
Anne Duprat, « Montaigne et l’étranger napolitain. Retour sur la rencontre de Ferrare (15 novembre 1580) »
Dans l’une des lacunes du Journal du Voyage en Italie se loge l’entrevue qu’aurait eue Montaigne avec Torquato Tasso. En revenant sur l’exhibition
de cette rencontre manquée, dont le romantisme allait dramatiser les enjeux, dans la critique paradoxale de la folie développée par l’« Apologie de Raimond Sebond », mais aussi sur l’usage volontairement discret que fait ailleurs Montaigne de la poésie du Tasse, il s’agit de mesurer la place qu’accorde l’écriture de soi à l’imaginaire de l’autre.
Anna Bettoni, « Venise et Padoue dans le récit du Journal de voyage »
Dans le cadre du paradigme urbain qui intègre la ville universitaire, Padoue et Venise, le récit du Journal contient deux présences familières à Montaigne : deux livres faisant différemment partie de sa culture, le gros livre des Opera de Nicolas de Cues (1565) et le petit livre des Lettere familiari de Veronica Franco (1580). Une enquête sur les exemplaires possibles ou avérés de ces objets du récit dessine les contours d’une atmosphère vénitienne où Montaigne trouva surtout une solidarité intellectuelle.
Chiara Nifosi, « Une langue de voyage. Étude quantitative sur l’italien de Montaigne »
Cet article aborde la partie en italien du Journal de voyage de Montaigne à partir d’une analyse quantitative visant à décerner les intentions qui se cachent derrière la décision d’abandonner le français à la suite de l’échec politique du séjour à Rome. Les données quantitatives présentées révèlent l’intérêt que Montaigne portait au thème du corps et de la maladie, ce qui invite à concevoir le Journal comme un chantier d’écriture du moi qui sera ensuite développé par l’auteur dans ses Essais.
Richard E. Keatley, « L’écriture des bains. Montaigne lecteur des De Balneis »
L’analyse des traités balnéaires cités dans le Journal de voyage permet de mieux comprendre le comportement et l’attitude de Montaigne aux bains. Si l’auteur souligne les contradictions des traités de Franciotti et de Donati, l’article identifie aussi des points qui relient le discours balnéaire à sa pensée. Le relativisme particulariste de Montaigne se trouve déjà chez ces deux auteurs pendant que l’esthétique topographique et littéraire contribue à la création d’un locus amoenus pour la négociation de sa maladie.
Amy C. Graves-Monroe, « Le transit de Montaigne. La digestion du terroir »
Cet article examine le pot de chambre de Montaigne pour accéder au corps. Il voit dans la diététique, les bains et la médecine du Journal de voyage, les gestes d’un corps qui s’offre comme le site de l’expérience scientifique et méthodique de l’ingestion des éléments du paysage. L’excrément et les mouvements intestinaux provoqués par les eaux laxatives sont analysés comme métaphore de l’écriture. Cette conception de la digestion évolue vers une acceptation d’un excrément résiduel servant à conserver le corps.
Olfa Abrougui, « La tentation historique dans le Journal de voyage de Montaigne »
En voyage en Italie, et tenté par l’écriture de l’histoire, Montaigne se convertit en mémorialiste et en chroniqueur. Tout en s’abstenant de tout jugement personnel, il consigne dans son Journal de voyage des observations de scènes pittoresques et insolites de l’actualité vive de la péninsule, en particulier celle de ses mœurs. Dans le flux de cette histoire immédiate et concrète, il essaye de marquer sa présence. Aussi son histoire individuelle s’imbrique-t-elle dans celle de l’Italie.
Warren Boutcher, « La citoyenneté romaine de Montaigne. La supplica des archives dans son contexte »
Cet article examine le contexte et la signification de la supplica de Montaigne pour l’obtention de la citoyenneté romaine en 1581. Provenant de l’Archivio Storico Capitolino de Rome, le document présenté change radicalement notre perspective sur le Journal de voyage, plus particulièrement l’évolution de l’opinion de Montaigne concernant les libertés dont jouissaient les citoyens et les étrangers à Venise et à Rome et ses méditations sur la Ville éternelle dans le chapitre « De la vanité ».
Jean-Robert Armogathe, « Michel de Montaigne, ciuis romanus »
L’épisode de la citoyenneté romaine de Montaigne est documenté par trois pièces conservées dans l’Archivio Storico Capitolino. Cet article étudie l’inscription de Montaigne sur le registre des privilèges, ainsi que l’expédition de la « bulle ». Quand Montaigne arriva à Rome, en 1580, les nouveaux statuts urbains qui venaient d’être proclamés par Grégoire XIII avaient pour
but de repeupler la Ville après le désastre de 1527. La citoyenneté romaine de Montaigne se situe dans ce contexte.
Yves Louagie et Patrizio Quintili, « À la recherche du “Pont du canal à deux chemins” décrit par Montaigne dans le Journal de voyage »
Le Pont du canal à deux chemins décrit en 1580 par Montaigne dans le Journal de voyage fut ignoré des éditions successives. La description complexe de ce pont utopique semble opaque, voire énigmatique. Mais l’analyse critique des variantes éditoriales livre une description intelligible et la confrontation topographique confirme la cohérence du texte original. Les contraintes hydrographiques expliquent l’importance encore actuelle de cet ouvrage d’art, une merveille technologique pour l’époque.