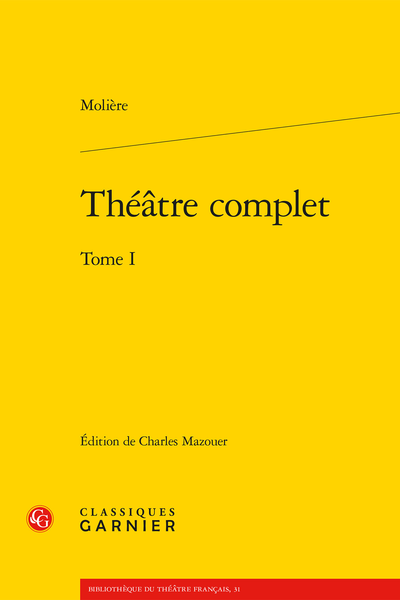
Note sur la présente édition
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Théâtre complet. Tome I
- Pages : 61 à 66
- Collection : Bibliothèque du théâtre français, n° 31
- Thème CLIL : 3622 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Théâtre
- EAN : 9782812438288
- ISBN : 978-2-8124-3828-8
- ISSN : 2261-575X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3828-8.p.0061
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 02/08/2016
- Langue : Français
NOTE SUR LA présente édition
Le lecteur trouvera ici les comédies de Molière selon l’ordre traditionnel, c’est-à-dire selon la chronologie des premières représentations, qui est presque totalement connue. Même si des décalages sont possibles ou certains entre le texte des premières représentations et celui que nous a livré l’imprimé – L’Étourdi et Le Dépit amoureux ont pu être retouchés par Molière entre la création et l’impression ; le Tartuffe a été mis trois fois sur le chantier, à plusieurs années d’intervalle, et fort remanié, et nous n’avons pas les deux premières versions –, l’ordre de présentation habituel permet de déployer assez exactement l’évolution de l’œuvre moliéresque.
L’établissement des textes
Les éditions
Il ne reste aucun manuscrit de Molière.
Si l’on s’en tient au xviie siècle1, comme il convient – Molière est mort en 1673 et la seule édition posthume qui puisse présenter un intérêt particulier est celle de Œuvres de 1682 –, il faut distinguer cette édition posthume des éditions originales séparées ou collectives des comédies de Molière.
Sauf cas très spéciaux, comme celui du Dom Juan et du Malade imaginaire, Molière a pris généralement des privilèges pour l’impression
de ses comédies et s’est évidemment soucié de son texte, d’autant plus qu’il fut en butte aux mauvais procédés de pirates de l’édition qui tentèrent de faire paraître le texte des comédies avant lui et sans son aveu. C’est donc le texte de ces éditions originales qui fait autorité, Molière ne s’étant soucié ensuite ni des réimpressions des pièces séparées, ni des recueils factices constitués de pièces déjà imprimées. Ayant refusé d’endosser la paternité des Œuvres de M. Molière parues en deux volumes en 1666, dont il estime que les libraires avaient obtenu le privilège par surprise, Molière avait l’intention, ou aurait eu l’intention de publier une édition complète revue et corrigée de son théâtre, pour laquelle il prit un privilège ; mais il ne réalisa pas ce travail et l’édition parue en 1674 (en six volumes ; un septième en 1675), qu’il n’a pu revoir et qui reprend des états anciens, n’a pas davantage de valeur.
En revanche, l’édition collective de 1682 présente davantage d’intérêt – même si, pas plus que l’édition de 1674, elle ne représente un travail et une volonté de Molière lui-même sur son texte2. On sait, indirectement, qu’elle a été préparée par le fidèle comédien de sa troupe La Grange, et un ami de Molière, Jean Vivot. Si, pour les pièces déjà publiées par Molière, le texte de 1682 ne montre guère de différences, cette édition nous fait déjà connaître le texte des sept pièces que Molière n’avait pas publiées de son vivant (Dom Garcie de Navarre, L’Impromptu de Versailles, Dom Juan, Mélicerte, Les Amants magnifiques, La Comtesse d’Escarbagnas, Le Malade imaginaire). Ces pièces, sauf exception, seraient autrement perdues. En outre, les huit volumes de cette édition entourent de guillemets les vers ou passages omis, nous dit-on, à la représentation, et proposent un certain nombre de didascalies censées représenter la tradition de jeu de la troupe de Molière. Quand on compare les deux états du texte, pour les pièces déjà publiées du vivant de Molière, on s’aperçoit que 1682 corrige (comme le prétend la Préface)… ou ajoute des fautes et propose des variantes (ponctuation, graphie, style, texte) passablement discutables. Bref, cette édition de 1682, malgré un certain intérêt, n’autorise pas un texte sur lequel on doute fort que Molière ait pu intervenir avant sa mort.
Voici la description de cette édition :
–Pour les tomes I à VI : LES / ŒUVRES / DE / MONSIEUR / DE MOLIERE. Reveuës, corrigées & augmentées. / Enrichies de Figures en Taille-douce. / A PARIS, / Chez DENYS THIERRY, ruë saint Jacques, à / l’enseigne de la Ville de Paris. / CLAUDE BARBIN, au Palais, sur le second / Perron de la sainte Chapelle. / ET / Chez PIERRE TRABOUILLET, au Palais, dans la / Gallerie des Prisonniers, à l’image S. Hubert ; & à la / Fortune, proche le Greffe des Eaux & Forests. / M. DC. LXXXII. / AVEC PRIVILEGE DV ROY.
–Pour les tomes VII et VIII, seul le titre diffère : LES / ŒUVRES / POSTHUMES / DE / MONSIEUR / DE MOLIERE. / Imprimées pour la première fois en 1682.
Je signale pour finir l’édition en 6 volumes des Œuvres de Molière (Paris, Pierre Prault pour la Compagnie des Libraires, 1734), qui se permet de distribuer les scènes autrement et même de modifier le texte, mais propose des jeux de scène plus précis dans ses didascalies ajoutées.
Le texte de base
La conclusion s’impose et s’est imposée à toute la communauté des éditeurs de Molière. Quand Molière a pu éditer ses œuvres, il faut suivre le texte des éditions originales. Mais force est de suivre le texte de 1682 quand il est en fait le seul à nous faire connaître le texte des œuvres non éditées par Molière de son vivant. Dom Juan et Le Malade imaginaire posent des problèmes particuliers qui seront examinés en temps voulu.
Au texte des éditions originales, ou pourra adjoindre quelques didascalies ou quelques indications intéressantes de 1682, voire, exceptionnellement, de 1734, à titre de variantes – en n’oubliant jamais que l’auteur n’en est certainement pas Molière.
Graphie et ponctuation
Selon les principes de la collection, la graphie sera modernisée. En particulier en ce qui concerne l’usage ancien de la majuscule pour les noms communs. La fréquentation assidue des éditions du xviie siècle montre vite que l’emploi de la majuscule ne répond à aucune rationalité, dans un même texte, ni à aucune intention de l’auteur. La fantaisie des ateliers typographiques, que les écrivains ne contrôlaient guère, ne peut faire loi.
La ponctuation des textes anciens, en particulier des textes de théâtre, est toujours l’objet de querelles et de polémique. Personne ne peut contester ce fait : la ponctuation ancienne, avec sa codification particulière qui n’est plus tout à fait la nôtre, guidait le souffle et le rythme d’une lecture orale, alors que notre ponctuation moderne organise et découpe dans le discours écrit des ensembles logiques et syntaxiques. On imagine aussitôt l’intérêt de respecter la ponctuation ancienne pour les textes de théâtre – comme si, en suivant la ponctuation d’une édition originale de Molière3, on pouvait en quelque sorte restituer la diction qu’il désirait pour son théâtre !
Il suffirait donc de transcrire la ponctuation originale. Las ! D’abord, certains signes de ponctuation, identiques dans leur forme, ont changé de signification depuis le xviie siècle : trouble fâcheux pour le lecteur contemporain. Surtout, comme l’a amplement démontré, avec science et sagesse, Alain Riffaud4, là non plus on ne trouve pas de cohérence entre les pratiques des différents ateliers, que les dramaturges ne contrôlaient pas – si tant est que, dans leurs manuscrits, ils se soient souciés d’une ponctuation précise ! La ponctuation divergente de différents états d’une même œuvre de théâtre le prouve. On me pardonnera donc de ne pas partager le fétichisme à la mode pour la ponctuation originale.
J’aboutis donc au compromis suivant : respect autant que possible de la ponctuation originale, qui sera toutefois modernisée quand les signes ont changé de sens ou quand cette ponctuation rend difficilement compréhensible tel ou tel passage.
Présentation et annotation des comédies
Comme l’écrivait très justement Georges Couton dans l’Avant-propos de son édition de Molière5, tout commentaire d’une œuvre est toujours un peu un travail collectif, qui tient compte déjà des éditions antécédentes – et les éditions de Molière, souvent excellentes, ne manquent pas, à commencer par celle de Despois-Mesnard6, fondamentale et remarquable, et dont on continue de se servir… sans toujours le dire. À partir d’elles, on complète, on rectifie, on abandonne dans son annotation, car on reste toujours tributaire des précédentes annotations. On doit tenir compte aussi de son lectorat. Une longue carrière dans l’enseignement supérieur m’a appris que mes lecteurs habituels – nos étudiants (et nos jeunes chercheurs) sont de bons représentants de ce public d’honnêtes gens qui auront le désir de lire les classiques – ont besoin de davantage d’explications et d’éléments sur les textes anciens, qui ne sont plus maîtrisés dans l’enseignement secondaire. Le texte de Molière sera donc copieusement annoté7, un index final récapitulant les mots et expressions expliqués en note.
Mille fois plus que l’annotation, la présentation de chaque pièce engage une interprétation des textes. Je n’y propose pas une herméneutique complète et définitive, et je n’ai pas de thèse à imposer à des textes si riches et si polyphoniques, dont, dans sa seule vie, un chercheur reprend inlassablement (et avec autant de bonheur !) le déchiffrement. Les indications et suggestions proposées au lecteur sont le fruit d’une méditation personnelle, mais toujours nourrie des recherches d’autrui
qui, approuvées ou discutées, sont évidemment mentionnées. On le vérifiera à la très abondante bibliographie, en fin de volume.
En sus de l’apparat critique, le lecteur trouvera, en annexes ou en appendice, divers documents ou instruments (comme une chronologie) qui lui permettront de mieux contextualiser et de mieux comprendre les comédies de Molière.
Mais, malgré tous les efforts de l’éditeur scientifique, chaque lecteur de goût sera renvoyé à son déchiffrement, à sa rencontre personnelle avec le texte de Molière !
La musique
Près de la moitié de la production moliéresque est constituée par des comédies-ballets – spectacles hybrides qui mêlaient au dialogue parlé la danse et la musique. Des danseurs, la trace est abolie. Mais de la musique, celle de Lully surtout, puis, vers la fin de la carrière de Molière, celle de Marc-Antoine Charpentier, nous avons toutes les partitions.
Comment ne pas rêver d’une édition des comédies-ballets qui donne à lire, aux endroits où elle intervenait dans le déroulement du spectacle, la musique ? C’est ce rêve qu’il a été possible de réaliser, avec l’appui du directeur des éditions Classiques Garnier. Il a été fait appel, pour la transcription de ces partitions en notation moderne, à des musicologues ; en ce qui concerne Lully, contrat a été passé avec l’éditeur de musique allemand de la grande série des Œuvres complètes de Lully (sous la direction de Jérôme de La Gorce et Herbert Schneider), Georg Olms Verlag. Cela constitue la nouveauté de la présente édition
Tout bien considéré, cette nouvelle édition du Théâtre complet de Molière a besoin d’espace. Cinq volumes au total sont donc prévus, dont la parution devrait s’échelonner entre 2016 et 2022 – pour autant que les circonstances de la vie le permettront, car nul n’est maître de sa destinée !
1 Le manuel de base : Albert-Jean Guibert, Bibliographie des œuvres de Molière publiées au xviie siècle, 2 vols. en 1961 et deux Suppléments en 1965 et 1973 ; le CNRS a réimprimé le tout en 1977. Mais les travaux continuent sur les éditions, comme ceux d’Alain Riffaud, qui seront cités en leur lieu. Voir, parfaitement à jour, la notice du t. I de l’édition dirigée par Georges Forestier avec Claude Bourqui des Œuvres complètes de Molière, 2010, p. cxi-cxxv, qui entre dans les détails voulus.
2 Voir Edric Caldicott, « Les stemmas et le privilège de l’édition des Œuvres complètes de Molière (1682) », [in] Le Parnasse au théâtre…, 2007, p. 277-295, qui montre que Molière n’a jamais entrepris ni contrôlé une édition complète de son œuvre, ni pour 1674 ni pour 1682.
3 À cet égard, Michael Hawcroft (« La ponctuation de Molière : mise au point », Le Nouveau Moliériste, no IV-V, 1998-1999, p. 345-374) tient pour les originales, alors que Gabriel Conesa (« Remarques sur la ponctuation de l’édition de 1682 », Le Nouveau Moliériste, no III, 1996-1997, p. 73-86) signale l’intérêt de 1682.
4 La Ponctuation du théâtre imprimé au xviie siècle, 2007.
5 Œuvres complètes, t. I, 1971, p. xi-xii.
6 Œuvres complètes de Molière, pour les « Grands écrivains de la France », 13 volumes de 1873 à 1900.
7 Il va sans dire que les instruments lexicographiques anciens (Dictionnaire de Richelet (1680), de Furetière (1690) et de l’Académie (1694) ; Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial de Le Roux, 1718), et modernes (le grand « Littré » (1877) ; les trois volumes du Lexique de la langue de Molière comparée à celle des écrivains de son temps de Ch.-L. Livet (1895-1897) ; l’incomparable outil de travail que représente le Dictionnaire du français classique, par Jean Dubois, René Lagane et Alain Lerond (constamment repris depuis 1988, et encore en 2001)) sont abondamment utilisés. Deux grammaires répondent aux questions de langue : Gabriel Spillebout, Grammaire de la langue française du xviie siècle, Paris, Picard, 1985 ; et, dans une perspective plus moderniste, Nathalie Fournier, Grammaire du français classique, Paris, Belin, 1998.