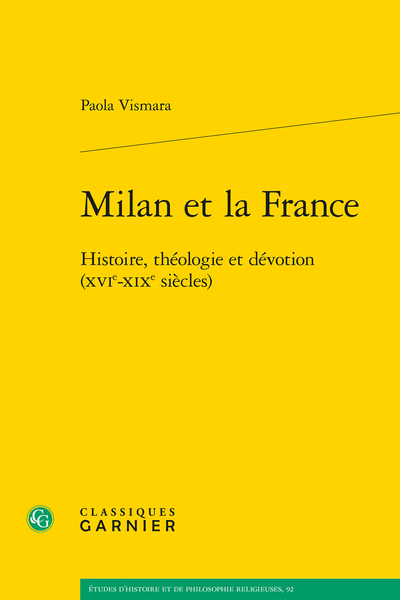
Avant-propos Le nouveau livre de Paola Vismara
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Milan et la France. Histoire, théologie et dévotion (XVIe-XIXe siècles)
- Auteurs : Ferretti (Giuliano), Colombo (Emanuele)
- Pages : 15 à 24
- Collection : Études d’histoire et de philosophie religieuses, n° 92
- Thème CLIL : 4046 -- RELIGION -- Christianisme -- Théologie
- EAN : 9782406137917
- ISBN : 978-2-406-13791-7
- ISSN : 2494-4912
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-13791-7.p.0015
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 21/09/2022
- Langue : Français
Avant-propos
Le nouveau livre de Paola Vismara
Dans ses dernières années, Paola Vismara avait souvent exprimé son désir de publier un nouvel ouvrage, que l’art noble de l’enseignement différait, l’empêchant d’y mettre la main. Ses efforts, souvent nocturnes, ont produit des matériaux nombreux qu’elle nous a légués. Dans ce riche dépôt, ses élèves et ses amis ont trouvé, entre autres choses, un ensemble cohérent, un canevas en chapitres, issu d’articles divers, presque tous parus en français et en italien, qui n’avaient besoin que de peu de chose pour aboutir. À l’initiative de Giuliano Ferretti, plusieurs collègues et amis de l’Université Grenoble Alpes, de l’Università degli Studi di Milano, de l’Accademia Ambrosiana et de la Veneranda Fabbrica del Duomo ont accepté de soutenir la réalisation de ce projet. C’est à ce canevas que les élèves de Paola Vismara, Marco Rochini en tête, soutenu par Emanuele Colombo, ont apporté la dernière touche, concrétisant le désir de livre de son auteur, tout en prolongeant son œuvre dans le présent. Tout cela est devenu Milan et la France, le livre que Paola Vismara avait pour ainsi dire composé au fil du temps et de ses nombreuses rencontres scientifiques en France, fruits des liens féconds qu’elle avait noués dans ce pays tout au long de sa carrière.
Milan a été la clé de voûte du travail de Paola Vismara : sa passion et son amour pour cette ville se ressentent en permanence dans ses écrits et se sont exprimés à travers de nombreuses collaborations avec des institutions urbaines. Membre durant des années du Comité de direction de la Classe di Studi Borromaici de l’Accademia San Carlo, devenue par la suite Accademia Ambrosiana, Paola Vismara a contribué à alimenter le dynamisme culturel de cette institution née de Frédéric Borromée. Elle a en outre été la première femme à intégrer le Conseil d’administration de la Veneranda Fabbrica del Duomo, instituée en 1387 par Gian Galeazzo Visconti. Mais, sans doute possible, c’est l’Université de Milan qui a été l’institution et la communauté à laquelle Paola Vismara a offert sa contribution la plus significative.
16Ses collègues se souviennent de son talent pour tisser des collaborations académiques qui se muaient souvent en liens d’amitié. Paola Vismara était connue pour sa franchise, elle s’exprimait sans filtre – une attitude peu commune dans le monde académique et dans les cercles ecclésiastiques, dominés le plus souvent par le politiquement correct. Cette franchise s’accompagnait d’une extraordinaire ouverture d’esprit : quiconque, indépendamment de son orientation religieuse ou politique, de son statut académique ou de son origine sociale, pouvait devenir un compagnon de voyage et participer à son inlassable soif de connaissance, à sa curiosité intellectuelle. Elle aimait répéter que l’on peut apprendre de chacun, depuis l’étudiant jusqu’au collègue, depuis ses petits-enfants jusqu’au dernier en date de ses collaborateurs. Dans ces simples paroles de remerciement rédigées pour son ouvrage le plus important, Oltre l’usura, elle a écrit : « Je remercie tous ceux qui, famille, amis, étudiants et collègues, ont maintenu éveillée en moi la passion de la recherche de la vérité et ont rendu plus complet le sens de l’heureuse beauté de l’existence1 ».
Dans l’introduction de ce même livre, elle proposait aux étudiants d’histoire religieuse de remettre au goût du jour une devise que Jacques Le Goff avait énoncée à ses étudiants d’histoire du droit, « Surtout, soyez vous-même ». Elle exprimait ainsi sa volonté d’étudier et d’écrire l’histoire de l’Église. « L’histoire religieuse a sa spécificité et son identité propre qu’elle doit à mon avis conserver, dans l’attention portée à la complexité de l’histoire2 ». Écrire sur l’histoire de l’Église en Italie n’est pas simple, en raison du risque perpétuel de réduire son travail à une approche confessionnelle et apologétique ou à un laïcisme anticlérical. Paola Vismara a toujours gardé ses distances vis-à-vis des courants qui attribuaient à l’époque moderne la fin du catholicisme légendaire, d’empreinte médiévale, et qui voyaient dans l’Église catholique le principal obstacle à la modernité. C’est précisément son approche spécifique de l’histoire religieuse qui lui a permis de montrer, en s’appuyant sur 17une très riche documentation, à quel point l’Église catholique a compté, non sans débats ni tensions internes, parmi les forces à l’origine de la naissance de la société moderne.
On était frappé par la sobriété avec laquelle elle travaillait et son souci constant de conserver un regard critique lui permettant de regarder le passé d’un œil objectif. En témoignent surtout ses fresques sur le xviiie siècle religieux lombard, qui ne manquaient pas de souligner l’émergence d’une déchristianisation dont la cause était à rechercher autant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’Église, bien souvent incapable de comprendre les langages et les nécessités religieuses des couches populaires. Dans l’écriture, elle se focalisait sur les détails et n’était satisfaite que lorsqu’elle trouvait le parfait équilibre dans ses évaluations. Elle ne supportait pas les titres factieux et les anachronismes car, selon elle, il fallait « donner sur le passé un jugement non pas émotionnellement superficiel, mais historique3 ».
Le même style caractérisait ses cours. Elle savait gagner l’estime de ses étudiants non pas à l’aide des feux d’artifice de la rhétorique, mais par des leçons préparées au cordeau et une disponibilité sans faille. Tous se souviennent des longues files d’étudiants patientant devant son bureau, et il suffirait de considérer le nombre et la variété des sujets de mémoires de licence et de master rédigés sous sa direction pour se rendre compte que, pour Paola Vismara, s’engager en tant qu’historienne de l’Église signifiait avant tout se mettre au service des étudiants. Ses travaux de synthèse sont d’ailleurs nés de sa tentative de se placer au niveau des étudiants et de répondre à leurs questions4.
Maintenant ses propres recherches dans l’orbite du xviiie siècle religieux dans le diocèse milanais, Paola Vismara aimait aussi faire des incursions en Europe et dans le reste du monde. Cela a été le cas du colloque organisé en 2007 à l’Università degli Studi di Milano sur le thème L’islam vu de l’Occident – Culture et religion au xviie siècle européen face à l’islam. À cette occasion, elle avait réuni des chercheurs de premier 18plan, invitant autour de la même table des orientalistes, des experts de l’islam et du monde arabe, des spécialistes de l’Église catholique et des habitués des archives ecclésiastiques et des bibliothèques. La rencontre s’est avérée particulièrement féconde d’un point de vue humain et intellectuel et les actes du colloque ont largement contribué à alimenter en Italie un débat déjà vif dans les historiographies française et espagnole représentées alors par Bernard Heyberger, Geneviève Gobillot, Loubna Khayati et Mercedes García-Arenal.
Lors de ce colloque, Paola Vismara s’est exprimée sur « Connaître l’islam dans le Milan des xviie et xviiie siècles5 » qui combinait ses compétences en histoire religieuse de Milan à l’époque moderne et une longue et laborieuse recherche sur certains Milanais ayant entretenu des contacts avec le monde islamique, en mettant à profit des sources inédites conservées à la Biblioteca Ambrosiana. Narrant la vie et les mésaventures de certains missionnaires, membres d’ordres mendiants, Paola Vismara a observé l’importance du rapport avec l’islam, y compris dans une ville qui, pour des raisons géographiques, n’était pas marquée par une connaissance directe du monde musulman, mais plutôt par un savoir élitiste et livresque. « La frontière, matérielle ou psychologique – concluait Paola Vismara – était souvent source de connaissance, un lieu de rencontre et d’échange : les sources témoignent d’un conflit mais, en même temps, d’une rencontre entre des civilisations et des cultures6. » Ce thème a de nouveau stimulé son intérêt dans les dernières années de sa vie, au moment de la conception du colloque de l’Accademia Ambrosiana sur l’esclavage en méditerranée et en Atlantique, dans lequel se sont impliqués des collègues et des amis du Brésil, dont Marina Massimi, Alcir Pécora et Carlos Zeron7.
Autre développement inattendu dans la recherche de Paola Vismara, son étude datant de 2009 sur la dévotion à une statue de Jésus appelée le 19Christ de Medinaceli et conservée à Madrid dans une église des années 1930. Dans son texte, elle observait : « Les raisons pour lesquelles un historien choisit tel sujet plutôt que tel autre ne sont pas strictement intellectuelles8. » En effet, durant ces années, Paola Vismara se rendait souvent à Madrid pour des raisons familiales. Lors d’une de ses promenades en ville, elle a remarqué une longue file de fidèles qui, depuis une église anonyme, s’étirait sur tout le pâté de maisons. Fait curieux, d’autant que ce jour-là la neige, insolite, tombait sur Madrid. Cela a été le point de départ de cette recherche sur la dévotion à cette statue. Cette dernière datait du xviie siècle et avait appartenu aux capucins espagnols dans une église située en terre barbaresque avant d’être pillée par les Maures et récupérée après paiement d’une rançon, exactement comme cela se pratiquait pour les personnes. La statue, acheminée à Madrid avec de grandes célébrations, est devenue le signe du Christ outragé. Depuis lors, elle a continué et continue encore à assumer une double fonction : inspirer les âmes sensibles à la religion et gratifier les hommes de grâces particulières.
Le cas espagnol a permis en outre à Paola Vismara de revenir à Milan où, au xviiie siècle, une copie de la statue madrilène était portée en procession à l’occasion de la libération des esclaves chrétiens détenus par les Maures. Son texte se clôt par une enquête sur la dévotion contemporaine qui liste les aspects marquant une continuité avec l’histoire ancienne, mais encore vivace et toujours aussi attractive.
Si Milan était sans aucun doute le centre affectif et intellectuel de Paola Vismara – le Milan du xviiie siècle et celui d’aujourd’hui –, un autre pôle géographique l’attirait depuis le début de sa carrière : la France, sa seconde maison selon ses dires.
Partie de son centre, de la culture religieuse de sa ville, Paola Vismara a progressivement élargi ses recherches à la péninsule et à l’Europe, tout en portant en effet une attention particulière à l’hexagone, terre d’un sentiment religieux fort et contrasté, profond et vivace, secoué par des ferments novateurs, mais toujours proche de l’Église de Rome. À l’évidence, le catholicisme d’outre-Alpes a occupé une place centrale dans sa réflexion. Elle s’en était rapprochée par l’étude des grandes questions 20dont débattaient la communauté scientifique et les personnalités les plus en vue. Le résultat de ce processus a été un long partenariat durable qui a associé Paola Vismara à plusieurs centres de recherche en France et à plusieurs générations d’historiens français. Elle a composé un cycle qui commençait par l’étude de saint Augustin, avec l’aide de Henri-Irénée Marrou, et se développait à travers ses travaux sur le sentiment religieux, sur la dévotion, sur l’argent et l’usure, pour ne citer que les plus importants. Ce travail, avec les interrogations qu’il suscitait, elle l’a partagé avec de nombreux collègues et élèves, tant en France qu’en Italie.
Ceux qui l’ont connue savent que l’œuvre et l’action de Paola Vismara se nourrissaient de passion spirituelle et d’engagement civil qui s’exprimaient par l’enseignement et l’écriture, mais également par le sens d’appartenance à une communauté intellectuelle internationale. Ces traits se révèlent encore plus clairement dans ses rapports avec la France, car l’intérêt pour cette dernière a rythmé ses travaux depuis ses débuts.
Dès ses premiers travaux dans les années 1980, Paola Vismara a participé aux rencontres du Centre d’histoire religieuse de Fontevraud, animées par une véritable liberté d’esprit qui était considérée nécessaire à la recherche historique. À cette époque, elle s’est liée aux personnalités les plus représentatives du mouvement catholique universitaire de Paris : Bruno Neveu et Jean-Robert Armogathe, connus pour leurs études sur l’histoire religieuse et sur la philosophie du Grand siècle. Des échanges profonds se sont alors établis entre Paris et Milan, entre l’EPHE et l’Accademia Ambrosiana, l’Università degli Studi di Milano et le Collegio Borromaico di Pavia. Un partenariat solide s’est créé et consolidé au cours de deux décennies. Cette amicitia, au sens que lui donnait Pétrarque, s’est bientôt élargie à la génération suivante de chercheurs qui sont arrivés à la Sorbonne et à l’EPHE. Vers le début du nouveau siècle, Alain Tallon, Olivier Chaline et Jean-Louis Quantin ont animé plusieurs projets de recherche, tout en y associant Paola Vismara qui a également participé à leurs cours et séminaires. Le livre Oltre l’usura, qui a connu un certain succès éditorial, a été présenté par l’auteur dans le séminaire d’Alain Tallon à la Sorbonne.
En l’espace de quelques décennies, les travaux de Paola Vismara se sont répandus dans le monde universitaire français, montrant par là combien son œuvre y était bien accueillie. En effet, Paola Vismara avait multiplié ses relations avec d’autres établissements universitaires 21et d’autres laboratoires de recherche. À Nancy, elle s’était liée depuis un moment à Louis Châtellier et à son école, à Lyon elle fréquentait régulièrement le Centre d’histoire religieuse André Latreille où elle rencontrait des spécialistes reconnus, tels que Philippe Martin et Bernard Hours. À Clermont-Ferrand, elle avait institué un partenariat solide avec Bernard Dompnier. Ensemble, ils avaient lancé une vision nouvelle de la dévotion et organisé des recherches et des rencontres portant sur les pratiques de la religiosité baroque. Sa collaboration avec d’autres cercles intellectuels français s’étendait jusque Chambéry, Bordeaux et enfin Grenoble qui, en entrant à leur tour dans ce mouvement intense d’échanges, ont participé à la dimension internationale centrée sur la France que l’on conférait au magistère de Paola Vismara. La valeur de ces partenariats entre Milan et la France s’est en outre révélée à travers sa participation de part et d’autre aux cycles doctoraux et aux habilitations (HDR) qui ont formé la dernière génération de spécialistes des deux côtés des Alpes. Par ailleurs, l’arrivée de ces dernières générations de chercheurs a consolidé la continuité du groupe d’experts en sciences religieuses auquel appartenait Paola Vismara. Jean-Louis Quantin avait succédé à Bruno Neveu à l’EPHE, de même que Sylvio De Franceschi succéda à Jean-Robert Armogathe dans la même institution.
Les études de Paola Vismara se regroupent, entre autres, autour d’une longue réflexion sur les rapports entre État et Église, entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, autrement dit entre liberté et autorité à l’époque moderne et contemporaine. L’originalité de ces recherches, qui reflètent sa personnalité exigeante, réside dans sa capacité à comprendre et à restituer les tensions qui animaient les relations entre religion et politique, afin de montrer, par exemple, que l’État moderne à l’époque des Lumières ne constitua pas nécessairement une source de progrès et de liberté, de même que l’Église catholique n’afficha pas des positions uniquement conservatrices. Dans ses travaux sur le jansénisme italien par exemple, on constate en effet que certains secteurs de l’Église – ceux qui relevaient de l’autorité des évêques – participèrent à la déchristianisation de la société au nom d’une modernité, mal comprise selon Paola Vismara, qui favorisa l’affaiblissement du sentiment religieux. Dans les essais sur Dogme et discipline ecclésiastique dans l’Italie du xviiie siècle et L’influence de la France, du Synode de Pistoia à auctorem fidei(publiés dans le volume présent, p. 251-271, 113-130), la question de l’autorité de l’Église est traitée à 22travers le prisme de la discipline ecclésiastique. Selon Paola Vismara, une partie des principaux acteurs séparaient le dogme de la discipline, tout en distinguant la discipline extérieure de la discipline intérieure, la première étant considérée comme fondamentale et l’autre comme secondaire. Cette opération aboutit finalement à la séparation entre la foi et les pratiques religieuses. Dans les années soixante du xviiie siècle, ce débat se focalisa sur l’intervention des autorités ecclésiastiques en matière disciplinaire, afin d’indiquer et de comprendre dans quelle mesure l’introduction de changements était possible. Dans les années suivantes, ce même débat évolua sensiblement vers la question centrale du rôle du prince dans le domaine religieux. Or, par le biais de la discipline et de la réforme de l’Église, Paola Vismara montre que le problème fondamental était en réalité celui de l’essor de la juridiction ecclésiastique et des prérogatives du souverain pontife. L’analyse de l’auteur prouve qu’une partie de l’Église, ayant choisi d’abandonner le modèle de l’antiquité religieuse au profit de la modernité, fut capable de prendre ses distances vis-à-vis du jansénisme et du rigorisme qui accordaient aux princes souverains le pouvoir de décider de la discipline extérieure. Paola Vismara fait clairement comprendre que les effets de l’orientation janséniste auraient limité drastiquement la sphère d’intervention de l’Église et affaibli l’autorité de celle-ci. Sur le plan historique et disciplinaire, l’influence de la culture française, précisément restituée dans le texte sur le Synode de Pistoia, s’avéra décisive pour l’évolution du jansénisme italien. Dans sa confrontation avec l’autorité de l’Église, ce dernier semble se comporter de manière analogue à celui des Parlements français dans leurs rapports avec la monarchie absolue. Ces deux mouvements furent d’ailleurs assez proches au cours du xviiie siècle : les magistrats gallicans adhéraient souvent au jansénisme et vice-versa. Il est intéressant d’observer un certain parallélisme dans l’action de ces deux sphères. En effet, de même que les jansénistes remettaient en cause l’autorité du pape à travers le débat sur la discipline de l’Église, les Parlements français remettaient en question l’autorité absolue du souverain à travers le débat sur le droit de remontrance. L’issue de ce combat au cœur de ces deux grandes institutions millénaires est clarifiée par Paola Vismara. Dans son analyse, elle indique que, dans le cas du jansénisme, le débat au sein de l’institution ecclésiastique renvoyait à la question entièrement politique du statut de l’Église. Dans le cas des Parlements, l’acceptation progressive de la part de la monarchie du 23droit de remontrance déboucha sur l’élargissement de la vie politique, affaiblissant les fondations de la monarchie elle-même et ouvrant la voie à une crise irréversible du droit monarchique – et pas uniquement des finances publiques – qui finit par renverser les Parlements eux-mêmes en tant qu’institutions de la royauté. Paradoxalement, le résultat fut à l’opposé de celui escompté par les magistrats gallicans : au lieu d’accéder au statut de partenaire privilégié du roi, ils contribuèrent à la destruction de la monarchie et à la naissance d’un système politique inédit dont ils furent exclus à jamais. Ce parallèle nous aide à comprendre la nature de la situation dans la péninsule italienne. Le débat au sein de l’Église de Rome fit émerger la présence active de deux visions opposées qui étaient extraordinairement importantes dans la lutte pour l’avènement de la modernité. L’adhésion aux quatre articles de l’Église gallicane déclarée par le Synode de Pistoia portait en elle le refus de l’autorité historique de l’Église de Rome et le rejet de l’autorité suprême du pape, comme l’avait observé le polémiste Michele di Pietro étudié par Paola Vismara. Cependant, l’aboutissement de ce conflit ne concorda pas avec celui entre les Parlements et la monarchie française. La Bulle pontificale Auctorem Fidei condamna les quatre-vingt-cinq propositions contenues dans les actes du synode et rejeta une vision de l’Église qui, limitant le pouvoir du pape, ôtait à l’autorité ecclésiastique ses droits sur la discipline pour les attribuer à l’État. Si les revendications du jansénisme italien avaient été acceptées, elles auraient entraîné la destruction d’une partie de l’institution ecclésiastique. Paola Vismara montre que la papauté se plaça du côté de la modernité en repoussant d’une part les thèses du jansénisme et en refusant de l’autre autant la religion abstraite et autoritaire du despotisme éclairé que le fonctionnalisme politique que celui-ci comportait. Comme Paola Vismara l’a observé avec finesse, les membres de la commission qui condamnèrent les propositions du Synode choisirent une Église opposée à celle des jansénistes et des gallicans, c’est-à-dire une Église visible, hiérarchisée, liée à son chef, et surtout populaire et ouverte à tous les fidèles. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, dans les dernières années, Paola Vismara a travaillé sur la dévotion, sur les cérémonies religieuses, sur le culte des saints et les confréries à la période moderne et contemporaine.
Le dialogue avec Paola Vismara, que ses articles repris dans ce livre permettent d’interroger de nouveau, s’appuyait sur la conviction que l’histoire est au fond un mystère, que l’historien ne peut que résoudre 24en partie, approximativement. L’image qu’elle-même a choisie en souvenir distribué lors de ses funérailles parle de cette posture d’humilité curieuse et ouverte aux imprévus continuels de la recherche historique. Il s’agit de la lithographie de Marc Chagall, La lutte de Jacob et de l’Ange, qui rappelle l’un de ses passages favoris de De la connaissance historique de Henri-Irénée Marrou. Étudier l’histoire, écrit Marrou, relève de
quelque chose comme la lutte de Jacob avec l’Ange de Yahvé au gué du Yabboq : nous n’y sommes pas seuls, nous nous rencontrons dans les ténèbres avec un Autre mystérieux (ce que j’appelais plus haut la réalité nouménale du passé), réalité à la fois ressentie comme terriblement présente et comme rebelle à notre effort : nous essayons de l’étreindre, de la forcer à se soumettre, et toujours finalement, en partie au moins, elle se dérobe…
L’histoire est un combat de l’esprit, une aventure et, comme toutes les équipées humaines, ne connaît jamais que des succès partiels, tout relatifs, hors de proportion avec l’ambition initiale ; comme de toute bagarre engagée avec les profondeurs déroutantes de l’être, l’homme en revient avec un sentiment aigu de ses limites, de sa faiblesse, de son humilité9.
L’humble lutte contre un « Autre mystérieux » a caractérisé la vie et l’œuvre de Paola Vismara – un combat silencieux et discret, qui l’a poussée à se battre jusque dans les dernières années de sa vie, aussi contre la maladie. Ceux qui l’ont connue savent que ce fut une lutte pleine de joie et d’espérance, comme le rappelle la citation de Dante, auteur qu’elle appréciait, qu’elle tenait à faire figurer sous l’image de Chagall :
Lume è lassù, che visibile face
lo Creatore a quella creatura
che solo in Lui vedere ha la sua pace
(Paradiso, XXX, 100-102)
Giuliano Ferretti
Université Grenoble Alpes
Emanuele Colombo
DePaul University Chicago
1 « Ringrazio quanti, dai familiari, agli amici, dagli studenti ai colleghi, hanno contribuito ogni giorno a mantenere desta in me la passione per la ricerca della verità e a rendere più pieno il senso della lieta bellezza dell’esistere. », Paola Vismara, Oltre l’usura. La Chiesa moderna e il prestito a interesse, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2004, p. 6. Voir aussi Paola Vismara, Questioni di interesse. La Chiesa e il denaro in età moderna, Milan, Mondadori, 2009 (traduction française : L’église et l’argent à l’époque moderne, traduit par Stefano Simiz, Lyon, Larhra, 2019).
2 « La storia religiosa ha una sua specificità e una sua identità e deve a mio avviso mantenerle, nell’attenzione alla complessità della storia. », P. Vismara, Oltre l’usura, op. cit., p. 5.
3 « dare sul passato un giudizio non emotivamente superficiale, ma storico », Luigi Mezzadri, Paola Vismara, La Chiesa tra Rinascimento e Illuminismo, Rome, Città Nuova, 2006, p. 348.
4 Paola Vismara, « Il cattolicesimo dalla “riforma cattolica” all’assolutismo illuminato », in Giovanni Filoramo, Daniele Menozzi (dir.), Storia del Cristianesimo, III. L’età moderna, Rome-Bari, Laterza, 1997, p. 151-290 ; L. Mezzadri, P. Vismara, La Chiesa tra Rinascimento e Illuminismo, op. cit.
5 Paola Vismara, « Conoscere l’Islam nella Milano del Sei-Settecento », in Bernard Heyberger, Mercedes García-Arenal, Emanuele Colombo, Paola Vismara (dir.), L’Islam visto da Occidente. Cultura e religione del Seicento europeo di fronte all’Islam, Gênes-Milan, Marietti, 2009, p. 215-252.
6 « La frontiera, materiale o psicologica, era sovente una sorgente di conoscenza, un luogo di incrocio e di scambio : le fonti restituiscono la testimonianza di un conflitto ma, al tempo stesso, di un incontro tra civiltà e culture », ibid., p 252.
7 Emanuele Colombo, Marina Massimi, Alberto Rocca, Carlos Zeron (dir.), Schiavitù del corpo e schiavitù dell’anima. Chiesa, potere politico e schiavitù tra Atlantico e Mediterraneo (sec. XVI-XVIII), Milan, Centro Ambrosiano, 2018.
8 « Le ragioni per cui uno storico sceglie un argomento piuttosto che un altro, non sono strettamente intellettuali », Paola Vismara, « La devozione al Jesús de Medinaceli, “Redentor Redimido”. Tra storia e sensibilità religiosa », Memorandum. Memória e história em psicologia 21, 2011, p. 162-178, ici p. 163.
9 Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique, Paris, Le Seuil, 1954, p. 52.