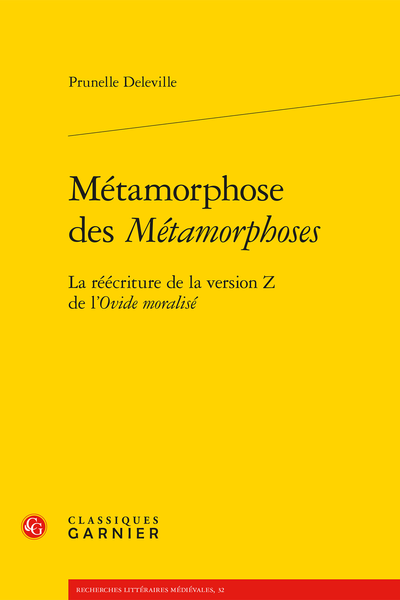
Nouvelle idéologie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Métamorphose des Métamorphoses. La réécriture de la version Z de l’Ovide moralisé
- Pages : 89 à 147
- Collection : Recherches littéraires médiévales, n° 32
- Série : Ovidiana, n° 1
- Thème CLIL : 3438 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moyen Age
- EAN : 9782406122425
- ISBN : 978-2-406-12242-5
- ISSN : 2261-0367
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12242-5.p.0089
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 02/03/2022
- Langue : Français
Nouvelle idéologie
Nouvelle conception
de l’amour et de la femme
L’amour en débat
Attrait pour les « ficcions sus amours1 »
Le nouveau rédacteur s’intéresse aux histoires qui traitent d’amour. Il exprime dans les passages qu’il réécrit une conception de l’amour et de la femme qui se rapproche de celle de Christine de Pizan dans l’Epistre Othea, où elle affirme, dans la « glose » à propos d’Hermaphrodite, que :
Ceste fable peut estre entendue en assez de manieres, et comme les clercs soubtilz philosophes ayant muciez leurs grans secrés soubz couverture de fable, y peut estre entendue sentence […] Et pour ce que la matiere d’amours est plus delitable a ouÿr que d’autre, firent communement leurs ficcions sus amours pour estre plus delitables mesmement aux rudes qui n’y prennent fors l’escorce, et plus agreable aux soubtilz qui en succent la liqueur2.
La réflexion de Christine de Pizan sur l’attrait des histoires d’amour se retrouve dans notre texte. Ce thème est effectivement central et intéresse tout particulièrement le réviseur. Les fables remaniées concernent souvent des récits qui touchent à l’amour. Par exemple, les histoires amoureuses de Pyrame et Thisbé, de Héro et Léandre sont rendues plus complexes et plus pathétiques, ce qui est la marque d’un goût prononcé pour ce genre de matière. Le narrateur intervient à plusieurs reprises pour rappeler la puissance des sentiments qui animent les amants, notamment lorsqu’il conclut l’histoire des amours de Pyrame et Thisbé :
90Cest excemble doit bien noter
Tous ceulx qui cuident destourner
Aux vrais amans qu’il ne s’entraiment,
Mais fous sont touz ceux qui s’en painent,
Car riens n’i vaut clef ne fermeure,
Ne grief menace, ne bateure,
Car qui loyaument aime et fort,
Il amera duqu’a la mort. (IV, v. 976-983)
Il n’y a pas de doute : le réviseur défend l’amour des jeunes gens. Les termes à valeur positive comme « vrais » ou l’adverbe « loyaument » placent les amoureux du côté de la vertu, alors que leurs opposants sont traités de « fous ». Leur folie tient au fait qu’ils contrarient une force qui ne peut l’être, en témoignent l’hyperbole « riens n’i vaut » et l’insistance sur la négation « ne fermeure, ne grief menace, ne bateure ». La négation de ces trois mots – « fermeure », « menace », « bateure » – qui forment un crescendo signale que l’escalade de la violence contre l’amour est vaine, et même funeste. C’est pourquoi le réviseur met en avant la détermination des jeunes amants qui
[…] dient en conclusion
Que mieux vaut sans comparaison
Qu’il assemblent, qui qu’il anuie,
Que ainssi languir toute leur vie.
Ainssi sont en joie et doulour… (IV, v. 682-686)
La rime entre « conclusion » et « sans comparaison » révèle la force irrépressible du sentiment profond qui unit les deux personnages, soulignée par la proposition « qui qu’il anuie ». Le rédacteur défend également l’amour des jeunes gens à travers les paroles que Thisbé adresse à ses parents :
Bien devrés haïr votre envie,
Vostre agait, votre jalousie !
Par vous mourons a grant destrece,
Dont vous arés au cueur tristece. (IV, v. 930-933)
La modalité déontique et le futur donnent des allures de sentence aux paroles de Thisbé. Cette dernière rétablit, en fixant les peines à venir des familles, une forme de loi qui est celle du cœur, et que défend aussi celui qui réécrit le texte. Tous les changements que nous avons étudiés signalent donc l’intérêt profond que le réviseur porte à la peinture des amours impossibles des jeunes amants. C’est pourquoi il complexifie aussi la fable. Nous l’avons déjà signalé : l’intrigue se complique quand 91les deux amants mentent à leurs gardes pour pouvoir rester seuls dans leur chambre respective et ainsi converser ensemble à travers la paroi. Certains éléments qui enrichissent la fable se retrouvent chez Christine de Pizan, qui est également intéressée par les récits amoureux. M. Gaggero a révélé ces échos entre le traitement du mythe de Pyrame et Thisbé dans le remaniement Z et dans l’Epistre Othea ainsi que La cité des dames3. Il a notamment relevé des similitudes telles que le fait que la mère de Thisbé enferme elle-même sa fille dans une chambre ou la façon dont Thisbé découvre la fissure du mur. Dans la version commune, il est bien question d’un mur qui sépare les amants, mais ni le narrateur ni les personnages n’insistent sur cet obstacle. Au contraire, dans le texte remanié, Pyrame en fait un objet de plainte : « Ravisse, hellas, ce seroit fort ! / Trop est le mur espés et fort, / Qui fait de nous le decevrance. / Ou prendroie donc esperance ? » (IV, v. 209-212). Ce mur devient un moyen de pathétique, dans la mesure où il symbolise l’impossibilité de l’amour, comme l’indique la rime entre « decevrance » et « esperance ». Dans La cité des dames, Christine de Pizan évoque aussi cette barrière dressée contre l’amour, en faisant dire à Thisbé :
« Ha ! paroi de pierre dure qui feis la decevrance d’entre mon ami et moy, se il avoit en toy aucune pitié, tu fendroies affin que je peusse veoir cellui que je tant desire4 ».
Dans Z nous savons également que Thisbé « Si perçut lors d’aventure / La lueur parmi la creveure » (IV, v. 343-344), ce qu’on lit dans La cité des dames : Thisbé « vit d’aventure en un quignet la paroit crevee par ou la lueur d’autre part appercevoit5 ». Dans le Pyramus et Tysbé de l’Ovide moralisé original, c’est aussi Thisbé qui aperçoit la première la fissure murale. Son amant l’en félicite : « Vostre en est bele l’aventure / D’apercevoir tel troveüre » (éd. E. Baumgartner, v. 336-337, correspondant à éd. C. De Boer, IV, v. 576-577). Il nous semble pourtant que le vocabulaire qu’emploie l’autrice est plus proche de la version Z : s’ajoutent à l’« aventure » commune aux trois textes, la « lueur »et la « creveure »qu’on devine dans le participe passé « crevee ».
92Ces effets d’écho entre l’œuvre de Christine de Pizan et notre réécriture ainsi que le goût partagé de ces auteurs pour les histoires d’amour signalent que notre adaptateur s’inscrit dans la tradition littéraire de son époque, encore plus peut-être que dans celle des premiers romans où l’amour est mis sur le même plan que la prouesse chevaleresque. Pour ce qui concerne la matière chevaleresque, le remanieur n’ajoute à la version originale qu’une seule exposition historique, celle qui concerne la mort d’Hector. La peinture de l’amour, qui est le thème de plusieurs nouvelles interprétations, importe donc plus que celle de la force guerrière.
Parmi les récits qui traitent des sentiments amoureux, la thématique des amours trahies occupe une place de choix, comme le montre le développement de certains passages sur la relation entre Médée et Jason, ou sur celle entre Énée et Didon. Dans ces deux récits, l’accent est mis sur la trahison masculine, comme chez Christine de Pizan6. À la fin de la narration des amours de Médée et Jason, le remanieur conclut sur l’ingratitude de Jason : « Grant joye en ot, si ot Jason / Qui li rendi mauvais guerdon » (VII, v. 1089-1090). La déloyauté du héros est un thème déjà bien connu, notamment mis en lumière dans le Roman de Troie, en vers et en prose. Christine de Pizan partage la même vision de cette histoire, dans l’Epistre Othea. Elle s’y adresse au jeune homme d’honneur sur ce ton :
Ne ressembles mie Jason
Qui par Medee la toyson
D’or conquist, dont puis lui tendy
Tres mauvais guerredon et rendy. (texte LIV)
Dans la lignée d’Ovide, pour qui les exemples de Jason, mais aussi de Thésée et d’Énée, « servent à illustrer l’inconstance masculine7 », Christine de Pizan et l’adaptateur de l’Ovide moralisé condamnent le comportement d’Énée envers Didon. Ils partagent tous deux une vision négative du héros, largement dominante jusqu’à la fin du Moyen Âge, si ce n’est dans l’Ovide moralisé original qui « a tenté d’offrir une vision plus positive8 » du héros troyen. Ainsi, alors qu’il quitte Troie en 93bateau, Énée est qualifié de « fuitis de Troie » (XIV, v. 212) dans les copies Z, comme dans le Roman d’Eneas, mais ce n’est pas le cas dans la version commune de l’Ovide moralisé. Cet adjectif réapparaît sous la plume du remanieur au moment où le jeune homme abandonne Didon. Le héros est donc associé à la lâcheté, dans le domaine chevaleresque et amoureux. Ce défaut est aussi mis en exergue par Christine de Pizan dans La cité des dames :
vint par fortune Eneas, fuitif de Troye apres la destruccion d’icelle […] S’en ala, sans congié prendre, de nuit, en recellee, traytreusement, sans le sceu d’elle. Et ainsi paya son oste9.
La trahison amoureuse est donc un thème qui unit et préoccupe ces deux auteurs, comme le montre l’ajout, dans Z, d’un développement sur l’ingratitude d’Énée assez similaire à ce qui figure dans Lacité des dames :
Dont villenie fist et oultrage
Et li vint de mauvés courage,
Et mal recogneut les biens faiz
Que la roïne li ot faiz,
Qui tant ot fiance en son pris
Que receu l’a pouvre et despris,
Et cueur et corps li abandonne.
Bien cuide qu’il la guerredonne
En foi tenir, com vrais amis,
Car ce li avoit il promis
Qu’il la prendroit a mariage
Et ne partiroit de Cartage,
Mes mal li a tenu convent,
Car, aussi tost qu’il vit bon vent,
Il se despartit de ce lieu
Et s’en ala, sanz dire adieu.
Eneas, li fuitis errant… (XIV, v. 243-259)
Le détail « et s’en ala, sanz dire adieu » résonne avec les mots de Christine de Pizan : « s’en ala sans congié prendre, de nuit en recellee traytreusement, sans le sceu d’elle ». Le vocable « seü » se retrouve également dans toutes les versions de l’Ovide moralisé (« Puis s’en partirent sans seü / De la roïne et de sa gent », éd. C. De Boer, XIV, v. 326-327). En outre, la version Z évoque seulement la fuite d’Énée et son attitude pusillanime, comme Christine de Pizan : « Puis s’en parti, sanz le seü / De la roïne et de sa gent » (XIV, v. 240-241). Le 94couple de vers « Et mal recogneut les biens faiz / Que la roïne li ot faiz » se retrouve aussi dans le constat « et ainsi paya son hoste ». Enfin, la mention de la promesse d’Énée (« il lui eust sa foy baillee que jamais autre femme que elle ne prendroit, et que a toujours mais sien seroit10 ») peut faire écho au passage « ce li avoit il promis / Qu’il la prendroit a mariage / Et ne partiroit de Cartage ». La version du récit des amours d’Énée et de Didon contenue dans les copies Z présente donc les mêmes spécificités que celle de Christine de Pizan dans La cité des Dames. Contrairement au premier auteur de l’Ovide moralisé,l’autre rédacteur n’a pas, semble-t-il, emprunté au Roman d’Eneas, où Énée est présenté différemment. Par exemple, dans le texte du xiie siècle, Énée ressent de la douleur à son départ de Carthage. Donc, le fait que le remanieur partage la même vision que Christine de Pizan et ne suive pas totalement le Roman d’Eneas signale qu’il souhaite mettre en lumière la tromperie masculine, à l’inverse du roman antique. Il nous semble impossible que le nouveau rédacteur ne connaisse pas le Roman d’Eneas. Ainsi, en s’éloignant de cette version du Roman d’Eneas, il marque son intérêt pour une vision d’Énée plus répandue à son époque, qui insiste sur la fausseté amoureuse. Le Roman d’Eneas est effectivement, comme l’Ovide moralisé original, un peu atypique dans la volonté de « blanchir » le héros : depuis Darès, Énée demeure une figure très controversée. Le remanieur, une nouvelle fois comme Christine de Pizan, oppose la fausseté d’Énée aux qualités de Didon, alors que d’autres auteurs médiévaux, tels que celui de l’Ovide moralisé initial ou plus tardivement Jean de Courcy déplorent la « folle amour » de Didon et voient en elle une figure de la luxure11.
Le remanieur marque même, encore plus que Christine de Pizan, sa compassion pour les femmes trahies en tissant un lien implicite entre les figures de Médée, Ariane et Didon. Ces trois héroïnes possèdent un savoir commun12, ce que le remanieur met moins en avant pour Didon que Christine de Pizan. Mais elles sont surtout unies par l’ingratitude de leur amant. L’ajout de l’adaptateur à propos du sort d’Ariane rappelle effectivement son jugement vis-à-vis de Jason ou d’Énée :
95|
Ariane |
Médée |
Didon |
|
Dont il me semble qu’il mesprist, Car mout li rendi adon De son bien fait mauvais gierdon Et pour celle desconfortee Est mer Adriane appellee La mer ou Theseüs passa, Quant la belle dorment laissa. (VIII, v. 682-688) |
Grant joye en ot, si ot Jason Qui li rendi mauvais guerdon. (VII, v. 1089-1090) |
Dont villenie fist et oultrage Et li vint de mauvés courage, Et mal recogneut les biens faiz Que la roïne li ot faiz, Qui tant ot fiance en son pris Que receu l’a, pouvre et despris, Et cueur et corps li abandonne. (XIV, v. 243-249) |
L’expression de l’ingratitude des amants unit ces trois histoires et marque la prise de position du remanieur en faveur des femmes trahies. Il rebaptise d’ailleurs la « mer de These » (éd. C. De Boer, VIII, v. 1340) « mer Adriane », comme une manière de glorifier Ariane au détriment de Thésée et de souligner l’abandon dont Ariane a été victime.
On retrouve cette même fascination pour les histoires d’amour dans les parties interprétatives. La nouvelle lecture historique de Callisto traite d’amour (et plus particulièrement de la tromperie masculine), comme celle de Pasiphaé13, de Pygmalion, ou encore, dans une moindre mesure, celle d’Actéon (le jeune chasseur surprend deux amants en plein batifolage). Les exégèses des amours de Pyrame et Thisbé, d’Eurydice et Orphée, de Mars et Vénus sont amplifiées. Il est également question d’amour dans l’exposition de la fable d’Europe. Le développement même de certaines lectures physiques concerne l’amour. Dans l’interprétation de la fable de Leucothé et Clytie, le second auteur soutient que la « fleur de soussi » (métamorphose de Clytie) représente les amoureux trompés et qu’on croit à tort qu’elle représente ceux qui ont joui de leur amour. Il défend implicitement ceux qui souffrent de la déloyauté amoureuse, comme il le fait pour Médée, Didon et Ariane.
En revanche, une fable comme celle de Narcisse, qui traite pourtant d’amour, n’est pas réécrite et ne reçoit pas de nouvelle explication, parce 96qu’elle ne traite pas de l’amour entre deux jeunes gens, mais renvoie plutôt à l’amour de soi, donc à l’orgueil. D’un autre côté, les récits fabuleux qui concernent des amours scandaleuses comme celles de Myrrha pour son père, de Byblis pour son frère ou encore de Pasiphaé pour un taureau sont raccourcis. Nous avions lu la réduction des plaintes de ces personnages comme une volonté d’atténuer le lyrisme du récit. Elle peut également s’interpréter comme un moyen de minimiser le scandale ou du moins de ne pas l’amplifier. On aurait donc affaire à un moraliste qui ne prise que les histoires d’amour « naturelles », c’est-à-dire conformes aux normes sociales, alors que l’auteur de la version du xive siècle dit clairement l’acte sexuel de la jeune fille avec son père :
Tant ont mené lor druerie
Que la fille conçut du pere.
Vierge vint, grosse s’en repere (éd. C. De Boer, X, v. 1875-1877).
De son côté, le remanieur se fait plus discret en écrivant que « La consut la fille du pere / Dont au dire est chouse amere » (X, v. 1175-1176). Le remplacement de ce qui désigne sans détour les ébats amoureux – « Vierge vint, grosse s’en repere » – par l’affirmation personnelle « Dont au dire est chouse amere » exprime une gêne. Ce sentiment se retrouve vis-à-vis de l’amour de Byblis pour son frère. À propos de Pasiphaé, l’auteur de l’Ovide moralisé originel s’excuse d’employer le mot « vit » (éd. C. De Boer, VIII, v. 768). Son adaptateur ne l’emploie pas du tout14. Il semble donc plus intéressé par des amours moins scandaleuses, plus conventionnelles.
Le réviseur s’intéresse aussi au corollaire de l’amour : la jalousie. Dans une explication historique qu’il développe, le nouvel auteur fait de la jalousie la raison pour laquelle Orphée perd Eurydice. Orphée maltraite son épouse, tant il est triste qu’elle l’ait trompé. La situation pousse Eurydice à le quitter15. Lorsqu’il relate les aventures de Céphale, le remanieur amplifie les paroles du héros qui déplore la mort de son amie par l’ajout d’une soixantaine de vers dans lesquels le personnage témoigne des ravages de la jalousie16 (VII, v. 2455-2518). Céphale évoque 97les conséquences funestes de la jalousie à travers l’exemple de Vulcain et de Phébus. La jalousie de Vulcain a entraîné la haine de son épouse et celle de Phébus a conduit à la mort de son amante. Le lien qui se tisse ici avec d’autres histoires de jalousie souligne donc l’attachement du compilateur à ce thème. L’amour l’intéresse en tant que tel et plus encore dans la prise de position que cette thématique implique, par rapport à l’Ovide moralisé mais aussi à des textes ouvertement misogynes.
Querelle autour du Roman de la Rose
À première vue, le texte présente une conception de l’amour proche de celle que partage Christine de Pizan. Comme elle, l’écrivain s’intéresse aux histoires d’amour naturelles entre un jeune homme et une jeune fille, tels que Héro et Léandre, Pyrame et Thisbé. Comme elle encore, il n’idéalise pas le sentiment amoureux, mais exhibe la fourberie de certains hommes. L’autrice ne juge pas l’amour en tant que tel, mais elle condamne les mensonges du discours amoureux masculin, de la même façon que notre rédacteur. Par exemple, la nouvelle exposition de la fable de Callisto repose sur une mise en garde contre les hommes qui séduisent les femmes par leur discours captieux :
Et tant font par leur grans malices
Que aucunes simpletes et nises,
Voire de telles qui sont saiges,
Attraient par leur sens lengaiges,
Et leur aliegent l’escripture17
Que c’est drois d’umaine nature
D’amer, ne honte, ne peché
N’y a, mes aucuns controuvé
Si ont par grant jalousie
Que il y a mal et villenie,
Puis si aliegent de grans dames,
Que l’en tint a bien preude femmes,
Si ont il amé et pis fet
Qu’on ne seüst oncques leur fet. (II, v. 1140-1153)
Ce type d’hommes peut s’apparenter à celui contre lequel s’insurge Sibylle de la Tour dans Le Livre du duc des vrais amants18. Dans ce livre, 98une jeune princesse entretient une relation adultère avec un jeune homme. L’amante demande à son ancienne gouvernante de venir la rejoindre, dans l’idée que sa présence favorisera les rencontres avec l’amant. Cette dernière comprend les motivations de cette requête et lui répond par la négative, en la mettant en garde contre l’amour qu’elle porte au jeune duc. Elle lui conseille alors de ne pas se fier « es vaines pensees que pluseurs joennes femmes ont qui se donnent a croire que ce n’est point de mal d’amer par amours, mais qu’il n’y ait villenie19 ». Le même argument est repris dans l’exposition que nous avons citée. On y retrouve également le même vocabulaire (« villenie », « peché »), même s’il reste très stéréotypé. Ensuite, l’amie affirme la fourberie des hommes : « ains scet on assez que communement sont fains et pour les dames decepvoir dient ce qu’ilz ne pensent mie ne vouldroient faire20 ». Ce jugement moral se lit aussi dans les vers de notre remanieur : « Ne leur chaut qu’il facent pour quoy / Peussent venir a leur vouloir. / Jurent et promectent pour voir / Se dont il mentent par les dans » (II, v. 1129-1132). Le réviseur joue ici le même rôle que Sibylle de la Tour, dans la mesure où il met à nu les motivations réelles des hommes. Dans sa lettre, cette femme expérimentée emploie souvent le mot « perilz ». Elle insiste sur ce danger par l’hyperbole « perilz et dongiers qui sont en tel amour, lesquelz sont sans nombre21 ». Elle conseille que la dame « qui ara esté aveuglee par l’envelopement de fole plaisance se repente durement22 ». La mention d’un « envelopement » résonne avec le déguisement que prend Jupiter, évoqué dans les vers de notre texte : « Se met en fourme de pucelle, / Pour plustost mieux avugler celle, / Ainssi com Jupiter le fist / Qui sa propre forme deffist » (II, v. 1116-1119). L’utilisation dans les deux cas du verbe « aveugler » dit lui aussi la proximité entre les deux textes. Le remanieur termine sa condamnation par le vers « Car certes tel en est l’usage » (II, v. 1197) qui ressemble à l’un des derniers mots de Sibylle : « et ne doubtez du contraire, car il est ainsi23 ». Enfin, le rédacteur suggère qu’il est de son devoir de mettre en garde les femmes en général, ce que Sibylle dit pour son amie :
99|
Le Livre du duc des vrais amants |
Ovide moralisé remanié |
|
Et au fort, mieulx doy vouloir faire mon devoir de vous loyaument amonester, et en deusse avoir vostre maltalent, que de vous conseillier votres destruction ou de la taire pour avoir vostre bon gré (l. 262-265) |
Mes, qui que plaisse ou desplaisse, Ja ne sera que je m’en taisse, Car se femme croit mon conseil, Je li lo et moult li conseil Qu’elle ne croye homme en tel cas. (II, v. 1180-1184) |
L’exposition nous semble donc partager bien des aspects de la lettre que Sibylle de la Tour adresse à la jeune princesse amoureuse. Ainsi, le réviseur et Christine de Pizan révèlent tous deux les pièges de la rhétorique amoureuse. Selon J. Cerquiglini-Toulet, « la question de la loyauté en amour traverse tout le siècle24 » (xive siècle) et « se pose déjà, ouvertement, dans Les Cent Ballades de Jean le Sénéchal et ses amis25 ». Par l’importance accordée à la loyauté amoureuse, valeur qui semble être considérée comme en déclin26, le nouveau rédacteur s’inscrit tout à fait dans les débats de son époque. Nous pensons notamment à la querelle autour du Roman de la Rose. Ses détracteurs reprochent au texte de Jean de Meun son obscénité et sa misogynie. Cette confrontation se développe après la naissance supposée de notre texte. Cependant, « dès la fin du xiiie siècle, on trouve en effet des auteurs qui semblent ne pas apprécier la misogynie qui ressort de la lecture du Roman de la Rose : ceux-ci soit atténuent cette misogynie, soit la critiquent ouvertement27 ». On supprime, par exemple, dans certains remaniements, les passages misogynes ou on les remplace par des « vers moins sévères vis-à-vis des femmes28 ». La question de l’obscénité du poème était déjà courante, si l’on considère qu’une famille de manuscrits du Roman de la Rose datée de la fin du xiiie siècle présentait un remaniement qui n’a retenu que « les parties qui ne contredisent pas l’idéal de l’amour courtois29 ». Mahieu le Poirier critique lui aussi la partie de Jean de Meun30. Dès le xive siècle, l’ouvrage est « lu d’abord comme un pamphlet contre 100les vices féminins31 ». La condamnation de la misogynie du roman n’est donc pas nouvelle et de fait assez répandue avant que n’éclate dès 1401 la querelle du Roman de la Rose, opposant Christine de Pizan, Jean Gerson et Nicolas de Clamanges aux partisans de Jean de Meun, Jean de Montreuil et les frères Col32. Le Livre du duc des vrais amants, tout particulièrement, est considéré comme une « contre-écriture » du Roman de la Rose qui « entend révéler le caractère trompeur de la fiction courtoise33 ». Notre réviseur exprime la même opinion dans l’interprétation de la fable de Callisto par laquelle il s’oppose à une partie de l’exposition du premier Ovide moralisé.
Pourtant d’autres éléments distinguent partiellement la pensée de Christine de Pizan de celle du remanieur. Dans la préface de l’Epistre Othea, J. Cerquiglini-Toulet rappelle que « l’exemple de Pyrame et Thisbé (histoire 38) aboutit à un conseil de prudence : ne pas croire sur des indices non vérifiés34 ». La recommandation qui suit la fable de Héro et de Léandre rejoint cet avertissement, puisqu’elle montre « qu’il ne faut pas aimer son plaisir au point de mettre sa vie en danger35 ». « Ces conseils n’ont rien de chevaleresque, mais enseignent une morale raisonnable et de bon sens. L’amour-passion est disqualifié36 ». J.-Y. Tilliette souligne que « l’époque médiévale est très réceptive à cette lecture sévère37 » de l’amour de Héro et Léandre. On la trouve déjà chez Fulgence et elle se lit encore chez Baudri de Bourgueil et le Troisième Mythographe du Vatican. Ces derniers vont même plus loin en plaçant ce récit sous le signe de la luxure, de l’abandon de la vertu et de la sensualité. Or, ce genre d’amour n’est pas condamné par le remanieur dans sa version des fables de Pyrame et Thisbé et de Héro et Léandre, ce qui constitue une différence majeure par rapport à Christine de Pizan et aux auteurs évoqués. Ces deux épisodes ne s’achèvent pas sur la mise en valeur d’un idéal de mesure en matière d’amour. La modération est plutôt demandée aux parents, par exemple, qui s’opposent à l’amour des jeunes amants 101dans le mythe de Pyrame et Thisbé. Cet aspect semble revenir à la suite de la mort de Héro et de Léandre, qui s’achève sur les vers suivants :
Grant dueil firent, se dit la fable,
Quant les virent les parens d’eus,
Et a bon droit, car de tout ·ii·
Fu grant damaiges et pitié.
Trop achaterent l’amistié
Qu’amours avoit entre eus faite,
Selons la fable qu’ai rettraite. (IV, v. 2491-2500)
Le sujet du verbe « acheter » est ambigu. Il peut aussi bien renvoyer aux amants qu’aux parents. Dans le second cas, il y aurait un parallèle implicite avec la nouvelle issue de la fable de Pyrame et Thisbé dans laquelle les deux amants condamnent leurs parents. L’assertion « a bon droit » nous semble aussi critiquer le comportement des parents. Un jugement discret porterait alors sur les parents, et non sur l’amour des enfants. Quoi qu’il en soit, contrairement à Christine de Pizan, le nouvel écrivain dresse un constat ou émet des suggestions mais ne délivre pas de conseils.
Dans les ajouts à la fable de Pyrame et Thisbé, les deux personnages font référence à une mort, qui est plutôt causée par un obstacle extérieur (ici la famille) que par l’amour même. Il semble donc que le rédacteur suggère que l’amour en soi-même n’est pas mortifère, mais qu’il le devient seulement lorsqu’il est empêché. Cet aspect se trouve déjà dans la première version du texte, mais il est accentué dans Z, grâce au développement du discours que les amoureux adressent à leurs parents. La première version du texte insiste plus sur le fait que Pyrame et Thisbé sont des amants loyaux car ils s’aiment par delà la mort38. Dans Z, cette idée est reprise, mais elle se double d’une réflexion sur les contraintes exercées contre les amoureux. L’amour passionnel est donc traité de façon presque rationnelle. Ainsi, le remanieur semble défendre un amour non pas courtois ou romanesque mais plutôt naturel, 102humain. Il ne condamne pas l’amour-passion comme Christine de Pizan, il montre seulement en quoi s’aimer passionnément, pour des jeunes gens, est une chose plutôt normale. Il se place du côté des deux jeunes héros, comme lorsqu’il développe le vers « Car li despartirs lor est maulz39 » (éd. E. Baumgartner, v. 55-56 correspondant à éd. C. De Boer, IV, v. 287) par ce passage :
Longuement fu leur deduit tielz
Et tant les joint nature ensemble
Que l’un de l’autre ne dessemble
Ne, quant a l’un plaist une chouse,
Jamais l’autre ne s’i oppose. (IV, v. 102-106)
L’infinitif substantivé « despartirs » est amplifié par les expressions « joint ensemble », « ne dessemble », « ne s’i oppose » qui saturent l’extrait du sème de la fusion. Le jeu de rime entre les contraires « ensemble » et « dessemble » renforce l’idée que rien ne peut contraindre le sentiment qui unit Pyrame et Thisbé. La valeur esthétique et symbolique de cette addition se double d’une dimension subjective. Même si le remanieur rejoint la topique romanesque de la gémellité des deux amants, il prend parti pour l’amour de Pyrame et Thisbé. Il place effectivement sous le signe de Nature le « deduit » des personnages, de telle sorte qu’on ne puisse pas le condamner. Cet aspect va de pair avec la morale finale qu’il donnera à la fable : il ne faut pas s’opposer à un feu si ardent.
Même si les conceptions du remanieur et de Christine de Pizan ne coïncident pas toujours exactement, leurs points de vue demeurent très similaires. Leur différence se situe surtout dans le fait que Christine de Pizan invite à une forme de retenue en amour alors que le remanieur exalte un peu plus l’amour. Mais leur définition de l’amour est identique en ce qu’elle s’oppose fermement à la conception de Jean de Meun. L’exemple de Pygmalion est à ce titre très instructif. Nous avons montré que le nouveau rédacteur pourvoit ce récit d’une exposition historique40 (IX, v. 757-812). Cette dernière ressemble à la 103Glose 24 que propose Christine de Pizan dans l’Epistre Othea. L’autrice y emploie, à propos de Pygmalion, des termes et qualifications très proches de ceux du remaniement Z ; elle évoque les mêmes détails41. Dans son ajout interprétatif sur Pygmalion, le remanieur entre aussi en résonance avec Jean de Meun, en développant son interprétation par une référence à la force naturelle que l’amour exerce sur tout un chacun, y compris Pygmalion, qui n’a de haine que pour les femmes légères :
Mais nature, quoi qu’il aviengne,
Contraint qu’a tout honme soviengne
De son euvre en affection,
Quel que soit l’operacion.
Pymalion, qui ot esté
Ainssi longuement en chasté,
Dessiroit moult en son courage
Feme avoir belle, bonne et sage,
Car c’est chousse trop naturelle
A tout masle d’avoir femelle.
Chacuns dessire par avoir,
– Se pueut chacuns par soi savoir –
Mes nul n’i vouldroit compagnie.
Chascuns veult avoir seul s’amie,
S’il aime en riens ne ne tient chere.
Pymalion en tel maniere
Dessiroit que feme eüst
Qui l’amast et qui sienne fust. (X, v. 767-784)
La nature est le thème central du propos. Elle joue le rôle de moteur du désir conjugal, en tant que sujet du verbe « contraindre ». La rime « naturelle » / « femelle » insiste sur la dimension innée de ce type d’amour. Le fait d’employer les termes « masle » et « femelle », deux dénominations scientifiques de l’homme et de la femme, ancre le propos dans une vision pragmatique de l’amour. Le remanieur se tourne ici du côté de Jean de Meun qui défend l’amour charnel. Il fait effectivement référence au discours de Raison qui dans le Roman de la Rose évoque l’existence d’un « amour naturel42 » commun aux hommes et aux animaux. En outre, son évocation de la contrainte d’aimer fait écho à la description de Jean 104de Meun de l’amour comme un « naturelz enclinemenz43 » comme ce qui « fait force44 » aux amants. Pourtant, le remanieur ne perçoit nullement l’amour comme Jean de Meun, pour qui, selon M. Zink, « il faut obéir en tout à la nature et satisfaire l’instinct sexuel45 ». Au contraire, le remanieur tire la nature du côté du mariage et non de la sexualité, lorsqu’il insiste sur le fait qu’il est naturel d’avoir une seule compagne. Il prend ainsi implicitement le contre-pied de Jean de Meun dont le roman invite à multiplier les partenaires et offre une image négative du mariage. Il partage ainsi le même avis que Christine de Pizan et Jean Gerson qui reprochent à Jean de Meun d’avoir terni l’image du mariage et en célèbrent les vertus. Pourtant, Christine de Pizan, dans sa glose moralisante, interprète l’amour de Pygmalion non pas comme une forme bénéfique et sereine d’amour conjugal, mais se concentre plutôt sur la statue, c’est-à-dire l’illusion, ce qui lui fait interpréter l’amour qui y est associé comme « le péché de luxure dont l’esprit chevalereux doit garder son corps46 ». Il n’est nullement question d’« esprit chevalereux » dans Z. Le remaniement ne traite pas d’élévation de l’âme, mais plutôt de choses toutes matérielles. Il analyse le sentiment de façon rationnelle, n’y voyant pas de dimension qui rende meilleur. Il y lit seulement un besoin naturel qui pousse parfois à l’excès, à l’aveuglement, aussi bien ceux qui aiment que ceux qui empêchent l’amour de s’épanouir.
Des femmes libres d’aimer ou de ne pas aimer
Comme Christine de Pizan, le remanieur n’opte pas pour l’amour courtois. Les vaillants chevaliers comme Jason et Énée sont d’ailleurs de piètres amants, ce qui signale que l’amour et la prouesse ne sont pas toujours corrélés. Nulle idéalisation ici : les hommes sont ce qu’ils sont. Mais, contrairement à Jean de Meun, le remanieur fait ce constat sans jamais le cautionner. À l’inverse de Jean de Meun, il s’en prend aux amants déloyaux. Le réviseur se place ainsi volontiers du côté des amantes. Il offre bien souvent une peinture pathétique de leur situation afin d’amener le lecteur à prendre leur parti, surtout quand il s’agit de femmes abandonnées. L’auteur initial a souvent la même attitude, mais sa position est plus ambiguë, car il peut allégoriser de façon positive et négative une même figure féminine. Le remanieur 105est souvent plus clément ; il ne porte pas de jugement de valeur sur les femmes. Le personnage de Salmacis, par exemple, est présenté sous un meilleur jour. Cette jeune nymphe tombe follement amoureuse d’Hermaphrodite. Le réviseur insiste sur la force que l’amour exerce sur elle, invitant le lecteur à une certaine compassion. Là où le premier auteur insiste sur la défense d’Hermaphrodite, le second met l’accent sur le fait que Salmacis ne peut rien contre la violence de ses sentiments :
|
Ovide moralisé original |
Ovide moralisé remanié |
|
Quant el vit qu’en nulle maniere, Ne pour anui ne por priere, Ne porroit l’enfant esmouvoir A ce qu’ele en peüst avoir Le delit qu’ele en atendoit, Et que trop fort se deffendoit Cil, qui haoit sa compaignie, Li dist comme par felonie (éd. C. De Boer, IV, v. 2472-2500) |
Et quant vit qu’en nulle maniere, Ne pour amour ne pour priere, Ne povoit l’enffent esmouvoir A ce qu’elle en peüst avoir Son delit, qui tant la destraint Ne pour l’iaue point ne desçaint, Celui qui haoit sa compaignie Se deffent, et celle li crie (IV, v. 1589-1596) |
Dans la version commune, la rime entre « atendoit » et « deffendoit » laisse penser que les propositions de Salmacis sont trop pressantes. Au contraire, par la rime « destraint » / « desçaint » le remanieur adopte le point de vue de Salmacis et insiste sur la force douloureuse de son désir, comme s’il cherchait à faire ressentir de la pitié pour Salmacis plus que pour Hermaphrodite. Contrairement au premier auteur, il ne juge pas les paroles de Salmacis à Hermaphrodite comme un acte de « felonie ». La focalisation émouvante sur la nymphe pourrait rapprocher la version de Z de la fable d’Hermaphrodite telle qu’elle est relatée dans l’Epistre Othea47. Le remanieur ne condamne donc pas cette amoureuse. Il ne présente pas non plus l’histoire de Byblis comme un exemple moral48, puisqu’il supprime l’introduction suivante :
Par lui pueent example prendre
Ces damoiseles et apprendre
Qu’eles n’aiment trop folement (éd. C. De Boer, V, v. 2079-2081).
106Lorsqu’une demoiselle est violée, comme Callisto, la faute n’est pas reportée sur elle. Dans l’exposition qu’il ajoute pour cette fable, le réviseur ne met pas en cause la nymphe, mais uniquement la façon dont Jupiter a abusé d’elle, contrairement à la version commune :
|
Ovide moralisé original, exposition |
Ovide moralisé remanié, exposition |
|
Cele fu compaigne et amie De Dyane, et de sa mesnie, Tant come el fu de joenne aage Et qu’el garda son pucelage, Puis fu, par son ventre, seü Qu’ele avoit o malle geü, Si perdi lors sa compaignie. Maintes sont qui en puterie Vivent grant part de lor aage, Sans perdre los de pucelage (éd. C. De Boer, II, v. 1699-1708) |
Cele fu compaigne et amie De Diane et de sa mainie. Tant com fu de jenne age Bien garda son pucelage, Mais aprés fu de homme deceue, Et par son ventre fu perceue Et descouverte la besongne, Si com la fable le tesmoigne. Si perdi lors sa compaignie Car vierge fu, or ne l’est mie. (II, v. 1206-1215) |
Le vers « Mais aprés fu de homme deceue » fait porter la culpabilité sur l’homme qui séduit la jeune fille. L’adaptateur emploie l’euphémisme « besongne » pour désigner l’acte sexuel, alors que l’auteur original est plus explicite dans son constat : « elle avoit o malle geü » (éd. C. De Boer, II, v. 1704). Le nouveau rédacteur est donc beaucoup plus discret. Ensuite, le vers « Car vierge fu, or ne l’est mie » remplace « Maintes sont qui en puterie » (éd. C. De Boer, II, v. 1706). Toute trace de jugement s’en trouve atténuée. Enfin, le remanieur supprime la longue diatribe contre l’avortement (éd. C. De Boer, II, v. 1707-1819). Il ne conserve qu’une description pathétique de Callisto devenue ourse, fuyant dans la nature, maltraitée par les animaux. Il y a donc bien une volonté de défendre les femmes dans la mesure où leur faute, si faute il y a, n’est plus condamnée, mais seulement décrite ou excusée. La seconde mise en prose de l’Ovide moralisé témoigne elle aussi, mais dans une bien moindre mesure, « d’une conception de la femme et de l’amour moins peccamineuse49 » que celle du texte original en vers. Par exemple, son auteur ne reprend pas, dans l’interprétation de Callisto, les mots de l’Ovide moralisé contre l’avortement. Le rédacteur de la première mise en prose, qui reprend d’autres passages misogynes de l’Ovide moralisé original, ne recopie pas non plus cette digression sur l’avortement. Le remaniement Z semble donc exprimer une vision 107plus clémente de la femme, ou du moins de Callisto, que partagent d’autres auteurs.
Le remanieur édulcore souvent ce qui peut donner une mauvaise image de la femme. Pour cela, il évite notamment d’utiliser des termes très négativement connotés comme « puterie », par exemple, dans l’exposition de Callisto. Dans le même livre, le corbeau veut indiquer à son seigneur que sa maîtresse « D’un nouvel ami est acointé » (II, v. 1627). Dans la version commune, ce n’est pas le terme « ami » qui est employé, mais celui d’« avoutre » (« S’a nouvel avoutre acointié », éd. C. De Boer, II, v. 2356). Ce changement peut être dû à l’utilisation machinale d’une expression fréquente en littérature, mais il peut aussi résulter d’une volonté de ne pas contaminer la figure féminine de la souillure qu’exprime ce mot. Les amours adultères ne reçoivent pas, dans Z, un traitement aussi sévère que dans la version originale. Par exemple, la nature extra-conjugale de la liaison de Vénus et de Mars est exhibée dans la version commune : « Fesoient ensamble avoultire » (fable, éd. C. De Boer, IV, v. 1286). Les deux amants sont désignés comme « luxurieux » (exposition, éd. C. De Boer, IV, v. 1505). Au contraire, dans Z, ces dieux « s’entramoient par amours50 » (IV, v. 1010) et passent du statut de « luxurieux » à celui d’« amoureux ». Pour la fable de Phaéton, il n’est plus question de la « puterie » de Clymène, puisque le remanieur supprime cette partie de l’adresse du jeune homme à son père51. Le réviseur désigne aussi de façon moins crue l’acte sexuel, comme s’il souhaitait ne pas ternir l’image des jeunes filles violées ou des femmes adultères. L’auteur original finit l’exposition d’Europe par la mention : « Ensi pot il ravir la bele, / Et tolir li non de pucele » (éd. C. De Boer, II, v. 5100-5101). Rien n’est dit dans Z sur cette perte de virginité. Le remanieur insiste plutôt sur la douleur de la jeune fille :
Quant la belle se vit trahie,
Moult fu dolente et esbahie,
Pleure, souspire et se demaine. (II, v. 3016-3018)
L’adaptateur cherche donc à passer sous silence, ou à édulcorer ce qui pourrait donner une mauvaise image des amoureuses, ou des femmes abusées. Il ne recopie pas le commentaire misogyne sur la façon dont Déjanire se laisse duper par Nessus :
108Trop est feme legiere et fole
Et trop est muable et ventvole
Et si croit trop legierement
Et plus tost croit certainement
Cel qui sa perte et son anui
Li amonneste que celui
Qui son preu li fet assavoir. (éd. C. De Boer, IX, v. 439-445)
Au contraire, il excuse dans la même fable le fait que la veuve d’Hercule (ici confondue avec l’amante d’Hercule, Iole) ait trouvé un autre ami après la mort du héros, alors que le premier auteur fustige la versatilité féminine. Il cherche aussi à blanchir une autre veuve : Jocaste, mère et épouse d’Œdipe. L’histoire d’Œdipe contenue dans Z est développée selon le Roman de Thèbes. Dans ce dernier, Jocaste est heureuse de son nouveau mariage avec celui dont elle ignore qu’il est son fils, selon une vision misogyne que le roman antique exprime ainsi : « Jocaste volentiers le prent, / car fame est tost menee avant, / qu’en em puet fere son talent52 ». Le remaniement Z ne garde aucune trace de cette justification ni de la joie de Jocaste. Bien au contraire, l’héroïne s’attriste de son sort53. Jocaste est donc partiellement innocentée ; elle est la victime du fatum et de la décision des conseillers qui lui proposent ce remariage.
Deux conceptions de l’amour s’opposent ainsi, qui nous semblent liées à une certaine vision de la femme. Les personnages féminins ne méritent pas d’être salis parce qu’ils aiment ou parce qu’ils sont aimés ou désirés malgré eux. Il s’agit, comme dans La cité des dames, de redorer le blason des femmes et de ne pas stigmatiser leurs relations amoureuses, ou de ne pas condamner les femmes abusées par des hommes trompeurs. On peut également comprendre, dans notre texte, la présentation édulcorée des relations charnelles comme une façon de répondre au traitement très cru et direct de l’acte sexuel chez Jean de Meun. Christine de Pizan accuse d’ailleurs ce dernier d’« excerciter les œuvres de nature, ne en ce ne fait excepcion de loy, comme se il vousist dire – mais dist plainement ! – que ils seront sauvez, et par ce semble que maintenir vueille le peché de luxure estre nul, ains vertu qui est orreur et contre la loy de Dieu54 ». On peut donc lire derrière cette façon de ne pas dire de mal 109des femmes l’expression d’une prise de position en faveur de la gent féminine, qui rejoint les controverses autour du roman de Jean de Meun.
Les femmes au centre
Le sujet des femmes n’a cessé de passionner les auteurs à partir de la fin du xive siècle. Boccace fait paraître en 1361 le De mulieribus claris55 dont Christine de Pizan s’inspire largement pour son livre La cité des dames56 de même que Martin le Franc en 1442 dans une version qu’il intitule Le champion des dames57. Boccace s’étonne « de voir que les femmes aient eu assez peu d’impact sur les écrivains de ce genre [les auteurs de vies] pour n’avoir obtenu aucun ouvrage spécialement dévolu à leur souvenir58 ». En défendant lui aussi les femmes illustres, le remanieur se place dans la dynamique qu’impulse Boccace.
Fascination pour le pouvoir féminin
L’adaptateur semble fasciné par les femmes, et en particulier par le pouvoir qu’elles peuvent manifester, soit qu’il constate simplement leur puissance d’agir, soit qu’il en fasse l’éloge. Il rejoint ainsi le parti de Boccace, pour qui « l’une des conditions exigées pour admettre telle ou telle femme parmi les femmes illustres est qu’elle ait manifesté, sur un point ou sur un autre, dans le bien, si possible, ou, sinon, dans le mal, sa capacité à échapper aux limites traditionnellement fixées à sa condition59 ».
La mise en lumière de cette puissance du genre féminin passe à travers l’affirmation qu’il ne sert à rien de vouloir s’opposer à elles. Ainsi, l’exposition de l’histoire d’amour entre Mars et Vénus, à laquelle Vulcain, le mari de Vénus, a voulu mettre un terme, est légèrement infléchie. Le nouveau texte se place du côté des femmes : il ne sert à rien de les contraindre. De son côté, le traducteur original des Métamorphoses insiste plutôt sur le fait que les maris trompés ne doivent pas révéler au grand jour leur cocuage. Il termine son exposition sur ce conseil : « Sel le triche, il la doit trichier » (éd. C. De Boer, IV, v. 1629). Cette sentence s’oppose à celle qui est présente dans Z : « Si ne vaut donc riens 110l’espier. / Il s’i vaut mieux du tout fier60 » (IV, v. 1178-1179). La nouvelle interprétation de la fable d’Actéon montre aussi combien s’opposer à la toute puissance féminine peut être fatal61. La dame qu’Actéon surprend un jour dans les bras d’un galant le condamne effectivement à l’exil puis à la mort. Le remanieur cherche donc à rendre compte de la force parfois implacable des femmes.
Cette mise en valeur du pouvoir féminin passe également par des descriptions plus laudatives. Les femmes sont souvent présentées, chez l’auteur original et son adaptateur, comme les premières actrices dans les exploits de certains héros. Jason et Thésée doivent beaucoup à Médée et Ariane qu’ils finissent pourtant par abandonner. Les deux textes insistent sur l’injustice faite aux femmes. En outre, le remanieur ne manque pas de souligner le fait que Thésée doit sa sortie du labyrinthe à Ariane, en ajoutant à la fin de cet épisode les vers : « Tout ainssi fist et acheva / Conme la belle dit li a » (VIII, v. 663-664). La rime « acheva » / « di li a » exprime très explicitement le rôle majeur d’Ariane, faisant de Thésée un acteur passif de sa propre geste. Certaines figures féminines se signalent donc par leur puissance, qu’elles transmettent aux hommes pour accomplir de grandes prouesses. Il arrive même qu’elles soient présentées comme supérieures en prouesse, comme par exemple dans la fable de Méléagre et Atalante. Alors qu’un sanglier monstrueux dévaste le pays, plusieurs hommes de valeur se proposent de sauver la population de ce massacre. Aucun ne parvient à toucher l’animal, si ce n’est une jeune femme du nom d’Atalante : le coup qu’elle assène au sanglier permet à Méléagre d’achever la bête. Ce dernier, tombé 111amoureux de la jeune fille, souhaite lui rendre hommage, en déclarant devant tout le monde :
« Belle, voustre en soit l’onnour.
Je la vous donne avec m’amour.
L’onneur doit voustre estre, sanz faille,
Car riens n’a ou mont qui vous vaille. » (VIII, v. 1459-1462)
Ce passage est ajouté dans la version Z. Le nom « onnour » est répété, faisant de la jeune fille une sorte de chevalier. Cette mise en avant de la valeur guerrière d’Atalante par Méléagre témoigne de l’attention que le remanieur porte aux femmes illustres, dont il fait ici indirectement l’éloge. Il semble avoir le même objectif que Boccace qui « donne [à la femme] une autonomie centrée autour de l’exploit qui lui vaut sa notoriété, et dont le cadre déborde largement la sphère courtoise62 ».
Pomme de discorde
La position par rapport aux femmes représente une source majeure de désaccord entre l’auteur original et celui qui réécrit le texte. Dans le commentaire de l’exposition de Callisto, nous avons vu comment le nouveau rédacteur prend position pour dénoncer la fourberie des hommes63, alors que l’auteur original fustige dans son exposition la duplicité des filles qui se font avorter. Il exprime tout de même une forme de compassion pour les femmes comme Callisto et ne les condamne pas totalement, dans la mesure où ce personnage figure, par sa métamorphose finale en constellation, l’âme pécheresse repentante. Cependant, l’adaptateur va plus loin en faisant passer la faute sur les hommes trompeurs. Une telle inversion du jugement contre les femmes se retrouve dans la fable d’Hercule, d’Iole et de Déjanire. (Le remanieur confond ici Iole, l’amante d’Hercule, avec Déjanire, son épouse). La scène se déroule après la mort d’Hercule, causée par la robe empoisonnée que son épouse Déjanire lui a envoyée sans savoir que son cadeau serait fatal. Le rédacteur de Z décrit la tristesse d’Iole, qu’il considère à tort comme l’épouse d’Hercule, et la justifie, alors 112que l’auteur original juge que cette affliction est feinte et éphémère (éd. C. De Boer, IX, v. 1037-1048) :
|
Ovide moralisé original |
Ovide moralisé remanié |
|
Fu partout la chose seuë De la mort qu’il ot receuë. Grant duel en fils la bele Yolens. Cele n’ot pas ses ongles lens D’esgratiner sa clere face, Mes poi pris duel que feme face, Quar puisqu’elle a le cuer joiant Fet elle grant duel de noiant. Dou cuer rit et pleure de l’ueil, Et tout ait elle au cuer grant duel L’a elle oublié en poi d’ore. Endementers que fame plore Pour son ami qu’on met en terre, El se pourpense d’autre querre. Pour Hercules fet duel la bele, Mes tost trouva amors nouvele. (éd. C. De Boer, IX, v. 1035-1050) |
Fu par tout le chouse seüe De la grief mort qu’il ot receue. Grant duil en fist belle Yollé Qui n’ot pas son cueur saoullé De grant duil faire et demener Et de souspirer et plourer, Mes plus legierement s’oublie, Pour ce qu’il avoit autre amie Et qu’il avoit du tout laisie, Et plus tost s’en est apaisie, Dont que sage fist et raison, Car point ne fait de desraison Cil ou selle qui en ombli Met amours qui point n’aiment li. (IX, v. 797-810) |
Contrairement à l’auteur primitif qui trouve que les femmes sont volages et oublient rapidement leur ami, l’adaptateur rappelle la raison pour laquelle Iole passe à autre chose : Hercule l’avait abandonnée et ne l’aimait pas en retour. Nous ne savons pas vraiment à quel épisode le réviseur fait ici référence, puisque Hercule a plutôt oublié son épouse Déjanire et passé sa vie aux côtés de son amante Iole. Quoi qu’il en soit, l’héroïne est excusée. Celui qui réécrit le texte va même plus loin en louant l’action du personnage : « sage fist et raison ». Cette nouvelle éthique explique très certainement la façon dont le réviseur introduit le récit des amours adultères entre Hercule et Iole, en insistant sur la versatilité masculine :
Si com l’istoire nous afferme
Ama Herculles mout lonc terme
S’espousse, sanz son cueur changier
Ne autre amer, mes de legier
Ne trouveroit on pas ·i· honme
En amour loial ne preudonme,
A moins qu’il le soit longuement,
Et se aucun dit que je ment,
Ce pueut en bien prover par euvre,
113Car experiance le prouve.
Mes vous vueil a ma matire :
Touz voirs ne sont pas biaux a dire. (IX, v. 397-408)
Dans un contexte de confrontation à propos de l’inconstance amoureuse, le proverbe « Touz voirs ne sont pas biaux a dire » instaure une nouvelle vérité selon laquelle les hommes sont versatiles et en discrédite une autre, celle du premier auteur, selon laquelle les femmes sont versatiles. Le remanieur refuse donc clairement le discours misogyne, de même que Christine de Pizan, dans l’Epistre au dieu d’amours, loue aussi le « grant savoir64 » de celles qui n’aiment plus leur amant parce qu’elles ont été trahies. On pense aussi au poème Vous semble il que fausseté soit ?, dans lequel Christine de Pizan suggère qu’une femme n’agit pas mal en choisissant un autre amant si le premier s’est retiré et l’a trompée. Deux conceptions de la femme et de l’amour s’opposent donc dans les versions originale et remaniée de l’Ovide moralisé, et plus largement dans le remaniement Z et d’autres textes. Chez Eustache Deschamps, par exemple, Déjanire (confondue dans Z avec Iole) est condamnée65. Au contraire, en plaçant du côté de la raison la recherche d’un autre ami, le nouvel auteur dit que l’amour est naturel et que s’enfermer dans le chagrin ou surtout s’obstiner à aimer sans retour est contre-nature. Il va plus loin encore que Boccace dans sa défense des femmes illustres. Ce dernier a effectivement une « obsession de l’honnête veuvage66 ». Son admiration de Didon, par exemple, qu’il considère comme « exemple vénérable, exemple éternel d’un veuvage infrangible67 », nous semble à l’opposé de la morale pratique que propose le rédacteur de la famille Z, tout comme Christine de Pizan.
Il en va de même pour l’exposition de l’histoire d’amour entre Orphée et Eurydice, à propos de la descente aux enfers d’Orphée parti chercher sa femme. Dans la fable, Eurydice se promène dans les champs. Un berger la voit, tente de la courtiser, mais celle-ci s’enfuit en courant. Dans sa fuite, elle est piquée par un serpent. Elle meurt de cet accident, et descend aux enfers. Orphée tente alors de la sauver. Le remanieur développe nettement l’exposition historique de ce récit, lui donnant un sens qui s’oppose à celui des allégories spirituelles qu’il supprime. Dans la première de ces allégories, Eurydice représente « la sensualité de 114l’ame » qui fut piquée par le serpent, c’est-à-dire le diable qui inocule le péché. De son côté, le remanieur analyse la fuite d’Eurydice de façon positive, dans son interprétation concrète :
|
Ovide moralisé original Allégorie spirituelle |
Ovide moralisé remanié Exposition historique remaniée |
|
Mes quant la sensualité Qui trop s’esloigne folement De raisonable entendement, Est teulz que vertus li enuie, Et tele amour refuse et fuie, Si vait corant a descouvert, Toute nuz piés en l’erbe vert, C’est a dire par les malices De ces terriennes delices Dont elle abuse folement. (éd. C. De Boer, X, v. 231-240) |
La fuite que la fable entant Veult dire que celle deffent S’amour pour estriver mout fort, Mes le serpent ou pié la mort, Dont mort li en est ensuvie : C’est que cil l’a tant poursuivie Qu’elle plus ne se set deffendre. (X, v. 208-214) |
Le mouvement décrit n’est pas le même dans les deux textes. Dans Z sont répétés des verbes d’empêchement qui signalent que la jeune fille tente de garder un contrôle sur la situation. Dans la version originale, sa fuite représente au contraire la façon dont elle se laisse aller au péché. L’auteur initial, par la mise en valeur de la folie à travers la répétition de l’adverbe « follement » et par l’emploi du verbe « abuser », signale qu’Eurydice se complaît dans le mal. D’un côté on stigmatise la sensualité, de l’autre on exprime implicitement la chasteté de la femme. Ainsi, il nous semble que le remanieur défend plus volontiers les personnages féminins que celui qui est à l’origine de l’Ovide moralisé. Il change ou développe parfois l’exposition pour exprimer une vision plus positive de la femme. On peut d’ailleurs penser qu’il modifie l’interprétation d’Eurydice pour réhabiliter la jeune fille dont le comportement est condamné dans l’allégorie spirituelle de l’Ovide moralisé original.
Cet attrait pour l’amour et les personnages féminins laisse entendre les désaccords du remanieur vis-à-vis de l’auteur original mais aussi les polémiques sur le Roman de la Rose de Jean de Meun. Le réviseur ne fait pas une peinture idéalisée du sentiment amoureux, comme dans l’amour courtois, mais il s’attache plutôt à exprimer la fausseté de certains discours masculins et à dire la nécessité naturelle et non spirituelle de l’amour. On peut également lire dans l’attention accordée à l’amour, aux figures féminines, un rapport avec les premières mises en roman qui marquent « un intérêt pour les mouvements de cœur, pour les sentiments amoureux, 115pour les personnages féminins68 », à l’inverse de la chanson de geste. Sans former un roman, notre texte emprunte à ce genre69. Par ces deux sujets le remanieur signale qu’il partage certaines positions avec le premier auteur, en même temps qu’il s’en démarque, parfois nettement.
Dans la tradition de l’Ovide moralisé, il est le seul à prendre ouvertement le parti des femmes. Aucun des deux prosateurs de l’Ovide moralisé n’accuse aussi lourdement Jason, Énée ou Thésée pour leur versatilité, par exemple. Ils ne détournent pas non plus les propos misogynes du premier auteur en défense des femmes. En cela, le remanieur a une position spéciale, en faveur des femmes.
Le remaniement Z s’intègre ainsi dans les polémiques littéraires, sociales et morales de son temps plutôt qu’il n’aborde des questions spirituelles. L’auteur de Ovide moralisé original n’est pas foncièrement misogyne, comme Jean de Meun peut l’être : il adapte plutôt le caractère de ses personnages, féminins ou masculins, à l’interprétation spirituelle qu’il veut donner de leurs aventures, et qui pour lui est première. Au contraire, pour le réviseur la psychologie amoureuse, la place des femmes sont primordiales. Il opère donc un véritable renversement de perspective. Cette nouvelle orientation s’accompagne d’une réévaluation de la posture de l’auteur. Le remanieur ne se définit pas en prédicateur70 qui bâtit son œuvre autour du dogme chrétien, mais plutôt en conteur, en moraliste aussi, mais en vue d’une éthique sociale. Par la mise en place de sa propre posture, le rédacteur de la version Z entame une discussion autour de la notion de vérité.
116Auctorialité et vérité
Posture auctoriale : une réappropriation antagoniste
Un moraliste
Le nouvel auteur cherche derrière les fables à décrire le monde, mais aussi à amener son lecteur vers ce qui est préférable pour son bonheur. Cette morale ne doit rien au dogme chrétien. Elle s’applique plutôt à la sphère sociale et désigne ce qu’il est bon de faire ou ne pas faire dans le monde d’ici-bas. Le remanieur nous semble donc pouvoir être qualifié de « moraliste », au sens que le mot peut avoir dans le Trésor de la Langue française : « personne qui observe la nature humaine, les mœurs, réfléchit sur elles, et en tire une morale ». En effet, en reprenant à son compte les fables traduites par l’auteur de l’Ovide moralisé,il se pose d’une part en observateur d’un monde que figure la fable et d’autre part il exprime son jugement moral en interprétant ces récits.
Quoiqu’il s’intéresse à l’histoire, à la physique, le rédacteur du remaniement ne renonce pas aux exposés à valeur moralisante. Ainsi, il se comporte parfois comme le premier auteur. Par exemple, il reprend volontiers le prêche contre les médisants, dans l’exposition de la fable du corbeau. Il recourt lui aussi à la modalité déontique, lorsqu’il exprime que « Nul ne doit amer jangleour, / Ne soy fier en losengeour » (II, v. 1791-1792). Il manifeste sa colère, entraînant le public avec lui, notamment quand il recopie certains vers tels que « Dieux confonde les losiengeurs ! » (II, v. 1804). Il reprend ainsi à la fois une constante sous la plume des auteurs de romans, mais aussi un trait de l’auteur de l’Ovide moralisé. Il lui arrive même d’adopter son ton, comme par exemple au début de sa nouvelle interprétation de Callisto :
Bien doit ceste fable noter
Et en son memoire porter
Femme qui est d’amours priee… (II, v. 1112-1114)
Les fins de vers « noter » et « memoire porter » se font écho et soulignent la dimension morale de l’exposition, que désigne également l’emploi de la modalité déontique. Dans la conclusion de son interprétation, le recours à la première personne du singulier signale aussi une prise de position morale :
117Mes, qui que plaisse ou desplaisse,
Ja ne sera que je m’en taisse,
Car se femme croit mon conseil,
Je li lo et moult li conseil
Qu’elle ne croye homme en tel cas. (II, v. 1180-1184)
Le remanieur laisse entendre son agacement par l’emploi d’hyperboles telles que « ja ne sera ». Cette stratégie énonciative vise l’adhésion du lecteur. La reprise du verbe « croire » crée un schéma très simple où s’opposent le bien et le mal. Le bien à suivre figure dans le discours de l’auteur ; le mal dans celui des amants fourbes. Le nouvel auteur adopte donc la même stratégie énonciative que le premier qui insiste sur la valeur édifiante des fables en prenant la posture d’un moraliste71. C’est en particulier le cas pour le mythe de Callisto dans lequel le remanieur usurpe pleinement la voix du premier auteur et revêt sa posture pour remplacer l’interprétation de la fable par la sienne72.
Mais cette détermination s’applique plus souvent que chez l’auteur original à une morale sociale, à des thématiques liées à la vie d’ici-bas. Par exemple, dans l’exposition de Callisto, il traite de l’honneur des femmes et de leur réputation. Dans celle de Bacchus, il déplore les dégâts causés par l’abus d’alcool. Il termine notamment cette exposition par le constat suivant :
Si m’est vis que encor a duree
Celle vie desmesuree,
Car nous voions mains crestiens
Errer, si com firent paiens,
Car de leur pance font leur dieux
Femmes, homes, jenes et vieulx,
Dont maint grant maux s’en ensuivent
Par ceux qui souvent s’enyvrent,
Dont mout est chouse abominable
A creature raisounable
De s’abandouner a tant boire
Qu’il en perde sens et memoire. (III, v. 2306-2317)
Le ton est nettement réprobateur. La rime « memoire » / « boire » acquiert une valeur mnémotechnique, révélant que la boisson est intimement liée 118à une diminution des capacités intellectuelles. L’accumulation « femmes, hommes, jenes et vieulx » et l’hyperbole « maint grant maux s’ensuivent » expriment le pouvoir dévastateur de la boisson. Le remanieur, en déplorant les méfaits de l’alcool, adopte donc les mêmes stratégies de persuasion que l’auteur de l’Ovide moralisé. Il condamne lui aussi l’abus de boisson, car le thème est social. En effet, l’adaptateur ne renvoie pas aux théologiens qui boivent alors qu’ils sont censés exhorter le peuple à faire le bien, comme dans la version moralisée du début du xive siècle. Il vise toute la population, s’adresse à tout homme, comme en témoigne l’emploi du singulier généralisant « A creature raisounable ». Il ne pense pas à ce qui est bon pour le Salut de l’âme, mais seulement au bon fonctionnement de la société. Cet aspect se retrouve dans la mention topique de toutes les couches et âges de la société : « femmes, homes, jenes et vieulx ». Le thème des méfaits de l’alcool revient dans l’interprétation de la fable des Minéides, métamorphosées en chauves-souris pour avoir méprisé Bacchus. Le réviseur modifie cette lecture, en qualifiant l’exposition de « sens morel » (c’est-à-dire « moral »)73. D’après le DMF est « moral » ce qui est « relatif aux mœurs, au comportement social, aux règles de conduite, à la morale » ou ce qui est « conforme à la morale74 ». En spécifiant ainsi à quel domaine appartient son interprétation revisitée, le remanieur se place en moraliste, uniquement préoccupé de ce qui relève du monde matériel et temporel. Mais l’emploi de la forme « morel » au lieu de « moral »a peut-être un double sens : le remanieur fait probablement une allusion à Eustache Morel, autre nom d’Eustache Deschamps, qui dans sa poésie décrit le monde contemporain avec un regard moral, et ironique. L’ironie du remanieur serait quant à elle de faire allusion à Eustache Deschamps dans un passage condamnant les méfaits de l’alcool, alors que ce poète vante habituellement les bienfaits du vin. Eustache Deschamps dépeint néanmoins les effets d’une consommation excessive d’alcool. Tel est le cas de la ballade 1121 Contre excès ou encore du Dit des quatre offices du roi dans lequel Panneterie énumère joyeusement les excès qu’engendre le fait de boire à jeun. En outre, l’interprétation de l’Ovide moralisé,qu’augmente le remanieur, est l’une des rares qui s’attachent à retranscrire les détails réalistes de la vie d’un milieu modeste, ici de celui de tisserandes. La tonalité et la thématique se rapprochent donc de celle des poèmes d’Eustache 119Deschamps. Par ce biais, le remanieur s’amuse à prendre le rôle et la posture du poète moraliste par excellence, Eustache Deschamps.
Le thème de la renommée, dont le réviseur traite par exemple dans l’exposition de la fable du corbeau, est lui aussi social. C’est pourquoi l’adaptateur n’hésite pas, pour ce cas, à reprendre l’exposition morale de l’auteur original qui dénonce les effets dévastateurs de la mauvaise parole sur la réputation de tout homme. En outre, lorsqu’il aborde l’orgueil, qui est pourtant le péché capital, le remanieur se contente d’une réflexion morale à valeur universalisante, sans recourir à un exposé dogmatique. Nous en avons un exemple pour l’exposition du mythe de Narcisse qui se termine par un court conseil au lecteur : « Si ne soit nullui ourguilleux, / Car en riens ne peut valoir mieux » (III, v. 1654-1655). Ces vers sont laconiques, par comparaison avec la peinture conclusive du sort qui attend les orgueilleux, dans la version originale :
Trop sont cil fol et non sachent
Qui pour tel biauté s’orgueillissent,
Quant en si poi d’ore perissent,
Quar nous n’avons point de demain :
Teulz est riches ou biaus au main,
Qui ains le soir a tout perdu.
Trop a cil le cuer esperdu
Qui pour tel vain bien et muable
Pert la grant joie pardurable,
Et se mire ou tenebreus font
D’enfer et d’abisme parfont. (éd. C. De Boer, III, v. 1892-1902)
Le nouveau rédacteur n’adopte pas l’attitude du prédicateur qui cherche à marquer profondément le public en décrivant l’image terrible de l’enfer, par exemple. Il n’utilise pas les tableaux apocalyptiques, outils d’une « pastorale de la peur75 ». Il ne scande pas le texte par la répétition de la structure « Trop […] qui » visant à pénétrer l’esprit du lecteur. Il ne joue pas d’effets terrifiants tels que la rime « s’orgueillissent »/« perissent ». Il livre seulement une morale de vie, qui est en rapport avec les faits de la fable et non avec le dogme chrétien. Cet aspect apparaît très bien dans l’exposition qu’il crée pour la fable de Pygmalion et qui est l’occasion de promouvoir le mariage, présenté comme un rite social, très concret, qui vient combler un désir de vie commune avec un membre du sexe opposé.
120Ainsi, l’œuvre n’a pas perdu sa valeur éthique. La morale chrétienne spirituelle qui a pour but le Salut de l’âme est seulement remplacée par une morale sociale, pragmatique. Le prédicateur est évincé par le moraliste, ou plus précisément par l’historien.
Un poète historien
L’histoire se conçoit comme le récit de faits passés (Historia est narratio rei gestae76), mais aussi comme une image des règles de conduite à adopter. « Il n’est pas un historien qui n’ait annoncé dans sa préface son intention de donner “le bon exemple” pour “mouvoir a vertus” ses lecteurs, ou plus généralement, d’écrire pour que son lecteur “voie clairement ce qu’il doit éviter avec soin et ce qu’il doit principalement rechercher”77 ». Jean de Courcy, auteur de la Bouquechardière, une histoire universelle du monde de sa création jusqu’à Jules César, explique que le passé l’intéresse en tant que « substance de fait de haute memoire, coulouree de couleur historial et oudeur de moralité78 ». La coordination entre la « couleur historial » et l’« odeur de moralité79 » lie intimement le récit des faits passés à la morale. La valeur édifiante encore présente dans notre version correspond à une certaine définition de l’historien et du poète. Pour J.-C. Payen,
l’historien (et le poète) sont les dépositaires de la mémoire. Ils inscrivent le souvenir des hauts faits, en même temps qu’ils enseignent les conduites qu’il faut éviter. Jean de Meung revendique l’association des clercs au pouvoir, parce qu’ils ont lu dans les annales l’expérience irremplaçable du passé80.
Le remanieur est lui aussi un historien ou un poète au sens où il reprend une fiction qu’il ramène à des faits réels et en dégage une certaine morale, une vérité qui aide à vivre dans le présent.
Cette porosité entre l’imagination littéraire (posture de poète) et l’interprétation historique (posture d’historien) se conçoit déjà dans 121l’Ovide moralisé initial81. Elle se manifeste aussi dans Z, notamment à travers l’emploi ambigu du nom « histoire82 ». Par exemple, le remanieur introduit sa nouvelle exposition sur Actéon de la façon suivante : « Or vous vueil exposser la fable / Dont l’istoire fu veritable » (III, v. 582-583). L’« istoire » dont il est question ne pouvant pas être le récit invraisemblable de la métamorphose d’Actéon, elle renvoie certainement à la narration qui entoure ce phénomène, et que reprend point par point l’interprète. On est ici à la limite de la fable, au sens de mensonge, et du vrai ; et le pont entre les deux est la poésie de l’expression, la construction d’un sens (caché ou dévoilé) par une fiction narrative, par une figuration littéraire du réel.
Ainsi, les interprétations du remanieur se veulent littéraires. Le remanieur tisse le récit pour confectionner un petit texte agréable à lire, comme le ferait un poète, un conteur. Il reprend, dans l’interprétation de la fable, une structuration narrative proche du conte (situation initiale, élément perturbateur, péripéties, situation finale83). Il réemploie également des stéréotypes romanesques, comme par exemple dans l’exposition de Pasiphaé. Les premiers vers donnent le cadre de la narration et disent son contenu :
Exposser vous vueil la fable
Conme au droit sens est acordable
De Pasiphe qui fu roïne,
Feme Minos, qui ne fu digne
De nulle digneté avoir,
Et de ce dist la fable voir
Que dissolue et malle vie
Mena celle qui n’ot envie
De nul bien ne de nul honnour. (VIII, v. 802-810)
Ce cadre vaut aussi bien pour un récit imaginaire que véridique. Le remanieur signale ensuite l’entrée dans le récit évhémériste, comme il le faisait dans le récit fabuleux, par l’emploi du marqueur temporel « un jour » qui inscrit l’action dans le passé. On lit dans la fable que Pasiphaé « ·i· jour a ses fenestres vint, / La s’apuya et la se tint » (VIII, v. 122356-357), et dans l’exposition que « Apoiee fu ·i· jour / A une fenestre au palais » (VIII, v. 812-813). L’emploi du passé simple, temps spécifique du récit, est d’ailleurs un autre élément qui signale le conte. De sa fenêtre, Pasiphaé tombe alors amoureuse de l’homme qu’elle voit passer. Cette réaction renvoie bien sûr au récit de la fable84 mais également à un stéréotype littéraire qui confère une tonalité romanesque à l’exposition85. Le récit se termine enfin sur les vers suivants :
Et pour ce que le corps ot bel
Et fort yere et fel et cruel,
Faint la fable qu’il avoit
Domble fourme, car il estoit
Honme bien fourmé et bel,
Mes nature avoit de torel ;
Et encore causse y a plus,
Car nonmés fu Minostaurus
Pour sa mere qui fu feme
Au roi Minos, mes pour l’infeme
D’elle et de li, il fu encor
Surnonmé par le non de “tor”. (VIII, v. 876-887)
Ces vers conclusifs montrent que celui qui réécrit l’Ovide moralisé cherche l’explication d’un phénomène invraisemblable, s’efforçant d’établir une forte collusion entre le domaine littéraire et le domaine interprétatif. Dans cette exposition, deux postures se dessinent donc. Les premiers vers associent « le droit sans », c’est-à-dire la vérité de la fable, au récit d’événements réels, car il est question d’une reine appelée Pasiphaé, qui exista vraiment. La référence à un « droit sans » suggère donc que l’écrivain se fait historien. De son côté, le corps du texte, par les topoï romanesques qui sont réinvestis, fait coïncider l’imaginaire et la réalité. L’agencement du récit et les thématiques qui y sont développées font tendre vers le fabliau86. Ainsi, le réviseur apparaît à la fois comme un poète ou un fabuliste et un historien.
La façon dont il entremêle physique et histoire, au sens évhémériste du terme, témoigne également de la complexité de sa posture. Son 123exposition de la naissance de Bacchus reprend, par exemple, les éléments de la lecture selon les « naturiens » qu’offre la version commune, mais ces éléments sont contenus dans un cadre historique. La matière est introduite par la mention « Or est raison que je reviegne / A l’istoire » (III, v. 889-890). L’interprétation se présente donc à la fois comme naturelle et historique. Puis, le réviseur continue en expliquant la mort de Sémélé :
Se nous note et senefie
Une anee qui fu jadis,
Ou le temps fu froit et tardis. (III, v. 896-898)
Le complément d’objet « une annee qui fu jadis » ancre le propos dans l’histoire. Enfin, le rédacteur insiste encore sur le cadre temporel :
Jupiter, dont tous biens venoit,
Si comme en ce temps on creoit,
Semellé ama en ce temps :
C’est la vigne ou ot dedens
Engendré le fruit, mes dehors
Il n’aparoit mie en corps. (III, v. 899-904)
La répétition du complément « en ce temps » témoigne d’une volonté d’associer l’explication d’un fait physique (la naissance de la vigne) et la mise en perspective historique, comme deux composantes indissociables pour comprendre la réalité cachée sous le mensonge de la fable. Le réviseur œuvre également de la même façon pour l’interprétation de la fable des Minéides (éd. C. De Boer, IV, v. 2448-2529 ; IV, v. 1703-1810 dans Z). Il la développe notamment par les vers :
Qui au morel sens veut descendre
Par ses ·iii· seurs peut on entendre
Que ·iii· filles voirement furent
Jadis, qui leur entente eurent
A tistre, a filler lin et laine,
Et chascune metoit grant paine
A gaigner pour avoir leur vie.
Mout sobrement, sens lecherie,
Vivoient tout coietement.
Ainssi le firent longuement,
Et ceulx avoient en despris
Qui lecherie orent apris.
Entre elles escharnissoient
Ceus qui surpris de vin veoient.
124Mes nul ne se doit trop fier
En soi ne soi glorifier,
Car telz est au jour d’ui bien bon
Qui demain yert faux et felon.
Celles qui moquer se soloient
De ceus qui dissolus veoient
Prindrent au vin tel appetit
Qu’assés n’en orent d’un petit.
Ains en burent si largement
Que il n’orent mes nul garnement
Ne or ne argent pour vin avoir.
N’ont mes entente a autre avoir. (IV, v. 1703-1728)
Ce passage est nettement plus bavard que les vers liminaires de l’exposition initiale : « Selonc que la fable devise / M’est avis que Baccus desprise / Cil qui vins boit outre mesure / Et cil qui dou boivre n’a cure » (éd. C. De Boer, IV, v. 2448-2452). Par l’attestation de vérité « ·iii· filles voirement furent / Jadis », le nouvel écrivain ajoute une dimension historique à l’interprétation. L’entrelacement du présent à valeur de vérité générale (« mes nul ne se doit trop fier […] / Car telz est au jour d’ui bien bon ») et des temps du passé traduit également la nature historico-morale du propos. Un véritable cadre se dessine ici : un temps (jadis), des personnages (trois sœurs), leur condition (peu d’argent), le mode de vie des personnages (une existence simple et sobre), la description d’une activité (le tissage). Le début de l’exposition est donc enrichi par la peinture d’un tableau réaliste, qui traduit une volonté de développer le cadre concret qu’évoque déjà l’exposition initiale. Il y est en effet question, dans un premier temps, de l’activité matérielle des Minéides, puis dans un second de l’énumération des dégâts sensibles de l’alcool, pour finir sur l’évocation succincte de la perte des biens spirituels87. Tous ces éléments sont repris dans Z, mais le remanieur préfère leur donner un cadre historique.
Ainsi, il se désigne comme un poète ou un conteur, car il construit habilement son récit, et comme un historien, car il décèle sous la fable la vérité des faits historiques et de la morale. La porosité entre ces deux univers (fiction/réalité) et les différentes postures que prend conjointement le remanieur attestent de la collusion qu’il cherche à établir entre une tradition exégétique et une tradition littéraire. Cette nouvelle posture exprime une mise à distance de l’autorité de l’exégète des Métamorphoses.
125Tuer le père
Pour M. Zink, l’allégorie, prise dans son sens large d’interprétation, est le signe de la subjectivité de l’auteur. Ceci s’applique partiellement à notre texte. L’adaptateur affirme bien souvent, dans l’exposition, sa différence par rapport à l’auteur original. Il défend volontiers tel ou tel personnage, telle ou telle vision de l’amour, en opposition avec son prédécesseur. Le fait que, dans ce genre de passages, il endosse le rôle d’historien, de conteur et de moraliste indique que l’exposition est le lieu d’expression d’une nouvelle posture auctoriale.
Le nouveau statut que le remanieur s’octroie témoigne d’une mise à distance de la figure du premier auteur. L’adaptateur ne semble pas lui accorder beaucoup de crédit, pour ce qui concerne les allégories religieuses. Il le met volontairement à distance. Selon M.-R. Jung, « pour les manuscrits du groupe z, […], l’auteur de l’Ovide moralisé ne représente aucune “auctoritas”88 ». Cet aspect est corroboré par la façon dont le réviseur usurpe la voix de l’auteur original. En effet, M.-R. Jung montre qu’il s’approprie parfois, sans le dire, le titre de « translateur89 » qui est censé désigner l’auteur original de l’Ovide moralisé, dans certaines rubriques des manuscrits de la famille Z. Par exemple, l’interprétation historique de la fable de Deucalion et Pyrrha est structurée par plusieurs rubriques90 où apparaît ce titre : Translateur raconte de la Bible (I, v. 1326rubr.) ; Cy parle le translateur de ce livre de Nambrot et des Babiloniens (I, v. 1389rubr.). Le lecteur pourrait penser que le « translateur » représente le traducteur d’Ovide et donc l’auteur de l’Ovide moralisé original. Tel est bien le cas pour l’exposition sur Deucalion et Pyrrha que reprend l’adaptateur sans la modifier. Pourtant, au livre II, la même désignation renvoie au remanieur, dans la rubrique qui introduit une lecture historique inédite91 : Coment Caliste muee en ource fut faite. Translateur : enseignement (II, v. 1112rubr.). Une autre 126rubrique Translateur apparaît dans le passage où le nouvel auteur explique la raison pour laquelle il a supprimé les allégories. Dans ces deux cas, le « translateur » renvoie forcément à l’adaptateur. Ce dernier usurpe donc le nom de « translateur », se faisant ainsi passer pour l’auteur original du texte92, ou du moins le rubriqueur l’a jugé comme tel. Selon M.-R. Jung, le but de ce stratagème est de « prendre ses distances par rapport aux traductions allégorisées93 ». De nombreuses rubriques appelées Ovide acteur, Ovide poete ou Ovide laissent également entendre que le texte représente une traduction fidèle et non remaniée des Métamorphoses. C’est le cas pour les fables de Pyrame et Thisbé, de Phrixus et Hellé, ainsi que pour celle de Héro et Léandre94. On retrouve également dans nos manuscrits des « citations latines d’un certain nombre de vers des Métamorphoses » qui « pourraient faire croire au lecteur qu’il a affaire à une bonne traduction des fables d’Ovide95 ». Cette façon de faire oublier que le texte est un remaniement permet à son rédacteur de prendre la place de l’auteur.
Dans le prologue d’autres refontes96, celui qui reprend en mains le texte signale sa démarche, comme par exemple dans le Roman de la Violette où le prosateur annonce, dans son prologue, travailler à partir d’un livre, « lequel estoit en langage provençal et moult dificile a entendre97 ». Dans la mise en prose de l’Ovide moralisé commandée par René d’Anjou, le copiste rappelle que le texte n’est pas le sien, mais qu’il l’a modifié pour répondre aux attentes de son mécène98. Au contraire, notre adaptateur n’énonce jamais qu’il réinvestit un texte existant. Il le suggère seulement à la toute fin de l’ouvrage, lorsqu’il fait allusion à une version allégorisée :
127Qui n’i met autre entendement
Que la lectre ne samble avoir,
Et qui croiroit, pour non savoir,
Qu’il n’i eüst autre sentence,
Il se deceuvroit, sanz dombtance.
Mes en ce livre je n’é mie
Escripte nulle allegorie99. (XV, v. 1184-1190)
Ce pied de nez trahit une forme de désinvolture et parachève ainsi les opérations de mise à distance du premier interprète des Métamorphoses d’Ovide. Le texte passe ainsi pour une traduction du poème ovidien, interprétée à la lumière de l’histoire et de la physique. Le remaniement Z se termine même sur cette usurpation. Une dernière rubrique Translateur introduit l’épilogue du remanieur qui affirme avoir terminé ici sa « translacion » :
Or ai trait a conclusion
La fin de ma translacion,
Et vous jure par saint Martin
Que de ce livre c’est la ffin. (XV, v. 2478-2481)
La référence à saint Martin semble elle aussi participer de cette appropriation du texte. Le saint est connu pour avoir partagé son manteau avec un miséreux. Selon une image de la fable comme le manteau qui cache le sens profond que découvre l’integumentum, le remanieur exprime peut-être ici avec ironie la façon dont il partage le texte avec un autre. Le manteau renvoie aussi au déguisement et donc à la manière dont le réviseur endosse le costume du premier auteur, prend le masque d’un autre. La réécriture se révèle et se dissimule subtilement. Dans la seconde mise en prose de l’Ovide moralisé, le copiste n’exprime pas non plus clairement qu’il travaille à partir d’une version en vers. Lui aussi s’octroie le statut du premier auteur. Il n’affirme pas que l’auteur est le traducteur, mais il l’assimile à Ovide, notamment lorsqu’il écrit : « je vueil reciter selon mon acteur Ovide les fables de l’ancien temps100 ». Il prend lui aussi la place du « translateur » des Métamorphoses. Son texte ne contient pas non plus les allégories spirituelles. Le scribe du témoin B de l’Ovide moralisé, qui se défait lui aussi des interprétations anagogiques, supprime des éléments du prologue original mais sans jamais le signaler. Il ne se présente jamais comme un nouvel auteur 128mais reprend à son compte le texte initial, bien qu’il en ait changé la portée. Il semblerait donc que la stratégie visant à ne pas affirmer que le texte constitue une réécriture de l’Ovide moralisé original soit liée à la suppression de la matière théologique. Il y aurait ici l’expression d’une volonté de faire oublier que la première « translation » des Métamorphoses d’Ovide s’est faite à la lumière de la vérité chrétienne. Au xve siècle, un pan des relecteurs de l’Ovide moralisé a probablement souhaité revenir au texte ovidien, sans pour autant avoir les moyens de traduire le texte du latin au français sur nouveaux frais.
Le remanieur semble effectivement reprocher à celui qui pour la première fois a traduit et allégorisé les Métamorphoses d’avoir lu le texte comme un théologien, un prédicateur. C’est pourquoi il choisit plutôt, quant à lui, la position du fabuliste-moraliste, de l’historien-poète. Les dispositifs mis en place pour faire oublier la voix de ce premier auteur, voire l’usurper, attestent du rejet de la posture auctoriale dans l’Ovide moralisé initial. Ce stratagème n’est pas un simple jeu rhétorique. Il cache une discussion d’ordre philosophique concernant le processus d’allégorisation des fables antiques.
La notion de vérité en question
Nous avons étudié comment le nouvel auteur construit son prologue en opposition avec celui du premier traducteur des Métamorphoses, en rejetant l’idée que tout récit finisse par ne renvoyer, de façon nécessaire, qu’à l’unique vérité chrétienne. Il lui préfère une pluralité de significations, toutes humaines, qu’il désigne comme « Mainte grant science notable, / Maint secret, mainte demoustrance » (I, v. 100-101). La question ontologique représente ainsi un point central autour duquel s’articule notre réécriture. Bien des passages semblent effectivement remaniés dans le but d’asseoir un nouveau type de vérité, même si le remanieur n’affirme jamais ouvertement qu’il propose une autre interprétation des fables.
Pourtant, il utilise un vocabulaire axiologique qui laisse entendre un dialogue implicite : « vraye histoire », « vraye exposition », « droit sens ».Ces expressions renvoient à un système de valeurs qui, dans le jeu de réécriture, s’oppose à celui qu’a établi le clerc anonyme du début du xive siècle. L’adaptateur manie ce lexique quand il développe 129l’interprétation historique ou en ajoute une nouvelle : sa discussion avec le premier Ovide moralisé concerne donc la vérité de la fable. Alors qu’il adjoint une trame narrative faisant de l’exposition physique sur Bacchus une lecture physico-historique, le nouveau rédacteur conclut de la sorte son interprétation : « Vous avés de la fable oïe / La vraye exposicion » (III, v. 932-933). Lorsqu’on sait que la meilleure signification est pour l’auteur original religieuse101, c’est-à-dire en l’occurrence celle qui représente Bacchus comme le Christ, on ne peut que penser que l’emploi de l’adjectif « vraye » n’est pas anodin dans ce contexte de remaniement et engage un dialogue sous-jacent. L’adaptateur souligne ainsi que la vérité de la fable ne peut résider que dans sa lecture concrète. Au livre XII, le remanieur emploie de nouveau cet adjectif à valeur axiologique lorsqu’il évoque la « pure vraie histoire / Qui est aprovee estre voire102 » de la mort d’Hector (XII, v. 2978-2979). Cette formulation désigne un ajout qui rétablit la valeur d’Hector et discrédite la lecture d’Ovide103 qui loue Achille et prend son parti, même dans le meurtre d’Hector. Mais, selon M.-R. Jung, les rubriques intitulées Ovide désignent ce qui constitue la traduction revue et amplifiée des Métamorphoses104. Dans ce cas, la référence à Ovide dans ce nouvel extrait pourrait désigner en réalité l’auteur original de l’Ovide moralisé. En effet, ce dernier interprète, dans son allégorie religieuse, Hector comme le diable, ce qui a pu déranger le réviseur qui souhaite au contraire redorer le blason d’Hector. L’adaptateur s’en prendrait donc implicitement à sa source directe. Lorsqu’il développe ou ajoute une exposition, il exprime de façon subtile son désaccord concernant la vérité que l’auteur applique à la fable. L’essence de cette réécriture, ou plutôt « contre-écriture », figure 130dans l’expression d’une nouvelle forme de signification, qui se construit en opposition avec la première version de l’Ovide moralisé.
L’expression de ce « débat » se lit encore une fois dans la majorité des passages propres au réviseur. Par exemple, au livre II, ce dernier reprend et adapte l’interprétation historique de la fable d’Europe. Les autres scribes de l’Ovide moralisé introduisent l’exposition par les mots : « L’estoire dist qu’ensi avint / Que Jupiter de Crete vint » (éd. C. De Boer, II, v. 5085-5086). Dans la nouvelle version, ces vers introducteurs sont complétés par : « Qui la fable entant proprement / Bien est a l’istoire accordant » (II, v. 2966-2967). L’adverbe « proprement » peut se lire comme une autre façon d’exprimer la sempiternelle formule introduisant l’exposition. Mais si l’on est conscient de la « contre-écriture », il exprime une volonté de s’opposer au premier texte quant à la signification de la fable. Nous apprenons dans le DMF que l’adverbe marque « l’idée d’insistance de la réalité de quelque chose, de la similitude de deux choses105 ». Par l’emploi de ce lexique, le remanieur définit donc la vérité du texte comme similitudo, comme un savoir qui reste très proche de l’énoncé ovidien, par opposé aux allégories religieuses qui ne lui conviennent pas car elles s’éloignent trop de leur source. Le rapport à la vérité est donc le point nodal, le moteur de cette « contre-écriture ». Ainsi, la nouvelle exposition historique de la fable de Pasiphaé débute en ces termes : « Exposser vous vueil la fable / Conme au droit sens est acordable » (VIII, v. 802-803). Le récit sur Pasiphaé n’est pas censé recevoir d’exposition évhémériste, puisqu’il est considéré comme historique au Moyen Âge. Le remanieur rappelle d’ailleurs, à la fin de son extrait, au moment où il commence le récit d’un nouvel épisode, que la fable qu’il a racontée « fut droite verité » (VIII, v. 889). Il laisse ainsi entendre qu’elle n’a pas besoin d’être exposée selon le sens concret. La présence d’une lecture historique pour le mythe de Pasiphaé surprend donc. Elle se justifie peut-être par un désir de confrontation, comme invite à le penser l’emploi de l’adjectif « droit » (« conforme à ce qui est vrai »), pour qualifier le « sens » de la fable106. Une fois de plus, le remanieur suggère que la nouveauté qu’il apporte concerne la vérité et que la signification de la fable telle que l’entend l’exégète chrétien (pour qui Pasiphaé représente Judée) 131n’est pas conforme à cette vérité. Une nouvelle exposition vient encore supplanter une analogie entre un autre personnage féminin et Judée : l’« enseignement » sur Callisto. Cette façon d’ajouter des expositions évhéméristes alors que le texte en est déjà pourvu, comme c’est le cas pour Callisto, ou que la matière n’a pas besoin d’être interprétée d’un point de vue concret, comme c’est le cas pour Pasiphaé, suggère que le remanieur n’apprécie pas les comparaisons avec Judée. Peut-être affirme-t-il sa position pour ces deux fables, car il lui semble incroyable de mettre sur un même plan Callisto, chaste jeune fille victime de Jupiter, et Pasiphaé consumée d’un désir coupable. Il revendique donc, comme une préoccupation centrale, une attention et une adéquation au sens littéral de la fable. C’est précisément ce que nous retrouvons dans un autre emploi de l’adjectif « droit », au début de l’« histoire » de Phaéton que développe l’adaptateur. Dans ce début, au lieu d’interpréter le récit « si com j’entens »,le remanieur précise vouloir livrer « La droite exposicion / Du pouete et l’entencion » (II, v. 572-573). Dans les vers qui suivent, il développe cette signification en remplaçant l’expression « com j’entens » par « entent » dont le sujet doit être Ovide.Avec le terme « entencion », il adopte peut-être l’attitude des auteurs d’accessus ad auctorem : l’un des aspects « obligés » dans ces accessus concernait justement « l’intention de l’auteur107 ». Le réviseur insiste sur le sens du récit, en reprenant le verbe « entent » par le substantif « entencion » et en qualifiant cette « entencion » de « droite ». Une discussion prend ainsi forme autour de la juste signification des fables. En opposant la subjectivité de l’auteur original à une autorité telle qu’Ovide, l’adaptateur discrédite le discours du premier auteur de l’Ovide moralisé sur la vérité de la fable. Étant donné qu’il développe de son côté l’interprétation historique par une vingtaine de vers qui expliquent tous les moments du récit, il reproche sans doute à l’exégète de ne pas respecter Ovide à la lettre, mais de divaguer ou ne pas se concentrer sur l’essentiel : l’interprétation concrète de la fiction, telle qu’aurait pu la faire Ovide lui-même. Cet aspect se retrouve dans la rime « exposicion »/« entencion » qui mime la façon dont l’interprétation et le sens que le poète latin a lui-même voulu donner à son propre récit doivent s’accorder. Le remanieur affiche ici sa marque de fabrique, insinuant que sa méthode est plus adéquate.
132Tous ces éléments prouvent que l’adaptateur n’attribue pas une grande autorité aux interprétations de l’Ovide moralisé du début du xive siècle. L’exposition représente le lieu privilégié d’un affrontement entre deux conceptions divergentes du commentaire de la matière ovidienne. En se faisant passer pour l’unique auteur du texte108, le remanieur cherche à imposer son mode de lecture concret des fables. Son souhait est de revenir à Ovide, en s’en remettant à une tradition plus ancienne de l’integumentum et plus proche de ce que pouvait connaître le poète antique.
Retour à la tradition antique de l’integumentum ?
En ne conservant que les « histoires » et les « expositions109 », notre remanieur s’apparente apparemment plus que l’auteur primitif aux conceptions antiques de la lecture allégorique.
L’exégèse de type physique provient des stoïciens qui font des dieux une « transposition anthropomorphique des forces élémentaires de la nature110 ». Ce genre d’explication est peu représenté dans l’Ovide moralisé, en comparaison des expositions historiques auxquelles l’auteur originel « accorde semble-t-il une valeur plus grande111 ». On pourrait dire la même chose du remanieur : il fait même parfois passer l’interprétation « selon la physique » après l’exposition « selon l’histoire », à l’inverse de l’ordre choisi par l’auteur initial. Ce réagencement signale que l’interprétation physique est reléguée au second plan. Par exemple, au livre I, l’exposition naturelle de la fable d’Argus suit l’exposition historique, contrairement à ce que proposent les autres manuscrits. En outre, certaines expositions naturelles se voient doublées d’une trame narrative, ce qui les place à mi-chemin entre l’histoire et la physique112.
L’« histoire », ce type d’interprétation qui intéresse tout particulièrement le remanieur, correspond normalement à l’interprétation de type évhémériste113. Elle s’inscrit dans une tradition antique initiée par Évhémère, auteur du milieu du iiie siècle avant J-C114. Ce mythographe est considéré 133comme l’instigateur de cet « allégorisme réaliste qui part de l’idée stoïcienne que les dieux de la mythologie sont des hommes divinisés115 ». Cette conception est marquée, dans les expositions historiques de l’Ovide moralisé initial et remanié, par l’assimilation des dieux à des hommes qui furent considérés comme des divinités. Par exemple, le dieu Saturne « fu de Crete rois » (Z, I, v. 218 ; éd. C. De Boer, I, v. 515) et se faisait « comme dieu servir et adorer » (Z, I, v. 221 ; éd. C. De Boer, I, v. 517). Ce transfert du divin vers l’humain apparaît dans la récurrence du verbe « acorder » pour désigner la façon dont l’exposition historique établit une correspondance entre la fable et l’histoire, c’est-à-dire le récit de faits avérés. Ce verbe caractérise l’exposition comme un pont entre deux réalités, comme un intermédiaire entre l’invraisemblance du récit ovidien et la rationalité du récit interprétatif. Par le truchement de l’exposition, les dieux païens sont ramenés à de simples hommes qu’un jour on désigna comme « dieux ».
Pour P. Demats d’ailleurs, ce type d’explication n’est pas une véritable exégèse : « à peine la peut-on qualifier d’interprétation, puisqu’elle se borne à passer le mythe au crible du bon sens afin d’en dégager, dans sa nudité et sa platitude, sa vraie signification littérale116 ». Cette conception nous semble correspondre à celle du remanieur qui s’attache uniquement à retrouver la signification littérale et concrète du texte, celle qui s’éloigne peu de la fable.
En outre, les interprètes qui recourent aux expositions historiques « n’attribuent jamais au poète qui a lancé ou répété la légende le dessein de cacher sous l’enveloppe fabuleuse une vérité des profondeurs, une vérité sous-jacente117 ». C’est bien là en partie la pensée de notre adaptateur. Les historiens ne font effectivement « jamais état de ce sens caché qui est le sens véritable118 ». Ceux qui s’adonnent aux explications historiques ne s’attachent « qu’à éliminer les extravagances qui sont le fruit de la superstition ou la trace du labeur poétique119 » et ne cherchent pas à exprimer une vérité cachée. Cette volonté de supprimer les « extravagances » de la fable est encore plus évidente120 dans Z, dont certains ajouts font correspondre les éléments extraordinaires du récit mythologique avec leur explication rationnelle, pour purger ce récit de 134tout élément trop invraisemblable. D’après S. Cerrito, avec le remaniement Z, « même les dieux perdent leurs droits aux pouvoirs magiques121 ». Le remanieur « efface toute façon ambigüe de traiter le surnaturel païen, et il est très attentif à ramener à la logique rationnelle des faits les miracles racontés par Ovide122 ». Un tel dessein pourrait expliquer pourquoi il cherche toujours à expliquer tous les aspects du mythe. Dans la fable sur l’enlèvement d’Europe, par exemple, il s’évertue à réduire le pouvoir divin de Jupiter à une puissance humaine, celle de tromper par le déguisement. C’est aussi le cas pour le récit des malheurs de Callisto : la métamorphose de Jupiter en Diane est comprise comme une image du masque qu’a pris Jupiter. Les dieux sont donc réduits à des hommes et toutes les extravagances sont évacuées.
Cependant, l’adaptateur ne nie pas que les fables ont un sens second123. Ainsi, plutôt que la vision d’Évhémère et ses continuateurs, il partage celle de l’histoire médiévale telle que la définit B. Guenée qui insiste sur la collusion entre le récit de faits passés et la morale124. Il s’intègre donc dans une vision laïcisée et concrète de l’integumentum. Il donne à lire ce qu’A. Strubel qualifie d’« “allégorisme” banalisé et laïcisé » qu’on retrouve à la fin de la période médiévale dans « une littérature allégorique laïque qui s’inspire de l’allégorie théologique, sans avoir à en respecter tous les enjeux […], en ne prétendant pas accéder ainsi aux secrets de la Création125 ». Les expositions historiques que le réviseur ajoute ne sont pas dictées par un retour aux auteurs évhéméristes antiques, mais sont plutôt influencées par la littérature, comme par exemple l’interprétation inédite126 de Pygmalion inspirée du Roman de la Rose, ou l’ajout sur la 135mort d’Hector qui réfère directement au Roman de Troie. En cela, nous ne pensons pas que la pratique du remanieur soit celle d’un humaniste soucieux de revenir à la lettre latine mais seulement celle d’un auteur cherchant à se rapprocher de l’esprit du texte premier. Certes, il donne l’impression de penser de l’auteur de l’Ovide moralisé la même chose que Rabelais qui se moque de sa lecture selon les Évangiles127. Mais, tout en préfigurant l’attitude ironique de Rabelais vis-à-vis de l’hypothétique interprétation religieuse des fables, il partage surtout avec Boccace l’idée que la fonction de la poésie est de mettre en mots par la fiction des allégories dévoilant l’ordre de la nature. Sa conception de la démarche interprétative se rapproche en effet de celle de Boccace qui considère que l’allégorie est le fondement initial de la poésie, cette « science vénérable », ce savoir-faire « plein de suc pour qui veut des fictions exprimer le sens128 ». Comme lui, il conçoit « la fabula comme une fable allégorique voilant et dévoilant l’ordre de la nature129 ». Boccace traite des Métamorphoses d’Ovide dans la Généalogie des dieux païens :
la surface mêle des éléments fabuleux à la vérité, comme lorsque nous racontons que les filles de Minée ont été changées en chauves-souris, pour avoir méprisé les fêtes de Bacchus tandis qu’elles tissaient, ou que les compagnons d’Acétès le marin, qui projetaient d’enlever Bacchus, furent changés en poissons. […] Ces fables, les poètes les plus anciens du premier âge les ont inventées : leur intention était d’habiller de fictions aussi bien les choses humaines que divines130.
Le prologue du nouvel Ovide moralisé énonce la même idée. En outre, le réviseur approuve la dimension cognitive et édifiante de la fable. Pour lui aussi « la beauté de l’écorce doit séduire le lecteur, c’est-à-dire l’inciter, par le plaisir de la lecture, à s’approcher des vérités que la fable renferme131 ». Mais, cela ne suffit pas à faire de lui un humaniste. D’ailleurs, si l’on en croit M.-R. Jung, il n’est pas retourné au texte 136latin des Métamorphoses132. Il cherche seulement à rester plus proche de l’esprit ovidien. Il précise dans son prologue qu’Ovide donna à ses fables un sens « Selon la loy dont il estoit, / Car d’autre cougnoissance n’oit » (I, v. 113-114). Le mot « loy » renvoie ici à la « loi payene » (I, v. 56) évoquée quelques vers en amont et qui s’oppose à la « loy » chrétienne. Le remanieur reconnaît bien sûr la supériorité de cette dernière sur la première, et professe que :
Jesucrist le filz Dieu nasqui,
Qui establi loy crestiene
Qui sur toute autre est certaine,
Ne il n’est autre loy creable,
A Dieu plaisent, ne agreable. (I, v. 66-70)
Cependant, il n’impose pas cette foi dans ses interprétations. Puisqu’il souligne le fait qu’Ovide ne pouvait penser selon la religion chrétienne, la volonté de s’en tenir à un mode de lecture de la fable pratiqué par les auteurs païens s’affirme comme une façon de conserver l’esprit des Métamorphoses.
D’ailleurs, la grande particularité du remaniement Z par rapport à l’Ovide moralisé premier, dans le traitement des interprétations concrètes, est la question de l’intention ovidienne. Le réviseur emploie des expressions qui présentent l’interprétation comme l’accord entre la fable et l’intention d’Ovide, alors que l’auteur original recherche l’accord entre la fable et la vérité (soit historique, soit chrétienne). Il se place sur le même plan que les auteurs d’accessus, qui tentent en particulier de percer « l’intention » de l’auctor. Ainsi, bien qu’il ne semble pas s’inspirer directement des commentateurs tels que Fulgence, les Mythographes du Vatican, Arnoul d’Orléans ou encore Jean de Garlande, le rédacteur de la famille Z applique la même démarche. Comme eux, il fournit seulement des explications physiques, historiques et morales aux fables.
En instaurant une discussion avec le clerc anonyme du début du xive siècle dont il usurpe la voix pour imposer la sienne, le nouvel auteur parvient à redéfinir le mot de « verité ». Pour son prédécesseur, cette dernière est uniquement chrétienne, surpassant en ce domaine les premiers niveaux d’interprétation. En désignant le contenu des interprétations sensibles comme « vrai », le remanieur impose une autre définition de la vérité qu’exprime la fiction ovidienne qui, selon lui, lui correspond mieux.
137Une vérité toute proche de la fable
Plus encore que l’auteur original, le remanieur cherche à coller le plus possible au récit de la fable lorsqu’il l’interprète. Une telle configuration s’explique par une recherche globale de cohésion, signe d’un esprit rationaliste, mais aussi par rapport à une définition de la vérité de la fable comme adéquation au sens littéral du texte, c’est-à-dire comme similitudo133. Le réviseur fait très attention à juxtaposer deux énoncés qui ont chacun leur cohérence : son interprétation se présente comme une transposition134 et une comparaison135. Selon l’adaptateur, la bonne explication est donc celle qui élucide tous les éléments de la fable, celle qui concorde le mieux avec elle. Par exemple, nous nous souvenons que le remanieur ajoute au sujet de Callisto une exposition qui met en garde les jeunes filles contre les trompeurs qui se déguisent à la façon de Jupiter. Il recopie dans un second temps la lecture évhémériste de l’Ovide moralisé original, mais il supprime la diatribe contre l’avortement qui y figure. Dans la fable, il n’est effectivement nullement question d’avortement. Il se peut donc que l’adaptateur propose de réviser les interprétations qui s’éloignent de la fable, qui ne lui semblent pas directement en rapport avec le texte. La vérité de la fable réside donc, selon lui, dans ce qui ressemble le plus à la fable. C’est pourquoi il reprend plus systématiquement les éléments de la fable dans l’exposition. Par exemple, dans l’interprétation d’Actéon, le remanieur présente le personnage (« Anthon fu un damoisiaux / Jeune, gentil, courtois et biaux », III, v. 584-585), comme il le fait dans l’introduction de la fable (« Antheon le gentilz / Fu mout a la chace ententis », III, v. 339-340). De même qu’au début de la fable (« Mes Fortune li fait contraire », III, v. 351), il désigne l’issue défavorable de l’aventure dans le préambule de son exposition (« Mes Fortune, qui ja nulli / N’espairgne, tant soit grant ne fort, / Ly nuysi tant qu’il en fu mort », III, v. 589-591). La répétition de la structure adversative « Mes Fortune » révèle le parallèle entre les deux passages. Enfin, l’entrée dans le récit interprétatif est marquée par « Or vous racompteray comment » (III, v. 592), faisant écho à l’annonce de la narration fabuleuse par « Bien l’orés ou conte rettraire » (III, v. 352). Notre réviseur fait donc résonner l’introduction de la fable avec celle de son exposition, précisant plus que le premier auteur les liens de parenté entre la fable et son « sens ». Au 138moment où il raconte comment Actéon, chassé par la dame puissante qui représente Diane, court à travers les bois, il souligne le rapport avec la métamorphose en cerf du personnage : « Pour ce la fable nous figure / Qu’il devint cerf pour l’aventure » (III, v. 641-642). La rime qu’il ménage entre « figure » et « aventure » traduit cette volonté de faire parfaitement correspondre le contenu du récit et son dévoilement, et ce encore plus que l’exégète original qui reprend lui aussi des termes de la fable, selon la démarche allégorique reposant sur la similitudo. Cette analyse nous permet de penser que, pour le remanieur, la vérité de cette exposition est supérieure à celle de l’Ovide moralisé original, parce qu’elle entretient un rapport plus étroit avec la fable.
Cette nouvelle définition de la vérité de la fable permet d’expliquer pourquoi le remanieur donne telle ou telle tonalité à ses expositions. L’auteur original n’interprète pas de façon historique le récit de la fable de Pasiphaé. La raison se trouve dans le fait que cette matière est considérée comme historique. En effet, dans la première version, les fables de ce livre ne présentent pas le premier niveau d’interprétation136. De son côté, le remanieur ne se prive pas de fournir une lecture évhémériste en invoquant la recherche du « droit sens » (VIII, v. 803) et en cherchant à faire coïncider le contenu de la fable et la tonalité de son exposition. Ainsi, la vérité de l’interprétation se trouve à ses yeux dans la justesse de la tonalité qu’on lui donne. La fable de Pasiphaé traite de choses obscènes, indécentes. Le réviseur fait alors ressembler son exposition à une sorte de fabliau. Il met en place un cadre plutôt réaliste : le bordel auquel se rend l’homme dont Pasiphaé tombe amoureuse et dans lequel 139Pasiphaé se fera passer pour une prostituée. Les personnages sont également caractéristiques de ce genre de récit. L’amoureuse est assimilée à une prostituée, puisqu’elle est désignée comme une femme « qui ne fu digne / De nulle digneté avoir, / Et de ce dist la fable voir / Que dissolue et malle vie / Mena celle qui n’ot envie / De nul bien ne de nul honnour » (VIII, v. 805-810). La négation de tout ce qui renvoie à la bonne conduite et l’affirmation de ce qui désigne la débauche (« dissolue et malle vie ») dresse de l’héroïne un portrait sans concession, qui ne laisse pas de doute au lecteur. Pasiphaé devient ainsi le parangon de la mauvaise vie. Le jeu sur les mots de la même famille (« digne » et « digneté ») souligne encore le statut du personnage. Enfin, la mise à la rime de l’expression « n’ot envie » exhibe la nature mauvaise de la jeune femme. Le personnage masculin est également un fieffé « hardel » (v. 815). Le remanieur n’emploie pas le même vocabulaire qu’à son habitude : les mots « bordel », « garces », « hardel » ne font pas partie des mots qu’il emploie fréquemment. Au contraire, il va piocher dans un lexique plus grivois, comme celui de récits légers. La description physique d’un personnage « corçu » ne ressemble pas à celle qu’il peut faire des personnages masculins. Il s’agit donc pour lui de coller le plus possible à la fable, en construisant une sorte de fabliau. À l’inverse, lorsqu’il développe l’exposition de la conquête de la Toison d’Or, il confère une allure arthurienne à son récit, parce que Médée est magicienne et qu’elle se rapproche des fées qui peuplent cet univers. La vérité du récit est donc intimement liée à la bonne tonalité de l’interprétation, celle qui sera le plus en adéquation avec la matière ovidienne.
Au sein des développements par lesquels il modifie la portée de l’ouvrage, l’interprète de la famille Z souligne cet aspect. Il soutient notamment, à la suite du sermon de Pythagore, la thèse suivante :
La fable ai pris tant seullement
Ou je prens tel entendement,
Conme il me plaist, ce me souffist.
Ovide mesmes qui les fist
N’i entendi pas tel sanz, sans dombte,
Com l’alegorie nous note.
Mout seroit fort chousse a escripre
Le droit sens de ce qu’il vost dire. (XV, v. 1193-1200)
La rime « souffist » et « fist » dit le rapport de proximité entre la version imaginée par le réviseur et le récit antique. La réserve qu’exprime la proposition « Ovide mesmes qui les fist » relègue le versant religieux 140au rang d’élucubration, dont la fausseté se signale par un non-respect du sens littéral du texte. La mise à la rime du syntagme « sans dombte » accentue encore l’accusation selon laquelle le premier auteur se serait fourvoyé. Ainsi, le remanieur caractérise de façon suggestive ce qu’il conçoit comme la vérité du texte, son sens profond : une signification concrète qui reste proche de la fable et cherche à en conserver l’esprit. Il définit finalement la vérité de la fable comme une forme de vraisemblance. Par l’étude des formules qui introduisent les expositions historiques de l’Ovide moralisé originel, M. Possamaï-Pérez envisage le rapport entre la vérité de la fable et l’interprétation historique comme un « rapport avec la vraisemblance137 ». Notre remanieur partage cette conception, puisqu’il reprend le même type de formulations, et même s’en contente, dans la mesure où il ne considère pas, comme le premier auteur, que la vérité historique est un tremplin nécessaire au « saut herméneutique » vers le sens spirituel. Il partagerait la même conception du vrai que les commentateurs ovidiens comme, par exemple, le glosateur du manuscrit des Métamorphoses Vat. lat. 1479138, qui ressemble au type de document à partir duquel le premier auteur aurait traduit le texte ovidien. Lors de la journée d’étude Ovide dans la Romania tenue à Lyon le 18 octobre 2018, L. Ciccone affirmait effectivement que pour ce commentateur le vrai se définit comme ce qui est vraisemblable139. Elle nous signalait, dans une discussion postérieure, qu’Arnoul d’Orléans aussi, sans l’exprimer explicitement, conçoit le vrai de la même façon.
Dans la continuité d’autres commentateurs d’Ovide, le remanieur pourrait aussi considérer Ovide comme une autorité scientifique à part entière. Dans ce cas, on comprendrait mieux qu’Ovide puisse, selon le réviseur, se suffire à lui-même. I. Salvo García a effectivement montré, à la journée d’étude que nous évoquions, qu’Ovide est perçu par les auteurs de la General Estoria comme une autorité scientifique à part entière, et même à égalité avec Pline. Notre réviseur se contente alors peut-être d’Ovide et de quelques expositions qui rationalisent les éléments invraisemblables et font le pont entre l’histoire et le présent, parce qu’il considère le poète latin comme une autorité suffisante, à la 141fois historique et scientifique. Finalement, les Métamorphoses sont déjà tellement « vraies » – en ce sens qu’elles disent le monde comme il a été et reste encore – que la seule vérité qu’on puisse ajouter est celle qui permet d’enlever la part d’invraisemblable « du récit fabuleux ».
Une vérité fondée sur l’expérience
En outre, selon notre réviseur, la vérité historique ou physique correspond mieux à l’intention du poète qu’à celle de l’auteur initial. C’est pourquoi, dans ses expositions, il se réfère très souvent à l’expérience qui, par son caractère universel, fait le lien entre Ovide et lui-même, plus que le dogme chrétien que le fabuliste païen ne pouvait concevoir.
D. Boutet signale, à propos de l’intégration de l’histoire dans le roman, que le poète tente ainsi d’éclairer son présent140. L’histoire permettrait donc de faire le pont entre le passé, comme par exemple celui du récit ovidien, et le présent de l’écrivain. Cet aspect est valable pour le réviseur : on l’observe dans l’importance qu’il accorde à l’expression d’un vécu personnel ou collectif. Il ne manque pas de faire appel à l’expérience pour asseoir la vérité de son exposé. Par exemple, dans la fable d’Iole et Hercule, il allègue l’expérience pour justifier le fait qu’Hercule abandonne sa femme141 :
Ne trouveroit on pas ·i· honme
En amour loial ne preudonme,
A moins qu’il le soit longuement,
Et se aucun dit que je ment,
Ce pueut en bien prover par euvre,
Car experiance le prouve. (IX, v. 401-406)
Le vécu collectif est ici posé comme un principe rationnel, garant de la valeur du propos. La répétition du verbe « prouver » dans les deux derniers vers souligne la dimension objective et rationnelle de l’expérience et rend sa vérité indiscutable. La rime entre « euvre », qui rappelle le sème de la réalité contenue dans l’« experiance », et « prouve » insiste encore sur cette dimension, tout comme l’allitération en « p » qui souligne les mots « prover » et « experiance ». Par l’emploi de la proposition « se aucun dit que je ment », le remanieur insiste sur le fait que l’expérience est une vérité à part entière. Il invoque une vérité toute 142humaine, accessible à tous. Ovide lui-même institue, au début de son Art d’aimer, sa propre expérience142 comme un gage de vérité :
Usus opus mouet hoc ; uati parete perito. / Vere canam
C’est l’expérience qui me dicte cet ouvrage : écoutez un poète instruit par la pratique. Je vais chanter la vérité143.
Le réviseur se rapproche donc de la pensée d’Ovide. Par ce retour sur l’expérience, il exprime qu’il a saisi ce qui unit l’auteur latin, lui-même et ses lecteurs et ce qui fonde l’intérêt de la fréquentation de ce poète antique. La réalité humaine, parce qu’elle est à la fois historique et actuelle, – et le remanieur ne manque pas au début du texte de situer Ovide dans un contexte temporel – se présente comme la caution de la vérité. C’est pourquoi notre réviseur affirme dans les expositions historiques la connaissance qu’assure l’expérience. Les deux domaines sont foncièrement liés car l’histoire représente la somme de ces expériences vécues un jour par des personnages du temps jadis, expériences qui, mises en récit, aideront les hommes dans leur propre vie, à toute époque. Cet aspect est parfaitement illustré dans l’exposition sur Callisto :
Ainssi est il, c’est chose voire,
Des hommes qui pour mieux attraire
Femmes se deffont de leur fourmes (II, v. 1122-1124).
L’emploi des tournures impersonnelles « ainsi est il », « c’est chose voire » et le présent de vérité générale insistent sur le fait que la vérité ne peut être qu’éprouvée, tangible. C’est pourquoi le nouvel auteur conclut cette même exposition par une formule incontestable : « Or s’en garde donc qui est sage / Car certes tel en est l’usage » (II, v. 1196-1197). L’expérience a ici littéralement et métaphoriquement le dernier mot. La mise en relation de la sagesse et de l’usage signale que la vérité qui se dégage du texte est empirique et qu’elle est vraie parce qu’elle se vérifie dans la réalité. L’adaptateur fait d’ailleurs reconnaître à Céphale, qui relate son malheur d’avoir perdu la femme qu’il aimait, le lien entre l’expérimentation et la sagesse :
143Si sai bien, par esprouver,
Que ce que on ne veut pas trouver
On ne doit mie aller querant,
Car qui va trop pres enquerant
Il treuve par aventure
Son deuil et sa malle adventure
Et dont aprés il se repent (VII, v. 2455-2461).
Le premier vers, en mettant d’un côté le verbe « savoir » et de l’autre le verbe « esprouver », suggère que l’expérience est le critère d’une connaissance stable, comme le souligne l’adverbe « bien », et qui s’avère utile à soi-même et aux autres. En effet, l’emploi du pronom « on » et du présent de vérité générale suggère que tout savoir universel sur le monde découle de son appréhension sensible. C’est encore en ce sens que le remanieur prolonge les paroles de Céphale qui condamne fermement la jalousie, cause de sa mésaventure. Le ton du personnage ressemble à celui du remanieur dans l’exposition sur Callisto, par exemple :
|
Propos de Céphale sur la jalousie |
Propos du remanieur sur la fourberie masculine dans l’exposition ajoutée sur Callisto |
|
Car j’ouse d’amours dire tant Que qui a tout son cueur donné En un lieu est tout asené, Pour ce que aulcun deffaut y treuve, Que ce vraye amour en li euvre Que pour tant ne s’en retraira Ne son cueur oster n’en pourra, Si le mectra en grant doulour Jalousie et trop grant amour Qui li mectra ou cueur la flame, Qui li bruira le corps et l’ame Ne jamais plus ne s’i fiera Ne celle plus ne l’amera Qu’il aura ou meffait prise. (VII, v. 2462-2475) |
Ja ne sera que je m’en taisse, Car se femme croit mon conseil, Je li lo et moult li conseil Qu’elle ne croye homme en tel cas. S’elle fait, ne s’en doubte pas Que encore s’en repentira Amerement et maldira L’eure c’onques homme crut Ne que telle acointance eut. (II, v. 1181-1189) |
L’affirmation de la première personne et de la franchise unit les deux premiers vers « j’ose d’amour dire tant » et « ja ne sera que je m’en taisse ». L’emploi du futur pour mettre en valeur le sort réservé au jaloux d’un côté et à la femme trompée de l’autre fait également se rejoindre la posture du personnage et celle du remanieur. Comme nous le signalions, l’adaptateur termine son interprétation du mythe 144de Callisto en rappelant l’usage (« Or s’en garde donc qui est sage / Car certes tel en est l’usage », II, v. 1196-1197), ce qui tisse encore un lien avec l’attitude de Céphale qui s’appuie sur sa propre expérience. Enfin, comme l’adaptateur qui relate les fables et s’en sert pour appuyer sa posture de moraliste, Céphale convoque les aventures des dieux pour asseoir la vérité de son constat :
Se pouvons nous de fait prouver
Et par excemple approuver
De Phebus qui par jalousie
Occit Corinis s’amie,
Puis se repenti durement.
Aussi avons nous conment
Vulcains prist Venus ou meffait
Et l’ahonta, dont pour ce fait
La dame moult l’an haï,
Dont le doullant s’en repenti… (VII, v. 2483-2492)
Céphale fait ensuite le lien, non seulement avec l’histoire des dieux et sa propre histoire, mais aussi avec celle de tout un chacun, comme le fait notre moraliste :
Et plusieurs fois est avenu,
Et avient souvent et menu,
Que mains maris par pou fier
Ont pris fames a espier
Et puis les ont desavoiees
Et bouté hors et mal menees,
Que puis aprés les ont reprisses. (VII, v. 2495-2501)
Il semblerait donc que le réviseur ait pris volontairement la voix de Céphale pour donner à sa condamnation de la jalousie la force persuasive et surtout la vérité d’un fait éprouvé. Parce qu’elle peut être vécue par toute personne, à toute époque (celle d’Ovide ou celle d’un lecteur du xve siècle), l’expérience fonctionne comme un principe véridique. Étant partagée par les hommes de l’Antiquité et ceux du Moyen Âge, à l’inverse du dogme chrétien qui ne pouvait être connu d’auteurs païens, elle représente le meilleur lien qui unisse ces deux époques. Le remanieur conçoit donc l’empirisme comme un axiome universel et intemporel qui lui permet de faire se rencontrer le monde antique et l’univers médiéval. L’épreuve sensible du monde est désignée comme une source fiable de savoir, comme on le lit dans la fable de Cadmus :
145Le franc hons par ceste estreve a
Certaine et vraye experiance
Trouvé et certaine science
Que on ne se doit fier pour riens
En Fortune ne en ses biens. (III, v. 748-752)
L’expérimentation permet à Cadmus d’enrichir sa connaissance, ce que révèle la rime entre « experiance » et « science ». Le même adjectif « certain » vient d’ailleurs qualifier les deux termes, invitant à mettre sur un pied d’égalité l’observation du réel et son interprétation. Finalement, toute vérité ne s’intègre que par une assimilation propre et personnelle de la réalité, ce que permet notamment la fable qui appartient elle aussi au domaine sensible. En cela, elle fait ressentir au lecteur ce qu’il pourrait lui-même appréhender dans sa propre réalité et l’aide à constituer les bases d’un savoir sur le monde. Ce n’est donc pas sans raison que le remanieur encadre son œuvre de la référence au plaisir de la fable. Le plaisir participe du monde sensible, angle sous lequel l’adaptateur veut lire les fables. Même s’il écrit qu’il faut comprendre les fables pour pouvoir en dégager un enseignement144, il n’exclut pas que l’on puisse y prendre plaisir. Il termine d’ailleurs la fin de sa dernière interprétation par la rime « delitable » et « fable » (XV, v. 1246-1247145). Étant donné que le plaisir de lecture n’est nullement exclu de tout l’ouvrage ni des expositions que l’adaptateur invente ou augmente, nous pensons que ce dernier conçoit le plaisir comme le premier degré de compréhension des fables. Nous avons analysé l’accord de tonalité entre l’interprétation et la fable comme la volonté du remanieur de ne pas dévier de l’intention ovidienne. Cet aspect est particulièrement manifeste pour les lectures évhéméristes d’Actéon, de Pasiphaé et de Médée qui ressemblent soit au fabliau, soit au lai, deux genres qui chacun à leur façon sont connus pour leur agrément146. C’est donc aussi que la dimension plaisante du récit est la première condition de l’accès au sens caché du texte.
Le remanieur conçoit même qu’une forme de vérité est accessible sans interprétation, tout en insistant sur le fait que le lecteur qui penserait 146qu’il n’y a pas de sens caché sous la fiction se tromperait. La fable, par son caractère agréable et sensible, représente une voie d’accès à la vérité. En effet, le réviseur affirme que
Voirs est qui Ovide prendroit
A la lectre et n’i entendroit
Autre sens, autre entendement
Que tel com l’aucteur grossement
Y met en racontant la fable,
Tout seroit chose mensongable,
Trop poi vallable et trop obscure. (XV, v. 1158-1164).
La référence au sens que « l’aucteur grossement / y met en racontant la fable » suggère que le sens littéral ne doit pas être rejeté en bloc. Le substantif « entendement » et l’adverbe « grossement » riment d’ailleurs ensemble, ce qui peut renforcer l’opposition entre le sens caché et la fiction, mais aussi suggérer qu’une part de vrai se lit déjà dans la fiction. Comme l’énonce J. Pépin, « si la vérité mythologique ne réside pas dans on ne sait quel message secret, il reste qu’elle-même soit vraie147 ». Contrairement à la version commune de l’Ovide moralisé, l’interprétation évhémériste n’est plus un « relais sensible » qui a pour but de préparer l’allégorie morale ou tropologique148. Le réviseur conçoit plutôt que le sens littéral de la fable est un moment indispensable et véridique dans le développement de la démarche interprétative : c’est le fondement même de l’herméneutique des victorins qui s’inspirent d’ailleurs de la lecture par Augustin des « Règles » de Tyconius. Le remanieur retrouve donc une pensée traditionnelle et consensuelle, là où le premier auteur s’en détache davantage. Le nouvel auteur considère donc l’interprétation littérale comme un texte à part entière qui donne l’occasion de développer ou de créer de véritables petites histoires, car « la vérité que cherche l’historien n’est accessible que dans et par le récit légendaire149 », et dans et par toute fiction en général, fût-elle vraie ou fausse. Les fables ovidiennes regorgent de vérités tangibles, comme l’affirme le remanieur à la fin du récit de la métamorphose en eau dorée de la rivière où se lave Midas : « […] encors sil est qui l’espreuve / En celle riviere or on trouve » (XI, v. 356-357).
147Ainsi, l’insistance sur l’expérience comme garantie de la vérité de l’exposition ou la rapide mention de l’intérêt du sens littéral définit une vérité sensible, basée sur l’immanence qui transcende les époques, à l’inverse du dogme chrétien qui, selon le remanieur, s’écarte trop du monde antique.
Le remanieur reprend donc à son compte des traits de la posture auctoriale du premier traducteur-exégète français des Métamorphoses. Il cherche lui aussi à livrer un enseignement moral à son lecteur, à travers le dévoilement des fables. Comme lui, il se fait volontiers moraliste, mais jamais prédicateur. Bien au contraire, s’il reprend la voix du premier auteur, c’est pour la dévier et la ramener vers des contingences humaines, sociales plutôt que religieuses et spirituelles. La façon dont il prend discrètement la place de l’auteur original est le signe d’une discussion implicite autour de la notion de vérité, qui constitue le nœud de sa réécriture, voire de sa « contre-écriture ». Cette prise de distance par rapport au clerc anonyme du début du xive siècle lui permet de définir sa propre vision de la vérité des fables : une vérité qui reste toujours proche du sens littéral de cette dernière, qui respecte d’un point de vue historique ce que pouvait imaginer Ovide, et qui s’adresse à un lecteur universel. Il parvient ainsi à faire la synthèse entre l’agrément des fables, la sagesse qu’elles cachent et la vérité historique qui s’en dégage. Comme le second prosateur de l’Ovide moralisé, qui suivra sa trace en supprimant lui aussi les interprétations spirituelles, il pense que la fable est « une manière poétique et fabuleuse de raconter la réalité et l’histoire150 ».
1 Epistre Othea, éd. G. Parussa, Genève, Droz, 1999, p. 316.
2 Ibid., p. 316.
3 M. Gaggero, « Pyrame et Thisbé, Métamorphoses d’un récit ovidien du xiie au xve siècle », Les romans grecs et latins et leurs réécritures modernes, études sur la réception de l’Ancien roman, du Moyen Âge à la fin du xixe siècle, éd. B. Pouderon, Paris, Beauchesne, 2015, p. 77-124.
4 Christine de Pizan, La Città delle dame, éd. P. Caraffi et E. Jeffrey Richards, Parme, Luni, 1997, p. 384.
5 Ibid., p. 384.
6 D’autres auteurs du xve siècle insistent aussi sur la tromperie amoureuse de ces héros, mais sans que cela ne les entache totalement. Par exemple, Jean de Courcy accuse lui aussi Jason, mais en fait néanmoins une figure du Christ dans sa moralisation. C’est aussi le cas de l’auteur de l’Ovide moralisé original.
7 J.-Cl. Mühlethaler, Énée le mal-aimé. Du roman médiéval à la bande dessinée, Paris, Les Belles Lettres, 2016, p. 70.
8 Ibid., p. 60.
9 Ibid., p. 378-380.
10 Ibid., p. 380.
11 Nous renvoyons encore ici aux éclairants travaux de J.-Cl. Mühlethaler, Énée le mal-aimé […], op. cit., p. 105-126.
12 L’Ars amatoria présente une liste d’amantes abandonnées dont Médée, Ariane et Didon font partie, mais ce sont surtout les Héroïdes qui inspirent ici nos auteurs.
13 L’insertion d’une exposition pour cette fable, qui a pourtant largement été réduite par le remanieur, nous semble tenir à la dimension scandaleuse du propos. La seule façon de justifier l’exposé d’une telle débauche est d’en dévoiler un sens en adéquation avec le sujet, sous la forme d’une sorte de fabliau.
14 L’auteur de la première mise en prose de l’Ovide moralisé quant àlui écourte ouvertement le récit qu’il jugeêtre« si vilain »qu’il ne peut le recopier (“Ovide moralisé” en prose […], éd. citée, p. 225).
15 « C’est a dire que la tristece / C’Orpheüs ot et la destresse / De ce qu’il avoit esté cous / Le faisoit estre si jalous / Qu’a Erudice malle vie / Menoit par sa grant jaloussie. / Selle le laisse oultrement / Et s’en fuit selleement. » (X, v. 238-245).
16 L’influence de Jean de Meun se fait ici sentir. Voir notre article « Tuit voir ne sont pas bon a dire. Ovide et parole proverbiale en langue vernaculaire », Ovide dans la Romania médiévale, éd. M. Possamaï-Pérez et I. Salvo-Garcia, CRMH, 41, 2021-1, p. 103-116.
17 Ici et au v. 1150, il ne faut pas lire le verbe aleger mais aleguer.
18 Christine de Pizan, Le Livre du duc des vrais amants, éd. et trad. D. Demartini et D. Lechat, Paris, Honoré Champion, 2013.
19 Ibid., l. 70-72, p. 336.
20 Ibid., l. 199-201, p. 346.
21 Ibid ., l. 193-194, p. 346.
22 Ibid., l. 205-206, p. 346.
23 Ibid., l. 252-253, p. 348.
24 J. Cerquiglini-Toulet, La couleur de la mélancolie […], op. cit., p. 52.
25 Ibid., loc. cit.
26 Ibid., p. 53.
27 Christine de Pizan, Le Livre des epistres du debat sus le Rommant de la Rose, éd. A. Valentini, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 125.
28 Ibid., p. 125.
29 Ibid ., p. 116.
30 Ibid., p. 127.
31 P.-Y. Badel, Le roman de la Rose au xive siècle, op. cit., p. 177.
32 Cette polémique a circulé sous la forme d’un texte intitulé les Epistres du debat sus le Rommant de la Rose, dans lequel Christine de Pizan a publié ses interventions lors de cette querelle. Christine de Pizan, Le Livre des epistres du debat sus le Rommant de la Rose, éd. A. Valentini, Paris, Classiques Garnier, 2014.
33 Christine de Pizan, Le Livre du duc des vrais amants, éd. citée, p. 43.
34 Christine de Pizan, Épître d’Othea, préf. J. Cerquiglini-Toulet, trad. H. Basso, Paris-Cologny, PUF-Fondation Martin Bodmer, 2008, p. 17.
35 Ibid., p. 17.
36 Ibid., p. 17.
37 J.-Y. Tilliette, « Pourquoi Bellérophon ? […] », art. cité, p. 161.
38 Le récit se conclut ainsi : « En tel maniere sont finé / Li dui amant par loiauté » (éd. E. Baumgartner, v. 888-889, correspondant à éd. C. De Boer, IV, v. 1150-1153). E. Baumgartner affirme que dans le texte « le narrateur ne juge jamais la conduite des deux jeunes gens, soulignant au contraire combien étaient faits l’un pour l’autre ces amants si “loyaux” » (Pyrame et Thisbé, Narcisse, Philomena. Trois contes du xiie siècle français imités d’Ovide, éd. et trad. E. Baumgartner, Paris, Gallimard, 2000, p. 17). Nous faisons ici référence à l’édition d’E. Baumgartner car C. De Boer s’éloigne pour ce passage de la version telle qu’il la trouve dans A1. Il reprend le texte d’un lai du xiie siècle au lieu de transcrire A1. C’est E. Baumgartner qui édite A1.
39 Dans l’édition du Piramus et Thisbé d’E. Baumgartner, qui ne s’éloigne pas ici du texte du témoin A1 de l’Ovide moralisé, le couplet complet est le suivant « Tart revienent a lor ostaulz / Car li despartirs lor est maulz » (éd. E. Baumgartner, v. 55-56 correspondant à éd. C. De Boer, IV, v. 287-288). Le second vers est remplacé par « Longuement fu leur deduit tielz » dans Z.
40 Voir p. 30. Nous rappelons qu’une exposition historique existe déjà dans l’Ovide moralisé initial, mais elle se situe au milieu de séries d’allégories, si bien que le remanieur a pu ne pas y prêter attention.
41 P. Deleville, « Christine de Pizan, lectrice de l’Ovide moralisé, mais lequel ? », Postérités de l’Ovide moralisé, éd. C. Gaullier-Bougassas et M. Possamaï-Pérez, Turnhout, Brepols, à paraître.
42 Le Roman de la Rose, éd. citée, v. 5759.
43 Le Roman de la Rose, éd. citée, v. 5766.
44 « Nature les i fait voer / Force leur fait, c’est chose voire » (v. 5776-5777).
45 M. Zink, Littérature française au Moyen Âge, op. cit., p. 259.
46 Epistre Othea, éd. citée, allegorie XXIV, l. 45-46, p. 236.
47 Des éléments de comparaison sont développés dans P. Deleville, « Christine de Pizan, lectrice de l’Ovide moralisé […] », art. cité.
48 Nous pensons pourtant qu’il a pu diminuer les accents lyriques de la fable pour réduire le scandale de cet amour incestueux.
49 S. Cerrito, L’Ovide moralisé en prose (version brugeoise). […],t. I, p. LXX.
50 Le terme « avoultire » est tout de même employé plus loin dans Z.
51 L’adaptateur ôte ces vers : « Donnez moi signe que l’en croie / Que ma mere sous fausse image / Ne vueille couvrir son putage / Et que je soie vostre filz » (éd. C. De Boer, II, v. 78-81).
52 Roman de Thèbes, éd. citée, v. 439-441.
53 « […] Quant celle l’entant, / A terre pasmee s’estant » (IX, v. 1283-1284). Ces vers s’opposent à ceux du Roman de Thèbes : « Quant la dame cest los oÿ / Mout fu liee si s’esjoï »(v. 459-460).
54 Christine de Pizan, Le livre des epistres du debat sus le Rommant de la Rose, éd. citée, p. 130.
55 Boccace, Les femmes illustres, De Mulieribus claris, éd. V. Zaccaria et trad., intro. et notes J.-Y. Boriaud, Paris, Les Belles Lettres, 2013.
56 Christine de Pizan, La città delle dame, éd. citée.
57 Martin le Franc, Le champion des dames, éd. R. Deschaux, Paris, Honoré Champion, 1999.
58 Ibid., p. IX.
59 Boccace, Les femmes illustres, De Mulieribus claris, éd. citée, p. xix.
60 On pourrait lire derrière cette conclusion l’influence ou les prémices du débat sur le Roman de la Rose, qui porte, entre autres, sur le fait que Jalousie, chez Jean de Meun, calomnie les femmes. Christine de Pizan reproche ainsi à cet auteur d’inviter à faire le mal plutôt que le bien dans la mesure où, selon elle, le discours de Jalousie incite les hommes trompés à « decevoir » à leur tour. Pour s’opposer à cela, elle objecte que « mains est mal, a realment parler, estre deceu que decevoir, car trop est pire le vice de propre malice que cellui de simple ignorance ». Le remanieur prend donc une fois de plus position contre Jean de Meun.
61 Le remanieur évoque ce danger à travers le constat quasi proverbial : « Si puet on voir que mout pesant / Haïne est de dame puissant » (III, v. 651-652). Le rédacteur de la seconde mise en prose de l’Ovide moralisé en arrive aux mêmes conclusions, mais à propos de la façon dont Junon a rendu Tirésias aveugle : « Bien puet chascun par ceste fable apparcevoir que perilleuse chose est hayne de poissant femme. Femme n’a point de conscience de celluy nuyre qui sa voulenté ne lui fait ou accorde, ce qu’il lui plaist soit droit soit tort, sens ou folie, mais qu’elle s’en puisse vengier. Et pour ce, celui qui est en dangier de femme, se garde de dire ne de faire chose qui lui soit contraire, car elle par quelque engin [fo 34voa] l’en pugnira sans regarder à quel fin elle en pourroit venir. » (S. Cerrito, L’Ovide moralisé en prose (version brugeoise). […], éd. citée, tome II, III, 12).
62 Boccace, Les femmes illustres, De Mulieribus claris, éd. citée, p. xvi-xvii.
63 Nous avons particulièrement développé cet aspect dans notre article « The Ovide “re-moralisé”: the Z rewriting of the Ovide moralisé », Ovid in the Vernacular. Translations of the Metamorphosis in the Middle Ages & Renaissance, éd. G. Pelissa Prades et M. Balzi, Medium Aevum Monographs, 39, 2021, p. 273-283.
64 Christine de Pizan, L’Epistre au dieu d’amours, Œuvres poétiques de Christine de Pisan, 1891, v. 477.
65 On pense à la ballade XXIX Comment Dyanira mist a mort Hercules.
66 Boccace, Les femmes illustres, De Mulieribus claris, éd. citée, p. XXIII.
67 Ibid., p. XXII.
68 M. Zink, La littérature française au Moyen Âge, op. cit., p. 138.
69 Nous remarquons d’ailleurs qu’il privilégie des emprunts à ce type de littérature.
70 Nous ne réduisons pas ici l’auteur original de l’Ovide moralisé à un prédicateur. Nous utilisons seulement le terme pour opposer deux postures, mais nous partageons bien sûr l’avis des amateurs de l’œuvre qui apprécient la valeur poétique des moralisations.
71 Sur la question de la persuasion, et d’une forme proche de celle du sermon, nous renvoyons aux études de M.-R. Jung (« Aspects de l’Ovide moralisé », art. cité), J.-Y. Tilliette (« L’Écriture et sa métaphore. Remarques sur l’Ovide moralisé », art. cité) et M. Possamaï-Pérez (L’Ovide moralisé […], op. cit., p. 789-835).
72 P. Deleville, « From the Ovide moralisé to an Ovide “re-moralisé” », éd. G. Pellissa et M. Balzi, à paraître.
73 « Qui au morel sens veut descendre / Par ses ·iii· seurs peut on entendre / Que ·iii· filles voirement furent. Jadis […] » (IV, v. 1703-1706). Dans tous les manuscrits Z, nous lisons bien « morel », qui de toute évidence se rattache à « moral ».
74 DMF : http://www.atilf.fr/dmf/definition/moral1, consulté le 19 octobre 2018.
75 F. Pomel, Les voies de l’au-delà et l’essor de l’allégorie au Moyen Âge, Paris, Honoré Champion, 2001, p. 153.
76 Isidore de Séville, Étymologies, I, 41, PL 82, 122.
77 B. Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris, Aubier, 1980, p. 27.
78 Cités par B. Guenée, ibid., loc. cit. D. Burghgraeve a très bien étudié le statut d’historien de Jean Courcy, De couleur historiale et d’oudeur de moralité […], op. cit.
79 D’après le DMF, « moralité » a la même signification que notre actuelle « moralité » qui désigne selon le TLFi le « caractère de ce qui est conforme aux principes, à l’idéal de la conduite », assez proche de la définition du DMF « enseignement, domaine relatif aux mœurs, aux comportements, à la morale », http://www.atilf.fr/dmf/definition/moralité et http://www.cnrtl.fr/lexicographie/moralit%C3%A9, consultés le 4 septembre 2018.
80 J.-C. Payen, Histoire de la littérature française, Le moyen Âge, op. cit., p. 47.
81 M. Possamaï-Pérez, L’Ovide moralisé […], op. cit., p. 326-333.
82 La définition du mot en moyen français exprime cette ambivalence. Le DMF le définit comme un « récit d’événements réels ou imaginaires », http://www.atilf.fr/dmf/definition/histoire, consulté le 4 septembre 2018.
83 Voir notamment une analyse de l’exposition sur Actéon, dans P. Deleville, « Une réécriture de l’Ovide moralisé […] », art. cité, p. 208-209.
84 « ·i· jour a ses fenestres vint, / La s’apuya et la se tint » (VIII, v. 357-358).
85 On pense, par exemple, aux lais ou aux détournements de ce motif stéréotypé dans les fabliaux tels que Celle qui fut foutue et défoutue pour une grue, ou dans La Prise d’Orange, quand Guillaume, qui s’ennuie à Nîmes, voit arriver depuis sa fenêtre le chevalier Guibert, qui s’est enfui d’une prison d’Orange et lui parle de la princesse Orable, dont Guillaume tombe amoureux.
86 J.-Y. Tilliette estime que l’auteur de la version originale emprunte lui aussi les formes du fabliau ou du conte édifiant dans ses moralisations, ce que reprend et développe le remanieur. Cf. J.-Y. Tilliette, « Pourquoi Bellérophon ? […] », art. cité, p. 155.
87 Contrairement à son habitude, le remanieur conserve ici la référence à la « joie pardurable », à l’enfer et à la « pardurable paine ».
88 M.-R. Jung, « Ovide, texte, translateur […] », art. cité, p. 87.
89 Ibid., p. 90.
90 Ibid ., p. 90.
91 Ibid., p. 90. Par « inédite », nous renvoyons une fois de plus au fait que l’explication ne se trouve pas dans la version commune de l’Ovide moralisé. M.-R. Jung ne précise pas à quelle source pourrait ici puiser le remanieur. Nous ne trouvons pas d’éléments qui se rapprochent de cette exposition chez le Mythographe du Vatican II, chez Arnoul d’Orléans, chez Jean de Garlande qui traitent du mythe. Giovanni del Virgilio rappelle la métamorphose de Jupiter, mais s’intéresse surtout à ce que représente l’ourse, contrairement à notre remanieur. Pierre Bersuire fait le pont avec la réalité actuelle (Sic videtur hodie accidere), comme le fait aussi notre auteur. Néanmoins, il assimile ce qui est arrivé à Callisto à un revers de Fortune et n’analyse pas vraiment la métamorphose de Jupiter, mais se concentre plutôt sur le fils de Callisto qu’il assimile aux carnales et mundanos amicos.
92 M.-R. Jung, « Ovide, texte, translateur […] », art. cité, p. 90.
93 Ibid., p. 92.
94 Ibid., p. 89.
95 Ibid ., p. 89.
96 Cet aspect est notamment mis en valeur par G. Doutrepont qui montre comme les prosateurs justifient leur pratique dans le prologue, parce qu’ils « jugent nécessaire d’indiquer la façon dont ils ont refait la matière originale », Les mises en prose […], op. cit., p. 469.
97 Histoire de Gérard de Nevers [ … ] , éd. citée, p. 106.
98 Le prologue débute de la façon suivante : « A l’onneur et louenche de la tressaincte Trinité : Pere, Filz et Saint Esperit, pour obeïr au bon plaisir et commandement de tres hault et excellent prince et mon tres redoubté seigneur René, par la grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicille […] sans moy nommer pour vaine gloire eschiver, me suis mis à convertir de rime en prose le grant livre d’Ovide nommé Methamorphose », Ovide moralisé en prose (texte du quinzième siècle), éd. citée, p. 42.
99 Nous avons déjà vu en introduction que le nom « allegorie » relève ici de l’interprétation spirituelle.
100 S. Cerrito, L’Ovide moralisé en prose (version brugeoise) […], éd. citée.
101 On pense, par exemple, à la façon dont le premier auteur qualifie le sens typologique de la fable d’Actéon de « plus noble et de meilleure sentence » (éd. C. De Boer, III, v. 604-605), par opposition à l’exposition historique. L’allégorie religieuse du mythe de Byblis l’emporte aussi d’un point de vue qualitatif sur l’interprétation concrète du mythe, puisque « Sentence y a mieudre et plus saine » (éd. C. De Boer, X, v. 2550).
102 Cependant, une nuance mérite d’être apportée dans l’emploi de la désignation « pure vraie histoire » pour ce passage, dans la mesure où le syntagme « vraie istoire » peut tout simplement désigner la matière troyenne, comme dans les mises en prose du Roman de Troie.
103 Le récit de la mort d’Hector est introduit par la rubrique La maniere coment Ovide met que Achilles occist li preux Hector (XII, 2692rubr.), ce qui met déjà à distance ce récit. Dans l’ajout qui suit cette narration, le réviseur rappelle ceci : « Or vous ai dit et raconté / Conment Achilles ot dombté / Hector, si conme Ovide compte, / Mes aussi conme il le raconte / (Et se vuil je prendre a prover) / Fait son dit trop a reprover / Par la pure vraie histoire / Qui est aprovee estre voire, / Si com le Troien le devisse / Qui raconte par autre guisse / La mort d’Ector et la proesce » (XII, v. 2972-2982).
104 M.-R. Jung, « Ovide, texte, translateur […] », art. cité, p. 89.
105 http://www.atilf.fr/dmf/definition/proprement, consulté le 3 septembre 2018.
106 Notons que le syntagme « le droit sens » est repris dans l’exposition amplifiée de la fable de Médée, ce qui signale bien que la question de la vérité interprétative est un point crucial de la réécriture : « Mes qui au droit san veult tendre / Ainssi doit la fable entendre »(VII, v. 729-730).
107 Un accessus est censé présenter les sept points suivants : causa suscepti operis, titulus, materia, intentio, modus tractandi, utilitas, philosophie suppositio, B. Roy, L’art d’amours, traduction et commentaire de l’Ars amatoria d’Ovide, Leiden, Brill, 1974, p. 40-41.
108 Cet aspect est développé p. 125-128.
109 Pour ces dénominations et leur emploi, nous renvoyons à l’introduction.
110 J. Pépin, Mythe et allégorie : les origines grecques et les contestations judéo-chrétiennes, op. cit., p. 126.
111 M. Possamaï-Pérez, L’Ovide moralisé […], op. cit., p. 383.
112 Nous l’avons déjà évoqué pour l’interprétation du mythe de Sémélé, voir p. 123.
113 M. Possamaï-Pérez, L’Ovide moralisé […], op. cit., p. 384.
114 La pensée de cet auteur sera reprise par Lactance (fin du iiie-début du ive s. ap. J.-C.), Servius (ive s.), Fulgence (v-vie s.), Eusèbe (ive s.), Jérôme (fin du ive-début du ve s.), saint Augustin (ve s.), Isidore de Séville (vie s.) et les Mythographes du Vatican.
115 J. Pépin, Mythe et allégorie […], op. cit., p. 57.
116 Ibid., p. 12.
117 Ibid., p. 13.
118 Ibid., p. 13.
119 Ibid., p. 13.
120 On la retrouve déjà dans l’Ovide moralisé original. Par exemple, la fable de l’enlèvement d’Europe par Jupiter métamorphosé en taureau est rationalisée par le rapt de la jeune fille dans un bateau qui avait la forme d’un taureau. L’exposition permet donc d’extraire toute invraisemblance de la fable, comme le fait de se métamorphoser.
121 S. Cerrito, « Entre Ovide et Ovide moralisé[…] », art. cité, p. 166.
122 Ibid., p. 166.
123 Nous abordons déjà cet aspect en première partie, p. 40-49.
124 B. Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, op. cit., p. 28. Pour cet aspect nous renvoyons aux p. 120-124.
125 A. Strubel, « Grant senefiance a »[…], op. cit., p. 89.
126 Nous qualifions l’exposition d’« inédite » car elle ne se lit pas dans les autres témoins de l’Ovide moralisé, et parce que nous ne trouvons pas son équivalent chez les mythographes qui constituent habituellement les sources auxquelles puise le premier auteur. Dans Z, Pygmalion méprise les femmes qui couchent avec les hommes. Pour cette raison, il souhaite vivre chastement. Mais sa nature humaine le contraint malgré lui à vouloir aimer et à se marier. Il imagine alors la femme de ses rêves, et c’est à cause de cette imagination que la fable évoque la statue qu’il avait faite. Il rencontre un jour la femme dont il tombe amoureux, mais elle refuse ses avances, comme une statue de bois, de pierre ou d’ivoire. Désespéré, le héros prie Vénus de l’aider : la belle est finalement touchée par les prières du jeune homme et consent à l’épouser. Lactance, Arnoul d’Orléans, Jean de Garlande, qui interprètent le mythe, ne développent pas un tel récit et n’en partagent pas les traits. Lactance répète la trame de la fable ; Arnoul d’Orléans dit que le héros a vraiment fait une statue d’ivoire dont il se servit comme d’une vraie femme ; Jean de Garlande oppose le monde idéal au monde qui devient matériel.
127 Nous pensons ici au prologue du Gargantua, dans lequel Rabelais désigne, pour se moquer, l’auteur de l’Ovide moralisé comme un « vrai coquelardon ». François Rabelais, Gargantua, éd. critique de J. Céard, G. Defaux et M. Simonin, Paris, Le livre de poche, 1994, p. 9.
128 Boccace, LaGénéalogie des Dieux païens (Genealogia Deorum gentilium) […], trad. cit., p. 42.
129 P. Pionchon, « La Généalogie des dieux païens entre le Décaméron et les nouvelles des humanistes du premier xve siècle », Cahiers d’études italiennes, 10, 2010, p. 55-78, part. p. 57.
130 Boccace, LaGénéalogie des Dieux païens (Genealogia Deorum gentilium) […], trad. cit., chap. xiv, p. 48.
131 P. Pionchon, « La Généalogie des dieux païens[…] », art. cité, p. 61.
132 M.-R. Jung, « Les éditions manuscrites de l’Ovide moralisé », art. cité, p. 274.
133 A. Strubel, « Grant senefiance a » […], op. cit., p. 25-26.
134 Ibid., p. 25.
135 A. Strubel, La Rose, Renart et le Graal […], La littérature allégorique en France au xiiie siècle, Honoré Champion, Paris, 1989, p. 66.
136 Cet aspect est très bien traité dans l’article d’I. Salvo García, « Les Métamorphoses et l’histoire ancienne en France et en Espagne (xiiie-xive s.) : l’exemple des légendes crétoises (Mét. VII-VIII) », Ovidius explanatus […], op. cit., p. 235-258. M. Possamaï-Pérez signale que l’auteur délaisse de plus en plus les interprétations « concrètes » au fur et à mesure qu’il avance dans son œuvre, comme s’il considérait désormais son lecteur comme assez averti pour ne plus lui ménager de « relais sensible » vers les vérités intelligibles. On pourrait également penser, pour le cas particulier de la fable de Pasiphaé, que l’absence d’interprétation dans la version originale est liée au fait qu’il s’agit d’une fable uniquement contre-nature et non pas surnaturelle. C’est notamment la façon dont Servius définit la fable de Pasiphaé : Et sciendum est inter fabulam et argumentum, hoc est historiam, hoc interesse, quod fabula est res contra naturam, sive facta sive non facta, ut de Pasiphae (Aen., 1, 235). Ces propos sont repris par R. Blumenfeld-Kosinski, qui explique que l’auteur (original) n’a pas proposé de lecture historique pour coller à ses desseins moraux. Si l’exposition historique avait rationalisé la fable en faisant du taureau un simple homme, alors il n’y aurait qu’une situation d’adultère et non plus l’acte contre-nature sur lequel s’appuie l’auteur pour condamner le comportement de Pasiphaé dans les allégories, cf. R. Blumenfeld-Kosinski, « The Scandal of Pasiphae : Narration and Interpretation in the Ovide Moralisé », Modern Philology, 93, 1996, p. 307-326.
137 M. Possamaï-Pérez, L’Ovide moralisé […], op. cit., p. 387. A. Strubel définit de la même façon « le premier stade de la vérité » dans l’Ovide moralisé, cf. « Allégorie et interprétation dans l’Ovide moralisé », art. cité, p. 152.
138 Pour une édition et traduction du texte, voir Un commentaire médiéval aux Métamorphoses. Le Vaticanus Latinus1479. Livres I à V, texte établi, introduit et annoté par L. Ciccone et traduit par M. Possamaï-Pérez, collab. P. Deleville, Paris, Classiques Garnier, 2020.
139 Les actes de cette journée d’études sont accessibles dans CRMH, 41, op. cit.
140 D. Boutet, Formes littéraires et conscience historique, aux origines de la littérature française 1100-1250, Paris, PUF, 1999, p. 114.
141 Nous rappelons ici qu’Iole et Déjanire, la véritable épouse d’Hercule, sont confondues.
142 Les poètes du xve siècle accordent aussi de l’importance à l’expérience, cf. D. Poirion, Le poète […], op. cit., p. 582. Nous ne savons pas s’il faut rattacher la démarche de notre remanieur à cette tendance. Il nous semble qu’il s’agit plutôt d’une posture topique et non pas de l’expression d’une parole singulière.
143 Ovide, L’Art d’aimer, éd. et trad. H. Bernecque, Paris, Les Belles Lettres, 1994, p. 3, v. 29-30.
144 « Mes ·i· chascun y peut apprendre / Asés sanz, si les set conprendre » (XV, v. 1205-1206).
145 « Aus rudes mesmes, qui le sens / N’entendent pas, sont il [les récits fabuleux] plaisant, / Car la matiere est delitable / Et plaisant a oïr la fable » (XV, v. 1209-1212).
146 Pour s’en persuader, il suffit de consulter le prologue de certains lais et fabliaux. Par exemple, au début du lai de Milon, nous lisons que « Ki divers cuntes vuelt traitier / diversement deit comencier / e parler si raisnablement / que il seit plaisible a la gent » (v. 1-4), Lais de Marie de France, éd. Karl Warnke, trad. L. Harf-Lancner, Paris, Lettres gothiques, 1990.
147 J. Pépin, Mythe et allégorie […], op. cit., p. 58.
148 M. Possamaï-Pérez, L’Ovide moralisé […], op. cit., p. 365.
149 P. Demats, Fabula […], op. cit., p. 13.
150 S. Cerrito « L’Ovide moralisé mis en prose à la cour de Bourgogne », art. cité, p. 114.