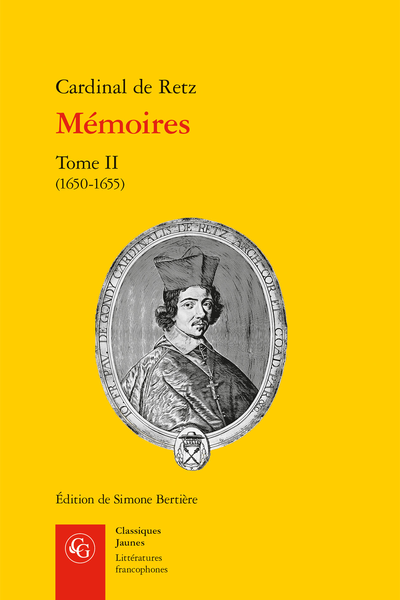
Table analytique
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Mémoires. Tome II. (1650-1655)
- Pages : 743 à 746
- Réimpression de l’édition de : 1987
- Collection : Classiques Jaunes, n° 573
- Série : Littératures francophones
- Thème CLIL : 3436 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques
- EAN : 9782812415517
- ISBN : 978-2-8124-1551-7
- ISSN : 2417-6400
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-1551-7.p.0741
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/04/2014
- Langue : Français
TABLE ANALYTIQUE DES MÉMOIRES
Tome I.
Première Partie. Années de jeunesse : galanteries, duels, études (219-233). Conspirations contre Richelieu (233-248). Retz résigné à être d'Église ; anecdotes diverses (248-262) : les capucins noirs (252-255), l'épinglière (258). Mort de Louis XIII ; Retz est nommé coadjuteur de Paris (261-262). Seconde Partie. Retz reçoit les ordres ; la retraite à Saint-Lazare (263-264). Cabale des Importants et progrès du pouvoir de Mazarin (264-270). Premières escarmouches entre Retz et la cour (271-
742TABLE ΑΝΑΙΥΉζ)υΕ
282). Panorama d'histoire sur l'évolution de la monarchie en France (283-286). Parallèle entre Richelieu et Mazarin (286- 290). Débuts du conflit entre le Parlement et la cour (290- 300). Le coup de force du 26 août 1648 (arrestation de Broussel) et les barricades (300-326). Séjour de la Reine à Rueil (327-336), suivi d'une victoire, toute provisoire, du Parlement (336-341). Retz débat de la situation avec Condé (341-348). Ralliement d'une partie de la noblesse à la Fronde (348-353). Fuite de la Reine et du Roi, qui s'installent à Saint-Germain ; début du siège de Paris ; organisation de la défense (353-370). Galerie de portraits (371-377). Le Parle¬ ment refuse de recevoir un héraut de son Roi (384-387), mais accueille un envoyé du roi d'Espagne (387-401). Retz et M. de Bouillon analysent la situation ; annonce du ralliement de Turenne à la Fronde (401-413). Conseil de Fronde chez M. de Bouillon (416-420). L'armée des Fron¬ deurs sort de Paris (423-425). Discussions sur la négociation avec l'Espagne (427-446). Conférence de Rueil et débats au Parlement ; paix de Rueil (446-469)· Défection de l'armée de Turenne ; mesures à prendre pour y faire face (470- 489)· Négociations des Frondeurs avec la cour pour leur « accommodement » (490-502). Début de la liaison de Retz avec Mlle de Chevreuse (502-504). Il continue, en compagnie de quelques autres, de * fronder» (505-515). Il se rend à Compiègne pour solliciter le retour du Roi, qui rentre en effet à Paris (515-518). Condé signe avec Mazarin un traité secret, qui le rend tout puissant ; il est plus arrogant que jamais (518-522). Affaire des « tabourets » (523-524). Attentat simulé contre Joly (528-530) ; coups de feu tirés contre le carrosse de Condé et mise en accusation de Retz et de ses amis (530-550).
Fin du premier volume (30 décembre 1650)
743745
Tome II.
Seconde Partie (suite : 1" janvier 1631). Entretiens secrets de Retz avec la Reine, pour une alliance de la vieille Fronde et de la cour contre Condé (9-14). Arrestation des Princes et soulèvement de la noblesse en leur faveur (14-18), « Paix fourrée » entre Retz et Mazarin (23- 27). Guerre de Bordeaux, troubles à Paris (28-51). Retz conseiller du duc d'Orléans (51-52). Paix de Bordeaux (58- 61). Retz fait solliciter le cardinalat pour lui par Mme de Chevreuse, qui essuie un refus (62-76). Retz négocie avec la Princesse Palatine l'union de la vieille Fronde et du parti condéen, tandis que l'agitation continue au Parlement et dans la rue (78-105). Retz, accusé par la cour devant le Parlement, pare le coup (108-111). Fuite de Mazarin ; la Reine ne peut le suivre, retenue à Paris avec le Roi par les Frondeurs (112-121). Libération des Princes (121). Début de la mésentente entre Condé et Retz ; Condé rompt avec la vieille Fronde pour se rapprocher de la Reine ; Retz se tient à l'écart (122-137). La Reine, excédée par les exigences de Condé, reprend contact avec Retz : entretiens nocturnes où il s'engage à la servir contre le Prince (138-148). « Guerre des pamphlets » (149-150). Nouveaux entretiens entre Retz et la Reine (150-161). Condé se retire à Saint-Maur ; indécision de Gaston d'Orléans (161-169). Retz sert d'inter¬ médiaire entre ce dernier et la Reine ; affaire de l'exclusion des « sous-ministres » (169-209). Retz dispute le pavé à Condé ; affrontement au Parlement, où il manque périr (209-237). La « comédie de la Suissesse » (237-241). Majorité du Roi ; guerre dans les provinces (243-253). La Reine a quitté Paris, et se trouve libre de rappeler Mazarin (253- 259). Attentats contre Retz (260-263). Les « contretemps » du Parlement et le projet de « tiers-parti » (265-303). Retz cardinal (303-310). Guere dans les provinces, prise d'Orléans par Mademoiselle, combat de Bléneau (310-320). Embarras du nouveau cardinal (323-326). Condé menace Paris ; com¬ bats en Ile-de-France (326-342) ; anarchie croissante (345-
744TABLE ANALYTIQUE
360). Combat du Faubourg Saint-Antoine (361-362). Émeute et incendie de l'Hôtel de Ville (363-368). La cour reprend peu à peu le contrôle des provinces (368-376). Retz s'interroge sur le rôle qu'il pourrait jouer désormais (376-383). Il se rend à Compiègne à la tête du clergé pour solliciter le retour du Roi à Paris et négocier l'accommodement de Gaston d'Orléans (383-398) ; c'est un échec ; Retz en débat avec Gaston d'Orléans ; irrésolution de ce dernier (398-411), qui capitule. Fin de la Fronde à Paris (411-426). Inquiétudes de Retz pour sa sûreté (430-438). Il est arrêté et emprisonné à Vincennes (438-458), puis transféré à Nantes (458-465). Évasion : de Nantes à Saint-Sébastien (465-474). Traversée de l'Espagne (475-482). D'Espagne en Italie, par mer (482-489).
Troisième Partie. Retz est accueilli en Italie et s'installe à Rome (491-496). Conclave (496-518). Position délicate de Retz à Rome ; ses relations avec le pape Alexandre VII (518-534). Difficultés financières et domestiques (535-540) ; utilité des Mémoires pour les enfants de la destinataire (537 et 540). Difficultés soulevées par l'administration du diocèse de Paris (540-552). Réflexions sur l'ingratitude (552-556).