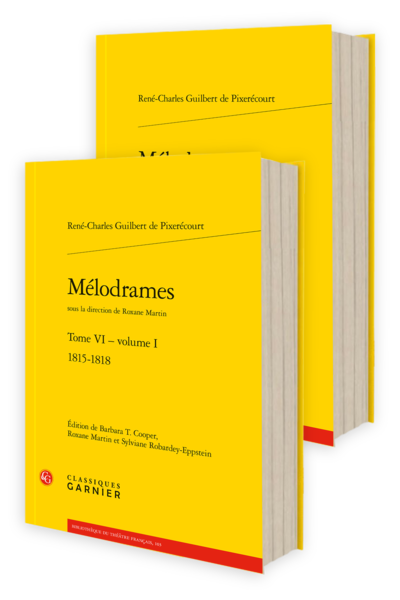
Établissement du texte
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Mélodrames. Tome VI. 1815-1818
- Pages : 861 à 866
- Collection : Bibliothèque du théâtre français, n° 103
- Thème CLIL : 3622 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Théâtre
- EAN : 9782406158776
- ISBN : 978-2-406-15877-6
- ISSN : 2261-575X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15877-6.p.0861
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 22/05/2024
- Langue : Français
établissement du texte
Le texte ici publié suit le protocole expliqué dans la « Note sur la présente édition » en tête de ce tome. Il est établi d’après l’édition princeps1 (Paris, Barba, 1818, 76 p. in-8o), désignée dans les notes de bas de page par le sigle Éd-1818(1). C’est cette même édition qui fut intégrée dans le Théâtre de René-Charles Guilbert de Pixerécourt colligé par les soins de l’auteur2 (t. 7). La pièce, qui ne figure pas dans le Théâtre choisi, a connu une seconde édition la même année (1818, Barba, 62 p.) que nous désignons par le sigle Éd-1818(2). Elle fut enfin rééditée dans la collection des « Chefs-d’œuvre du répertoire des mélodrames joués à différents théâtres », Paris, chez Mme Veuve Dabo, 1824, t. 4, p. 117-222, in-18, édition exempte de l’indication générique « en prose et à spectacle ».
Nous ne proposons pas de variantes pour les éditions, étant donné qu’elles ne présentent pas de différences notables entre elles, à l’exception de broutilles typographiques et de l’orthographe du prénom « Magdelon » modifiée en « Madelon » dans l’édition de 1824. Cette dernière corrige en outre quelques coquilles ou erreurs présentes dans les deux éditions précédentes, et nous signalons ces occurrences dans les notes du texte lorsque nous corrigeons en suivant cette leçon. Nous signalons également en notes de bas de page les rares cas où nous avons jugé plus pertinent de suivre la leçon des deux manuscrits existants.
Le premier manuscrit, complet et entièrement autographe, désigné sous le sigle MsA, est conservé à la SHLML (1 cahier relié et paginé, 69 fo écrits ro, corr. vo, boîte no 7, pièce no 77). Sauf sur la page de titre qui n’est pas numérotée, ce manuscrit est paginé de 1 à 67 en haut à droite de chaque page recto. Au verso de la dernière page, Pixerécourt a dressé le calendrier de son travail, révélant qu’il composa le texte et en modifia certains passages entre le 16 avril et le 8 juin 1818. Hormis 862la liste des dramatis personæ qui figure au verso de la page de titre, le texte principal initial figure au recto et il est écrit dans toute la largeur des pages (sans marge). Le verso, laissé vide, est réservé aux ajouts ou réécritures de répliques, de séquences ou de scènes se trouvant sur les pages en regard. Nous donnons toutes les différences entre le texte de l’édition et le texte du MsA, sans pour autant fournir systématiquement les variantes internes et propres à ce dernier. Cela implique que nous ne mentionnons pas le texte figurant sous les biffures ni les repentirs d’ordre reformulatoire, sauf s’ils apportent des nuances signifiantes, susceptibles de révéler une intention d’ordre dramaturgique (distribution des répliques, permutation ou redécoupage de séquences, etc.), sémantique (morale, symbolique, terminologie, etc.), scénique et ludique, syntaxique, rythmique, voire stylistique. En d’autres termes, nous donnons des variantes qui, à première vue, peuvent parfois sembler peu utiles, mais qui, selon les points de vue du lecteur, et a fortiori du chercheur, peuvent éclairer certains modes de composition, une intention d’auteur, une acuité de metteur en scène, etc. Sous les biffures se cachent le plus souvent des hésitations révélatrices. Par exemple, il n’est pas inutile de signaler que le titre de « chevalier », choisi pour désigner Armand, a été soupesé (« colonel » puis « officier » ont été biffés). Autre exemple : lorsque Pixerécourt biffe le pronom démonstratif « cela », pour le remplacer par « ça », il pourrait sembler superflu de mentionner une telle variante, puisque les deux mots s’équivalent ; mais au sein d’une réplique formulée par le personnage du braconnier, ce remplacement signale la volonté de rendre de manière réaliste le langage du peuple. Tout détail signifiant a donc été retenu dans les variantes.
Nous adoptons ces mêmes principes en ce qui concerne le second manuscrit (MsC), complet également et partiellement autographe. Il est conservé dans le fonds de la censure théâtrale aux Archives nationales sous la cote F18 600B. Il s’agit d’un duplicata, terme indiqué sur la page de titre, sur laquelle on trouve également l’indication « Théâtre de la Gaîté ». Ce manuscrit se compose de deux cahiers différents, reliés ensemble3. Le premier, plus petit, se compose de 14 folios écrits recto-863verso correspondant au premier acte. Le second, de taille habituelle, comprend les actes II et III, avec numérotation des feuillets au recto, et séparément pour chaque acte (16 fo + 14 fo). Une première main a pris en charge la copie du texte du premier acte (1er cahier en entier) ainsi que les trois premières scènes de l’acte II qui se trouvent dans le second cahier. À partir de la scène 4 de l’acte II, une deuxième main (autre copiste) prend le relais jusqu’à l’acte II, scène 12 incluse. Aux scènes 13 et 14 de l’acte II, un troisième copiste apparaît. Puis on retrouve la deuxième main pour le troisième acte jusqu’à la réplique de Bonneval « Parlez, ma fille, je vous l’ordonne comme père et comme magistrat » (dernière scène). La dernière page (fo 14 ro-vo), qui clôt l’acte III, est de la main de Pixerécourt.
Le premier copiste du MsC a ménagé sur chaque page une marge à gauche. Les suivants adoptent une marge à gauche pour les feuillets recto, et à droite pour les feuillets verso. Pixerécourt est intervenu dans les marges des deux cahiers, continuant donc de modifier le texte recopié qui provenait du MsA. De fait, le MsC fait subir au texte initial des suppressions en tous genres (biffures de mots, répliques, échanges ou séquences entières barrées) tandis que les ajouts ou réécritures sont consignés dans les marges. L’on trouve par ailleurs ici et là, dans les deux cahiers du MsC, des biffures et des ajouts souvent interlinéaires effectués dans une autre encre et d’une plume plus épaisse, dans une autre graphie provenant de la main probable du régisseur Marty. Nous précisons ces occurrences dans les variantes (en signalant qu’il s’agit d’une autre encre, plus foncée), mais nous n’avons en revanche pas jugé utile de spécifier dans les variantes les différentes mains qui se sont relayées pour recopier le texte du MsA dans le MsC. Le lecteur pourra en revanche en déduire que, lorsqu’il s’agit de changements dans la marge du MsC (puis dans les dernières séquences du dénouement), il s’agit de la main de Pixerécourt (voir supra).
L’état des deux manuscrits, les indications portées sur la page de titre du MsC, et celles qui figurent dans le procès-verbal de la censure (cote 864F21 976, AN) permettent de reconstituer à peu près la chronologie de la genèse4. La version « finale » du MsA fut consultée par les censeurs entre le 8 juin (date de la finalisation du texte) et le 19 juin (date du procès-verbal où ils exigent des changements). À ce moment-là, Pixerécourt est déjà en répétitions et retravaille son texte avant même d’avoir reçu les consignes des censeurs. Le 23 juin, l’autorisation est confirmée par le ministre de la Police générale, toujours à charge de changements. La majorité des variantes concernant le MsC a donc été effectuée après cette date.
Le MsC a fait au moins un aller-retour entre le théâtre et le bureau de la censure. La pliure centrale visible sur les deux cahiers atteste leur usage durant les répétitions.
Une autre copie du MsA, déposée à la censure avant le retravail du texte, demeure manquante. Certaines questions subsistent et ne peuvent être résolues. En effet, dans leur procès-verbal, les censeurs ont signalé les pages auxquelles devaient être effectués changements et suppressions. Or, les numéros ne correspondent pas à la pagination du MsC ; c’est donc qu’ils se référaient à la copie manquante, sur laquelle le dénouement n’avait pas encore été changé (ce que nous apprend le procès-verbal). Dans ces conditions, et compte tenu du fait que le MsC est extrêmement chargé de biffures, de passages rayés ou barrés, et qu’il présente une accumulation de réécritures, d’ajouts, de repentirs, de renvois et déplacements, etc., il n’a pas été possible de retrouver avec certitude ce qui relève de changements initiés par les exigences de la censure, ou de modifications dictées par la propre décision de l’auteur, que ce soit pour des raisons morales, de bienséance, de nécessités dramaturgiques et structurelles, d’inspirations nouvelles ou encore de mise en scène. Néanmoins, lorsqu’il a été possible de les déduire du contexte, nous avons mentionné les raisons probables de ces modifications5.
Certaines scènes ont été scindées ou déplacées, ajoutées ou supprimées, ce qui implique, en de nombreux endroits, des décalages entre la numérotation des scènes de l’édition et celles des manuscrits. Nous avons chaque fois pris soin de signaler ces cas dans les variantes.
De toute évidence, il manque un manuscrit « mis au propre » qui probablement fut envoyé à l’éditeur, puisque l’on observe parfois quelques 865discrépances entre le MsC et les formules finales de l’édition ; on pourra repérer ces écarts dans les variantes. Il s’agit, dans de nombreux cas, de didascalies absentes des manuscrits, et qui pourtant figurent dans l’édition.
Les variantes les plus notables concernent la réécriture de séquences considérées comme violentes et potentiellement choquantes (scène du meurtre, menaces et chantage exercés par le traître criminel sur Ernestine et sa fille) ; le dénouement a subi des modifications conséquentes, dans la logique de la nouvelle configuration due à la mort par suicide du fils complice ; quelques longueurs (discours moralisateurs, détails apportés au cours du procès, entre autres) ont été supprimées. Dans tous les cas, l’on trouvera dans les variantes l’intégralité des passages d’origine, ce qui permettra de comprendre à quel point le texte qui arriva chez l’imprimeur Barba un peu plus de trois semaines après la première représentation était le fruit d’un lourd remaniement en amont, et d’un travail à la fois méticuleux et acharné, pensé et soupesé, conséquent et patient.
La partition que nous éditons a été transcrite à partir du matériel d’orchestre manuscrit, conservé au département de la musique de la BnF (18 parties : vl principal, vln 1 [2 exempl.], vln 2 [2 exempl.], alt., b. [2 exempl.], cb. [2 exempl.], fl., cl. 1, cl. 2, bn, cor 1, cor 2, trb., timb., 380 fo, cote Mat th 136). Ce matériel a subi de nombreuses corrections, sans doute effectuées lors des reprises du mélodrame. Quelques livrets ont fait l’objet d’une remise au propre. Ils ne reprennent pas les passages que l’on retrouve biffés dans d’autres parties séparées, qui sont incontestablement celles qui ont été utilisées lors de la création. Nous avons transcrit autant qu’il l’a été possible les passages biffés, en les indiquant chaque fois dans la partition. Certains d’entre eux, devenus illisibles sous les ratures, ont été traduits par des mesures vides. Nous le précisons en note. Les signes d’expression et d’articulation ont été uniformisés en nous référant au livret du violon conducteur. Lorsque les indications de tempo n’étaient pas conformes entre les diverses parties, nous avons signalé la variante entre crochets (par exemple, « andante », noté par ailleurs « andante amabile », a été transcrit sous la forme « Andante[amabile] »). Les cors I et II apparaissent parfois sous différentes tonalités. Nous les avons transcrits à l’identique, en précisant la tonalité de chaque instrument sur la portée. Pour le ballet, nous n’avons pas transcrit les passages qui apparaissent biffés sur le livret du violon conducteur dans 866la mesure où ces mêmes passages n’apparaissent plus dans aucune des parties. Nous en avons conclu que ces modifications avaient été effectuées en amont de la première représentation.
Pour ce texte dont il était conscient des enjeux moraux et esthétiques, Pixerécourt n’a pas ménagé ses forces. L’on jugera, dans les variantes proposées, tout ce que les différentes strates de l’écriture révèlent des virtualités du mélodrame (idées tuées dans l’œuf ou séquences non advenues) mais aussi ce qu’elles révèlent d’un mode créatif toujours prompt à s’infléchir et à se renouveler.
1 La Bibliographie de la France, ou Journal général de l’imprimerie et de la librairie annonce la parution de la brochure dans sa livraison du 5 septembre 1818 (7e année, no 36, p. 510).
2 Voir, sur ce recueil, l’introduction générale de cette édition (t. 1).
3 Le premier cahier (acte I) a été semble-t-il rattaché au second après coup, ce qui pourrait laisser comprendre que les actes II et III ont été révisés pendant que le bureau de censure relisait le premier acte envoyé plus tôt. Puis le théâtre a envoyé le cahier contenant les actes II et III et les examinateurs y ont relié l’acte I. La présence d’un mot sur papier à en-tête de l’administration du théâtre de la Gaîté, qui se trouve inséré dans les pages du manuscrit précisément à l’endroit où le deuxième copiste prend le relais, semble pouvoir corroborer cette hypothèse. Il n’a pas été possible de retrouver l’auteur de ce mot, mais il faut croire que le destinataire était l’un des censeurs : « Mon bon ami, voici La Chapelle des bois. Ce duplicata est si exact qu’il y a une foule de ratures. / Si Jean Sbogar[autre mélodrame en préparation au théâtre et qui sera joué fin octobre] est approuvé, veuillez me le renvoyer. Tout à vous, / [signature indéchiffrable] ».
4 Pour les étapes et les dates, voir notre « Présentation ».
5 Voir également notre « Présentation ».