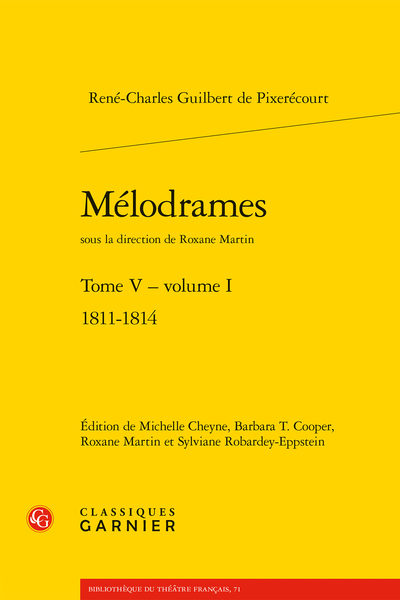
Avant-propos
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Mélodrames. Tome V, volume I. 1811-1814
- Pages : 9 à 11
- Collection : Bibliothèque du théâtre français, n° 71
- Thème CLIL : 3622 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Théâtre
- EAN : 9782406105541
- ISBN : 978-2-406-10554-1
- ISSN : 2261-575X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-10554-1.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/03/2021
- Langue : Français
avant-propos
Les années 1811-1814, couvertes par ce cinquième tome, constituent une période décisive pour l’auteur Pixerécourt, qui prend clairement parti contre la politique de Napoléon. Il faut dire que les dernières années de l’Empire sont particulièrement éprouvantes pour les Français. La crise alimentaire de 1811, l’augmentation massive des impôts en 1812, la mobilisation de 1813 qui permet, tous les trois mois, la levée de plusieurs dizaines de milliers d’hommes afin de renflouer une Grande-Armée exsangue après la campagne de Russie nourrissent les mécontentements. Ils se font jour dans le rapport Laîné qui, condamnant la politique extérieure de l’Empereur, est adopté à la très grande majorité des voix par le Corps législatif le 29 décembre 1813. La 6e coalition, on le sait, aura raison de l’Empire. La bataille de Paris, le 30 mars 1814, favorisera le rétablissement de la monarchie en France.
Pendant ces années, Pixerécourt poursuit tant bien que mal sa collaboration avec Jean-Baptiste Dubois, directeur du théâtre de la Gaîté, auquel il réserve l’exclusivité de sa production mélodramatique. Dans un système théâtral toujours aussi réglementé et étroitement surveillé par la police impériale, il peine à rencontrer le succès. Parmi les trois mélodrames qu’il fait jouer jusqu’à la fin de l’année 1812, deux (Le Précipice, ou les Forges de Norvège et Le Fanal de Messine) parviennent à dépasser la centaine de représentations, mais ne seront jamais repris après la chute de l’Empire ; le troisième (Le Petit Carillonneur, ou la Tour ténébreuse) connaît un four complet. Quelques tentatives sont menées sur d’autres scènes, sans grande réussite. Le Berceau, divertissement joué le 23 mars 1811 à l’Opéra-Comique en l’honneur de la naissance du roi de Rome, obtient un succès d’estime auprès de la critique, mais L’Ennemi des modes, ou la Maison de Choisy, comédie représentée au théâtre de l’Odéon le 7 décembre 1813, est sévèrement jugée. Faut-il y voir une attaque larvée contre un auteur qui semble de plus en plus s’engager en faveur du rétablissement de la monarchie ? Tout porte à le croire, d’autant que 10la totalité des journaux de Paris avait été supprimée par le décret du 4 février 1811, hormis quatre favorables à la politique de l’Empereur. Rien d’étonnant, dans ce contexte, à y lire un accueil clément pour la pièce en l’honneur de la naissance du prince impérial – qui fut un exercice contraint pour la plupart des dramaturges – et une critique acerbe à l’encontre dela comédie, qui affiche une coloration ostensiblement royaliste. Pixerécourt y développe une action située dans deux quartiers de Paris, le Marais et la Chaussée d’Antin, bien connus pour abriter les deux noblesses rivales qui animeront la vie politique française pour les prochaines décennies : la noblesse ancienne, légitimiste, et la noblesse d’Empire qui se confondra bientôt avec la bourgeoisie orléaniste1. Le ralliement aux royalistes – que l’on verra revendiqué déjà, au détour d’un jeu de mots, dans Le Petit Carillonneur – se rend plus lisible dans les mélodrames écrits en 1813-1814. Fortifié peut-être par le manifeste lancé en mars 1813 depuis l’Angleterre par le comte de Provence (futur Louis XVIII), Pixerécourt renoue avec la formule du « mélodrame historique2 » et propose deux pièces qui connaîtront un succès et une postérité exemplaires : Le Chien de Montargis, ou la Forêt de Bondy, visé par la censure le jour même de la promulgation de la Charte constitutionnelle, se présente comme un hommage non déguisé à la monarchie restaurée ; Charles le Téméraire, ou le Siège de Nancy, rédigé pendant l’été 1813 et interdit par la censure impériale, rencontre un meilleur accueil en 1814, notamment pour sa dernière réplique qui vise clairement Napoléon : « Un insensé revêtu d’un pouvoir sans bornes est le plus redoutable fléau des nations ». Virulent réquisitoire contre l’Empereur, Charles le Téméraire sera de nouveau interdit pendant les Cent-Jours. Reprogrammé après la seconde abdication de Napoléon, il scinde l’alliance de l’auteur avec le nouveau pouvoir en place, qui lui sera bientôt favorable comme on le découvrira dans les prochains tomes de cette édition.
11Les cinq mélodrames contenus dans ce tome doivent donc être considérés à l’aune de ce climat politique. Si les deux pièces jouées sous la première Restauration affichent les caractéristiques du grand mélodrame à succès tel que Pixerécourt sait les créer, la production antérieure présente des aspects inédits qui prouvent combien l’auteur, pourtant limité dans ses moyens d’expression par une censure vigilante, n’a pas pour autant délaissé le champ des expérimentations dramatiques. Elles sont de deux ordres. Le premier consiste en une exploration renouvelée de l’usage du comique dans le mélodrame. Deux traitements très différents du mélange des genres sont ainsi proposés dans ce tome, l’un avec Le Fanal de Messine, l’autre avec Le Petit Carillonneur, où Pixerécourt met en œuvre des stratégies métathéâtrales visant à distancier la morale et l’esthétique du mélodrame. Le second concerne la prise en charge, par l’auteur, du contenu sémantique de la musique de scène. Avec Le Précipice, ou les Forges de Norvège, Pixerécourt inaugure un système d’annotation de ses manuscrits qu’il conservera pour tous les mélodrames à venir et que l’on trouvera reproduit dans l’appareil critique de notre édition. Les éléments sonores, convoqués dès l’ébauche de la charpente dramatique, sont transformés en indications précises à destination du compositeur. C’est dire si Pixerécourt envisage dès lors le mélodrame comme un laboratoire fécond pour explorer les relais entre parole et musique. Élevée au statut de langage et entièrement maîtrisée par lui sur le plan narratif, la musique fait désormais partie intégrante de la dramaturgie.
Notre édition critique, qui s’appuie sur l’ensemble des documents conservés (manuscrits de l’auteur, de la censure, éditions et partitions musicales), offre ainsi un panel intéressant pour apprécier l’amplitude de l’écriture pixerécourtienne. Les cinq mélodrames de ce tome, dont trois ont été enrichis de leur musique de scène originale, présentent des stratégies rédactionnelles fort différentes, qui montrent une nouvelle fois combien le mélodrame fut loin de se mouler dans une structure répétée et redondante.
Roxane Martin
1 Le nom des personnages achève de lever le voile sur le fonds politique de cette comédie : M. Saint-Louis et Mme de Saint-Phar revendiquent clairement l’opposition entre les deux noblesses. Saint-Phar est le surnom attribué à Louis-Étienne de Saint-Farre, fils naturel de Louis-Philippe d’Orléans et de la comédienne Étiennette Marie Perrine Le Marquis. L’enfant fut élevé au sein de la famille d’Orléans.
2 Rappelons que l’auteur avait déjà utilisé cette formule pour engager une critique du pouvoir impérial avec Marguerite d’Anjou (1809) et Les Ruines de Babylone (1810) [voir le t. 4 de cette édition].