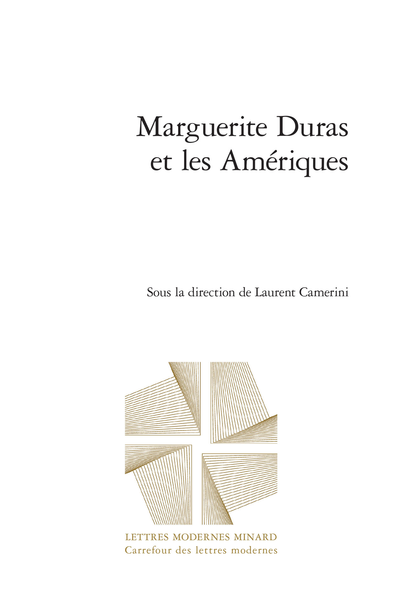
Avant-propos
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: Marguerite Duras et les Amériques
- Author: Camerini (Laurent)
- Abstract: Cette introduction met en avant les enjeux d’une réflexion autour des relations possibles entre Marguerite Duras et les Amériques (influences sur l’imaginaire de l’auteur tant au niveau poétique qu’éthique voire politique, intertextualités, dialogues sur le plan cinématographique ou théâtral). Sont également présentées l’ensemble des contributions contenues dans le recueil.
- Pages: 11 to 17
- Collection: Crossroads of modern letters, n° 16
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406138037
- ISBN: 978-2-406-13803-7
- ISSN: 2494-7520
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-13803-7.p.0011
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 11-30-2022
- Language: French
- Keyword: USA, Canada, nouveauté, découverte, périple
Avant-propos
Invoquer Marguerite Duras, ou suivre ses traces, en terres américaines renferme une part de nouveauté dans la mesure où, au sein des études durassiennes, le continent américain n’a jamais été embrassé dans son immensité géographique ni dans sa pluralité. Si l’intertextualité et les influences du roman américain, reconnues par l’auteure1, et d’écrivains états-uniens (London, Faulkner ou Hemingway2), ont été parfois – voire très tôt – explorées, si l’on sait l’intérêt manifeste que Marguerite Duras portait à un certain cinéma nord-américain3 – y compris à quelques films sud-américains que nous ne manquerons pas de mentionner – de même qu’à certains artistes comme Charlie Chaplin4, Joe Downing5 ou Ralph Gibson, et si récemment les liens avec le monde anglo-saxon et la langue anglaise ont fait l’objet d’une analyse approfondie6, il n’en reste pas moins qu’aucun véritable voyage n’a été entrepris au-delà de ces terres déjà connues de la critique durassienne. Les territoires plus au sud et l’autre hémisphère ont négligemment été délaissés, du fait peut-être d’une vision occidentale inconsciemment trop ethnocentrée. Loin 12d’être exhaustif, pluridisciplinaire de par ses approches, cet ouvrage souhaite donc proposer de nouvelles perspectives.
Que représentent les « Amériques », cet ensemble géographique singulier constitué de nations, de cultures et d’identités diverses, à la fois construit sur une histoire et des peuplements, des mouvements migratoires communs qui ont donné naissance à des rencontres, des syncrétismes et des métissages, mais empreint également de nombreuses divisions, voire de fractures, de barrières, invisibles ou tragiquement réelles et qui continuent de séparer les êtres humains ? En 1953, dans Les Petits Chevaux de Tarquinia, pour Ludi qui cherche en vain à convaincre sa femme de partir en voyage, que symbolise New York, cette lointaine métropole encore inconnue de l’écrivaine ? Que représentent les USA pour Marguerite Duras lorsqu’elle adapte The Miracle Worker de William Gibson avec Gérard Jarlot en 1961, ou The Beast in the Jungle de Henry James en 1981 ? Ses représentations ont-elles évolué au cours du temps ? Sont-elles les mêmes après les voyages réalisés dans les années soixante ? Sont-elles identiques entre les premières évocations, dans Un barrage contre le Pacifique et dans LeMarin de Gibraltar, et les commentaires de Duras sur la politique reaganienne ou la ségrégation raciale aux États-Unis lorsqu’elle discute avec François Mitterrand en 19867 ?
Nous avons choisi de nous demander, également, quels impacts ont eu lesdites représentations sur l’imaginaire et la création de l’auteure. Qu’elle soit centrale, du Nord ou du Sud, l’Amérique prise dans sa globalité évoque généralement pour Duras le départ, le voyage, un lointain ailleurs où une vie nouvelle, faite à la fois de liberté et de sauvagerie, est possible. Comme le souligne Florence de Chalonge en préambule, l’écrivaine se réfère avant tout à l’Amérique du Nord. Dans « De quoi l’Amérique est-elle le nom chez Marguerite Duras ? », de Chalonge affirme que les évocations, souvent hyperboliques, et les occurrences ne sont guère légion, et qu’une bonne partie d’entre elles s’inscrit non seulement dans un contexte d’après-guerre, mais peut faire également référence à un contexte littéraire légèrement antérieur à la Seconde Guerre mondiale et qui, aux yeux de Duras, symbolise le renouveau d’une écriture qui cherche à repousser les limites. C’est à ce renouveau 13et à ces limites que s’intéresse également, dans sa contribution, Walter Romero pour qui l’écriture, en particulier dans Emily L., fait écho à l’errance et sonde les contours d’une territorialisation « américaine », bien plus insulaire que continentale, floue voire aporétique. Évoquée également dans Emily L., l’Amérique du Sud, la latine, semble, pour sa part, prise dans les limbes de l’oubli. Lorsque surgit au détour d’une phrase, comme par hasard, le nom d’un pays latino-américain, ce dernier ne renvoie la plupart du temps à aucune réalité tangible et ne semble se limiter qu’à sa force évocatrice, voire onirique, comme bien souvent avec l’onomastique et la mappa mundi durassiennes8. C’est comme si, malgré les distances, tout était mis en équivalence, sur le même plan ou la planéité d’une carte. Dans La Mer écrite, une photo de l’estuaire de la Seine, prise par Hélène Bamberger, évoque « peut-être le Chili ou un Japon très revu et très corrigé9 », ou lorsque Marguerite Duras présente Carlos d’Alessio, l’Argentine devient « ce Viêt-Nam du Pacifique Sud », caractérisé par « des frontières aplanies, des défenses disparues, la libre circulation des fleuves, de la musique, du désir » (O, 1069). Dans cette géographie erronée car sublimée, Duras ne se prive pas non plus d’inventer de nouveaux territoires comme le Mexicanos de Yes peut-être.
Notons, néanmoins, que l’écrivaine a bel et bien visité certaines régions et villes du continent, qu’elle a pu parcourir les grandes étendues de l’Amérique du Nord. Dans le second tome de sa biographie, C’était Marguerite Duras, Jean Vallier s’attache à retracer ses voyages aux États-Unis10. En février 1964, elle se rend à New York pour la première fois, et elle y retournera en 1969 pour le lancement quelque peu mouvementé de Détruire dit-elle11. Au cours du périple de 1964, qui dure environ deux mois, elle découvre aussi Chicago, et probablement le Kentucky de son ami Joe Downing. Elle s’émeut devant l’immensité des grands espaces américains, mais également devant l’opulence et le confort matériel qu’offre une société de consommation en plein essor12. Est-elle alors sensible à des problématiques plus sociales ? Plus tard, en 1985, alors qu’elle publie « La lecture dans le train » dans The New York Times, une 14scène retient son attention : celle de « la nuée des femmes de ménage de Harlem qui arrivent la nuit dans les grands magasins de Broadway et de la Fifth Avenue » et qui « prennent toutes une heure sur leur temps de travail pour lire les livres qu’elles trouvent » (ME, 1020). Dans « “Les brothers et sisters au Prisu”, Marguerite Duras et la cause noire américaine », Dominique Villeneuve s’interroge sur cette possible lecture sociale des USA, certainement marquée par une sensibilité postcoloniale, et tente de voir si les voyages que nous venons de mentionner ont pu avoir un impact sur La Pluie d’été, du fait de la mention spécifique des brothers et sisters, expression qui pourrait renvoyer à celle utilisée par Bobby Seale, le leader des Black Panthers. Villeneuve émet également l’hypothèse d’une intertextualité avec deux grandes figures de la littérature afro-américaine : James Baldwin et Toni Morrison.
En 1981, Marguerite Duras poursuit sa découverte et se rend cette fois-ci au Canada, plus précisément à Montréal. C’est là que naissent les fameux entretiens que l’on connaît13, et sur lesquels Lauren Upadhyay revient dans « “Écrire dans cette espèce de globalité”, Marguerite Duras à Montréal » afin de démontrer en quoi le passage en Amérique a pu influer sur une perception du réel et faire évoluer une écriture qui oscillera entre fiction et écrit journalistique ou qui mêlera différentes strates diégétiques. Pendant son séjour dans la ville québécoise, semble poindre une volonté d’évoquer spécifiquement la misère du monde. Il s’agit, pour Upadhyay, de voir comment fonctionnent ces juxtapositions scripturales, également présentes dans L’Été 80, et dont la tentative vise à survivre à la tragédie d’évènements passés ou en cours, et à envisager « une nouvelle fraternité » (MDM, 47).
Or, si les aventures en terres nord-américaines ont eu des répercussions sur la pensée et l’écriture durassiennes, deux des articles proposés dans ce volume ont choisi de mentionner le voyage moins connu, de trois semaines, effectué en juillet-août 1967 à Cuba. Dans « Duras-Guevara ou l’utopie d’un “homme nouveau” », Laurent Camerini retrace le séjour de Marguerite Duras dans les Caraïbes et met à jour l’influence de la pensée guévarienne tant sur les prises de positions éthique et politique de l’auteur que sur sa production littéraire, avec notamment la création du personnage d’Ernesto qui évoluera au fil du temps. Vincent Tasselli 15nous délivre, ensuite, une autre lecture de cette expérience cubaine. Selon lui, c’est après cette expérience et alors qu’elle prend progressivement conscience du rejet salutaire de tout communisme doctrinaire que se dessinerait une vision désenchantée du politique, vision d’un monde dystopique ou d’une fin du monde ou du logos s’il en est, comme il le démontre dans « La destruction du capitalisme ; échos du séjour cubain de Marguerite Duras dans Yes, peut-être et Abahn Sabana David ».
Au-delà de ces expériences tangibles,on ne peut nier le rôle moteur qu’ont eu réellement ou indirectement des rencontres, des acteurs « américains », lors de la gestation de certaines œuvres durassiennes. Nombreux ont été les collaborations et les projets. Et quand bien même les scénarios pour les sociétés américaines Four Star Television ou Twentieth Century Fox n’ont pas abouti, on peut se demander ce que seraient devenus Lol V. Stein ou Détruire dit-elle sans ces premières ébauches. Trois contributions explorent plus en avant des relations jusqu’à présent moins étudiées avec le cinéma nord-américain. Virginie Podvin revient brièvement sur l’appel fait par Hollywood à Marguerite Duras et analyse plus en détail les correspondances, au cours des années soixante, et l’admiration réciproque, les affinités particulières tissées, les projets manqués entre Marguerite Duras et Joseph Losey, tandis que Michelle Royer s’intéresse à l’engouement de Duras pour le film miraculé Wanda (1970) de Barbara Loden et pointe les similitudes possibles entre les univers cinématographiques des deux réalisatrices aux confluences de la production des années soixante-dix et des mouvements féministes de l’époque. Pour Royer, rapprocher les deux road movies que sont Wanda et Le Camion permet de mieux percevoir une certaine idée du cinéma nord-américain véhiculée par Duras. Françoise Barbé-Petit, quant à elle, met en synergie les univers de Marguerite Duras, de Heart of darkness de Joseph Conrad et de Francis Ford Coppola, en se référant plus précisément à l’ajout de la scène de la plantation dans Apocalypse Now Redux. Dans l’enchevêtrement de ces univers qui pénètrent les tréfonds de la nuit et l’inconnu, ce sont la thématique de l’horreur et les images de la lèpre et du fleuve qui retiennent son attention.
Lorsqu’on évoque le cinéma, et plus largement les collaborations « américaines » manquées ou avérées, la prudence est de mise car il ne faudrait oublier de mentionner les liens avec une contrée plus australe ou du moins avec ses compatriotes. En effet, le film Baxter Vera Baxter 16aurait-il le même charme et la même intensité sansle rythme andin entêtant de Mañana Goodbye ? La création filmique durassienne, et India Song par exemple, aurait-elle eu la même tessiture, voire la même reconnaissance internationale, sans une certaine sensibilité « argentine » et sans le génie musical de Carlos d’Alessio ? Qu’en serait-il également de la production théâtrale durassienne, et de Savannah Bay sans les décors de Roberto Plate ? En 1981, la version de Duras de La Bête dans la jungle réunit trois jeunes Argentins : Alfredo Arias à la mise en scène, Roberto Plate pour les décors, et Carlos d’Alessio pour la musique. Dans París no se acaba nunca, le romancier espagnol Enrique Vila-Matas évoque ce « grupo argentino de París14 », qui gravita autour de Marguerite Duras, et auquel appartenaient notamment les écrivains Raúl Escari et Copi. Dans « La construcción del cuerpo en Marguerite Duras : puntos de apoyo en la teatralidad de Copi », Facundo Martinez nous offre une analyse comparative des univers théâtraux de ce dernier (avec principalement un texte comme Eva Perón) et de Marguerite Duras, tout en mettant l’accent sur le traitement et la perception du corps, un corps déraciné, un corps trans, (traversé et traversant), loin de toute innocence et servant à interroger l’universel.
Nous voyons, de ce fait, que les rapports artistiques, littéraires, doivent indéniablement être interrogés, et ce pour tout le continent américain. À l’inverse, il est enrichissant d’examiner avec attention l’impact de Duras sur les créations artistiques « américaines », de voir quels sont les éventuelles descendances et les dialogues établis, comment a été reçue et perçue son œuvre. Dans « Duras en Amérique : deux scènes éditoriales », en prenant entre autres appui sur le concept d’iconographie d’auteur, sur les couvertures de différents livres et sur les péritextes, Lucía Vogelfang analyse la réception de l’œuvre de Duras tant aux USA qu’en Argentine. Lorena Rojas s’y intéresse également par le biais de la traduction faite de La Vie Tranquille par les écrivaines et poétesses argentines Alejandra Pizarnik et Juana Bignozzi. Disons-le ouvertement : rares ont été les analyses qui ont cherché à rapprocher Marguerite Duras d’écrivains latino-américains. Or nombreux d’entre eux, et particulièrement une « jeune » génération, reconnaissent avoir été influencés par l’univers et l’écriture de Duras. Tel est le cas de l’Uruguayenne Alicia Migdal15, 17des Argentins Guillermo Sacomanno16 ou Camila Sosa Villada17, du Mexicain David Miklos18. Prenant appui sur le conte « A imitação da rosa » de la Brésilienne Clarice Lispector, et utilisant une approche psychanalytique (Lacan, Freud), Maria Cristina Kuntz met en relation les portraits et les délaissements de Lol V. Stein et de Laura, le personnage féminin de Lispector.
Dans le même ordre d’idées, il nous paraît important de signaler que la personne même – ou personnage créé de toutes pièces – de Marguerite Duras a pu inspirer certains dramaturges. Parfois, elle va jusqu’à faire son apparition sur les planches, comme dans la pièce canadienne, Les Marguerites (2018) de Stéphanie Jasmin, dont Eugénie Matthey-Jonais analyse la mise en scène qui fait la part belle à la voix de Duras, en tant que prolongement de sa figure autoritaire, et à une écriture durassienne définie comme mystique. Yann Mével, lui, se penche sur La Muerte de Marguerite Duras, pièce de théâtre écrite en 2002 par l’Argentin Eduardo Pavlovsky qui affronte avec une certaine dérision la solitude et la mort, et qui n’est pas sans évoquer l’univers beckettien. Afin de compléter ce panorama théâtral, et en guise d’épilogue, nous avons choisi de publier trois entretiens réalisés avec des metteurs en scène et/ou acteurs latino-américains, aux parcours très différents, afin de comprendre comment est actuellement perçue et transposée à la scène l’œuvre de Marguerite Duras. Un épilogue ouvert aux dialogues et qui, espérons-le, permettra d’envisager des prolongements aux différentes pistes proposées dans ce volume…
Laurent Camerini
1 « Le roman américain a exercé sur moi une grande influence qui se retrouve dans la première partie des mes œuvres » (« Les hommes de 1963 ne sont pas assez féminins », entretien avec Pierre Hahn, Paris-Théâtre, no 198, juillet 1963, p. 35).
2 Voir notice « Hemingway » in Bernard Alazet, Christiane Blot-Labarrère (dir.), Dictionnaire Marguerite Duras, Paris, Honoré Champion, 2020, p. 281-282.
3 On ne peut oublier « L’homme tremblant », la conversation entre Duras et Elia Kazan publiée dans les Cahiers du Cinéma en décembre 1980 et on sait combien la production américaine The Night of the Hunter du britannique Charles Laughton (naturalisé américain en 1950) était importante pour elle.
4 Voir notice « Chaplin », in Bernard Alazet, Christiane Blot-Labarrère (dir.), Dictionnaire Marguerite Duras, op. cit., p. 116-117.
5 Cécile Hanania, « Marguerite Duras rencontre Joe Downing », in Olivier Ammour-Mayeur, Florence de Chalonge, Yann Mével, Catherine Rodgers (dir.), Marguerite Duras, passages, croisements, rencontres, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 341-354.
6 Voir le dossier « Marguerite Duras et le monde anglo-saxon », in Cahiers Marguerite Duras, no 1, 2021, <https://www.societeduras.com/cahier-n-1-2021> (consulté le 01 mars 2022).
7 Voir plus particulièrement « La Nouvelle Angoulême », in Marguerite Duras, François Mitterrand, Le Bureau de poste de la rue Dupin et autres entretiens, Paris, Gallimard, 2006, p. 111-132.
8 Sans doute en est-il de même avec le Canada et Vancouver dans les Aurélia.
9 Marguerite Duras, La Mer écrite, Paris, Marval, 1996, p. 26.
10 Voir « À la découverte de l’Amérique », in Jean Vallier, C’était Marguerite Duras, Tome II, 1946-1996, Paris, Fayard, p. 431-443.
11 Ibid., p. 587.
12 Ibid., p. 435.
13 Marguerite Duras à Montréal, textes et entretiens réunis par Suzanne Lamy et André Roy, Montréal, Québec, Éditions Spirale, 1981. Désormais abrégé MDM.
14 Enrique Vila-Matas, París no se acaba nunca, Barcelona, Editorial Anagrama, 2003, p. 180.
15 Marta Labraga de Mirza, « El sujeto de la escritura y el yo extranjero : Alicia Migdal y Marguerite Duras », Revista de la Biblioteca Nacional de Uruguay, 04/05, 2011, <http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/31959> (consulté le 01 mars 2022).
16 En témoignent ses nombreux articles sur Duras dans le journal Página12 ou sa préface à l’édition argentine de Le dernier des métiers.
17 Voir la quatrième de couverture de son livre Las Malas où Duras est citée comme source d’inspiration : Camila Sosa Villada, Las Malas, Buenos Aires, Tusquets, 2019.
18 José Quezada Roque, « David Miklos, el novelista en busca de su origen », Máspormás, 19/06/2017, <https://www.maspormas.com/ciudad/david-miklos-la-pampa-imposible/> (consulté le 01 mars 2022).