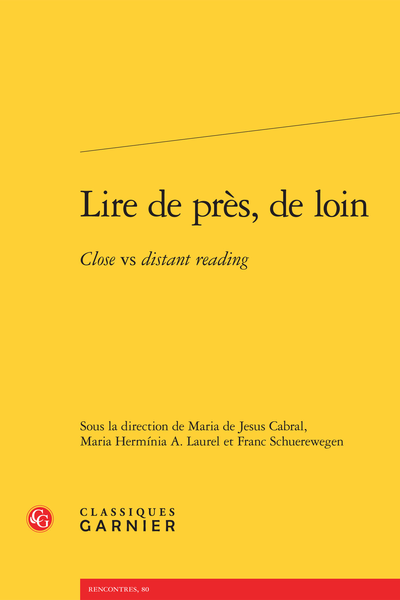
Ouverture à trois voix
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Lire de près, de loin. Close vs distant reading
- Pages : 7 à 18
- Collection : Rencontres, n° 80
- Série : Théorie littéraire, n° 3
- Thème CLIL : 4053 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Théorie Littéraire
- EAN : 9782812421266
- ISBN : 978-2-8124-2126-6
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-2126-6.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 19/05/2014
- Langue : Français
Ouverture à trois voix
Quelqu’un dit, quelque part,
dans le global world :
Les travaux de Franco Moretti ont fait à juste titre un assez inquiétant bruit de tonnerre dans le Landernau « lettré ». Ce que nous croyions faire bien, lisant les textes de près, attentivement, les scrutant, les décortiquant, à la loupe, en quelque sorte, nous le faisions donc mal. Une longue tradition de la microlecture, qui était forcément à nos yeux la bonne lecture, car elle s’efforçait de prendre en compte « le grain du texte », se voyait soudainement mise en cause. Pourquoi lire de près ? Lisons de loin, a dit Franco Moretti, prenons de la hauteur, voyons les choses en grand, passons à la vitesse supérieure. D’ailleurs, toujours selon le même auteur, pourquoi se fatiguer à lire les textes ? D’autres usages, d’autres dispositifs sont possibles. Nous pouvons aussi, par exemple, les classer, les cataloguer, compter leur nombre de pages, compter les volumes dans une bibliothèque, bref, mettre tout cela en graphe, en carte. Analyser peut aussi être synonyme de cartographier, et on sait que la cartographie littéraire est un exercice où Franco Moretti a brillamment réussi : « Nous savons comment lire des textes, apprenons maintenant comment ne pas les lire » ; « Si, entre le très étroit et le très large, le texte lui-même disparaît, eh bien, ce sera une de ces situations où l’on peut légitimement dire que moins est plus (less is more) ». Ou encore : « Les textes sont assurément les objets réels de la littérature […] mais ils ne sont pas de bons objet de connaissance pour l’histoire littéraire ». Certes, on peut d’abord juger choquants de tels propos. Moretti ne cherche-t-il pas en quelque sorte à déshumaniser ce que l’on appelle dans le pays où il enseigne les Humanities ? Le traitement des textes – car on ne peut plus, à ce moment, parler d’un acte de lecture – sera-t-il désormais, dans le monde que Franco Moretti appelle
de ses vœux, réservé à des robots, à des machines ? D’ailleurs, on le voit aussi très bien, ce que l’on propose de mettre au rancart ici, c’est très exactement l’idée que le texte est au centre des études littéraires. Nous formons dans nos départements des fétichistes du texte, alors que, pour Moretti, « le texte n’est pas un bon objet de connaissance pour l’histoire littéraire ». Donc, oublions le texte, débarrassons-nous d’un objet aussi encombrant, ou futile. Mais si notre objet n’est pas le texte, quel est-il ?
Les propos de Moretti nous font d’abord peur ; bien vite, toutefois, nous sommes obligés d’admettre que l’homme n’a pas tout à fait tort et que la longue et noble tradition de la close reading à laquelle nous adhérons, dans laquelle nous avons grandi est aussi, depuis toujours, en quelque sorte, génératrice d’un embarrassant paradoxe. C’est que, plus on est attentif au fonctionnement d’un texte, à ses « détails » – le « détail » est bien évidemment une notion dont le close reader ne peut faire l’économie –, plus, en somme, on a le nez collé sur l’objet, moins cet objet devient accessible. Un épisode proustien me vient ici en mémoire. Le héros tente d’embrasser Albertine. Quand il approche son visage des joues de sa bien-aimée, ce visage s’éloigne. Close, si on veut, justement parce que l’on s’approche ici de trop près, redevient distant. Je cite Proust : « D’abord au fur et à mesure que ma bouche commença à s’approcher des joues que mes regards lui avaient proposé d’embrasser, ceux-ci se déplaçant devinrent des joues nouvelles ». Plus loin : « Tout d’un coup, mes yeux cessèrent de voir, à son tour mon nez, s’écrasant, ne perçut plus aucune odeur, et sans connaître pour cela davantage le goût du rose désiré, j’appris, à ces détestables signes, qu’enfin j’étais en train d’embrasser la joue d’Albertine ». Il y a là à mon sens une assez belle allégorie de la microlecture et de ses paradoxes : pour qu’un objet soit accessible, pour que le texte soit lisible, quelque chose comme une « bonne distance » est nécessaire. Mettez-vous trop loin, vous ne voyez rien, venez trop près, et vous redevenez aveugle. Le close reader, même s’il a sans doute le plus souvent du mal à l’admettre, peut aussi souffrir d’un excès de proximité qui compromet d’office les résultats de son analyse.
J’ai cité Proust, je pourrai aussi, à propos de la même difficulté toujours, citer ce passage de Jean-Pierre Richard qui fait de lui-même, dans Poésie et profondeur, à propos de son rapport aux textes, un autoportrait en amant proustien : « La critique nous a paru de l’ordre d’un parcours, non d’un regard ou d’une station. Elle avance parmi des paysages dont
son progrès ouvre, délie, replie les perspectives. Sous peine de choir dans l’insignifiance du constat, ou de se laisser absorber par la lettre de ce qu’elle veut transcrire, il lui faut avancer toujours, toujours multiplier angles, prises de vues ». On aura sans doute compris déjà pourquoi les deux passages se ressemblent. Mettez à la place des « joues d’Albertine » « le texte que je lis », vous arrivez grosso modo à la même image, et à la même conclusion. Le critique risque d’« écraser » son objet dès lors qu’il souhaite l’étudier attentivement, passionnément, comme le personnage proustien. Mais s’il ne l’« écrase » pas, y aura-t-il eu un contact avec l’objet ? Franco Moretti, me semble-t-il, prône aussi la distant reading pour échapper au paradoxe de la proximité. Puisque la microlecture produit de l’instabilité, puisque des phénomènes de fuite et de « déportement » sont ici inévitables, changeons notre fusil d’épaule ; cessons de raisonner en termes de « texte » et de « lecture » ; en un mot, créons, pour la lecture littéraire, un autre cadre conceptuel : « Et ici, vous n’avez vraiment plus besoin de lire le texte ; plutôt, à travers le texte, vous cherchez votre unité d’analyse ». Le propos, et le point de vue soutenu, nous avait un peu étonnés au départ, finalement, force est de l’admettre, on s’y fait très bien. S’il existe un paradoxe de la close reading – en scrutant l’objet, on perd l’objet –, Moretti formule quant à lui un paradoxe de la distant reading, dont on voit bien à présent qu’il peut être bénéfique : cessons de lire les textes, justement pour mieux les lire et les comprendre. Ne disons plus que nous nous intéressons au texte, pour sauvegarder… le corpus des textes… On sait d’ailleurs que la méthode de Franco Moretti s’est avérée particulièrement fructueuse dès lors qu’elle est aux prises avec cet autre objet fuyant et instable qu’est la littérature « mondiale » : World Literature. Quand on lit à la manière de Jean -Pierre Richard, on produit des analyses excellentes de, entre autres, Chateaubriand, Proust, Mallarmé, Michon et j’en passe et des meilleurs. Mais quand apparaît ce que j’appellerai avec la formule de Jérôme David le spectre de Goethe, quand la littérature devient planétaire, la posture richardienne se voit aussi soudainement moins efficace, ou moins performante : comment faire la microlecture d’une traduction ? Comment lire « de près », en traduction, un texte dont on ne comprend pas la langue originale ? Les comparatistes, on le sait, se trouvent souvent confrontés à ce défi ! Comment lire à la fois, et en close reader toujours, Proust et Pamuk, Zola et Kenzaburo Oe, Michon et Garcia Marquez, Montaigne et Mafouz ? Il
est clair que, à ce moment, dans ce contexte élargi, d’autres habitudes, d’autres démarches sont nécessaires. Le terrible Moretti, de ce point de vue, peut aussi être un guide pour nous.
Réflexion faite, je crois que, dans le débat entre close et distant readers, deux positions sont possibles, et qui peuvent d’ailleurs, en ce qui me concerne, aller de pair. Soit on part du principe qu’il s’agit vraiment d’un débat, c’est-à-dire d’une polémique et l’on part donc à la recherche d’un vainqueur. Qui perd ? Qui gagne ? Ou plutôt : qui pense qu’un tel est gagnant, un tel autre perdant, et pourquoi peut-on le penser ? Pourquoi a-t-on, en outre, le droit de ne pas être d’accord avec la position qui est prise, quitte à soutenir la position inverse ? Soit on admet que close et distant reading ne sont guère autre chose que des angles d’approche, que l’on choisit en fonction du type d’analyse que l’on veut conduire, des résultats que l’on souhaite obtenir. On fera alors tantôt un peu de close, tantôt un peu de distant, dans une sorte de calme syncrétisme qui ne nécessite pas la polémique, où la polémique, en fait, est nuisible. Close et distant readers vivent alors ensemble de façon harmonieuse dans leurs départements universitaires. Il arrive que le même collègue s’affiche tantôt coiffé de la casquette close, tantôt de la casquette distant. On ne lui en veut pas, on comprend les raisons de son choix… J’ai parlé d’un syncrétisme, il faudra peut-être dire aussi : un pragmatisme. Le critique a besoin d’outils, il choisit ses outils en fonction de ses besoins, de son programme. J’admets volontiers que le premier scénario que j’ai évoqué est trop antagoniste. On fait certes la guerre à l’université – il s’agit d’ailleurs en ce milieu d’une sorte de sport favori – mais il ne faut pas, ici, forcer la note. Le second scénario me semble en revanche trop iréniste. Je sens bien, parce que j’appartiens au « champ », qu’une certaine rivalité existe entre les deux camps et, donc, qu’il existe effectivement deux camps. On peut seulement espérer alors qu’ils finiront par faire la paix d’une manière ou d’une autre et, aussi, que le présent volume pourra aider à sa façon à les rapprocher. Je dirai sans jeu de mots que close et distant readers pourraient être universitairement plus close et que ce serait une bonne chose en ce qui me concerne.
F. S.
Quelqu’un ajoute :
À l’origine de notre problématique, un constat : si la close reading est immédiatement identifiable au courant du New Criticism anglo-saxon et à toute une tradition philologique européenne de la seconde moitié du xxe siècle – largement exploré d’Auerbach à Léo Spitzer ou Tzvetan Todorov, du « premier » Jacques Derrida à Paul de Man, sans oublier Michel Charles et Michael Riffaterre, jusqu’à sa formulation française en « microlectures » par Jean-Pierre Richard –, la distant reading est un domaine relativement récent, moins connu et associé, généralement aux thèses polémiques de Franco Moretti.
Ce déséquilibre est moins troublant si l’on arrête notre attention sur le mot qui, dans l’intitulé de cet ouvrage, relie les deux perspectives ou les deux méthodes d’analyse. Le mot versus, on le voit, vaut moins par l’opposition, somme toute ironique qu’il implique, que par sa force de questionnement.
Il s’agissait donc moins d’opposer, suivant une démarche critique zélée, deux méthodes comme on opposerait deux clans, deux camps, deux moments : l’ancien, qui repose sur la noblesse des lettres et une compréhension herméneutique de la res literaria, et le nouveau, plus démocratique, allié à des savoirs jugés plus « légitimes » (la géographie, la statistique, la biologie), militant pour une plus grande objectivité des études littéraires. Replacé à l’aune des Cultural Studies, de l’interdisciplinaire, des débats et des disputes sur la World Literature, il s’est avéré riche de conséquences. Entre déconstruction et dialectique, c’est le mot lecture qui a, de fait, réactivé la réflexion critique, en inspirant les travaux que l’on va lire dans ce volume. C’est lui qui constitue le fil rouge qui relie les textes réunis ici.
Comment lire et que lire ? Il y a-t-il une bonne distance de lecture comme l’on pourrait parler du placement du verre par rapport à l’œil ? Une macrolecture, comme le propose Franco Moretti, est-elle encore une lecture ou bien sort-elle du domaine proprement littéraire – du grain du texte, du temps, du rythme et de la voix, qui en sont des composantes à part entière ? « Depuis que nous sommes dialogue », ajouterais-je, avec Hölderlin.
La littérature comparée est par excellence la discipline qui envisage les textes du dehors, en position d’« exotopie », pour reprendre un mot de Bakhtine. Son prisme est par nature excentré, situé « à une place qu’on est le seul à pouvoir occuper hors des autres » soucieux de rendre compte de la diversité constitutive du champ (selon la notion opérante de Bourdieu), de sa dynamique et ses interactions plutôt que ses concentrations.
Une approche plus compréhensive – géographique et culturelle et évolutive, au-delà d’historique – des phénomènes peut certes permettre d’envisager la littérature autrement, de la décentrer de multiples inféodations (institution, canon, légitimation…). Les conjectures de Moretti sont intéressantes en ce qu’il nous invite à aborder les œuvres, classique et modernes, sans préjugés – géopolitiques, esthétiques ou autres – contraignants. Dès lors, l’enseignement même de l’histoire littéraire pourrait sortir de l’approche monographique, avatar du lansonisme, pour s’ouvrir à l’histoire naturelle et sociale des œuvres, cherchant dans celles-ci non la réponse à la nature humaine, selon le vœu de Zola, mais la façon dont elles ont survécu au cours des temps, au gré des évolutions. « Vie des œuvres » au lieu de « Vie et œuvre ». Il suffirait de relire à ce propos la célèbre « Enquête » de Jules Huret sur l’évolution littéraire pour comprendre l’aisance avec laquelle, par-delà les tendances et les « écoles », les écrivains du dernier quart du xixe siècle conversaient véritablement, entre eux, et faisaient dialoguer les domaines de la connaissance. Mallarmé, prônant une littérature « entre l’Art et la Science », est à cet égard emblématique.
Franco Moretti remet en cause des frontières somme toute très artificielles dressées au sein de la littérature. Que ses soupçons se soient révélés d’une portée remarquable, le parcours de Jérôme David en est le témoignage.
Or, lire en position ex-centrique, adopter la marge plutôt que le centre n’est pas forcément lire de loin. Le comparatiste, pour rester à cet exemple, rapproche, fait dialoguer les textes – l’intertextualité et la polyphonie lui sont des outils essentiels – pour en saisir les variations, les transitions, les métamorphoses ; à partir de ce geste de lecture, il les rend proches en leur distance. Par et à travers le texte, par et à travers ce texte spécifique placé devant ses yeux, par et à travers ces « vingt-quatre lettres » qui, comme l’a bien vu Mallarmé, en sont le dénominateur privilégié. C’est pourquoi le Poète proposait comme définition de la lecture le mot pratique,
une invention toujours en acte. Une nouvelle épistémè née au temps de « Crise de Vers » à l’aube de la Modernité. En quoi Mallarmé préfigure des questions de lecture mises à l’écart par le structuralisme...
Que peut-il revenir, en effet, d’une distant reading si elle élude l’expérience personnelle et le processus indiqués et impliqués dans l’aspect continu du verbe, en anglais ? Comme il arrive souvent, c’est de l’intérieur du mot, du « signifiant fermé et caché » qu’évoquait Mallarmé dans Le Mystère des lettres, que surgit la réponse au problème.
J’évoquerai maintenant Le Côté de Guermantes où l’épisode de l’accident vasculaire cérébral de la grand-mère du narrateur – non sans lien avec la digression mentale de Marcel – est dit à partir de la contiguïté lexicale : alluvion – allusion… Les vertus de la suggestion. Le temps de Proust rejoint en tout cas le nôtre à ce moment-là, dans et par l’acte de lire. Joues, aubépines, huitres, clochers, reviennent pleines de sens – sensation et signification – et avec une temporalité vivante, souple, animée. En prose et contre l’historicisme, ces mots devenus présent à l’état pur nous montrent l’historicité essentielle du langage. Et du sujet, homo significans qui invente l’avenir du passé, comme dirait Pessoa.
La lecture ne fait que mettre à découvert un infini de « mondes possibles », dont participe aussi ce qui ne se voit pas du discours. Le silence de Mallarmé, l’alchimie de Proust, le magnétisme de Pessoa.
S’attacher au paysage et au relief, aux arbres et aux rochers ne saurait faire abstraction de la substance, de la sève, du langage, qui est circulation de vie. Une lecture de loin de La Recherche serait comme une partition sans musique. C’est là que la méthode de Moretti, si on l’envisage stricto sensu, nous laisse sur notre faim. Le danger est bien pointé par Laurent Jeanpierre dans son introduction à la traduction française de Graphes, cartes et arbres, on risque « désormais de lire extensivement, ou plutôt de “voir” (au lieu de lire) de loin ».
Sans doute il-y-a-il profit à opposer lire et voir, dès lors que même un aveugle peut dialoguer avec le texte, l’écouter au plus près, le représenter et le réinventer, sans intervention de la vue. Une voix fidèle, blanc sur noir, supprime les ténèbres.
Il était temps, il était tentant, en tout cas, de déjouer ces oppositions de saisir l’occasion d’une revalorisation de la lecture qui définit la res literaria. Non pour redorer le palmarès critique et des querelles anciennes Europe/Outre-Atlantique. Mais pour se mettre à l’écoute de
cette chose littéraire, et l’interroger dans ses certitudes comme dans ses contradictions. On pouvait deviner la sorte de résistance que l’idée d’une distant reading allait susciter. Elle s’est avérée riche dans le jeu propre de nos discours croisés. « Toute critique est une invention », disait Michel Butor. Une invention toujours provisoire.
M. J. C.
après quoi on dit :
Les chercheurs en littérature sont invités à inventer de nouvelles stratégies et de nouvelles complicités interdisciplinaires, face à la déterritorialisation de la pensée critique et à l’émergence de nouveaux discours totalitaires méconnaissant la diversité culturelle ou craignant les nouvelles dynamiques littéraires, se devant d’énoncer de nouvelles formes de résistance face à la mort annoncée de la discipline (comme « métadiscipline ») dans le monde globalisé, informatisé, décentré, multiculturel que nous avons en partage. Il conviendrait sur ce point de lire Antonio Negri, et les arguments grâce auxquels ce philosophe du contemporain justifie l’émergence d’une « nouvelle axiomatique politique » : « Tous les concepts philosophico-politiques que la modernité nous avait offerts sont désormais en crise – de la souveraineté à l’État-Nation, de la citoyenneté à la classe ouvrière, des frontières aux migrations, des subjectivités politiques à la massification des luttes, des phénomènes de dépendance au tiers-mondisme, etc. ». C’est dans ce cadre où règne l’incertitude, l’éphémère et la mouvance – où le canon littéraire ne saurait plus être réduit au « canon occidental » –, que les études comparatistes cherchent à repenser leur objet, et qu’elles cherchent des formes de résistance aux conséquences de la mondialisation prévues par Negri. Revenons à la lecture lucide du philosophe sur l’« espace de référence » contemporain, celui de la mondialisation, dont la dynamique propre est régie par des formes « tout autant uniformes et homogènes ». Pour Negri, « les processus de mondialisation sont transversaux et jouent
par conséquent sur la totalité des réalités qui constituent le tissu mondial : l’Empire comme structure et l’Empire comme réalité sont des enfants qui se ressemblent ». Situées sous le signe de la résistance aux discours totalitaires et nationalistes dans l’après-guerre, les études comparées ne sauraient écarter leur nature profondément politique – tout autant que profondément nécessaire – de nos jours.
Effectivement, les études de littérature comparée ont toujours eu le mérite de s’interroger, depuis leur fondation institutionnelle, en héritage des perspectives cosmopolites héritées du xviiie siècle sur leur objet, par nature instable, de même que sur leur méthode d’approche des textes.
C’est justement à une « littérature en mal de discipline » ou, si l’on veut, à des études comparatistes en mal de discipline, que répondent, à l’heure actuelle, des propositions de travail aussi intéressantes que celles qui sont présentées dans le présent ouvrage. On se propose de revenir sur la matière première du travail comparatiste : les textes et nos postures de lecture. Qu’en est-il de la littérature comparée, lorsque son objet, la littérature, est elle-même en mal de définition ?
Les textes que l’on va lire, présentés dans le cadre d’un colloque qui voulait lui-même marquer, sur le plan des méthodes, un tournant, posent la question très précisément. Comment lire : de près, de loin ? Des arguments de poids surgissent en faveur de l’une et de l’autre posture. Des arguments qui soutiennent des postures d’approche des textes propres, certes, mais non proprement divergentes. L’objectif de ce colloque n’est certes pas de les concilier, mais de nous inviter à une réflexion sur les grands changements qui sont en train de s’opérer dans le domaine des études comparées, à l’issue du débat sur la lecture littéraire : sur les postures de lecture.
Ce débat ne saurait ignorer le changement qui s’opère lors de l’ouverture du champ d’étude à des perspectives non européennes, non occidentales. C’est là d’ailleurs que Franco Moretti enracine sa réflexion. Sa constatation, selon laquelle l’entreprise comparatiste n’a été finalement qu’une bien modeste entreprise intellectuelle, peut sembler choquante au départ, l’est-elle vraiment ? Moretti a le mérite de reconnaître que la majeure partie des recherches comparatistes ont eu, traditionnellement, comme toile de fond, des référents textuels de l’Europe occidentale. Moretti invite, en somme, à la dislocation territoriale, se rapprochant ainsi de la tendance excentrique vérifiée dans le champ des études comparées aujourd’hui.
Se poser la question du « comment lire », à partir de quelle « bonne distance », implique un raisonnement d’ordre spatial, de posture, de distance, par rapport au texte : de près, de loin ; mais aussi de l’ordre de l’appropriation du texte : en le lisant de près, en y cherchant un sens, une intention, n’est-ce pas admettre le rapport de l’appartenance du texte soit à son auteur, soit à son lecteur, soit à lui-même, de façon autotélique, intransitive ? Le lire de loin équivaudra-t-il à perdre le texte dans d’autres ensembles de textes, qui en diluent la spécificité, et avec celle-ci, la lecture spécifique qui pourrait en être faite ? Quelles conséquences en termes de rapport – y inclus de pouvoir – entre le lecteur et le texte ? Quelles conséquences en termes du pouvoir du texte lui-même ? Concevoir, à la limite, de ne pas lire les textes ou, du moins, reconnaître que nous ne pourrons jamais les lire tous, situe le lecteur devant des voies de lecture insoupçonnées : la première, qui reconnaît l’existence d’un type de non-lecture fructueuse, qui n’est pas du tout synonyme d’une apologie de l’ignorance, ni du refus de la lecture ; la deuxième, qui découle de la disponibilité, de la circulation, du nombre croissant et incontrôlable des livres dans le monde, et de leurs traductions, et de la reconnaissance de notre impossibilité à tout lire, des limites à la lecture. Plutôt que de souhaiter d’élargir la notion de World Literature/« littérature monde » à une accumulation de lectures, Franco Moretti attire notre attention sur la nécessité de modifier nos catégories littéraires ; pour cet auteur, la notion de World Literature renvoie plutôt à un problème, un problème qui cherche la bonne méthode non pas à sa solution – ce qu’aurait peut-être espéré le lecteur avide de recettes de lecture – mais une méthode qui permette de mieux mettre en lumière, de loin, à partir de modèles non littéraires, issus de l’histoire sociale, culturelle ou économique (donc, qui échappent au contrôle des disciplines « voisines » de la littérature), de mieux mettre en lumière plusieurs facteurs qui interfèrent dans la construction de l’histoire littéraire : d’inviter le lecteur à considérer le système de la littérature mondiale comme profondément inégal (one and unequal), à l’image du système de domination culturel ou économique des sociétés, qui détermine des rapports asymétriques de pouvoir entre les différentes cultures. À travers sa proposition de distant reading – focalisée non sur les textes individuellement, mais sur les réseaux que constituent, à leur tour, les genres littéraires, les thèmes, les tropes, il est ainsi amené à mettre en évidence les réseaux d’interférences, d’influences, d’importation,
de relations entre les littératures du monde ; cette posture devient pour l’auteur la source première de la connaissance/de la lecture d’un texte.
Se poser la question du « quoi lire » (ou, du canon littéraire à respecter), implique encore un raisonnement d’ordre spatial : à partir du moment où la circulation des livres est un fait de la contemporanéité, du monde dans lequel nous vivons, à partir du moment où nos références littéraires cessent d’être exclusivement centrées sur le canon occidental et s’ouvrent au monde (notamment, grâce à la traduction), ce que la notion de World Literature (d’après David Damrosch) consacre, qui se veut surtout une méthode d’approche des textes adéquate à la réalité contemporaine. Si, d’une part, cette proposition dépasse la posture traditionnelle de l’histoire littéraire qui prônait l’étude de la situation contextuelle (génétique, historique, sociale, géographique, hiérarchisée selon des typologies génériques) des œuvres, elle se propose de tenir compte, d’autre part, de l’évolution des formes, et de leur spatialisation « réfractée » entre les deux points focaux de l’ellipse où se tient leur vie littéraire : là encore, l’on vérifie que des rapports de domination marquent cette évolution, ce qui permet de considérer l’histoire des formes comme une histoire de pouvoir.
Fin du comparatisme ou triomphe de la lecture ? La réponse à cette question ne saurait reprendre le rapport d’opposition dichotomique absolu qu’elle semble soulever. Invitation plutôt à une nouvelle dimension du comparatisme, fondé sur des perspectives spatiales de la lecture. À la réflexion centripète, du même au même, qui a marqué non seulement l’histoire littéraire, mais aussi l’histoire du comparatisme et les conceptions de la lecture autotélique qui les soutenaient, se substitue désormais l’image réfractée de l’ellipse qui permet de passer du monde ancien au monde global.
M. H. A. L.
Jérôme David revient aux questions que soulève déjà son ouvrage Spectres de Goethe à partir de la notion fort intéressante et sans doute incontournable dans le contexte donné qu’est le Anzatspunkt ; Helena Carvalhão
Buescu s’intéresse au cas du portugais, dans le cadre de l’hypothèse critique d’une « littérature-monde » ; José Cardoso Bernardes envisage le phénomène et la méthode de la distant reading dans une perspective que l’on peut appeler bibliographique ; Ana Paula Coutinho réfléchit quant à elle aux vertus du dispositif « bifocal » ; Emmanuel Bouju attire notre attention sur la sorte de vertige que peut éprouver celui qui prend au sérieux la notion – qui n’a en effet plus rien d’anodin aujourd’hui – d’une littérature authentiquement et résolument « globale » ; Alain Trouvé explore la tension entre proximité et rapprochement dans un cadre psychanalytique ; Vincent Jouve écrit sur la lecture « comme art du zoom » ; Gérard Dessons analyse un certain type de « glissement » que l’on peut observer dans la définition de la méthode distant quant à la notion du temps et pose la lenteur comme critère de la poéticité des textes. Maria de Jesus Cabral signale, à propos de Mallarmé, une véritable synthèse qui semble se faire, à l’écoute du texte, entre distance et proximité via la théâtralité du langage ; Luc Rasson étudie la question fort délicate du discours politique, et de ce que doit ici être la « bonne distance » entre le critique et son objet ; Franc Schuerewegen se penche sur le cas de Balzac, lu par Proust, qui est, dans le contexte donné, très distant reader ; Jean-Marie Gleize médite, en poète qu’il est, sur le cas du « gravier ». Nous reproduisons en fin de volume un entretien avec Vincent Jouve où l’on revient à la question des rapports entre littérature, lecture et valeur.
Nous sommes reconnaissants à Madame Marisa Henriques pour l’aide qu’elle a apportée dans l’établissement du manuscrit.
Les éditeurs