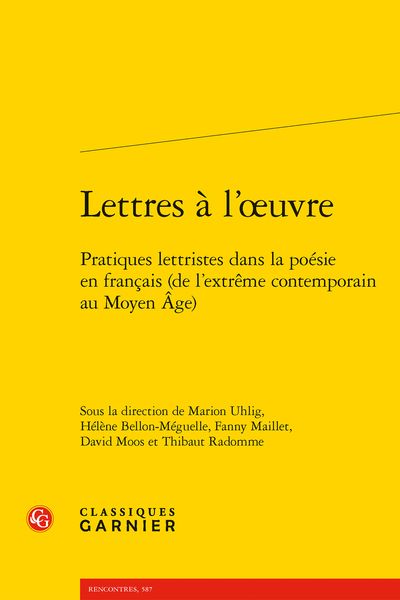
Variations hétérogrammatiques dans les Alphabets de Perec Jeu gratuit ou création poétique ?
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Lettres à l’œuvre. Pratiques lettristes dans la poésie en français (de l’extrême contemporain au Moyen Âge)
- Auteur : Viegnes (Michel)
- Résumé : Dans Alphabets (1976), Georges Perec utilise les dix lettres les plus fréquentes (e, s, a, r, t, u, l, i, n, o) auxquelles il ajoute une lettre parmi les seize restantes, pour composer des poèmes dont chacun est l’anagramme de la série de départ. S’agit-il d’un jeu gratuit, ou trouve-t-on dans cette contrainte une réponse à l’obsession mallarméenne du « coup de dés », en lien avec les traumatismes qui hantent l’auteur de W ou le souvenir d’enfance (1976) ?
- Pages : 231 à 244
- Collection : Rencontres, n° 587
- Série : Confluences littéraires, n° 7
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406149545
- ISBN : 978-2-406-14954-5
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14954-5.p.0231
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 23/08/2023
- Langue : Français
- Mots-clés : Alphabet, anagramme, cratylisme, gratuité, onzain, Oulipo, série
VARIATIONS HÉTÉROGRAMMATIQUES
DANS LES ALPHABETS DE PEREC
Jeu gratuit ou création poétique ?
Après avoir composé en 1969 un palindrome de 1247 mots pour un total de 5566 lettres – le plus long connu en langue française – et construit la même année son roman La Disparition sur un lipogramme, Georges Perec s’est intéressé à la poésie de diverses manières, les plus connues étant sa réécriture, au chapitre dix dudit roman, de classiques tels que « Recueillement » de Baudelaire ou le sonnet des « Voyelles » de Rimbaud, sur lesquels il applique le même procédé en éliminant tous les e. Sept ans plus tard, dans le recueil Alphabets, il prend les dix lettres les plus fréquemment utilisées en français (e, s, a, r, t, i, n, u, l, o) auxquelles il ajoute une lettre choisie parmi les seize restantes, de manière à composer des poèmes de onze vers « hendécagrammatiques » dont chacun est l’anagramme de la série de départ1. Perec permute ainsi les lettres pour former des mots différents et offre au lecteur le résultat de l’opération sous deux formes typographiques, l’une « géométrique », apparaissant comme un quadrangle de onze lettres contiguës sur onze lignes, et l’autre qui est en quelque sorte sa « traduction en prose ».
Comme le précise la quatrième de couverture, le principe est analogue à la musique sérielle : « on ne peut répéter une lettre avant d’avoir épuisé la série. » (Perec, 1976, 4e de couverture). Il y a donc onze poèmes en B, onze en C, et ainsi de suite pour chacune des seize lettres les moins fréquentes, bien connues des joueurs de Scrabble car elles y rapportent plus de points2. On a donc au total seize séries complètes de chacune 11 poèmes, pour un total de 11 x 16, soit 176 poèmes.
232S’agit-il d’un jeu langagier totalement gratuit, comme ceux que Perec composait pour des périodiques afin d’arrondir ses fins de mois3 ? Ou bien trouve-t-on dans cette contrainte une réponse possible à l’obsession mallarméenne du « coup de dés », dont Valéry avait hérité en la transposant en une quête quasi maniaque de l’art comme anti-hasard4 ? Toujours sur la quatrième de couverture du recueil édité en 1976 par Galilée, il est dit que ce protocole pourrait « suggérer un nouvel art poétique susceptible de remplacer les vestiges rhétoriques encore en usage dans la plupart des productions poétiques modernes et contemporaines, dans le ressassement même de leurs lettres, de leurs mots et de leurs thèmes5. » Ce « nouvel art poétique » s’inscrit lui-même dans une longue histoire : ces 176 onzains – la dimension numérique ayant manifestement une grande importance pour Perec – se situent « dans le prolongement des 157 sonnets et des 143 poèmes japonais de Jacques Roubaud, et sous l’ombre tutélaire des 449 dizains de la Délie6 ».
Sans revenir sur les fameux dizains de Maurice Scève, remarquons simplement que Perec se place ici dans une perspective transséculaire. On peut s’attarder en revanche un instant sur la référence à Jacques Roubaud, déjà présente dans La Disparition7 : le mathématicien-poète avait publié en effet un recueil de poèmes assez particulier, ∈ (EPSILON) sur le modèle du Go Ban, le plateau du jeu de go, équivalent de l’échiquier ou du damier. Dans ce recueil, chaque sonnet porte une référence chiffrée (GO n) qui correspond à sa place dans l’ordre des coups joués et renvoie à un diagramme en fin de volume. On sait que Roubaud et Perec, ainsi que d’autres oulipiens, appréciaient particulièrement le jeu de Go, d’origine chinoise (sous le nom de Wei qi) mais que l’on connaît 233en Occident sous la forme qu’il a prise au Japon au xve siècle. Ils avaient d’ailleurs collaboré en 1969 avec Pierre Lusson à un Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du Go8. En 1973, Roubaud prolonge ce tropisme asiatique avec Trente et un au cube, recueil de trente-et-un poèmes de trente-et-un versde trente-et-une syllabes, chacun de ces « vers » étant la somme syllabique du traditionnel tanka japonais (forme fixe de cinq vers, longs respectivement de 5, 7, 5, 7 et 7 syllabes). On a là le rêve à la fois mallarméen et borgésien d’un livre total transgressant la planimétrie de l’écrit dans ces strophes « au carré » pour entrer dans une troisième dimension avec un recueil-cube.
Nous reviendrons sur la relation à Roubaud, mais interrogeons-nous pour le moment sur les intentions de ces poèmes carrés que sont les Alphabets, en partant des trois niveaux distingués par Umberto Eco9. En premier, l’intention de l’auteur (intentio auctoris) : dans le cas de Perec, on connaît assez bien son goût pour les dispositifs ludiques qui peuvent cacher des sens plus sérieux voire plus tragiques, comme l’absence de « e » dans La Disparition ou la centième case laissée vide dans La Vie mode d’emploi. Vient ensuite l’intention du texte (intentio operis), dans la mesure où certains de ces effets peuvent échapper à la mécanique conçue au départ, et pour finir les opérations complexes de la lecture (intentio lectoris), qui se déploient sur une gamme assez large, selon que le lecteur – ou plutôt le lectant, dans la terminologie de Vincent Jouve10 – est animé d’un parti-pris herméneutique, une quête de sens caché, ou bien au contraire aborde ces onzains comme de simples fantaisies lettristes, des loisirs de verbicruciste11.
Admettons-le d’emblée : dans leur majorité, ces variations hétérogrammatiques, une fois « traduites en prose » pour reprendre la formule même de Perec, sont dignes du Jabberwocky de Lewis Carroll. Un chatoiement furtif émane toutefois de cette combinatoire de onze lettres, qu’il tende à une signification vraisemblable ou fasse seulement 234miroiter un dédale de signifiance12. La possibilité d’un sens qui affleure, par opposition à l’inanité sonore du pur « jeu », est la question qui sous-tend toute lecture de ces 176 textes. Mais une autre question, de nature philosophique, serait de savoir s’il existe vraiment un jeu « pur », en tant qu’« activité réglée portant sa fin en elle-même » pour reprendre la définition qu’en donna un éminent linguiste, Émile Benveniste13, ou si cette gratuité parfaite n’est pas aussi illusoire que l’intransitivité absolue du poème, telle que l’avaient théorisée Riffaterre et d’autres structuralistes. Il est vrai qu’un formalisme ludique et apparemment gratuit s’exhibe visuellement dans certains textes où la série de la onzième lettre – provenant des seize lettres moins usitées – est clairement détachée des dix lettres de base. On en trouve un bel exemple avec le F initial du onzain 50 :
|
F |
INALROUTES |
|
F |
LANSOURETI |
|
F |
TISOLERAUN |
|
F |
RETNULASOI |
|
F |
SOULTARENI |
|
F |
LEOUITRANS |
|
F |
USELAIRTON |
|
F |
RILEUSNOTA |
|
F |
INALOUTRES |
|
F |
ATLOURSNIE |
|
F |
RETAOLINSU14 |
Mieux encore, dans le onzain 123, le Q placé en position finale permet « naturellement » l’adjonction d’un U en lettre initiale à partir du deuxième vers, encadrant ainsi le texte :
235|
LANOISETRU |
Q |
|
UANTLESOIR |
Q |
|
UISORTENLA |
Q |
|
UESONTIRLA |
Q |
|
UESTIONLAR |
Q |
|
UANTROILES |
Q |
|
UINTEALORS |
Q |
|
UARTSILONE |
Q |
|
UETANILORS |
Q |
|
UARENILOTS |
Q |
|
UONTLESIRA |
Q |
On trouve également un dispositif avec une lettre traçant une diagonale : E dans le onzain 41, S dans le 42, M dans le 106 et P dans le 108. Le plus intéressant est sans doute le 24, avec la lettre O :
|
O |
RUTILANCES |
|
T |
O |
CSINLARUE |
|
CL |
O |
UASENTIR |
|
LAT |
O |
URNISEC |
|
NICL |
O |
SAURET |
|
CLUSE |
O |
TARIN |
|
LANCRE |
O |
SITU |
|
ESNUITC |
O |
RAL |
|
ETLASCRU |
O |
NI |
|
TRUCSNIEL |
O |
A |
|
CARUTENSIL |
O |
Ce sillon transversal percé de onze « trous », qui attire si fortement l’œil, peut justement évoquer le schéma multiplié d’un œil braquant sur le lecteur – et sur le scripteur ? – son regard vide. Le vers final du sonnet « Vocalisation », imité des « Voyelles » de Rimbaud, associait d’ailleurs, comme son original, le O à l’œil (« Ô l’omicron, rayon violin dans son Voir »)15. Mais dans une autre optique cette lettre en 236forme de margelle de puits peut aussi faire songer au passage de W ou le souvenir d’enfance où le narrateur médite sur la forme polonaise de son patronyme, Peretz, homophone d’un terme hébreu signifiant précisément « trou16 ».
Dans une gradation saisissante de la difficulté et de la complexité, certains onzains combinent le clinamen de la lettre en diagonale et la verticalité de l’acrostiche répétant le premier vers, comme dans les textes 41 (avec E), 45 avec N et surtout 43 avec L :
|
LANGESOURIT |
LANGESOURIT |
|
ALORSGEINTU |
AL |
|
NGLASTIREOU |
N |
L |
|
GRELOTASUNI |
G |
L |
|
ERSALUTONGI |
E |
L |
|
SAITOLURNEG |
S |
L |
|
OURANTLESIG |
O |
L |
|
UIGNARTLESO |
U |
L |
|
RTISANGELUO |
R |
L |
|
INTEUGRASLO |
I |
L |
|
TIONASURGEL |
T |
L |
On peut lire ici, dans ces deux formes typographiées que présente l’édition Galilée, un calembour à la fois visuel et phonétique, ce qui caractérise l’image de l’ange dans l’iconographie traditionnelle étant justement ses ailes.
Le simple acrostiche peut se compliquer d’une symétrie en miroir. C’est le cas, notamment des textes 28 et 3, dont la complémentarité est évidente (c’est nous qui rajoutons le gras) :
237|
L U S I N E A T R O C |
USINEATROC SECRITONAL UCREINALTO SOLANTECRU ULOSACITER CRANOUTILS SOCURNELIT ALONUSECRI OCETLUSINA TUASLECRIN INUARTLOSE |
CANESOURIT ECRITASONL TRINCLOUEA TREAUCLOSN COURTASILE ITRACUNSOL ILCONTEURS CRESAULOIN ITANSLECOU UNACRESTIL LUSINATRO |
L U S I N E A T R O C |
Rapprochés, ces deux onzains sont quasiment « encadrés » par la formule « l’usine à troc », laquelle fait clairement sens dans ce contexte, le « troc » pouvant équivaloir aux permutations anagrammatiques des lettres. Quant à « l’usine », il n’est pas interdit d’y voir un synonyme d’« ouvroir ». Usine de littérature potentielle, où la forme engendre l’art : « O tu as l’écrin : ci, nu, art l’ose », lit-on dans les deux derniers vers du premier onzain. Même si cet « art » est ardu et proche du « travail » au sens étymologique : « Ça ne sourit, l’écrit à son lutrin cloué », avertit l’incipit du second onzain. Le poème serait-il donc cet « astre [au]clos » dont le rayonnement est retenu, prisonnier de sa camisole formelle, qui n’est pas un « asile » protecteur ? Pourtant, tel le poème mallarméen faisant triompher le dire poétique dans l’expression même de sa stérilité et de son échec, le rayonnement perce la carapace et nous atteint.
Comme s’il voulait lui-même légitimer ces deux pôles de l’intention déchiffrante – échec et victoire, jeu gratuit et troc signifiant – Perec ouvre son recueil avec deux onzains bâtis sur la série B, comme la règle choisie par lui l’y contraignait, mais particulièrement « parlants », si l’on ose dire. Le deuxième est très clairement une paraphrase mallarméenne :
|
ABOLIUNTRES |
Aboli, un très art nul ose |
|
ARTNULOSEBI |
|
|
BELOTSURINA |
Bibelot sûr, inanité (l ’ ours-babil : |
| 238
NITELOURSBA |
|
|
BILUNRATESO |
Un raté…) sonore |
|
NORESAUTLIB |
|
|
ERANTSILBOU |
Saut libérant s ’ il boute |
|
TELABUSNOIR |
L ’ abus noir ou le brisant |
|
OULEBRISANT |
|
|
TRUBLIONASE |
Trublion à sens : |
|
NSARTEBLOUI |
Art ébloui ! |
Les italiques, que l’on peut supposer choisies par l’auteur, constituent à elles seules un indice citationnel. En effet presque toutes les autres « traductions en prose » en regard des onzains figurent en caractères romains. Ici, tout lecteur de Mallarmé reconnaît facilement ses vocables préférés, tel « aboli », « bibelot » « inanité », « sonore », dans l’ordre même où ils figurent au cœur du célèbre « Sonnet allégorique de lui-même ». L’exclamation finale « Art ébloui » peut quant à elle renvoyer au « solitaire ébloui de sa foi » du sonnet « Quand l’ombre menaça de la fatale loi ». Dans ce dernier sonnet, pour suivre l’interprétation qu’en donne Bertrand Marchal, le « Je » lyrique rejette le « vieux Rêve » de la transcendance religieuse, qui n’est qu’« un orgueil menti par les ténèbres / Aux yeux du solitaire ébloui de sa foi17 ». En d’autres termes, le sujet poétique proclame le remplacement de la foi traditionnelle par une autre foi, une foi exclusive en son art poétique, ce « dire qui porte en lui sa propre évidence », selon la formule de Hugo Friedrich18. L’art de cette poésie perecquienne, ce « très art nul », n’est un dépassement, ou un « saut libérateur » de l’aliénation métaphysique que s’il « boute » l’illusion du Sens, comme Jeanne d’Arc avait « bouté l’Anglais hors de France ». Cette « métaphysique de la présence » dénoncée par Derrida comme hantant toujours notre inconscient culturel est un « abus noir », qu’il s’agit d’évacuer ou de « briser » en jouant au « trublion à sens ». Tout le paradoxe oulipien est là résumé : ce désordre libérateur est obtenu au moyen d’un ordre artificiel et contraignant à l’extrême, qui 239porte uniquement sur le signifiant, le « gramme », au sens derridien, pour mieux désarticuler le signifié19.
Mais le premier onzain, qui précède juste celui-ci, pourrait nous orienter vers une piste très divergente, celle d’un tâtonnement, à travers ce jeu sur les lettres, en quête d’une réalité supérieure et qui serait hors-texte :
|
SATINORBLEU |
Satin, or bleu, trouble sain. |
|
TROUBLESAIN |
|
|
RITENOUSBAL |
Rite : nous balbutions la réalité |
|
BUTIONSLARE |
|
|
ALITENOUS BR |
Nous brûlons. |
|
ULONSABRITE |
Abrite la brune toison, brutalise |
|
LABRUNETOIS |
Le bâton suri, ablutions errantes : |
|
ONBRUTALISE |
Oubli… |
|
LEBATONSURI |
|
|
ABLUTIONSER |
|
|
RANTESOUBLI |
À noter que dans ce recueil où chaque texte s’accompagne d’une mention du lieu et de la date, ce onzain est daté « Paris, 27 juin 1975 », le deuxième déjà cité étant daté du jour d’après, le 28 juin 75, alors que le troisième onzain est quant à lui daté du 1er janvier de la même année. L’ordre des textes n’est donc pas chronologique. On entend dans ce poème inaugural les échos d’une quête qui, si elle n’est pas religieuse à proprement parler, emprunte tout de même le lexique du sacré, avec « rite » et « ablutions ». On peut imaginer un clerc gyrovague aux « ablutions errantes » qui réprimerait sa chair, la « brune toison » et le « bâton suri » se passant de tout commentaire. Le « trouble sain », même s’il n’y a pas de t final à « sain », annonce que l’on s’approche d’un but recherché et souhaitable, quel qu’il soit : « nous brûlons » peut s’interpréter au sens du joueur qui se rapproche de la bonne réponse. « Balbutier » la réalité n’est certes qu’un début, mais ce B. A-BA est un début prometteur si l’on replace la métaphore dans son contexte culturel. Pour Démocrite et Épicure, on le sait, les elementa étaient aussi bien les « particules élémentaires » à l’origine 240du monde que les lettres de l’alphabet, grec pour eux, latin pour leur porte-parole Lucrèce20.
Voilà pour une perspective atomiste, certes matérialiste, mais qui voit le langage comme un reflet de l’architecture cosmique. Dans une perspective très différente, celle de la Kabbale juive, les lettres sont de véritables talismans. Le Sefer-Yetsirah (Livre de la création) proclame que le monde a été créé grâce à d’innombrables combinaisons des vingt-deux lettres de l’alphabet hébraïque. Les caractères de la langue sacrée, véhicule de la Révélation, détiennent en effet un pouvoir à la fois théurgique et herméneutique pour les Kabbalistes21. Marcel Benabou, qui apparait dans La Disparition sous les traits de l’avocat Hassan Ibn Abbou, mentionne dans un entretien qu’il avait parlé de la Kabbale à Perec, en lui rappelant justement la doctrine mystique des lettres. L’historien de la Rome antique, lui aussi membre de l’Oulipo, précise que leur intérêt commun pour la Kabbale n’avait rien de religieux mais relevait plutôt d’une fascination poétique pour cette idée d’une homologie entre les signes écrits et l’univers22. Il est révélateur que la plus ancienne réminiscence du narrateur de W ou le souvenir d’enfance concerne justement une lettre hébraïque ; encore s’agit-il d’un souvenir incertain, à demi rêvé, comme le connote le mode conditionnel des verbes :
Le premier souvenir aurait pour cadre l’arrière-boutique de ma grand-mère. J’ai trois ans. Je suis assis au milieu de la pièce, au milieu des journaux yiddish éparpillés. Le cercle de la famille m’entoure complètement […] Tout le monde 241s’extasie devant le fait que j’ai désigné une lettre hébraïque en l’identifiant : le signe aurait eu la forme d’un carré ouvert à son angle inférieur gauche […] et son nom aurait été gammeth, ou gammel. La scène tout entière, par son thème, sa douceur, sa lumière, ressemble pour moi à un tableau, peut-être de Rembrandt ou peut-être inventé, qui se nommerait « Jésus en face des Docteurs23 ».
Cette fascination pour les signes pourrait confiner à une nostalgie cratyléenne : ce socle ontologique des lettres, des mots qu’elles composent et des phrases que composent ces mots, s’est perdu, dissous dans un « oubli » général. C’est ainsi du moins que l’on peut lire le mot tissé par les cinq dernières lettres du poème inaugural.
Pourtant l’auteur – si l’on veut croire à une véritable intentio de sa part – s’ingénie à tricher en empêchant le lecteur de se reposer placidement dans cet oubli et dans la jouissance purement formelle de ces textes. Le onzain no 97, dédié à Jacques Roubaud, offre quelques pistes qui vont dans cette direction :
|
EPSILONTARU |
Epsilon : |
|
PTURELIASON |
ta rupture lia sonnets à loi pure à l’opus intraité. |
|
NETSALOIPUR |
|
|
EALOPUSINTR |
Son pluriel n’a tu prose où art l’inspira, |
|
AITESONPLUR |
où lents puisent parole |
|
IELNATUPROS |
pour l’instant usé à polir. |
|
EOUARTLINSP |
|
|
IRAOULENTSP |
|
|
UISENTPAROL |
|
|
EPOURLINSTA |
|
|
NTUSEAPOLIR |
|
|
à Jacques Roubaud |
|
Roubaud, qui avait comme François Le Lionnais une formation de mathématicien, s’en explique lui-même au début de son livre intitulé ∈ : ce signe qui correspond à la graphie cursive ancienne de la lettre grecque epsilon, est dans la théorie des ensembles un signe d’appartenance : appartenance d’un élément à un ensemble, voire appartenance au « monde de l’être-au-monde », pour reprendre ses propres termes24. Un élément qui appartient, c’est par exemple une lettre en tant qu’elementum au sein d’un ensemble non précisé, qui peut aller du mot à l’alphabet entier. Mais epsilon, c’est également la cinquième lettre de l’alphabet grec, tout comme son équivalent, le e latin. La « rupture » du e/epsilon, c’est peut-être aussi son éviction dans le jeu du lipogramme que Perec a pratiqué, y compris à l’intérieur de cette forme de haute contrainte qu’est le sonnet et qu’affectionne par ailleurs Roubaud. Mais comment cette éviction/rupture peut-elle lier ces « sonnets à loi pure » à un « opus intraité » ? On peut d’abord faire observer que l’opus, terme latin pour œuvre, connote une ambition artistique supérieure : si cette œuvre demeure virtuelle, « intraitée », c’est peut-être parce qu’elle parlerait d’autre chose que d’elle-même, et notamment d’une réalité humaine, historique, morale, trop douloureuse pour être explicitement dite, même si elle est « mal tue par l’encre même », comme dirait Mallarmé25. En effet Claude Burgelin et d’autres commentateurs de Perec l’ont relevé, à la suite d’Ali Magoudi et de sa Lettre fantôme26 :ce pluriel de e, c’est « eux », les déportés, les disparus dans la nuit et le brouillard dont parle indirectement un ouvrage en prose, inspiré lui aussi par le même « art », ou artifice. On aura reconnu La Disparition,récit loufoque autour d’un disparu nommé Anton Voyl, dont le nom lui-même voile et dévoile la voyelle absente. Ce e pluriel, ces « eux » multiples et anonymes qui ont disparu pour de vrai, vont peut-être finir, au terme d’un lent processus de création et d’interprétation, par « puiser parole ». La prose va donner en creux une voix à ces fantômes, même si « pour l’instant », la pratique 243ludique use ce signifiant-lettre à force d’utiliser son absence, comme un artisan maniaque finirait par user l’objet qu’il façonne à force de le polir.
D’autres textes témoigneraient en faveur d’une pertinence autobiographique de ces jeux de lettres. L’écriture des Alphabets étant quasiment contemporaine de celle de W ou le souvenir d’enfance, on ne saurait éluder la place que tient la vingt-troisième lettre de l’alphabet dans le recueil. Le onzain 127 livre une clé assez parlante :
|
SIREWOTANLU |
Sire Wotan, luis : un Waterloo nu |
|
ISUNWATERLO |
se rit, wallon. Waste, ruine ! |
|
ONUSERITWAL |
Luis ! Ta Wroslaw ruine totale, ours |
|
LONWASTERUI |
winternal où Wissowa lit runes ! |
|
NELUISTAWRO |
Wilno rue. Tarnow, élu, sait. |
|
SLAWRUINETO |
|
|
TALEOURSWIN |
|
|
TERNALOUWIS |
|
|
SOWALITRUNE |
|
|
SWILNORUETA |
|
|
RNOWELUSAIT |
|
|
Paris, 21 mars 1976 |
|
On sait que dans W ou le souvenir d’enfance la lettre W renvoie à des signifiés multiples : elle désigne d’abord cette île contre-utopique où la société est régie selon une version dévoyée de l’idéal olympique, mais c’est aussi l’initiale du patronyme de Gaspard Winckler. Elle apparaît surtout comme le couplage des deux V initiaux de Villars-de-Lans et d’un autre lieu-clé de l’enfance du narrateur – rue Vilin, où se trouvait le salon de coiffure de sa mère, ou encore Vincennes – ce couplage reflétant celui des deux récits parallèles27. Dans l’imaginaire collectif, la lettre W, la dernière officiellement intégrée à l’alphabet français, évoque un apport étranger, en particulier des langues et cultures du nord de l’Europe, comme le suggéraient déjà L’Encyclopédie et le Dictionnaire de 244Trévoux. Perec joue aussi bien sur cet imaginaire historique que sur le souvenir douloureux de son enfance. La lettre « maudite » renvoie à un Nord polonais et germanique : polonais avec Wroslaw (variante de Wroclaw ?) Wilno (forme polonaise de Vilnius) et Tarnow, trois villes marquées par des chocs violents et des massacres de populations juives durant la Deuxième Guerre mondiale ; germanique avec Wotan, dieu de la guerre, et Georg Wissowa, célèbre philologue allemand qui « lit runes » – on notera d’ailleurs la paronomase runes/ruines. La guerre encore, avec Waterloo et surtout le « Waste » qui évoque aussi bien la « terre gaste » des romans arthuriens que le Wasteland de T.S. Eliot28.
Proposer une véritable conclusion sur un objet aussi complexe et périlleux que ces Alphabets,labyrinthe ou galerie des glaces parsemés de trompe-l’œil et de chausse-trappes, constitue une gageure. Que dire, au final, de ces contraintes lettristes extrêmes et du double défi qu’elles lancent au poète qui les compose et au lecteur qui les décrypte ? Aboutissent-elles à la démultiplication du sens par le dépassement des carcans, visant comme objectif (impossible) la constitution d’un langage à la densité maximale, subsumant la dichotomie hasard/nécessité ? Ou conduisent-elles au contraire à l’anéantissement de toute signification, autre que celle d’un « néant » néo-mallarméen ? Telle était l’interrogation de départ pour cette courte étude, qui ne saurait apporter une réponse définitive ; mais l’on devinera sans doute de quel côté, à notre avis, penche la balance.
Michel Viegnes
Université de Fribourg
1 Perec, Georges, Alphabets : cent soixante-seize onzains hétérogrammatiques, Paris, Éditions Galilée, 1976.
2 Jusqu’à dix pour W, X, Y et Z, alors que les dix lettres les plus fréquentes n’en apportent qu’un seul. Bien entendu, ce système de points varie d’une langue à l’autre : dans la version anglaise du jeu, le W apporte très peu de points étant donné qu’il fait partie des lettres les plus fréquentes dans la langue de Shakespeare.
3 Tels que les grilles de mots croisés qu’il composait pour l’hebdomadaire Le Point ou les « jeux intéressants » qu’il concevait pour le magazine Ça m’intéresse, et que Bernard Magné a rassemblés et réédités chez Zulma en 2008 : près d’un tiers d’entre eux sont d’ailleurs des jeux de lettres.
4 Dans « L’Amateur de poèmes » composé en 1905, il définit le poème comme « une durée pendant laquelle [il] respire une loi qui fut préparée », et où « nul hasard » ne peut s’immiscer(Album de vers anciens, Gallimard « Poésie », 1974, p. 38-39).
5 Perec, Alphabets, op. cit.,4e de couverture.
6 Ibid.
7 Cf. Parayre, Jacques, « Traces directes ou indirectes de Jacques Roubaud dans La Disparition », Cahiers Roubaud, Les Cahiers de la Licorne,mis en ligne le 28 août 2018.
8 Paris, Christian Bourgois, 1969. Le Go a aussi probablement servi de modèle au Glasperlenspiel, le « jeu des perles de verre », dans le roman éponyme d’Hermann Hesse (1943).
9 Lector in Fabula. Le Rôle du lecteur, ou La Coopération interprétative dans les textes narratifs,trad. Myriam Bouzaher, Paris, Le Livre de Poche ; Biblio / Essais édition (18 janvier 1989).
10 La Lecture,Paris, Hachette, « Contours littéraires », 1993.
11 Rappelons que les verbicrucistes créent les grilles de mots croisés, à ne pas confondre avec les cruciverbistes qui jouent à remplir ces mêmes grilles.
12 Pour reprendre la distinction de Michael Riffaterre dans « L’Illusion référentielle » (Littérature et réalité,éd. G. Genette et T. Todorov, Paris, Seuil, « Poétique », 1982).
13 « [Le jeu est une] activité réglée qui porte sa fin en elle-même et ne vise pas une modification utile du réel. » (« Le Jeu comme structure », Deucalion, 1947).
14 Alphabets, op. cit. Dans cette édition de 1976 chez Galilée, le numéro de page est identique au numéro du onzain lui-même. Les autres onzains suivant le même schéma, outre le 123 cité à suite (avec Q en position finale) sont 78 (avec R en position finale), 125 (avec V en position initiale) et 162 (avec R en position initiale).
15 L’original se lisant : O l’Omega, rayon violet de Ses yeux. On peut également rappeler que dans l’alphabet proto-sinaïtique, le signe ancêtre du O est tiré du hiéroglyphe égyptien de l’œil, dont il ne conserve que le rond de l’iris.
16 « Le nom de ma famille est Peretz. Il se trouve dans la Bible. En hébreu, cela veut dire “trou” » (W ou le souvenir d’enfance [Denoël, 1975], Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 2020, p. 56.
17 « La crise des années soixante […] confirme le passage d’un idéalisme métaphysique à un idéalisme purement poétique. » (Mallarmé, Poésies,éd. B. Marchal, Paris, Gallimard « Poésie », 1992, p. 243).
18 Structures de la poésie moderne, trad. F. Demet, Paris, Denoël/Gonthier, 1976, p. 187.
19 « Je me donne des règles pour être totalement libre » (« Georges Perec : des règles pour être libre », dans Entretiens et conférences, vol. I, Nantes, Joseph K., 2003, p. 208).
20 Homologie dont s’est réclamé Francis Ponge, pour qui le parti pris des choses implique le compte tenu des mots : « The basic Lucretian analogy between the permutation of atoms in the things of the external world and that of letters in the words of the textual world is appropriated by Ponge in the development of his new rhetoric »(Meadows, Patrick, Francis Ponge and the Nature of Things. From Ancient Atomism to a Modern Poetics, Lewisburg, Bucknell University Press, 1997, p. 87).
21 Voir Lalou, Frank, Les Lettres sacrées de l’alphabet hébreu. De l’archéologie à la Kabbale, Paris, Véga, 2015.
22 « [Perec et moi] nous voulions libérer la littérature de ce carcan de “Grande littérature” et de grandiloquence ; montrer qu’aussi bien la littérature que le langage sont partout. C’est une idée oulipienne, mallarméenne, mais aussi cabalistique, puisque dans le Zohar, comme dans la Kabbale, l’alphabet est la matière du monde. Voilà deux textes qui m’ont beaucoup marqué, non de manière religieuse mais du fait de la manipulation des lettres et des mots. » (Nettei, Guadalupe, « Benabou et Perec. Histoire d’une amitié », mexiqueculture.pagesperso-orange.fr, consulté le 02.01.2022).
23 W ou le souvenir d ’ enfance, op. cit.,p. 26-27. Mais le narrateur déconstruit lui-même ce souvenir, précisant que le caractère hébreu reproduit dans le texte n’existe pas ; tout au plus pourrait-il ressembler à un Mem, certainement pas au Gimmel (plutôt que « Gammeth, ou gammel ») « dont [il] se plait à croire qu’il pourrait être l’initiale de [s]on prénom » (ibid.). Néanmoins, pour Claude Burgelin, « tout est en place dans cet acte I de la mémoire : mise en scène, dans une sorte d’Épiphanie, d’un enfant merveilleux que les siens reconnaissent comme élu en raison de cette maîtrise sur les signes… » (Georges Perec,Paris, Seuil, « Les Contemporains », 1988, p. 165).
24 En théorie des ensembles, signe figurant la relation d’appartenance. On écrit a ϵ A et on lit : « a élément de A » ou « a appartient à A » (Bourbaki, première partie, livre I, chap. 2, § 1). Par extension, symbole de l’appartenance au monde de « l’être au monde » (Roubaud, Jacques, ϵ, Gallimard, 1967, p. 11).
25 Cette formule se trouve dans son « Hommage » quelque peu contraint au « dieu Richard Wagner irradiant un sacre / Mal tu par l’encre même en sanglots sibyllins. » (op. cit., p. 63).
26 Paris, Éditions de Minuit, « Paradoxe », 1996.
27 On trouve d’autres toponymes en V dans le récit parallèle, comme Venise, où « j’ai vu entrer dans une gargote de la Giudecca un homme que j’ai cru reconnaître » (op. cit.,p. 14). On peut également penser au « bureau Veritas », dont lui parle Otto Apfelstahl (ibid., p. 66).
28 Ce monument du modernisme poétique écrit aux lendemains de la Première Guerre mondiale et publié en 1922 évoque les ruines culturelles d’une civilisation européenne qui sait désormais qu’elle est mortelle, pour faire écho à la formule bien connue de Valéry.