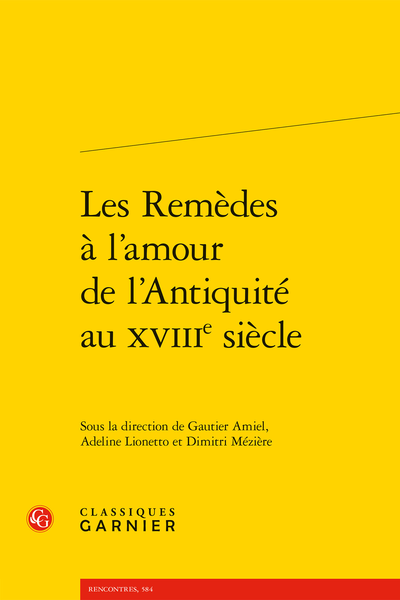
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Les Remèdes à l'amour de l’Antiquité au xviiie siècle
- Pages : 345 à 349
- Collection : Rencontres, n° 584
- Série : Lectures de la Renaissance latine, n° 19
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406147435
- ISBN : 978-2-406-14743-5
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14743-5.p.0345
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 12/07/2023
- Langue : Français
Résumés
Gautier Amiel, Adeline Lionetto et Dimitri Mézière, « Introduction. Guérir de la passion : éradiquer ou contrôler l’amour ? »
L’amour comme mal à traiter, endiguer ou éradiquer est un motif qui parcourt la production littéraire depuis l’Antiquité. En proposant un panorama des grands courants érotico-littéraires qui se succèdent en Europe, et en revenant sur les conceptions des maux amoureux qui s’y déploient, il s’agit ici de présenter les différentes visions (médicales, littéraires et philosophiques) du remède amoureux qui structurent une véritable tradition littéraire depuis l’Antiquité jusqu’au xviiie siècle.
Dimitri Mézière, « Le discidium, un remède à l’amour des bêtes et des hommes chez Virgile (Géorg. III. 209-283) et Ovide (Ars et Remedia) ? »
Partant du constat que la séparation amoureuse est régulièrement associée à des images équestres ou bovines dans l’Ars et les Remedia d’Ovide, cette étude entend éclairer la façon dont ces poèmes dialoguent avec l’excursus central du chant III des Géorgiques au sein duquel Virgile présente la séparation comme un remède ambivalent à la fureur des bêtes. Il s’agit de montrer comment Ovide inverse le sens du passage virgilien en faisant de la séparation (discidium) un remède efficace à la passion.
Amandine Mussou, « Le meillour art : les traductions des Remedia amoris en français à la fin du Moyen Âge. Les Eschés amoureux, Ovide du remede d’amours »
Cet article étudie conjointement deux traductions médiévales françaises des Remedia amoris, celle insérée dans Les Eschés amoureux d’Évrart de Conty (composés dans les années 1370-1380) et une traduction anonyme inachevée datant du début du xve siècle. L’article analyse la façon dont est assumée l’instabilité du texte ovidien : la mise en scène de l’autorité du doctor amoris346s’assortit dans ces textes d’une réflexion sur les pouvoirs du livre et d’effets de polyphonie savamment entretenus.
Charles Senard, « Les remèdes à Laure. Pétrarque dans la tradition des Remedia amoris »
La quête par Pétrarque d’une harmonie entre philosophie païenne et révélation chrétienne trouve une illustration dans son traitement du motif des remèdes à l’amour. Dans le traité du Secretum, Augustinus, après avoir convaincu Franciscus de la nécessité de mettre un terme à son amour pour Laure, parce qu’il porte à l’oubli de Dieu, ajoute aux remèdes traditionnels provenant principalement des Tusculanes de Cicéron (préférées aux Remedia d’Ovide) le remède suprême, chrétien, de la prière.
Hélène Casanova-Robin, « Les remèdes à l’amour dans les dialogues contra amores au xve siècle »
L’étude porte sur quelques exemples significatifs du paradigme médical dans les discours antérotiques latins du xve siècle italien : exprimant la nécessité de remédier à la passion d’amour, Piccolomini, Ficin, Platina, y recourent pour étayer leurs argumentations diverses, témoignant d’une actualisation de l’héritage antique – et médiéval – et de la richesse du débat contemporain. La poésie, quant à elle, ouvre parfois des voies inattendues, où le remède procède d’une sublimation par l’écriture.
Constance Griffejoen, « Dire l’amour pour en guérir ? Bussy-Rabutin et la tradition antique des remèdes à la passion »
Exilé sur ses terres de Bourgogne et délaissé par sa maîtresse la marquise de Montglas, Bussy-Rabutin (1618-1693) trouva dans la lecture et la traduction des auteurs latins de fréquentes occasions de divertissement. Il imita notamment les Remèdes à l’amour d’Ovide et cet article vise à cerner les enjeux d’une telle réappropriation. Il s’agit d’examiner comment Bussy remodèle la topique des remèdes au mal d’amour selon les contours de son expérience et de sa culture.
347Jean-Christophe Courtil, « Venerem inhibere. Les substances anaphrodisiaques dans les traités médicaux latins »
Il semble tout à fait étonnant que les traités médicaux latins proposent autant de substances visant à éteindre une fonction physiologique, celle du désir sexuel. Nous tâcherons d’analyser les principes d’action (physiques, symboliques et analogiques) de ces procédés, afin d’en déterminer les fonctions et les destinataires. Nous verrons que les anaphrodisiaques possèdent non seulement une fonction thérapeutique, mais aussi sociale, celle de limiter l’adultère et le recours à l’avortement.
Estela Bonnaffoux, « L’excès amoureux et sa cure dans quelques practicae médiévales »
Les pathologies provoquées par l’excès amoureux ont fait l’objet de nombreux développements dans les practicae des xive et xve siècles. Cet article étudie les différentes thérapies proposées pour les guérir. Il s’appuie sur le Lilium medicinae de Bernard de Gordon (mort en 1330), la Practica sive Philonium deValesco de Tarenta (actif en 1382-1417), l’Opus preclarum d’Antonio Guaineri (mort en 1458) et la Practica Maior de Michel Savonarole.
Justine Le Floc’h, « La diététique de l’amour au xviie siècle. Médecine et rhétorique dans les régimes de santé de Joseph Du Chesne (1606) et de Pierre Jaquelot (1630) »
Le Portrait de santé de Joseph Du Chesne (1606) et L’Art de vivre longuement selon Médée de Pierre Jaquelot (1630) ont en commun d’inclure l’amour au rang des perturbations de l’âme qui relèvent du champ d’expertise de la diététique. Tous deux proposent un discours psychophysiologique qui dégage les effets somatiques et comportementaux produits par la passion. Ils puisent dans l’histoire antique les préceptes et exemples tirés des mythes pour guérir leurs patients, malades de trop aimer.
Charline Granger, « L’imagination thérapeutique dans De la passion de l’amour (1782). Soigner le mal par le mal »
L’imagination comme remède à la passion amoureuse est réinterprétée au xviiie siècle à l’aune des théories physiologiques d’inspiration sensualiste. 348L’auteur de De la passion de l’amour (1782), soi-disant médecin anglais, s’appuie sur cette relecture pour penser à nouveaux frais, sur un mode mi-parodique, mi-sérieux, la séparation de deux types de discours concurrents en matière de traitement de la passion amoureuse : celui relevant de la médecine, et celui relevant de la littérature.
Naïs Virenque, « L’arbre d’amour du Breviari d’amor. Un outil visuel pour réguler la passion et préserver l’amour charnel »
Entre 1288 et 1291, Matfre Ermengau rédige le Breviari d’amor, une encyclopédie qui définit ce qu’est l’amour en s’appuyant sur un diagramme, l’arbre d’amour. Le présent article détermine les raisons qui conduisent Matfre à élaborer cet arbre, examine en quoi celui-ci constitue un outil pour réguler l’amour, et s’intéresse aux liens avec des propos prophylactiques ou thérapeutiques favorisant la complicité des amants tout en leur assurant de répondre aux exigences d’une vie vertueuse.
Nathalie Godnair, « La musique, remède à la passion amoureuse ? Ambiguïté d’une émotion esthétique à la Renaissance »
Les effets de la musique sur la passion amoureuse sont présentés de manière paradoxale dans les textes de la Renaissance. Si certains auteurs évoquent la manière dont elle fait naître le désir de l’« escoutant », d’autres attestent à l’inverse la manière dont elle vient guérir « les sens empoisonnés du venin amoureux », ou consoler le cœur amoureux. Il s’agit d’observer comment s’articulent ces différents effets, mais aussi comment s’infléchit au xvie siècle la nature de l’expérience esthétique.
Louise Dehondt, « Rire de la vieille femme pour guérir les maux d’amour dans la poésie française de la Renaissance »
Cet article examine la dimension thérapeutique que revêt le blâme de la vieille femme dans la production poétique satirique et amoureuse du xvie siècle où le portrait détaillé du corps féminin âgé est présenté régulièrement comme un remède au désir sexuel et à la passion amoureuse, susceptible de déclencher un rire salutaire, chez le poète comme chez le lecteur.
349Alexandra Gorichon-Herren, « Les amours d’Antiochus et Stratonice. Une thérapeutique hétérodoxe »
Au départ prosélyte, le récit des amours séleucides est devenu une anecdote historique, à visée exemplaire. Sa structure diégétique et son imaginaire nosologique ont permis un incessant dialogue avec les savoirs médico-moraux sur la maladie d’amour. À l’aune de sa conceptualisation pathogène du désir, l’analyse propose d’étudier les trois thérapeutiques qu’elle recèle en son sein pour s’en prémunir ou en guérir : la cure par le coït, la cure par l’image, la cure par la parole.
Juliette Goutierre, « La lettre, ersatz de l’amant et remède à l’amour. Des Héroïdes d’Ovide aux Lettres portugaises »
Dans les Héroïdes d’Ovide, comme dans les Lettres portugaises, l’épistolaire amoureux revêt un usage thérapeutique inattendu. Alors qu’elle vise à convaincre l’amant et à alimenter l’amour, la lettre est finalement réduite à n’être qu’un monologue dont naît le remède à l’amour. Si d’une part, elle a une fonction analgésique, apaisant le symptôme du mal d’amour qu’est la souffrance de la solitude, elle a, d’autre part, la paradoxale vertu curative de mettre fin au mal d’amour lui-même.
Nicolas Fréry, « L’asile profané. Désenchantement du lieu et guérison des amants dans La Nouvelle Héloïse »
Pour guérir Julie et Saint-Preux de leur amour, Wolmar exige qu’ils s’embrassent sous ses yeux dans le bosquet où ils avaient échangé dix ans plus tôt leur premier baiser. En itérant une scène qui a le prestige de l’hapax, l’expérimentateur entend dépouiller le passé de son aura. Cet article a pour propos d’étudier cette thérapie paradoxale, en montrant que si elle vise à profaner un lieu chargé de souvenirs pour en ôter la nocivité, elle se révèle impuissante à remédier à une passion incurable.