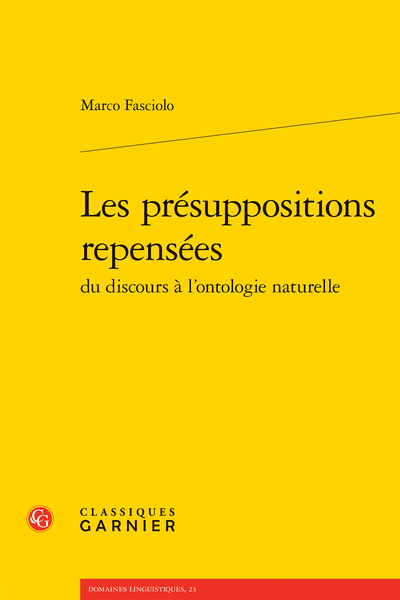
Préface
- Publication type: Book chapter
- Book: Les présuppositions repensées du discours à l’ontologie naturelle
- Pages: 7 to 9
- Collection: Linguistic Domains, n° 23
- CLIL theme: 3147 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage
- EAN: 9782406146407
- ISBN: 978-2-406-14640-7
- ISSN: 2275-2803
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-14640-7.p.0007
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 05-10-2023
- Language: French
Préface
Sans présuppositions, pas de discours, pas de parole cohérente possible. Les présuppositions ne sont pas seulement des conditions nécessaires au sens, ce sont des conditions nécessaires à la cohérence d’un discours, et, pourrait-on ajouter, virtuellement, à toute énonciation. Les présuppositions manifestent en effet le fonds commun, l’espace partagé des interlocuteurs qui entrent en interaction. Parlons-nous d’un individu, d’un objet, c’est qu’il existe. Affirmons-nous un changement, comme arrêter de fumer, cela suppose initialement l’existence d’un autre état (fumer). Parlons-nous du monde, nous partons de son état connu, que nous n’avons pas besoin de répéter – sans quoi la parole confinerait à l’impossible, car nous devrions refaire l’histoire à chaque énonciation – : nous le supposons admis préalablement au discours, ou admissible comme trivial, bref, nous le présupposons. Et même, lorsque l’interlocuteur ne sait pas tout ce que nous savons, nous pouvons prétendre, souvent sans dommage particulier, que ce partage existe car il n’est pas pertinent de s’y attarder, c’est le phénomène de l’accommodation : si j’arrive en retard au bureau et que j’explique à mon patron que j’ai dû emmener mon chat chez le vétérinaire, l’information selon laquelle je possède un chat peut être inconnue de mon patron mais est de si peu d’intérêt que je peux en quelque sorte la prendre pour acquise et cela ne suscitera pas de questions. Mais au fond, que présupposons-nous en réalité ? Je parle d’un individu, il existe, mais des éléments de sa définition, si l’on peut dire, sont-ils également présupposés ? Je parle d’un changement, mais à quel degré cela implique-t-il les éléments constitutifs de l’état ainsi modifié ? Et que fait-on exactement lorsque l’on « présuppose » ? La question ontologique s’invite dans la discussion et promet d’être riche.
Il y a une multitude de cas de figure qui tombent sous la notion de « présupposition » et qui conduit le chercheur à dresser des typologies avant de se préoccuper de leur parenté fondamentale ; or l’on s’arrête souvent trop vite au niveau de ces typologies. Effectivement, 8si les linguistes – sémanticiens et pragmaticiens en particulier – et philosophes du langage se sont intéressés aux présuppositions, un sujet qui semble pratiquement sans fin, ce n’est généralement pas pour se poser de questions ontologiques à leur sujet. Nous les prenons comme des évidences, comme si nous n’avions pas à saisir leur nature – elles semblent s’imposer au regard immédiat du linguiste. Et pourtant, il s’arrêtera bientôt sur des cas limite, des situations où les critères intuitifs qui lui viennent à l’esprit ne s’appliquent qu’au prix de quelques aménagements.
Les travaux sur les présuppositions partent presque toujours de la question des conditions nécessaires à la vérité des propositions (pour ce qui concerne les présuppositions au sens le plus strict) ou considèrent éventuellement les conditions de la pertinence des actes de langage (pour ce qui concerne les présuppositions dans un sens élargi, discursif, qui concerne l’arrière-plan conversationnel), mais aujourd’hui, dans le panorama actuel de la recherche sur le sens, il est difficile de se contenter des catégorisations classiques sans se poser d’autres questions, plus profondes. Parmi celles-ci, certaines ont à voir avec l’ontologie de ces propositions qui émergent d’une manière particulière dans le discours. Faut-il vraiment conserver la notion de présupposition, ne s’agit-il pas simplement d’inférences conditionnées par des éléments contextuels, comme le propose l’approche la plus radicalement pragmatique ? Y a-t-il des différences profondes entre types de présuppositions, selon qu’elles sont déclenchées syntaxiquement, sémantiquement ou pragmatiquement ? Est-ce que la clé de leur nature est à chercher dans l’organisation du code linguistique, dans celle de l’esprit, ou dans les modes de l’agir humain, et ces options sont-elles mutuellement exclusives ?
Il fallait un philosophe autant que sémanticien pour proposer d’entrer sérieusement et en profondeur sur ce terrain, qui peut paraître accessoire aux linguistes mais qui est en réalité fondamental : comment prétendre décrire, en effet, ce pour quoi la définition manque ? Comment parler de « déclencheurs de présuppositions » quand les présuppositions sont réputées connues a priori ? Comment jongler avec la multitude des cas de figure habituellement rangés sous cette étiquette, qui pourrait paraître trop commode pour être adéquate ? Jusqu’où est-il possible, et légitime sur le plan épistémologique, de dérouler l’ontologie conceptuelle présupposée à partir des éléments lexicaux ? Et puis, que pouvons-nous 9savoir d’un phénomène si nous nous bornons à le regarder depuis le rivage sans vouloir en saisir la théorie qui en détermine la surface ?
On peut bien sûr continuer à marcher à l’aveuglette en espérant ne pas rencontrer de mauvaise pierre sur le chemin, ou renoncer – c’est ce qu’on fait un certain nombre d’auteurs, au prétexte de l’hétérogénéité, cet éternel revenant, et risquer de mettre pêle-mêle les présuppositions et toutes sortes d’autres contenus logiquement ou pragmatiquement produits par un énoncé dans un même paquet général. On peut aussi s’atteler à une tâche beaucoup plus importante, fondamentale en ce sens que les éclaircissements qu’elle produira seront d’un impact réel pour la compréhension d’un phénomène plus profond, plus fondamental, que superficiellement technique. C’est ce que fait Marco Fasciolo dans cet ouvrage qui emmène son lecteur aux sources de la notion, qui rejoignent d’ailleurs les sources de la séparation entre la sémantique, territoire où habite la stabilité du sens à travers les emplois d’un terme, et la pragmatique, où vit l’inférence et une forme de variabilité aux contours indéfinis.
Si le chercheur souhaite passer du niveau descriptif au niveau théorique, explicatif, il lui faudra en effet s’armer convenablement pour assurer la qualité de ses analyses et de ses prédictions. C’est là que l’ouvrage de Marco Fasciolo intervient, en permettant d’entrer le plus finement possible dans la notion pour saisir la dimension « fonctionnelle » des présuppositions, qu’il observe en regard des aspects de contenus, pour aboutir à des distinctions originales et nouvelles. Pour Fasciolo, les présuppositions ne sont telles qu’en vertu d’une certaine « pratique », vis-à-vis de laquelle la proposition remplit une fonction de cohérence. On trouve ici une inspiration multiple, venue des travaux de Prandi, de Gross et de Kleiber en particulier, que Marco Fasciolo étend vers de nouveaux espaces de la sémantique, de la pragmatique et de la philosophie du langage.
Louis de Saussure
Professeur à l’Université
de Neuchâtel