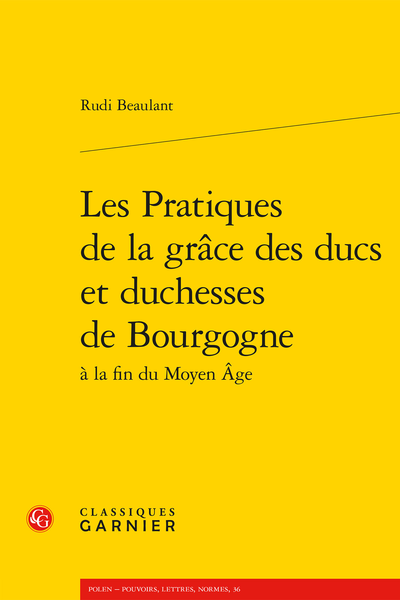
Préface
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Les Pratiques de la grâce des ducs et duchesses de Bourgogne à la fin du Moyen Âge
- Pages : 13 à 19
- Collection : POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n° 36
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406159483
- ISBN : 978-2-406-15948-3
- ISSN : 2492-0150
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15948-3.p.0013
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 07/02/2024
- Langue : Français