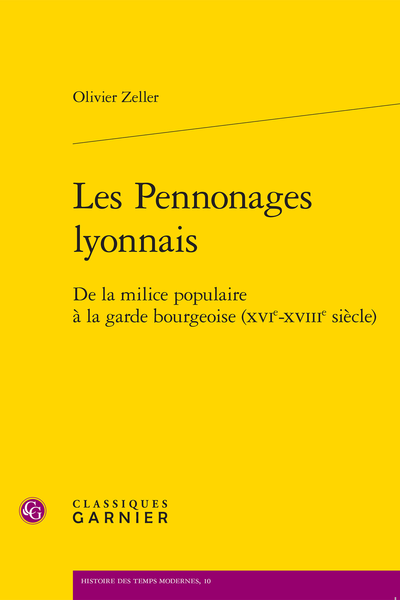
Table des matières
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Les Pennonages lyonnais. De la milice populaire à la garde bourgeoise (xvie-xviiie siècle)
- Pages : 1063 à 1073
- Collection : Histoire des Temps modernes, n° 10
- Thème CLIL : 3388 -- HISTOIRE -- Les Temps Modernes (avant 1799)
- EAN : 9782406119913
- ISBN : 978-2-406-11991-3
- ISSN : 2425-9748
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11991-3.p.1063
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 12/01/2022
- Langue : Français
Table des matières
Abréviations 9
Avant-propos 11
Introduction
Les ongles du lion 17
PREMIÈRE PARTIE
TERRITOIRES ET HIÉRARCHIES
Une géographie mouvante 47
Définir des limites, organiser l’espace 49
Des descriptions purement textuelles 49
Jalons urbains : les repères de frontière 50
Une logique d’itinéraire 55
L’affectation des maisons : règles tacites
et dispositions pragmatiques 58
Pénurie spatiale : la conflictualité des places d’armes 62
L’escouade : du groupe humain au territoire 65
Les dénominations mouvantes d’un espace flou :
du chef éponyme au symbolisme local 73
La fin d’une appropriation symbolique 76
Nommer les territoires, une préoccupation tardive 77
De réajustement en réforme 83
Fluctuations démographiques et géographie
administrative au xvie siècle 83
Rééquilibrages locaux 88
Divide et impera : le projet du major Séverat (1641-1649) 90
Le temps des suppressions 94
Soixante-cinq ans de stabilité géographique (1681-1746) 97
La sanction des émeutes : la refonte de 1746 101
La hiérarchie générale des quartiers : de l’ancienneté
du chef au classement fonctionnel 113
Une hiérarchie spécifique 113
L’ordre social préservé 117
Rivalités populaires 118
Vers une hiérarchie immuable 121
Conclusion. Une géopolitique urbaine 124
Conflits d’autorité et distanciation hiérarchique 127
Une gouvernance conflictuelle 128
Les arquebusiers de la ville 129
Le guet et son chevalier-capitaine 136
La garde des portes : des trois cents Suisses
à la compagnie franche du régiment de Lyonnais 146
Capitaine des arquebusiers ou capitaine de la ville ?
Une interminable controverse 155
Des conflits récurrents de juridiction (1627-1780) 167
Concurrence des troupes et antagonisme des autorités 170
Un état-major pour Lyon 177
Le conseil de guerre, instance d’exception 179
Grades et territoires : une organisation évolutive 187
L’éphémère système des surintendances 187
Des dizeniers aux caporaux, des quarteniers
aux capitaines 191
La densification de l’encadrement populaire 199
La diversification administrative
des tâches subalternes (1760-1789) 211
Le grade et le symbole : l’enseigne et son drapeau 216
Des drapeaux de ville aux drapeaux de quartier 216
Les fonctions de l’emblème 218
Un symbolisme ambigu 224
1065Au xviiie siècle : vers une hiérarchisation interne 238
La promotion symbolique de Confort 238
La bureaucratisation de la hiérarchie 244
De la milice des pennonages à la garde bourgeoise 256
À la recherche d’une renaissance :
une émulation « patriote » 257
Symbolisme martial : de la distinction locale
au mimétisme militaire 272
Sélection sociale et jeu des apparences 273
Un étroit contrôle territorial : le projet
de François-Pierre-Suzanne Brac 284
Conclusion. Du service du roi à la défense des privilèges 287
DEUXIÈME PARTIE
OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS
SOCIOLOGIE, CARRIÈRES, FONCTIONS
Les officiers pennons
Aspects institutionnels 291
Les structures d’encadrement : de l’adaptation locale
au modèle rigide 291
Consensus de quartier, pouvoir politique et style
administratif. Les métamorphoses du mode de désignation 294
Quand les habitants se donnaient un chef 294
Les années de troubles : l’éphémère puissance
des officiers pennons (1563-1594) 298
Mise à distance du peuple et interventions du pouvoir 320
Résider sur place (1614) 329
Choisir, retenir, révoquer (1637) 333
La condition de bourgeoisie (1679) 337
L’impossible résidence (1679-1694) 339
Dix années de vénalité (1694-1705) 341
Le pouvoir consulaire restauré (1705-1744) 353
1066La grande épuration de 1746 361
La renaissance des revendications de corps (1765-1788) 366
Une cooptation sous contrôle. Les réformes de 1764
et de 1781 374
Des commandements en déshérence chronique 380
L’organisation des Entrées : des nominations
de circonstance 381
D’inutiles velléités de remise en ordre 384
Le rythme heurté du remplacement des officiers
(1600-1789) 385
L’abandon de l’obligation de résidence (1746-1789) 391
La décadence d’un système : le carrousel des enseignes 396
Lieutenants et capitaines : un avancement interne
(1650-1789) 397
Attitudes particulières : la valorisation du grade 399
Conclusion. Le long dessaisissement du consulat 405
2 500 officiers pennons
Sociologie et culture 409
Le miroir d’une société 409
Mutations sociologiques 409
La longue déqualification politique et administrative
des officiers de quartier 416
Notabilité de quartier et propriété immobilière 421
Trajectoires officières 424
De « l’ordre des armes » au choix souverain 424
De la variabilité des temps de service 426
Temps de service et hiérarchie 429
Les déroulements de carrière : une profonde évolution 433
De l’hérédité de fait des capitaines à l’accaparement
lignager des grades : des particularités locales 434
Intersociabilités 445
L’ombre de la compagnie du Saint-Sacrement 445
Notre-Dame du Confalon 447
La loge Saint-Jean d’Écosse du Patriotisme 450
Le bureau des mères nourrices 460
1067La Société Philanthropique 462
Honneurs, contingences et rivalités 470
Apologie de l’autorité locale 470
L’évergétisme d’Horace Cardon 474
Les sacrifices de Guichard Julliéron 475
René Gros de Saint-Joyre, parangon
des vertus miliciennes 476
Jean-Jacques Pincetty, un évergète en quête d’honneurs 485
Le revers de la médaille : les contraintes de la fonction 496
Querelles intestines 507
Conclusion. Changements sociaux et mutations mentales 512
Les yeux et les bras du consulat 517
Vox populi 518
Porte-paroles des habitants 519
La colère du peuple 523
Compter, dénombrer, taxer. Des administrateurs de terrain 525
Débusquer les réfractaires 526
Évaluer les effectifs mobilisables 527
En quête des blés 531
À la recherche d’armes et de poudre 532
Le pouvoir certificateur de l’officier pennon 534
Répartitions forcées 537
La difficile assiette des impositions 539
De nouvelles procédures administratives 548
Contrôler la population la police de la ville 549
Traquer le Huguenot 549
Démasquer les politiques 551
Prendre l’étranger au gîte 552
La paix du quartier : chasser les indésirables 564
Face à la contagion 568
Repérer les malades 568
Lever les taxes d’épidémie 572
Gérer la misère urbaine 575
Deux capitaines fondateurs : Giron et Mazard 578
Les distributions de charbon : une bienfaisance contestée 579
1068Une charité bien ordonnée : les aumônes de réjouissance 580
Le recueil des enfants trouvés 581
Lutter contre l’incendie 590
Les insuffisances du matériel 590
Le temps des charpentiers 592
Le temps des pennonages 596
Conclusion. Distanciation résidentielle
et déqualification administrative 603
Sous un plafond de verre
Les bas-officiers 607
Apprendre à commander. Les « maîtres en fait
de hautes armes » 608
Dérobade des élites et ségrégation sociale 612
Les rythmes de carrière, l’espace et la conjoncture 616
La déconsidération sociale des petits grades 617
Un avancement assuré, mais limité 620
Pénurie d’hommes : la distension du lien résidentiel 622
Été 1789 : la tardive émergence politique des sous-officiers 624
Conclusion. La mutation polymorphe
du petit encadrement 626
TROISIÈME PARTIE
LE SERVICE MILICIEN
GUET, GARDE ET PARADE
Sociabilités, devoirs civiques et résistances 633
Le service de guet et garde au quotidien 633
Une scansion du temps urbain 635
L’œil du capitaine 644
Les postes de garde, points névralgiques 645
Le péril des armes 660
1069De l’armement personnel à l’arsenal de prêt 665
Au xvie siècle : primauté de l’armement domestique 665
Les armes de prêt des capitaines 671
Une police de l’armement intermittente 674
Désarmer le peuple 676
Menaces obsidionales 683
Une protection illusoire 684
1553 : la crainte d’une cinquième colonne 685
1557 : après Saint-Quentin 687
1560 : la menace huguenote 688
Un permanent qui-vive : 1567-1588 691
1597 : le péril savoyard 693
1636 : l’année de Corbie et la menace comtoise 696
1703-1711 : l’ultime alerte de la guerre
de Succession d’Espagne 701
L’ordre intérieur 703
Le passage des gens de guerre 705
De la chasse aux sorciers au contrôle des noctambules 710
Jours de supplice 712
L’impossible répression des émeutes 719
Fraudes et résistances 736
Quand les hommes manquent à l’appel 737
Comment se faire exempter 748
Confins indécis, immeubles-Janus,
ou la fraude à la résidence 764
« Envoyer à la garde » : du serviteur en armes
au soldat à gages 765
Un palliatif : le « soldat de peine » 768
Les crises récurrentes de l’autorité officière 775
Comportements mutins : les sergents bafoués 780
Résistances populaires 783
Insulter la garde 786
Des traits d’appartenance collective ? 788
Au cœur du quartier, la compagnie joyeuse 788
Nations, métiers, quartiers 790
Des marqueurs d’identité ? 793
1070Un échec significatif : la réforme banalisante
de Rochebaron (1746-1766) 797
Fêtes et représentations officielles 800
Lyon se donne à voir : des métiers aux pennonages 800
Entre honneur et spectacle : les pennonages à la parade 820
Le quartier, cadre des fêtes de commande 824
La garde des princes : de l’honneur à la défiance 837
Conclusion. Trois siècles d’avatars 839
L’image des pennonages dans la littérature locale 843
Badinage élitaire. Les vers au lieutenant Colhabaud 844
Un regard socialement sélectif. La relation burlesque
de l’entrée du légat Chigi (1664) 845
La réforme brocardée. « Les Bourgeois Militaires
ou les Gardes de Lyon (1746) » 849
Trois acteurs pour un pamphlet 849
Émulations bourgeoises 852
Des apparences picaresques 854
Une satire sociale des pennonages (vers 1761) 857
La mode de l’uniforme 858
Une évocation du quotidien 859
Une satire méprisante 860
La chanson pour le passage de la princesse de Savoie,
ou les contraintes de la fête (1773) 861
L’espoir d’une milice garante de l’ordre bourgeois (1786) 864
Conclusion. Peuple acteur et peuple figurant 870
Épilogue
De la garde bourgeoise à la garde nationale 873
Conclusion générale
La sociabilité perdue 885
Chronologie sommaire 893
1071Annexe 1
Un conflit de frontière : la règle de l’entrée d’immeuble (1665) 897
Annexe 2
Une onomastique incertaine : les dénominations de quartier 899
Annexe 3
Les modifications de la géographie des quartiers 903
Annexe 4
Les redécoupages de 1647 911
Annexe 5
Le partage d’îlots entre les quartiers de la rue Buisson
et de la rue Neuve (1711) 913
Annexe 6
La réforme de 1746 : revendications du quartier
de la rue Neuve 915
Annexe 7
Les officiers des arquebusiers de la ville 917
Annexe 8
L’évolution des dizaines : 1557, 1561, 1568 921
Annexe 9
La vexillologie lyonnaise en 1622 923
Annexe 10
La vexillologie lyonnaise de 1714 à 1789 927
Annexe 11
Honorariats et vétérances des officiers
de la garde bourgeoise (1773-1790) 931
Annexe 12
Les sous-officiers décorés (1782-1784) 933
1072Annexe 13
Compte rendu du défilé de 1786 935
Annexe 14
Couplets à M. Tolozan de Montfort,
commandant de la ville (1786) 939
Annexe 15
Requête des officiers de la milice bourgeoise
au ministre Bertin (1775) 941
Annexe 16
La Loge Saint-Jean d’Écosse du Patriotisme en 1786 945
Annexe 17
Acte consulaire refusant la démission
de René Gros de Saint-Joyre (1641) 951
Annexe 18
Les épitaphes d’officiers dans l’église des Grands-Augustins 953
Annexe 19
Duel entre lieutenant et capitaine (1628) 955
Annexe 20
Tillets de transmissions d’ordres aux officiers pennons 959
Annexe 21
Contrôle social et répression de la prostitution (1617-1618) 965
Annexe 22
La garde de l’Herberie lapidée (1617) 969
Annexe 23
La réglementation des pennonages (xvie-xviiie siècles) 971
Glossaire 975
Sources 979
1073Bibliographie 997
Index des noms de lieux 1011
Index des noms de personnes,
de loges et de régiments 1023
Table des cartes 1053
Table des graphiques 1055
Table des illustrations 1057
Table des tableaux 1059