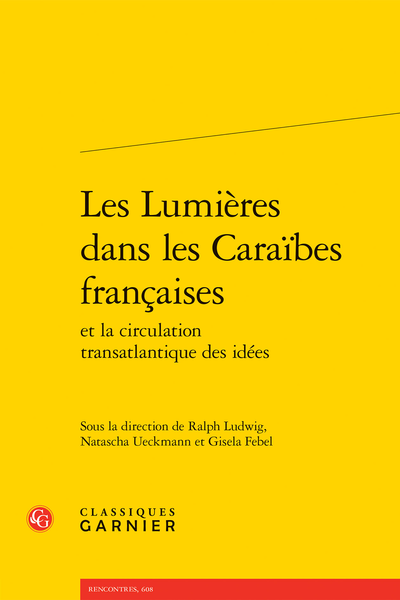
Au préalable Circulations – Lumières – Antilles
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: Les Lumières dans les Caraïbes françaises et la circulation transatlantique des idées
- Authors: Ludwig (Ralph), Ueckmann (Natascha), Febel (Gisela)
- Abstract: Les Lumières, comprises comme vaste processus de circulation transatlantique, permettent de cerner comment les Amériques et les Antilles deviennent un moteur d’idées original et irremplaçable. Celles-ci ouvrent un champ dialectique qui élargit, transforme, concrétise et défie les conceptions universalistes de cette époque.
- Pages: 7 to 12
- Collection: Encounters, n° 608
- Series: The eighteenth century, n° 44
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406158387
- ISBN: 978-2-406-15838-7
- ISSN: 2261-1851
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15838-7.p.0007
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 02-14-2024
- Language: French
- Keyword: Esprit, autonomie du sujet, commerce triangulaire, raison, tolérance, encyclopédisme, Europe, Amériques, Afrique
Au préalable
Circulations – Lumières – Antilles
Les idées, qui permettent aux sociétés humaines de construire des structures et de progresser, s’émancipent de ceux qui les ont formulées à un moment historique donné. Elles n’appartiennent à personne, elles sont en mouvement, circulent et se transforment. Il arrive même qu’elles se retournent contre leurs auteurs d’origine, parfois à juste titre. Enfin, elles s’adaptent continuellement à de nouvelles conditions. Cette constatation vaut pour les idées des Lumières, dans leurs circulations impliquant l’Europe, la Caraïbe et l’ensemble des Amériques, ainsi que les autres continents.
Quoi qu’il en soit, les idées des Lumières sont plurielles dès le départ, leur ramification constituant un aspect fondamental de ces mouvements. Elles ne cessent de se croiser, se différencier et s’opposer : du matérialisme au sensualisme, du libéralisme anglais à la pensée libertine, des différents concepts de religion naturelle ou révélée au déisme ou à l’athéisme, du droit naturel au droit du plus fort, de la citoyenneté à l’idée de paix éternelle, du républicanisme au cosmopolitisme, et on pourrait citer bien d’autres champs de dissension.
Ce caractère ouvert est la première qualité des Lumières explicitée par Tzvetan Todorov en 2006 dans son livre intitulé L’esprit des Lumières. Elle lui paraît essentielle pour le triomphe de la pensée rationnelle sur le dogme suivant : « Les Lumières ont été une époque de débat plutôt que de consensus » (ibid., p. 10).
La seconde caractéristique des Lumières, d’après Todorov, est l’autonomie du sujet, et plus précisément l’autonomie de l’esprit ou la liberté de la pensée ; elle s’avère cependant être une revendication partagée par tous les intellectuels des Lumières, indépendamment de leur orientation philosophique ou théologique. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau exige du bon citoyen qu’il sache « agir selon les maximes de son propre jugement » (Rousseau, 1820, p. 133 ; Todorov, ibid., p. 37), et Denis Diderot esquisse le sujet idéal comme étant « un philosophe qui, foulant aux pieds le préjugé, la tradition, l’ancienneté, 8le consentement universel, l’autorité, en un mot tout ce qui subjugue la foule des esprits, ose penser de lui-même » (Diderot, 1778, p. 161 ; Todorov, ibid., p. 37). Selon la célèbre formule d’Emmanuel Kant, « Les Lumières sont ce qui fait sortir l’homme de la minorité qu’il doit s’imputer à lui-même1 ».
Ces idées – ainsi que d’autres énumérées par Todorov – entrent dans de vastes processus de circulation. Les Lumières ont été, depuis le début, un mouvement global, et l’on a, ces derniers temps, souligné de plus en plus la dimension transatlantique de cette globalité2.
Dans les flux transatlantiques – ceux des personnes comme ceux des idées –, le bateau a joué un rôle-clé, portant à son bord femmes et hommes, lettres, livres, et marchandises d’un rivage à l’autre. Il en débarque celles et ceux qui s’enfuient, découvrent l’ailleurs, y cherchent fortune, allant jusqu’à commettre des crimes pour s’enrichir, s’y installent, parlent et – pour autant que leur éducation le leur permette – écrivent : voyageurs, colonisateurs, scientifiques, écrivains, missionnaires, marchands ou victimes, les esclaves dégradés au rang de marchandises. Le commerce triangulaire arrachera 12,5 millions d’Africaines et d’Africains à leur terre natale3. Dans leur cas, le mouvement migratoire prend la forme d’une déportation ; celle-ci constitue un défi majeur pour les Lumières et une contradiction flagrante de leurs principes.
Ceux qui croupissent dans la cale apportent des bribes de mots. D’autres racontent par fragments, certains transfèrent d’une manière ou d’une autre des idées, dont celles des Lumières, quelques-uns les explicitent et les propagent, d’un côté et de l’autre de l’Atlantique. Les esclaves antillais absorbent, chuchotent ou, à certains moments, crient des mots de liberté comme ils les entendent.
Cette circulation est non seulement multiforme, mais aussi multidirectionnelle. Elle va de l’Europe aux Amériques, des Amériques vers l’Europe, elle transite par l’Afrique, s’étend à d’autres continents encore, elle va d’île en île. Elle peut être directe et triangulaire, ou carrément prendre la forme d’une errance, telle que celle des flibustiers. Les idées des Lumières 9circulent en s’exprimant d’abord dans un discours polyphonique. Il est donc essentiel, pour nos recherches, de cerner, à l’intérieur de ce discours transcontinental et global, quelques voies de transmission particulièrement révélatrices : certains agents (auteurs, politiques, révoltés…), certains médias (livres, correspondances, théâtre, poésie…), et certaines manifestations (constitutions, manifestes…). Plus concrètement, les Lumières, vues au travers du prisme de la circulation coloniale et décoloniale, sont – au moins doublement – en mouvement (cf. Carey & Festa, 2009 ; Dhawan, 2014).
Considérées comme un courant du xviiie siècle (et des années charnières), elles sont – pour l’essentiel de leur formulation de certains principes universels et humanitaires – inconséquentes. Ainsi, en dépit de leurs efforts, elles ne parviennent pas à appréhender, et encore moins à engendrer, la reconnaissance inconditionnelle de l’égalité de tous les hommes entre eux. Certains penseurs ont même du mal à admettre que l’homme noir doive être reconnu comme être humain. Kant, apôtre de l’autonomie du sujet, méprise l’homme noir (cf. Calixte, dans ce volume).
Ces grands principes humanitaires – thématisés notamment par la Révolution française – sont ainsi restés inachevés. Et c’est ce potentiel d’inachevé – voisin du terme « fragmentaire » qu’on trouve chez le philosophe Ernst Bloch (1976) – qui constitue leur valeur aujourd’hui.
Les Lumières doivent une partie essentielle de leur message à la circulation transatlantique, et une vision des Lumières selon laquelle elles auraient pris leur source exclusivement en Europe serait, au minimum, incomplète. Une part fondamentale de leur élan est en effet due à l’échange avec les Amériques et l’Afrique. La conceptualisation de « l’un » européen n’a été possible que par l’échange avec « l’autre » non européen. Un exemple : la guerre d’Indépendance de l’Amérique du Nord, où se battirent côte à côte, au siège de Savannah en 1779, soldats français, nord-américains, gens de couleur libres de Saint-Domingue (dont Jean-Baptiste Belley) et futurs libérateurs d’Haïti. Ce brassage se reproduit sur le plan des idées des Lumières, dans ses différents processus de circulation4.
L’encyclopédisme et le nouveau mouvement de classification objective des phénomènes naturels se développe à partir de celle de Linné et de son Systema naturæ de 1735, laquelle met de l’ordre dans l’apparente confusion de la nature en divisant minéraux, végétaux et animaux en 10classes, ordres, genres, espèces et variétés. Diderot précise qu’« encyclopédie » signifie « enchaînement de connaissances » ; il s’agit de « rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre » et d’en exposer aux hommes « le système général ». Mais ces idées seraient impensables sans l’échange avec les autres parties du monde, ainsi que le soulignent aujourd’hui les théories postcoloniale et décoloniale, formulées par Homi K. Bhabha, Edward W. Said, Gayatri Chakravorty Spivak d’une part et Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Mignolo d’autre part, ainsi que bien d’autres encore (cf. Lander, 2000 ; Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007).
Il arrive que cet échange prenne la forme d’une dialectique conflictuelle. Si l’entendement – ou, selon Kant la raison – constitue un autre concept central des Lumières, en lien avec la dimension de la laïcité, ces idées peuvent se heurter, aux Antilles, à un grand nombre de pratiques religieuses d’antan et d’aujourd’hui. Les Caraïbes présentent un paysage d’orientations religieuses très diverses dès l’époque de la traite jusqu’à nos jours : certains vestiges de croyances autochtones se mêlent à des rites et croyances d’origine africaine et à ceux, arrivés plus tardivement, d’origine indienne. Dans la culture populaire, ces éléments furent sauvegardés et transformés par le temps. Leur confrontation aux religions chrétiennes importées, souvent octroyées par la force, mais aussi par le biais de l’éducation et de « missions civilisatrices » a fait surgir toute une richesse de croyances syncrétiques et de pratiques parallèles.
Même si l’idée de la tolérance au xviiie siècle a pu sembler faire parfois fonction de principe harmonisant, ce conflit avec les idées des Lumières rejaillit dans leurs circulations actuelles. Le roman L’ange du patriarche de l’Haïtienne Kettly Mars (2018) en est le tableau cruel, et D’autres vies sous la tienne de la Martiniquaise Mérine Céco (2019), le procès. Ces romans peuvent être lus comme une nouvelle interrogation critique des idées rationnelles et encyclopédiques des Lumières. Et cette ramification de la circulation contemporaine des idées des Lumières dépasse les Antilles5, ainsi que l’exprime Salman Rushdie en 2006 :
11J’ai beaucoup relu récemment les auteurs des Lumières. Le grand combat du xviiie siècle ne se livrait pas contre l’État mais contre l’Église. […] Je ne suis pas croyant, et entre la raison et la foi je choisirais toujours la raison. Mais la raison pose problème, y compris à un adepte de la pensée rationnelle : que nous soyons croyants ou athées, nous ne pouvons pas nous contenter d’une vision de l’homme comme créature rationnelle. Nous sommes aussi des rêveurs, ce qui ouvre sur une autre dimension. […] En ces jours sombres d’obscurantisme, un peu de lumière ne ferait pas de mal ! Mais en tant qu’écrivain je suis forcément attiré par les ténèbres. (Rushdie, 2006, s. p.)
Sonder au présent le potentiel d’inachevé des Lumières, à savoir la complexité moderne des « Lumières transhistoriques », oblige à partir des Lumières historiques, et à reconnaître non seulement leurs richesses, mais aussi les insuffisances et inconséquences de la réflexion du xviiie siècle. Ainsi s’ouvre un champ de tensions, et c’est dans ce cadre que s’inscrit notre ouvrage, en se penchant sur les différents aspects de ces circulations – complexes, souvent contradictoires, transatlantiques – qui commencent à s’esquisser dès la fin du xviie siècle et s’étendent jusqu’aujourd’hui. L’objectif consiste, en focalisant les étapes historiques, à mettre au jour l’incidence des Lumières transhistoriques sur la réflexion antillaise contemporaine, et vice versa. La littérature – au centre de l’intérêt, mais de manière non exclusive – est un lieu privilégié de cette exploration ; plus que la réflexion théorique, elle peut non seulement penser, mais aussi imaginer, vivre, flairer, embrasser et sélectionner, accueillir ou au contraire rejeter les différents flux des divers canaux et niveaux de circulation.
Ralph Ludwig
Université-Martin-Luther
Halle-Wittenberg
Natascha Ueckmann
Université-Martin-Luther
Halle-Wittenberg
Gisela Febel
Université de Brême
12Sources
Bandau, Anja, Dorigny, Marcel et Von Mallinckrodt, Rebekka (dir.), Les mondes coloniaux à Paris au xviiie siècle. Circulation et enchevêtrement des savoirs, Paris, Karthala, 2010.
Bloch, Ernst, Le principe espérance, vol. i, Paris, Gallimard, 1976.
Carey, Daniel et Festa, Lynn (dir.), The Postcolonial Enlightenment : Eighteenth-Century Colonialism and Postcolonial Theory, Oxford, Oxford University Press, 2009.
Castro-Gómez, Santiago et Grosfoguel, Ramón (dir.), El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2007.
Ceco, Mérine, D’autres vies sous la tienne, Paris, Écriture, 2019.
Davis, David Brion, « Foreword », Atlas of the transatlantic slave trade, Eltis, David et Richardson, David (dir.), New Haven & Londres, Yale University Press, 2010, p. xvii-xxii.
Delon, Michel (dir.), Dictionnaire européen des Lumières, Paris, Presses Universitaires de France, [1997] 2010.
Dhawan, Nikita (dir.), Decolonizing Enlightenment : Transnational Justice, Human Rights and Democracy in a Postcolonial World, Opladen, Budrich, 2014.
Diderot, Denis, « Opinions des anciens philosophes », t. 1, Œuvres, t. 5, publiées, sur manuscrits de l’auteur, par Jacques-André Naigeon, Paris, Desray & Déterville, an vi – 1798.
Kant, Immanuel, « Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung ? », Berlinische Monatsschrift, Heft 12, 1784, p. 481-494. Traduction française par Jules Barni, Kant, Emmanuel, « Réponse à cette question : Qu’est-ce que les Lumières ? », Éléments métaphysiques de la doctrine du droit, Paris, Auguste Durand, 1853, p. 281-288.
Lander, Edgardo (dir.), La colonialidad del saber : eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLASCO, 2000.
Mars, Kettly, L’ange du patriarche, Paris, Mercure de France, 2018.
Pellerin, Pascale (dir.), Les Lumières, l’esclavage et l’idéologie coloniale. xviiie-xxe siècles, Paris, Classiques Garnier, 2020.
Rousseau, Jean-Jacques, Pensées et maximes, vol. 1, Paris, Roret & Roussel, 1820.
Rushdie, Salman, « Mes Lumières », Le Nouvel Observateur, 21 décembre 2006, édition en ligne, s. p.
Todorov, Tzvetan, L’esprit des Lumières, Paris, Laffont, 2006.
1 « Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit », Kant, 1784, p. 481, en français : 1853, p. 281.
2 Nous renvoyons, à titre d’exemple, aux travaux pionniers de Hans-Jürgen Lüsebrink (cf. la bibliographie de Lüsebrink, dans ce volume), et, dernièrement, au tour d’horizon de Pellerin (2020).
3 « The transatlantic slave trade, which persisted for 366 years and resulted in the forced deportation of 12,5 million Africans to the New World, ranks as one of history’s greatest crimes against humanity. » (Davis, 2010, p. xvii).
4 La multidirectionnalité ainsi que le caractère composite et transitif de ce mouvement sont soulignés relativement tôt par Bandau, Dorigny & von Mallinckrodt (2010).
5 C’est cette approche moderne des Lumières que vise Michel Delon lorsqu’il formule sa quatrième définition des Lumières : « Les Lumières désignent à la fois un mouvement de pensée historiquement situé, l’époque où celui-ci s’est affirmé mais où il n’a pas toujours été majoritaire d’un point de vue quantitatif ni même parfois qualitatif, la problématique que nous en avons héritée, enfin un système de valeurs qui reste ou qui redevient aujourd’hui l’enjeu de débats. Ces quatre définitions sont conjointes, souvent concurrentes, parfois contradictoires. » (Delon, 2010, p. vii).