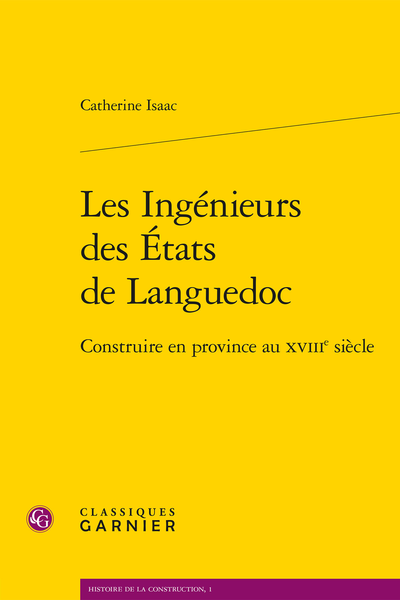
Table des matières
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Les Ingénieurs des États de Languedoc. Construire en province au xviiie siècle
- Pages : 703 à 709
- Collection : Histoire de la construction, n° 1
- Thème CLIL : 3378 -- HISTOIRE -- Histoire générale et thématique
- EAN : 9782406161011
- ISBN : 978-2-406-16101-1
- ISSN : 3037-9415
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16101-1.p.0703
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 30/04/2024
- Langue : Français
Table des matières
Abréviations 7
Préface 9
Introduction 13
Première partie
Des hommes
L’administration des travaux publics du Languedoc 29
Une des plus vastes provinces du royaume 29
La genèse de l’administration des travaux publics
du Languedoc 34
Le personnel administratif 37
Les syndics généraux 38
Les commissaires des travaux publics 40
Les syndics et commissaires diocésains 40
Le système des préciputs 41
Les relations avec l’intendant 43
Le personnel technique 44
1712-1740 Le premier directeur des ouvrages
de la province 44
1740-1790 L’organisation hiérarchique 49
Les sous-inspecteurs et inspecteurs 51
Les directeurs 53
D’autres pays d’états : autres lieux, autres règles 56
704La Bretagne 57
La Bourgogne 59
1791 : La fusion avec le corps des Ponts et Chaussées 61
Les hommes des travaux publics en Languedoc 65
Questions de vocabulaire 65
Des directeurs, des inspecteurs, des ingénieurs 65
Des ingénieurs et des architectes 67
Un partage des rôles emblématique du xviiie siècle 70
Des ingénieurs qui ne sont pas architectes 72
Questions de recensement 76
Les directeurs des travaux publics :
des astronomes aux ingénieurs 80
La Société royale des sciences de Montpellier 80
Des experts d’utilité publique 84
Un vivier de compétences
au service des États de Languedoc 88
Une première génération : des directeurs académiciens 89
Une deuxième génération :
des inspecteurs promus directeurs 91
Une troisième génération :
des enrôlements exclusivement familiaux 92
La pérennité d’un groupe uni 93
Un nombre considérable d’inspecteurs 98
Tant dans les sénéchaussées… 98
… que dans les diocèses 102
Des Irlandais en Languedoc 103
Des ingénieurs des Ponts et Chaussées en Languedoc 106
Des ingénieurs du Génie en Languedoc 111
Comment devient-on ingénieur en Languedoc ? 115
De longue date, un enseignement scientifique
de haut niveau 116
Des collèges jésuites parmi les plus importants
du royaume 116
Des Jésuites ingénieurs et architectes 117
705Sorèze, une réputation internationale 120
La formation des directeurs : les relations interpersonnelles 121
À l’Ouest : familles et académies 121
À l’Est : familles d’abord 126
Les inspecteurs, des parcours diversifiés
et des points communs 129
Un recrutement local 129
Des milieux sociaux diversifiés 131
Le rôle des Académies toulousaines 133
Un apprentissage au contact des anciens 137
Sur le modèle des ingénieurs du roi 139
Les ressources de formation 141
Les bibliothèques des collèges 142
La bibliothèque de l’Académie des sciences,
inscriptions et belles-lettres 143
La bibliothèque de François et Bertrand Garipuy 144
La bibliothèque de Joseph Marie
et Charles François de Saget 146
L’esquisse d’un portrait intellectuel 150
La vie quotidienne 155
Les rémunérations : une mise en place progressive 156
Trois directeurs bien rétribués 157
Les inspecteurs : des appointements homogènes 159
Les pensions à la discrétion des États 162
Des rémunérations en apparence élevées… 163
… mais peu lucratives 164
L’environnement de travail 168
Les locaux 168
Les instruments 170
Les déplacements 170
Les documents de travail et les « modelles » 171
Le goût des arts 176
Une moralité scrupuleuse 179
Conclusion 183
706Deuxième partie
Des savoirs
Introduction à la deuxième partie 189
Rassembler et diffuser les savoirs
Les Académies des sciences 191
La Société des sciences de Montpellier, les sciences de la vie 193
L’Académie des sciences de Toulouse, les sciences physiques 200
Une approche scientifique du toisé 201
Les prémices du calcul de structures 203
Réduire en art les pratiques 205
Des concours peu fructueux 209
L’exemple d’une ambition scientifique sans lendemain 211
Un franc-tireur 214
L’emprise de la tradition 215
Voyager « pour acquérir des connaissances » 219
1768, Garipuy en Hollande 220
1785 Des voyageurs sur les côtes
de Méditerranée et de l’océan 222
1786, un ingénieur en Hollande 233
Former des ingénieurs
Les écoles des ponts et chaussées du Languedoc 253
La source : les écoles de dessin 254
Le dessin, base de la formation technique 255
Le besoin d’une formation spécifique
aux travaux publics 257
Un antécédent : l’école du génie du Canal du Midi 259
L’essor d’une initiative privée 262
Des écoles de dessin à celles des ponts et chaussées 265
707L’école du génie pour les ponts et chaussées de Toulouse 268
Le projet de Mondran 268
Un règlement qui reprend le projet de Mondran 271
Les cours du corps professoral toulousain :
l’enseignement par l’exemple 275
L’école des ponts et chaussées de Montpellier 282
Un fonctionnement réglé dans les moindres détails 283
Des ressources pédagogiques de qualité 287
Un plan de cours soigneusement coordonné 291
Un paysage national 293
Autre pays d’états, autre modèle : la Bretagne 293
Montpellier, Toulouse, Paris :
des écoles sœurs, mais pas jumelles 295
Les écoles provinciales, un élan interrompu 298
Les relations province-Paris 298
Des élèves lancés 300
À Toulouse, un enseignement technique
de qualité qui n’est pas remplacé 302
Conclusion 307
Troisième partie
Des constructions
Introduction à la troisième partie 311
Une déférence envers le passé 317
Persistance de traditions romaines ? 317
Fierté d’un patrimoine 321
La construction des ponts, un processus mal maîtrisé 325
De la décision de construire à la passation d’un contrat 325
Des décisions longuement mûries 326
Le devis, clé de voûte du processus constructif 331
708Un travail solitaire 332
Une ébauche timide de standardisation 335
Un support de communication essentiel 336
Des annexes contractuelles 337
Quoi faire mais pas comment faire 340
L’adjudication 343
Les commissaires organisent les enchères publiques 344
Des contrats sources de litiges 347
Les péripéties du contrat du pont de Lavaur 348
Des difficultés révélatrices 352
L’exécution des travaux et le suivi des chantiers 354
Commissaires et inspecteurs,
interlocuteurs quotidiens des entrepreneurs 355
Le directeur ne conduit pas le chantier 356
Le directeur et l’inspecteur agréent le personnel 357
L’entrepreneur garde son indépendance 358
Les ingénieurs des Ponts et Chaussées
dirigent le travail et tiennent les délais 360
Des chantiers mouvementés 361
Des risques non maîtrisables 361
Des options techniques qui impliquent des difficultés 362
De nombreux changements en cours de construction 364
D’innombrables litiges avec les entrepreneurs 365
Le cas emblématique de Lavaur 366
Des difficultés récurrentes 367
La remise en cause du contrat en bloc 368
Un cintre exceptionnel 369
L’entrepreneur conçoit le cintre 373
La résiliation du contrat 377
Le décintrement s’opère sans difficulté 378
Le cintre comme révélateur 380
Chauvet dessine 380
Perronet commente 404
Des préoccupations esthétiques 409
Un certain archaïsme formel 409
709Une ambition esthétique 411
Une simplification parfois nécessaire 416
Une collaboration prestigieuse 418
Des « ingénieurs-artistes » 419
Le projet comme idéal 421
Des États en marge de l’innovation 421
Le projet comme grille d’analyse 422
Ponts et Chaussées, la maîtrise rationnelle 424
Province de Bourgogne, le budget à tout prix 425
Province de Languedoc, l’empirisme persistant 426
La puissance financière des États 428
Conclusion 431
Conclusion générale 433
Annexe
Dictionnaire biographique 439
Remerciements 635
Sources et Bibliographie 637
Index des noms 681
Index des lieux 687
Index des institutions 693
Index des matières 695