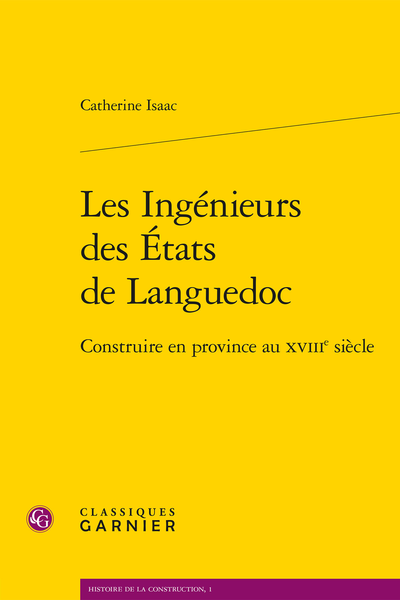
Conclusion
- Publication type: Book chapter
- Book: Les Ingénieurs des États de Languedoc. Construire en province au xviiie siècle
- Pages: 183 to 185
- Collection: Construction History, n° 1
- CLIL theme: 3378 -- HISTOIRE -- Histoire générale et thématique
- EAN: 9782406161011
- ISBN: 978-2-406-16101-1
- ISSN: 3037-9415
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-16101-1.p.0183
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 04-30-2024
- Language: French
Conclusion
Le Languedoc, province la plus étendue du royaume, pays d’états, fort de sa capacité à lever l’impôt, se dote au xviiie siècle de sa propre administration des travaux publics. Lors d’une phase préliminaire, les États provinciaux ont recours aux ingénieurs du roi. Subséquemment, soucieux de se démarquer du pouvoir royal, ils recrutent leur propre personnel technique.
Pour délimiter et discerner les contours du groupe étudié, en l’absence de listes de personnel, la recherche s’est fondée sur le principe posé par Carlo Ginzburg et Carlo Poni pour la micro-histoire : « Le fil d’Ariane qui guide le chercheur dans le labyrinthe des archives est celui qui distingue un individu d’un autre dans toutes les sociétés connues : c’est le nom1. »
Cela a conduit à la découverte d’un ensemble bien plus nombreux que nous ne le pensions au départ, et permis en outre de faire sortir de l’anonymat tous ceux qui ont contribué à la politique d’aménagement, en particulier routier, des États, dont plusieurs témoins ont loué les résultats2. Au-delà des quelques rares figures qui étaient passées à la postérité, c’est tout un réseau d’inspecteurs qui a œuvré à ces multiples chantiers dans tout le territoire de la province. Leur recrutement est une première spécificité, puisqu’à la différence des autres pays d’états, le choix se porte sur des personnalités locales, sans lien avec le corps des Ponts et Chaussées. À l’origine, les États de Languedoc recourent aux sociétés savantes, notamment à la Société royale des sciences de Montpellier, sœur de l’Académie royale des sciences de Paris. Des mathématiciens et astronomes se changent alors en ingénieurs. Les effectifs nécessaires augmentant, le vivier doit s’élargir, mais les réseaux de sociabilité 184académique conservent un rôle dans la transmission des connaissances, moins toutefois que les relations familiales, qui conduisent à l’émergence de dynasties ou de familles d’ingénieurs.
La recherche orientée par les noms a rendu possible la mise au jour des « trajets qui convergent vers le nom ou qui partent du nom [qui] composent une toile d’araignée aux mailles étroites proposant à l’observateur la représentation graphique du réseau des rapports sociaux dans lequel l’individu est pris3. » Ainsi sont découvertes les « structures invisibles 4 » des réseaux qui jouent un rôle clé, même s’il est implicite, dans l’organisation de ce corps, dont la deuxième spécificité tient à l’importance des liens familiaux ou au sein des sociétés savantes, les deux pouvant coïncider.
Le mode d’exercice de leur activité les distingue des corps du Génie et des Ponts et Chaussées. Moins fonctionnaires que « professionnels libéraux », les directeurs doivent disposer de leurs propres locaux, pour y héberger leurs bureaux et ceux du personnel auxiliaire qu’ils emploient. Les jeunes inspecteurs viennent s’y former. Si les rémunérations octroyées par les différentes instances provinciales semblent confortables comparées à celles de leurs confrères des Ponts et Chaussées, les revenus des directeurs se trouvent de fait amputés de tous ces frais. En outre, se consacrant exclusivement à la province, ils n’ont aucune activité annexe qui leur assurerait un gain supplémentaire. Hommes aux multiples facettes, l’art occupe une place significative dans la vie de beaucoup d’entre eux. D’une intégrité scrupuleuse, si leur travail ne leur permet pas de s’enrichir, ils bénéficient néanmoins de la gratitude de la province lorsqu’à la fin de leur carrière, elle leur accorde une pension.
L’absence jusqu’aux années 1780 d’une institution d’enseignement spécifique aux travaux publics fait reposer la formation des nouveaux ingénieurs sur les relations interpersonnelles, familiales ou non.
Enfin, un autre résultat, inattendu, a surgi de l’analyse suivant les termes de Carlo Ginzburg qui soulignait que l’« une des premières expériences de celui qui se risque à l’approche micro-historique est précisément de découvrir la pertinence faible, et parfois nulle, des scansions construites à l’échelle macro-historique (et d’abord des découpages 185chronologiques)5 ». Dans le cas présent, nous avons pu montrer que les ruptures organisationnelles provoquées au niveau national par la Révolution française ne se retrouvent pas au plan individuel, la plupart des ingénieurs en poste poursuivant leur activité au sein de la nouvelle administration. En outre, un plus grand nombre d’ingénieurs ont pu accéder à des postes à responsabilité, grâce à des possibilités d’évolution favorable, qui ne se seraient jamais présentées dans l’organisation antérieure. Ainsi plusieurs ont été nommés à des postes d’ingénieurs en chef départementaux (Laupiès, Mercadier, les frères O’Farrell, entre autres) voire d’inspecteur divisionnaire (Ducros, Saussine).
La deuxième partie permet d’étudier comment ces ingénieurs ont pu constituer un corpus de connaissances dans le domaine de la construction, tant par les échanges et les réseaux de sociabilité académiques, qu’au cours des voyages qu’ils ont entrepris, missionnés par la province, et comment les États, soucieux de pérenniser la transmission de ces connaissances pour disposer d’un personnel formé et compétent, créent des écoles des ponts et chaussées.
1 Carlo Ginzburg, Carlo Poni, « La micro-histoire », Le Débat 1981/10 (no 17), p. 133-136.
DOI 10.3917/deba.017.0133, https://www.cairn.info/revue-le-debat-1981-10-page-133.htm.
2 Voir entre autres Arthur Young, Voyages en France, Paris, Tallandier, collection Texto, 2009, p. 125.
3 Carlo Ginzburg, Carlo Poni, op. cit., p. 3.
4 Ibid.,p. 4.
5 Ibid.