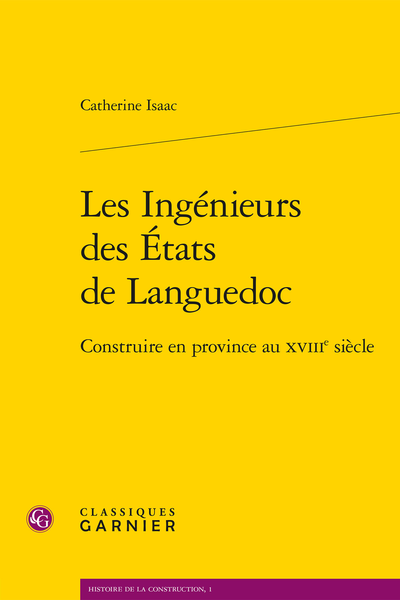
Conclusion
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Les Ingénieurs des États de Languedoc. Construire en province au xviiie siècle
- Pages : 307 à 308
- Collection : Histoire de la construction, n° 1
- Thème CLIL : 3378 -- HISTOIRE -- Histoire générale et thématique
- EAN : 9782406161011
- ISBN : 978-2-406-16101-1
- ISSN : 3037-9415
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16101-1.p.0307
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 30/04/2024
- Langue : Français
Conclusion
L’étude des activités intellectuelles des ingénieurs languedociens et de leur contribution à la constitution, à la consolidation et à la transmission d’un corpus de savoirs, tant théoriques que pratiques dans l’ensemble des disciplines qui relèvent de la construction, montre qu’ils ont été plutôt des passeurs que des novateurs.
L’analyse des sources, notamment celles des académies des sciences auxquelles appartiennent plusieurs directeurs, révèle des travaux partagés entre captation de savoirs vernaculaires et diffusion d’un savoir mathématique hors de portée des praticiens, fussent-ils ingénieurs. Si les directeurs semblent instruits des développements de la science moderne, spécialement du newtonisme, démontrant une bonne maîtrise des mathématiques et de la physique théorique, ces connaissances restent peu opérantes sur le plan pratique. Leurs communications n’ont pas fait progresser de manière significative le niveau technique des ingénieurs languedociens, les traités de Bélidor demeurent la référence commune.
Les États, manifestant une volonté d’ouverture, envoient à plusieurs reprises des ingénieurs en mission d’étude dans d’autres régions de France et à l’étranger. Reflet de la prégnance dans la province des questions d’architecture hydraulique (ports, canaux, marais), les destinations privilégiées sont les côtes de France et la Hollande. La réputation de ce pays est établie en Europe en général et en France en particulier depuis le xvie siècle. Les Languedociens sont donc à la recherche de solutions éprouvées plutôt que d’innovations. Les résultats se révèlent contrastés, seul aurait pu être profitable le dernier voyage, conduit par un ingénieur expérimenté ayant déjà été confronté à la résolution de divers problèmes. Ceci apparaît comme une condition nécessaire, car comme l’a souligné Gaston Bachelard « toute connaissance est 308réponse à une question. S’il n’y a pas de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique1. »
Hormis les tentatives de Jean Baptiste Mercadier pour se faire apprécier des sociétés savantes, il est en outre remarquable que les ingénieurs languedociens n’aient apparemment pas cherché à publier ni leurs travaux académiques ou personnels ni leurs comptes-rendus de voyages. À la différence de leur devancier Henri Gautier, ils n’ont jamais pensé à faire reconnaître leurs compétences ou leurs connaissances par l’écriture2. Au demeurant, alors que leur continuateur Delaistre déclare en introduction de son Encyclopédie de l’ingénieur n’attendre « ni gloire ni fortune : je me croirai trop récompensé si je me suis rendu utile 3 », ils n’ont pas, par excès de modestie ou volonté de se protéger, ressenti l’intérêt ou le besoin de compiler leurs savoirs dans des publications.
Le partage et la transmission de ces savoirs sont devenus toutefois une nécessité. Au cours de la décennie 1780, les États ont pris ainsi des dispositions fructueuses. S’emparant de l’initiative toulousaine de création d’une école du génie, ils l’étendent à l’autre grande capitale provinciale, dès lors ils rationalisent et modernisent la formation de leur personnel des travaux publics. Ces établissements prometteurs voient leur élan interrompu par la Révolution française, et la fusion avec le corps des Ponts et Chaussées. Avant de s’y résigner, la direction des travaux publics du Languedoc s’est opposée à cette disparition, recourant à un argumentaire qui illustre le dilemme des relations entre la province et la capitale : aspiration à la reconnaissance de ses talents, mais aussi ambition de leur offrir la possibilité de s’épanouir sans s’exiler.
Ces actions volontaristes des États pour encourager l’acquisition et le maintien de savoirs et de compétences dans la province sont néanmoins trop tardives pour produire des effets concrets. De fait, les grands chantiers ayant été lancés au milieu du siècle, ces initiatives n’ont pas trouvé d’occasion de se déployer dans la conception de nouveaux ouvrages.