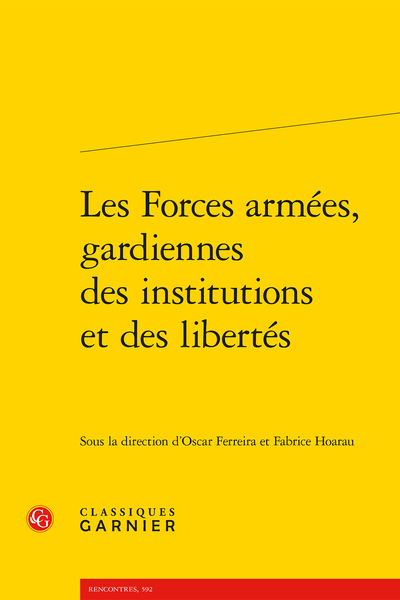
Résumés
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: Les Forces armées, gardiennes des institutions et des libertés
- Pages: 401 to 406
- Collection: Encounters, n° 592
- CLIL theme: 3262 -- DROIT -- Droit général -- Histoire du droit
- EAN: 9782406150640
- ISBN: 978-2-406-15064-0
- ISSN: 2261-1851
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15064-0.p.0401
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 08-09-2023
- Language: French
Résumés
Oscar Ferreira et Fabrice Hoarau, « Introduction »
Souvent regardée comme une menace potentielle pour les libertés et les institutions, l’armée a aussi pu tenir le rôle de gardienne de ces dernières, notamment dans l’hypothèse où ce sont les gouvernants qui entrent dans l’illégalité ; les forces armées peuvent alors assurer le respect de la constitution, en incarnant une résistance et une dissidence a priori peu compatibles avec l’obéissance exigée du militaire.
Paul Chauvin-Madeira, « Les forces armées, gardiennes des institutions de l’Ancien Régime contre le roi ou ses ennemis ? Un débat au sein de la doctrine militaire »
Cette étude porte sur quatre écrivains militaires de la fin de l’Ancien Régime choisis parce qu’ils incarnent deux conceptions opposées du rôle politique de l’armée gardienne des institutions contre les ennemis du roi pour les uns, contre le roi lui-même pour les autres. Ces exemples illustrent donc l’existence d’un débat au sein de la doctrine quant au rôle politique de l’armée qui se prolonge et s’explique en fait par une opposition quant à leurs propres conceptions politiques.
Aurélie Lahaie, « L’armée chez les utopistes français du xixe siècle : gardienne des institutions et des libertés ? »
Sous la IIIe République, les utopistes de toutes mouvances, impactés par la guerre contre la Prusse, s’emparent de la question de l’armée. Ils sont partagés. D’un côté, ils veulent la disparition d’une institution semant la mort et empêchant la paix, accusée de se ranger du côté du pouvoir et non du peuple. De l’autre, ils saluent l’alliée que peut être une armée réorganisée en temps de guerre, afin d’imposer un nouveau système, mais aussi en temps de paix, pour soutenir la vie de la société.
402Nathalie Droin, « Forces militaires et liberté d’expression sous la Troisième République. La surprotection d’une armée obéissante au nom de la garantie des Institutions républicaines »
La IIIe République n’a jamais caché sa méfiance à l’égard de l’armée, suspectée de velléités monarchistes, ce qui explique son choix de limiter les droits politiques et certaines libertés des militaires. Pour des motifs d’ordre public et, soi-disant, de garantie des Institutions républicaines, les Républicains vont maintenir dans la loi sur la presse du 29 Juillet 1881 le délit de provocation des militaires à la désobéissance, très discutable pour un régime qui se veut démocratique et libéral.
Fabrice Hoarau, « Un général au secours des institutions de la République. Les messages et les discours de De Gaulle après la défaite de 1940 »
Rien ne prédestinait un militaire promu général pendant la campagne de France à incarner la lutte de la République contre ses ennemis (régime de Vichy ; Allemagne nazie) : dépourvu de légitimité politique et presque inconnu de l’opinion publique, il ose pourtant parler dès juin 1940 au nom de la France et de la République, comme un véritable chef d’État, et penser le régime appelé à succéder à une IIIe République jugée en partie responsable de la défaite.
Massensen Cherbi, « L’armée française et les putschs algérois de mai 1958 et avril 1961. Entre instrument de la Ve République et gardien autoproclamé de “l’ordre constitutionnel républicain” »
Le pouvoir modérateur exercé, de facto, par l’armée française, à l’occasion des putschs algérois de mai 1958 et d’avril 1961, en a fait à la fois un instrument de la Ve République et le gardien autoproclamé de la Constitution de 1958. L’armée fut ainsi qualifiée, entre 1958 et 1962, de défenderesse des « intérêts supérieurs de la France », de garante de « l’ordre constitutionnel républicain » ou encore de « gardienne de la liberté et du territoire national ».
Jean-François Roulot, « Les LEGADs français. Le conseil juridique aux armées en opérations »
Les conseillers juridiques en service dans les armées françaises expriment autant par leur existence que par leur fonction, la volonté des armées, sous la 403direction du chef de l’État, de se conformer à la légalité républicaine. Dans les missions sur le territoire national, ce sont les considérations juridiques qui encadrent strictement l’action des armées. Il en est de même en international où l’usage de la force peut être appliqué même a minima de ce que rend possible le droit international.
Frederik Dhondt, « Armée, gendarmerie, Garde civique. Les gardiens de la Constitution belge face aux citoyens »
La Révolution belge de septembre 1830 associe le peuple à la prise du pouvoir. La Garde civique voit le jour. Cette institution évolue dans un contexte bourgeois, allant de pair avec des capacités inégales des autorités locales. Nous étudions la genèse de la triade « armée – gendarmerie – Garde civique » et son évolution à la Belle Époque. La disparition de la Garde après la Grande Guerre et l’introduction effective de la conscription créent un rapport différent entre citoyens et soldats.
Arthur Braun, « Le “principe de l’armée de milice” en droit constitutionnel suisse. Concrétisation républicaine de la figure du citoyen-soldat »
Parce qu’elle est empreinte du principe de milice, l’armée suisse apparaît, plus que toute autre armée, insérée au sein de l’État et dans la société en général. La maxime « la Suisse n’a pas d’armée, elle est une armée » correspond encore à cette réalité profonde. La Suisse possède une identité militaire forte, consubstantielle à son histoire. Cette identité est singularisée sur le plan constitutionnel par le maintien du système de milice et incarnée par la figure républicaine du citoyen-soldat.
Laurent Reverso, « L’armée, la constitution, les libertés dans les constitutions italiennes de 1848-1849 »
Oubliées par l’historiographie libérale, les neuf constitutions italiennes des années 1848-1849 offrent deux rôles aux forces armées. Celui de gardien de la bonne marche des institutions dans le sens où ces dernières voient leur fonctionnement conditionné par le maintien des libertés. Celui de défenseur du pouvoir, quel qu’il soit. Tantôt garantes de la seule conservation des institutions, tantôt des institutions et des libertés, en particulier quand elles se muent en garde nationale ou civique.
404Hugo Rousselle, « “Arditi non gendarmi”. La défense du peuple contre les violences et le front prolétarien antifasciste »
Au lendemain du premier conflit mondial, l’Italie fait face à une situation troublée. Appartenant aux vainqueurs, elle estime sa « victoire mutilée » et connaît une agitation sociale forte. Des milices d’anciens combattants des troupes d’assaut nommés arditi se forment et suivent D’Annunzio à Fiume. Après cet échec certains adhèrent au fascisme mais d’autres vont former le premier grand groupe armé antifasciste trans-partisan pour lutter pour la protection des libertés : les Arditi del Popolo.
Jacky Hummel, « Une protection des institutions confiée à une armée parlementaire ou impériale ? L’impensable contrôle parlementaire du budget militaire (Allemagne, 1862-1914) »
Dans le cadre de l’Empire wilhelminien, le vote des principaux projets de loi militaires a constitué un moment de vérité cristallisant la tension entre prérogatives monarchiques et compétences budgétaires parlementaires. Témoignant des ambitions et désillusions du libéralisme allemand, les batailles parlementaires portant sur le vote des crédits militaires ont interrogé le statut constitutionnel de l’armée (dans laquelle Bismarck voit l’instrument essentiel de préservation de l’unité nationale).
Elina Lemaire, « Les doctrines politiques des colonels grecs (1967-1974). Forces armées, institutions et libertés »
Les « doctrines » des colonels de la Junte grecque (1967-1974), formulées par des officiers d’origine sociale modeste et sans aptitude au commandement, sont pauvres et marquées par de nombreux éléments de contradiction. Il est possible toutefois d’identifier dans cet ensemble doctrinal quelques idées relativement stables, notamment sur le rôle de l’armée comme « gardienne » du régime politique et du système social, au besoin contre les libertés.
405Oscar Ferreira, « Le pouvoir modérateur des forces armées au Brésil. Une lecture du général Bertholdo Klinger et de la revue militaire A Defeza Nacional (1913-1932) »
Organe des « Jeunes-Turcs », ces officiers réformateurs brésiliens partis en Allemagne entre 1906 et 1912 pour finaliser leur formation, la revue militaire A Defeza Nacional demeure aujourd’hui l’un des principaux lieux d’exposition de la doctrine des forces armées. Dirigée par Bertholdo Klinger, elle popularisa la thèse du pouvoir conservateur des militaires, moins sous l’angle constitutionnel que sous l’aspect social, du fait des interférences du « pouvoir spirituel » du positivisme comtien.
Carlos M. Herrera, « Les Forces armées, gardiennes des institutions et des libertés ? Guerre froide, Sécurité nationale, ordre juridique. Quelques remarques à partir du cas argentin (1963-1970) »
Ce texte analyse la place de la défense de la constitution dans les dictatures militaires, instaurées en Argentine sous l’égide de la doctrine de la sécurité nationale. Si la lutte anticommuniste assumait l’héritage occidental en matière de gouvernement représentatif et des droits de l’homme, d’une part, et de promouvoir une politique de développement fondée sur la planification, d’autre part, le dessein juridique devait conduire à une série d’opérations sémantiques en matière constitutionnelle.
Eugénie Merieau, « La doctrine de la légalité révolutionnaire en doctrine et dans la jurisprudence de la Cour Suprême thaïlandaise »
Sept ans en moyenne, a repris, acculturé et développé un important corpus de doctrines juridiques des coups d’État. En particulier, la théorie kelsénienne de la légalité révolutionnaire. Celle-ci a été appliquée par la Cour Suprême, enrichie par la doctrine thaïlandaise, puis mise en œuvre par la Cour Constitutionnelle et ce, jusqu’à caractériser le coup d’État comme faisant partie intégrante de l’ « identité constitutionnelle » du pays.
406Luc Klein, « La suprématie civile sur la force armée à l’épreuve du coup de force contre les libertés. Expérience de pensée à partir des droits français et américain »
Si la crainte des démocraties occidentales envers le coup d’État militaire est dépassée, les forces armées n’en demeurent pas moins un risque potentiel pour la garantie des libertés. Leur subordination hiérarchique est en effet susceptible de faire planer une menace sur l’État de Droit, dans l’hypothèse où le pouvoir exécutif s’appuie sur leur concours dans le cadre d’une légalité exceptionnelle. Ce chapitre propose d’en mesurer les enjeux et les conséquences en droit comparé franco-américain.
Hamza Cherief, « De “Mad Mike” aux “EMSP”. Chronique juridique du mercenariat en Afrique sub-saharienne »
Facteur de déstabilisation incriminé comme tel, le mercenariat constitue aussi un mode de recrutement. S’interroger sur la possibilité que les mercenaires puissent être gardiens des institutions et des libertés permet d’aborder la question de la définition du mercenaire et celle de sa qualification juridique. Cette problématique prend une signification particulière en Afrique sub-saharienne qui fut l’un des principaux théâtres d’opération des mercenaires durant le processus de décolonisation.
David Cumin, « Les forces armées, gardiennes de l’ordre juridique international. Des clauses de la Charte des Nations Unies à la pratique des Nations Unies, ou de la “centralisation” à la “décentralisation” du jus ad bellum »
Via son art. 42, la Charte des Nations Unies centralise au CSNU le droit de recourir à la force armée, réserve faite de la légitime défense, suppléance de la sécurité collective. Cette centralisation est normative. Elle est décisionnelle lorsqu’il y a consensus au Conseil. Mais en raison de l’absence d’application des art. 43 à 47, donc faute pour le Conseil de disposer de forces armées, elle n’est pas exécutive. En cas de dissensus, la décentralisation est complète, exécutive et décisionnelle.