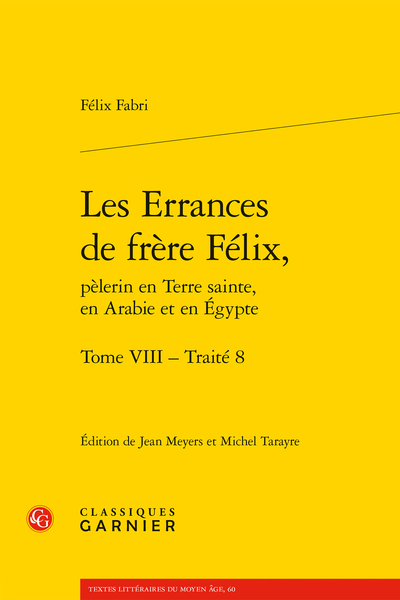
Avertissement
- Publication type: Book chapter
- Book: Les Errances de frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte. Tome VIII. Traité 8
- Pages: 7 to 11
- Collection: Literary Texts of the Middle Ages, n° 60
- CLIL theme: 3438 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moyen Age
- EAN: 9782406107231
- ISBN: 978-2-406-10723-1
- ISSN: 2261-0804
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-10723-1.p.0007
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 12-07-2020
- Language: French
AVERTISSEMENT
Ce huitième tome contient l’essentiel du traité 8 (fo 64 b-133 b), consacré à la période du 1er au 29 octobre 14831, qui relate l’arrivée et le séjour des pèlerins en Égypte.
C’est sans doute une des parties les plus riches et les plus réussies de l’Evagatorium. Pour en mesurer l’originalité, il faut lire ou relire le beau et grand livre que Jeannine Guérin Dalle Mese a consacré aux récits de voyage en cette terre, du xive à la fin du xvie siècle2. Elle a en effet montré que par rapport à bien d’autres auteurs, « Fabri est plus curieux, plus ouvert aux multiples aspects du monde nouveau qui s’offre à lui3 ». Comme il le confie lui-même dans ce traité 8 (fo 102 a), le Dominicain a écrit pour tous les lecteurs, les jaloux, les curieux, les inexpérimentés, mais c’est sans doute ici qu’il en fait le mieux la démonstration et qu’il porte à son comble cette attention nouvelle au lecteur, qui, avec lui, devient souverain4.
Les premières relations sur l’Égypte témoignaient essentiellement d’un voyage aux sources chrétiennes, mais elles sont devenues peu à 8peu un voyage aux sources païennes et aux sources de la religion, un voyage en cette terre mythique de mémoire et de rêve5, et c’est déjà le cas chez Félix Fabri. Au Caire, il n’y a aucune église latine à visiter, et le « tourisme religieux » peut céder la place au « tourisme tout court »6. Certes, les pèlerins visitent bien l’arbre de la Vierge (89 a-b), une église orientale dédiée à saint Serge et une autre à saint Georges (fo 91 b-92 a), mais l’intérêt principal est désormais ailleurs : il est dans le jardin de Matarieh, avec ses baumiers et ses bananiers (fo 75 a-76 b), il est dans les pyramides (fo 89 b-90 a) et dans le sphinx, considéré par Fabri comme une statue d’Isis, dont il raconte l’histoire en détail (fo 90 a-90 b), il est dans les deux obélisques stupéfiants entre lesquels un souterrain, gardé par une porte en fer infranchissable, cache l’ancienne demeure des Titans et de leurs trésors (fo 92 b-93 a), il est dans les incroyables couveuses artificielles (fo 94 b-95 a), dans le dressage si habile des pigeons voyageurs (fo 95 a), dans le château du sultan, construit sur une colline miraculeusement séparée des montagnes du désert (fo 96 a-97 b), il est dans la colonne de Nectanébo et dans la sépulture du grand Pompée (fo 97 b), dans l’histoire du Nil, fleuve du Paradis, et dans l’explication de ses crues (fo 116 b-120 b), dans l’étude de sa légendaire fécondité (fo 121 b-122 a) et dans la description des crocodiles et des hippopotames qui y vivent (fo 120 b-121 b).
Contrairement à tant d’auteurs si lapidaires, Félix Fabri convoque, dans chacune de ces pages, tout ce qu’il a de curiosité, de culture et d’érudition pour faire aussi de son récit, comme à son habitude, une véritable somme encyclopédique du savoir viatique. Mais, comme l’a si bien écrit Jeannine Guérin Dalle Mese7, « sa culture, en tout cas, ne l’éloigne pas de la réalité qu’il a sous les yeux », il ne fait pas que compiler, il présente toujours les choses de façon personnelle, avec des yeux émerveillés et un remarquable talent de conteur.
Malgré des mots très durs envers l’Islam, le Coran et leurs fidèles, Félix Fabri sait aussi faire preuve d’ouverture d’esprit quand il est question non plus de l’autre religion, mais des individus réellement rencontrés8. 9Quand quelques pèlerins pleurent en disant adieu à Elphahallo, leur fidèle guide octogénaire, frère Félix ne cache pas qu’il était devenu pour eux « comme un père », dont ils allaient désormais être privés (fo 85 a). Dans l’ingénieux récit de l’épisode au cours duquel Bernard de Breydenbach perd et retrouve sa bourse (fo 73 a-b) et dont Jeannine Guérin Dalle Mese a donne une analyse fouillée9, Fabri rappelle certes la fâcheuse tendance à voler des chameliers et des âniers, sur lesquels se porte la suspicion des pèlerins, alors qu’ils n’y sont pour rien, mais ce que l’auteur veut finalement montrer, outre « son plaisir évident de conter », c’est que « l’honnêteté d’un inconnu, d’un homme d’une autre race » peut aussi « triompher même au cœur du désert10 ». Face aux superstitions et aux miracles de l’Orient, comme celui du cimetière des saints musulmans, qui, certains jours, se dressent dans leurs tombeaux (fo 91 a), contrairement à beaucoup de voyageurs qui les démystifient de façon simpliste ou les accumulent juste pour surprendre le lecteur, frère Félix « prend les faits au sérieux », s’interroge, donne son avis, non sans « une certaine envolée lyrique11 » et réduit même l’altérité du prodige en le rapprochant d’une « chose semblable » arrivée « de nos jours dans le diocèse de Cologne12 ». L’ouverture d’esprit de Fabri est tel qu’il va même jusqu’à écrire qu’il y a dans le Coran, ouvrage en général « mensonger », des pages qui semblent « plus vraies que le texte du saint Évangile » (fo 105 b)13.
Dans ce volume, on retrouvera l’humanité du frère dominicain, si tangible dans la pitié qu’il ressent devant les pauvres travailleurs qui confectionnent des briques dans la boue du Nil, devant le sort horrible 10des êtres humains vendus sur les marchés aux esclaves (fo 131 a) et devant les malheureuses prostituées, avec lesquelles il ne dédaigne pas d’avoir une brève conversation (fo 133 a-b)14. On y retrouvera aussi l’art de conter l’anecdotique, comme dans l’aventure du petit groupe de pèlerins, auquel se joint l’auteur, qui s’égarent dans le désert pour aller prendre un bain dans la mer Rouge, qu’ils croient toute proche (66 b-69 a). Félix Fabri, avec un art littéraire indéniable15, dramatise l’épisode pour tenir le lecteur en haleine et en tire un plaisant récit, plein d’ironie « qu’il exerce sur lui-même et non pas sur les autres16 ». Dans l’Evagatorium, « l’aventure de l’individu revêt de l’importance. Il s’agit de celui qu’il connaît le mieux, lui-même, mis en relief avec ostentation17. » On y retrouvera enfin l’habituelle tendance à l’excursus, la digression, la divagation, si caractéristique de son écriture. À ce propos, qu’on me permette à nouveau de citer ce qu’écrit Jeannine Guérin Dalle Mese :
« Tout ce qu’il voit en Égypte est sujet à “divagations” pour Fabri, comme il en a prévenu le lecteur, mais le domaine des prodiges, d’une richesse extrême, le fait pénétrer dans tout ce que la culture d’un Occidental de la fin du xve siècle a pu amasser ; il est en somme un excellent témoin de toutes ces croyances puisque celles-ci appartiennent à tous les registres, populaires, littéraires, religieux. Étalage de connaissances ? Ouvrage qui se veut somme et désire épuiser tous les sujets ? Je ne le pense pas. En tout cas, il n’épuise pas le lecteur car le plaisir de narrer les choses les plus invraisemblables se communique à la lecture. Lui se meut en narrateur et en personnage avec le plus parfait naturel au milieu de cette forêt de légendes, de superstitions, de forces occultes18. »
Si la langue latine de Félix Fabri, comme j’ai pu l’écrire ailleurs19, n’est pas celle d’un humaniste, son regard sur l’Égypte est déjà celui 11d’un homme de la Renaissance. Car, pour reprendre une expression de la conclusion du livre de Jeannine Guérin Dalle Mese, il y a bien chez lui un « désir humaniste », que l’on devine derrière son long développement sur le Nil, qui annonce l’attitude des savants géographes du siècle suivant20, derrière sa sensibilité devant la beauté des ruines et des merveilles passées qui s’y cachent, derrière sa fascination devant l’Égypte, « pays des dieux, mère de l’écriture », « Paradis terrestre où coule le Nil, reflet de l’autre paradis où naît le Fleuve21 », derrière son intérêt constant pour la mythologie antique et sa volonté d’y voir « une tentative pour comprendre le monde, pour expliquer intuitivement ce qui est mystérieux pour l’homme22 ».
Sur les principes d’édition, nous renvoyons comme d’habitude le lecteur aux explications données dans le premier tome23.
Jean Meyers
1 Le texte latin édité ici correspond à la fin du t. II et au début du t. III de l’édition de Hassler : Fratris Felicis Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti Peregrinationem, éd. C. D. Hassler, Stuttgart (« Bibliothek des Literarischen Vereins », 2 et 3), 1843, p. 517-545 et p. 1-171. Jean Meyers, qui a établi le texte latin du manuscrit autographe, remercie Michel Tarayre pour l’aide considérable qu’il lui a à nouveau apportée en collationnant au préalable les deux manuscrits N et S. Sur le manuscrit de Fabri, on pourra lire aujourd’hui J. Meyers, « Grande uolumen comportaui : la conception de l’Euagatorium d’après le manuscrit autographe de Félix Fabri », Studium in libris et sedula cura docendi. Mélanges offerts à Jean-Louis Charlet, A. Stoehr-Monjou et G. Viard (éd.), Paris, Études augustiniennes, 2016, p. 417-434.
2 J. Guérin Dalle Mese, Égypte. La mémoire et le rêve. Itinéraires d’un voyage, 1320-1601, Florence, Leo S. Olschki Editore (« Biblioteca dell’Archivum Romanicum », Serie I, vol. 237), 1991.
3 J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 107, n. 21.
4 J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 75 : « Avec Fabri (fin xve), les choses changent totalement […]. À la souveraineté du narrateur a succédé la souveraineté du lecteur, et c’est lui qui dicte sa loi. »
5 Cf. J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 595.
6 Cf. J. Guérin Dalle Mese, Égypte, qui écrit p. 45 que pour les voyages en Égypte, « très vite la visite aux églises perd, peu à peu, de son importance dans le récit, tandis qu’est privilégiée celle aux lieux profanes. Du “tourisme religieux”, on passe au “tourisme” tout court. »
7 J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 406 (cf. aussi p. 278).
8 À ce sujet, cf. J. Meyers, « Construction et images de l’autre et de l’étranger dans les Errances de frère Félix Fabri (1483-1484) », La Naissance d’autrui, de l’Antiquité à la Renaissance, J. Lagouanère (éd.), Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 391-411. J. Guérin Dalle Mese s’en était elle aussi aperçue, comme le prouve ce qu’elle écrit dans Égypte, p. 140 : « L’aversion manifestée pour le groupe disparaît [chez Fabri] lorsque l’approche individuelle établit des relations qui permettent de découvrir les qualités de l’autre, en dehors des préjugés habituels. »
9 J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 253-256.
10 J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 256.
11 Sur cette attitude particulière, cf. J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 334-337 (p. 334 et 335 pour les deux citations).
12 Sur cette manière de rapprocher l’altérité, cf. J. Meyers « Merveilleux et fantastique dans le récit de voyage : le cas de l’Evagatorium de frère Félix Fabri », “Furent les merveilles pruvees et les aventures truvees”. Hommages à Francis Dubost, F. Gingras, F. Laurent, F. LeNan et J.-R. Valette (éd.), Paris, Honoré Champion, 2005, p. 439-463.
13 Sur ce passage « à la limite de l’hérésie », cf. les remarques de J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 185-186.
14 J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 145-152, montre bien que tous les voyageurs ne s’encombrent pas, comme Fabri, de sentimentalité en abordant la question des marchés d’esclaves et des lieux de prostitution.
15 Sur la littérarité de l’Evagatorium, cf. J. Meyers, « Récit de voyage et littérarité : conception et principes de lectures de l’Evagatorium de frère Félix Fabri (1483) », La littérarité latine, de l’Antiquité à la Renaissance, B. Colot (éd.), Presses universitaires de Rennes, 2019, p. 89-104.
16 J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 471.
17 J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 472.
18 J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 339-340.
19 J. Meyers, « Fabris Latein », Die Welt des Frater Felix Fabri, F. Reichert et A. Rosenstock (éd.), Weißenhorn, Anton H. Conrad Verlag (« Veröffentlichungen der Stadtbibliothek Ulm », 25), 2018, p. 59-74, spéc. p. 73.
20 Cf. J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 304.
21 J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 595.
22 J. Guérin Dalle Mese, Égypte, p. 596.
23 Cf. t. I, p. 63-65.