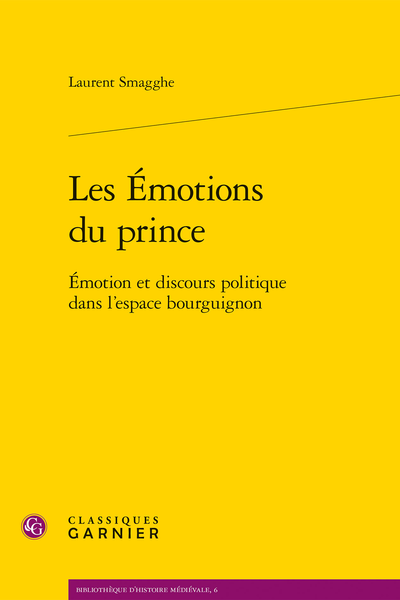
Préface
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Les Émotions du prince. Émotion et discours politique dans l’espace bourguignon
- Auteur : Crouzet-Pavan (Élisabeth)
- Pages : 9 à 13
- Collection : Bibliothèque d'histoire médiévale, n° 6
- Thème CLIL : 3386 -- HISTOIRE -- Moyen Age
- EAN : 9782812443565
- ISBN : 978-2-8124-4356-5
- ISSN : 2264-4261
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4356-5.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 11/06/2012
- Langue : Français
Préface
Au commencement de toute réflexion historique, un peu d’historiographie est de règle. Il faut donc le souligner : lorsque, il y a quelques années, la recherche de Laurent Smagghe fut engagée, les émotions et leurs usages n’avaient pas vraiment encore gagné leur statut d’objet historique. Il existait déjà bien sûr, pour ce qui est de l’histoire du Moyen Âge, les travaux importants de B. Rosenwein. Des recherches étaient en cours ou s’achevaient et, au premier rang d’entre elles, la thèse de D. Boquet. Mais le panorama historiographique était très différent de celui que l’on pourrait aujourd’hui esquisser puisque de ces « practiques » de l’émotion, et de leurs « practiqueurs », pour user d’un terme qui est celui de Commynes, des analyses ont été depuis lors plus souvent menées.
L’ouvrage de L. Smagghe éclaire à cet égard fort bien, et ce dès son introduction, le cheminement historiographique et épistémologique récent. « À n’en plus douter, les émotions ont acquis la dimension d’un objet historique », nous dit la première ligne de ce livre, et on ne peut que souscrire à cette affirmation. Il reste que, plus que pour un autre objet historique peut-être, des considérations historiographiques et des remarques de méthode s’imposent aujourd’hui encore à qui veut s’intéresser aux émotions du prince entendues comme part intégrante de sa rhétorique, du dialogue qu’il noue avec ses entourages ; les émotions comprises comme une forme de communication, un langage et donc un système de sens. L’émotion, écrit justement L. Smagghe, « est pour le gouvernant un passage obligé, comme une didascalie implicite qui apporte un supplément d’âme à l’efficacité de son pouvoir ».
Les premières pages de ce livre justifient donc la méthode mise en œuvre et le choix même du mot « émotions ». Elles expliquent comment la démarche qui avait paru à l’origine de ce travail se dessiner – celle de mener une véritable étude lexicologique – s’est avérée impossible. Elles font comprendre comment, après bien des expérimentations et des lectures répétées des sources, choix a été fait d’opérer une sélection sévère d’émotions et de situations. Ce livre a donc nécessité une maîtrise absolue du corpus des sources privilégiées. Il a fallu sans fin reprendre les
textes, et en particulier l’ample ensemble des sources narratives, souvent écrites directement dans l’entourage des ducs, et d’abord l’historiographie officielle issue des plumes des indiciaires bourguignons, Chastellain et Molinet. Il a fallu lire au plus près pour identifier et saisir les manifestations émotionnelles mais aussi pour parvenir à déchiffrer les procédés discursifs qui étaient à l’œuvre. Une analyse en profondeur a donc été conduite sur la base documentaire au prix d’un travail procédant par des approches successives. Citant M. Yourcenar, L. Smagghe le déclare : la fréquentation de cette matière protéiforme a été longue jusqu’à faire émerger du flou « sous ses paupières fermées » ces émotions acculturées. Autant dire que contre la méthode défendue par d’autres historiens, à l’exemple de N. Pancer, qui est d’entretenir une intimité avec les textes en pratiquant une lecture intuitive et rétrospective, en vue d’y déceler des émotions cachées, contre une démarche qui utilise les affects du lecteur, c’est une autre approche qui a été retenue, celle qui justement refuse d’entretenir un lien passionnel avec les textes pour mieux traquer des gestes, des postures, des mises en écriture, et découvrir dans ces épisodes émotionnels l’expression d’une culture politique.
Décision avait été prise, dès les commencements même ou presque de cette recherche, de ne pas dépouiller de manière systématique certaines sources, à l’exemple des lettres de rémission, pourtant produites en nombre par le pouvoir bourguignon. Le livre de Nathalie Zemon Davies a en effet établi qu’en matière de description des sentiments ces textes ne livrent qu’une rhétorique obligée, un discours se devant d’être efficace et donc convaincant. Il avait été en revanche résolu d’intégrer au corpus un ensemble de sources littéraires. Tout un faisceau de causes expliquait ce choix. D’une part, nos connaissances sur les bibliothèques bourguignonnes ont beaucoup progressé ces dernières années. Il devenait plus aisé de savoir quels avaient été les livres commandés par les ducs, de déterminer les sujets en vogue, tout en gardant présent à l’esprit qu’il n’est pas toujours facile de connaître le poids et l’influence des bibliothèques héritées, le jeu des goûts propres, l’influence des modes. Mais d’autre part, selon les fécondes réflexions de S. Greenblatt, l’hypothèse était aussi de considérer que la société exprime puissamment sa présence dans ce monde fictionnel, comme de montrer que ce monde fictionnel avait pu symétriquement exercer son influence et proposer ses modèles, marquer sa présence dans les pratiques et les comportements. L’intuition était qu’il existait une profonde perméabilité entre ces deux mondes, une perméabilité se traduisant de diverses façons. Par là même, qui étudiait les émotions ne pouvait pas faire l’économie
des manifestations de cette perméabilité. Ces pistes ont été suivies et le livre de L. Smagghe prouve de manière tout à fait exemplaire combien la prise en compte des sources littéraires était féconde pour découvrir le prince en tant qu’« athlète émotionnel ».
Il documente en effet, et c’est un premier niveau de perméabilité, sans doute le plus évident et le plus attendu, comment les données du temps, le monde réel, pénétraient la littérature. À l’exemple du roman de Jean Wauquelin, consacré à Alexandre. L’enlumineur, du moins est-ce la lecture de L. Smagghe, choisirait, pour ne pas faire trop écho au différend qui opposait alors le duc Philippe à son fils, de ne pas représenter de manière trop expressive ou directe la matière du roman, la révolte du fils Alexandre contre son père Philippe. L’artiste opterait à dessein pour une certaine posture d’évitement. Ou bien, il nous est exposé combien Le naufrage de la Pucelle de Molinet est un texte politique. Il s’agit d’illustrer la fragilité de la position de l’héritière de la maison de Bourgogne, la duchesse Marie, même si cette dernière jouit du soutien loyal de la noblesse bourguignonne, même si un aigle (Maximilien d’Autriche) va au total venir la sauver et empêcher que la nef ne chavire. Mais à l’inverse, cet univers culturel littéraire pénètre un récit, riche par ailleurs en références bibliques et antiques, pour venir remodeler ce qui a été, ou plutôt la mémoire de ce qui a été. Et c’est Commynes reconstruisant les événements pour produire de l’émotion. Dans les semaines qui suivent la mort du duc Charles le Téméraire sur le champ de bataille de Nancy (janvier 1477), l’agitation que connaît la ville de Gand se traduit par l’arrestation et la condamnation de deux serviteurs de la maison de Bourgogne, Guillaume Hugonet et Guy de Brimeu, exécutés, le 3 avril 1477, sur la place du marché. On sait que la duchesse Marie de Bourgogne n’assista pas à cette exécution. Il n’empêche. Le mémorialiste fait subir une torsion à la chronologie et aux faits. Il met en représentation la duchesse Marie de Bourgogne sur la place du marché de Gand, plaidant la cause de ses deux ministres, et suppliant selon les règles et les modèles de la supplication au féminin.
Mais la perméabilité, ou la communication, entre le monde de la fiction romanesque et celui du récit des émotions des princes pouvait fonctionner encore autrement. Pour Jean Nicolay ou Philippe de Commynes, pas de doute. Ce sont « les haultes histoires de Romme » qui ont échauffé le tempérament sanguin de Charles le Téméraire et nourri ses rêves de domination. Jean Molinet, dans sa Chronique, nous le montre pareillement second Scipion, grand Hannibal, glaive de
justice, miroir de chevalerie, ne souffrant jamais la peur et donc hardi toujours. Jeu de reflets, dira-t-on, où l’on ne sait plus qui, du héros ou de son mémorialiste, invente les postures et les affects. Les deux sans doute. En effet, loin des reconstructions, et de la prose encomiastique de Molinet, il est attesté que les contemporains, nourris qu’ils étaient des mêmes lectures et des mêmes références romanesques et courtoises, spectateurs des « practiques » du prince, les interprétaient, spontanément ou presque, par le recours à cette matière romanesque. On pense aux paroles un peu ironiques accueillant le duc Philippe après sa colère sylvestre : « Bon jour, monseigneur, bon jour, qu’est cecy ? Faites-vous du roy Artus maintenant ou du messire Lancelot ? Cuidiez-vous qu’il n’y ait nuls messires Tristans qui voisent par chemin et qui vous valent bien ? »
L. Smagghe a donc, on le constate, retenu une approche résolument pluridisciplinaire. Il a emprunté des notions théoriques et un questionnaire non seulement à l’histoire des théories politiques et de la politique ou à l’histoire littéraire, mais aussi aux neurosciences, à l’anthropologie, à l’histoire de la médecine et des représentations médicales, à la philosophie. Une telle méthode lui a permis de mieux définir son objet d’étude mais aussi d’éviter de tomber dans les pièges de l’anachronisme. Ainsi se comprend l’important premier chapitre dédié aux représentations anthropomorphiques et au corps comme métaphore des théories politiques. Le corps est en effet le siège de l’alchimie des humeurs et le lieu où s’effectue l’expression des émotions. Il est aussi l’objet des contraintes que lui applique une abondante littérature morale et pédagogique et, s’agissant de celui du prince, d’une rigoureuse grammaire des comportements. On retiendra par exemple les analyses consacrées à la politisation du discours médical et à la médicalisation parallèle du discours politique, un discours qui recourt au vocabulaire anatomique pour décrire les maux dont souffre le royaume et qui dit comment l’État et le corps naturel obéissent aux mêmes principes de fonctionnement ou de dysfonctionnement. On lira avec le même profit les lignes consacrées aux perthuis du corps, aux yeux, à la bouche dont le contrôle s’impose puisqu’ils sont les lieux d’expression des émotions. Quant aux portraits émotionnels du prince, ils fournissent autant d’éléments utiles au déchiffrement des émotions plus précisément analysées dans les chapitres suivants.
L’auteur donne de la sorte de solides éléments de réponse à l’une des questions de méthode soulevées à bon droit dans l’introduction, celle de la « vérité » des émotions. Sans doute est-ce là en effet une des objections qui pourraient être énoncées à l’encontre de l’histoire des émotions par une
historiographie de type positiviste. Que peut-on percevoir des émotions ? Où est la « vérité » des émotions après qu’a opéré le travail de mise en écriture dans des sources saturées d’intentions ? Or, la quête de L. Smagghe vise à déchiffrer les « practiques » formalisées, la culture du masque et l’art de feindre autant qu’à saisir les comportements ou les manifestations qui s’écartent des règles de la rhétorique émotionnelle. Une large place est par là même donnée à l’économie du courroux princier, un courroux qui est une pratique de gouvernement à condition d’être maîtrisé et, dans tous les cas, manifesté en dernier recours : « Sous peine d’encourir notre indignation ». Il faut donc savoir contrôler la chaleur du tempérament, il faut savoir « user de conseil et de froideur », comme l’illustre très bien la lecture du formidable ratage que constitue l’investiture au titre de comte de Flandre de Charles le Téméraire en juin 1467 à Gand. Le courroux sert à revivifier l’autorité. Mais il faut y céder après avoir exercé tous les moyens de l’éteindre. Il faut être dur à courroucer sous peine autrement de perdre précisément de cette autorité. L’analyse de cette passion masculine et princière culmine dans l’interprétation de l’affrontement dramatique entre Philippe le Bon et son fils Charles de Charolais, à propos des Croÿ, en janvier 1457. Vient ensuite, et ce sont d’autres belles pages, une réflexion plus ample sur les émotions du prince, saisies au jour le jour, le rire mais surtout les larmes. À la question de l’affliction, L. Smagghe s’attache particulièrement et il trouve une situation témoin qui mobilise son attention dans la description faite par Chastellain, plus de quarante ans après les faits, de la réaction de Philippe le Bon à la mort de son père. Le protocole du deuil est analysé et L. Smagghe observe le dialogue des émotions entre le prince et la cour, décrivant le prince souffrant, tombé dans un apparent silence, Philippe tel un gisant pétrifié de douleur, tandis que la cour se lamente, « comme s’ils vissent toute la fabrique du monde finir devant eux ».
Autant de séquences d’analyse dans une démonstration dont la structuration est aussi solide que l’objet considéré pourrait, à l’inverse, sembler à ceux que l’étude des émotions ne convainc pas mobile et insaisissable. Autant d’éclairages, et je cite les mots mêmes de l’auteur, sur les « subtilités de cette communication particulière » du prince, des éclairages qui « font émerger l’émotion du pouvoir et le pouvoir de l’émotion ».
Élisabeth Crouzet-Pavan
Université Paris-Sorbonne