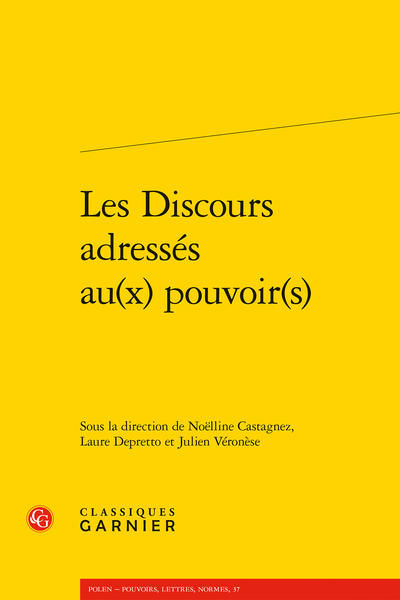
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Les Discours adressés au(x) pouvoir(s)
- Pages : 407 à 413
- Collection : POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n° 37
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406167723
- ISBN : 978-2-406-16772-3
- ISSN : 2492-0150
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16772-3.p.0407
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 22/05/2024
- Langue : Français
Résumés
NoëllineCastagnez, Laure Depretto et Julien Véronèse, « Introduction »
Les discours adressés au(x) pouvoir(s) sont envisagés sous trois angles successifs qui constituent les trois parties de cet ouvrage : l’adresse au Prince, centrée sur la rhétorique délibérative et épidictique et le face-à-face avec le gouvernant ; les formes de la demande (suppliques, requêtes, pétitions), en fonction du régime politique et du type de requérant ; le rôle d’intercession et de médiation des porte-paroles.
Pierre-Alain Caltot, « “Patrivmque aperitvr vertice sidvs”. Mise en scène de la comète de César comme discours adressé au Prince dans la poésie latine augustéenne et néronienne »
Apparue en juillet 44 pendant les ludi consacrés à Jules César, la comète de César (sidus Iulium) constitue une occasion de légitimer le pouvoir d’Auguste. Les poètes augustéens et néroniens consacrent l’événement en motif littéraire dans la bucolique, l’ode, l’épopée et l’élégie et présentent le Princeps en dépositaire de l’héritage des Iulii et de César divinisé. La circulation intertextuelle de ce motif poétique participe ainsi d’un dialogue continu entre poétique et politique.
Emilia Ndiaye, « À Memmius ou Lucilius, à Sisebut ou Richard. Quelques adresses d’auteurs de traités sur la nature à des hommes de pouvoir »
Dans leurs traités sur les choses de la nature, Lucrèce (De la nature), Sénèque (Questions naturelles) puis, au Moyen Âge, Isidore de Séville (De la nature), Adélard de Bath (Questions naturelles) et Guillaume de Conches (Dragmaticon), naturalistes mais aussi moralistes, adressent leur dédicace à un homme de pouvoir. Nous examinerons la fonction pragmatique de ces adresses, avec leurs procédés topiques, et la stratégie utilisée par chaque auteur pour asseoir sa voix auctoriale face au pouvoir.
408Rosa Benoit-Meggenis, « La parrèsia du moine dans l’empire byzantin (viiie-xiiie siècles) »
Notre propos est de montrer que la position spirituelle des moines au sein de la société byzantine les autorisait à s’adresser avec liberté et franchise aux plus puissants personnages de l’armée, de l’administration impériale et au souverain ; les Vies de saint et les chroniques qualifient cette attitude de parrèsia, terme grec déjà attesté dans les sources antiques, qui désigne la familiarité mêlée d’audace que seuls les philosophes pouvaient adopter en s’adressant aux élites.
Karol Skrzypczak, « S’adresser au roi en son absence. La première Justification du duc de Bourgogne et la Proposition de l’abbé de Cerisy (1408) »
La question de l’absence du roi se trouve au cœur des enjeux politiques et juridiques du règne de Charles VI (1380-1422). Le meurtre de son frère, Louis d’Orléans, en 1407, ouvre une polémique dont les deux discours les plus connus, la Justification du duc de Bourgogne et la Proposition de l’abbé de Cerisy, prononcés en 1408 dans le cadre de séances solennelles durant lesquelles le roi, leur destinataire principal, fut absent, constituent des témoins privilégiés des paroles adressées au pouvoir.
Bernard Ribémont, « Du prince défunt (Philippe le Bon) au prince successeur (Charles le Téméraire). L’adresse au pouvoir de Guillaume Fillastre, chancelier de l’Ordre de la Toison d’Or »
La forte personnalité de Philippe le Bon a suscité, après son décès, une série de textes lui rendant hommage et parmi eux, celui de Guillaume Fillastre. Cet hommage présente l’intérêt d’être composé par un « homme du duc », mais qui se trouve dans une position délicate après la mort de Philippe. Son hommage en devient un « chastoiement » pour Charles le Téméraire et est ainsi un témoignage de la transformation du traditionnel planctus en adresse au pouvoir.
Mellie Basset, « Fénelon, conseiller politique du duc de Bourgogne. Étude de la correspondance adressée au prince durant la guerre de Succession d’Espagne »
Cette étude propose d’analyser les lettres écrites par Fénelon au duc de Bourgogne entre le 7 septembre et le 17 novembre 1708 pour lui donner des conseils politiques, militaires, moraux et spirituels. Il s’agit de montrer, à 409travers trois approches (pragmatique, stylistique et rhétorique), que non seulement Fénelon possède l’ethos du parfait conseiller dévoué, mais aussi qu’il met en place une panoplie de stratégies oratoires afin que le prince écoute ses mises en garde.
Laure Depretto, « Écrire en disgrâce. Bussy-Rabutin s’adresse au roi-lecteur »
Les écrits de Bussy-Rabutin s’essaient à toutes les formes de l’adresse au roi, de la plus directe et la plus normée (le placet) à la plus indirecte (le discours à sa famille). Comme actions pour retrouver la faveur, ils ne prévoient pas les lecteurs qu’ils affichent pourtant comme destinataires : ni les enfants, ni la postérité, mais bien le roi. Et pas n’importe quel roi : moins le roi de grâce que le roi-lecteur. Ils témoignent ainsi de l’étroite relation entre mode de publication et signification.
Jeanne-Marie Jandeaux, « Le discours familial auprès du pouvoir royal et de ses représentants dans les dossiers d’enfermement pour correction au xviiie siècle »
Dans la seconde moitié du xviiie siècle, des familles éplorées s’adressent au roi pour le supplier de leur accorder un ordre pour faire enfermer un parent dont la conduite déviante menace leur honneur. Leur objectif est de convaincre et apitoyer le monarque, de démontrer que seule une lettre de cachet peut les sauver. La réception favorable de ce discours dramatique par l’administration royale est contrebalancée par la voix de l’accusé qui s’érige en victime d’un arbitraire familial et royal.
Éric Derennes, « Des femmes interpellent les Chambres en faveur de la duchesse de Berry (1832-1833) »
En 1832, la duchesse de Berry provoqua un soulèvement légitimiste dans certains départements de la France qui se solda par un échec et son emprisonnement à Blaye. Une campagne de pétitions fut aussitôt lancée pour demander sa libération. Parmi les signataires, des centaines de femmes se distinguèrent, notamment à travers des pétitions exclusivement féminines. Au-delà de « faire nombre », elles entrèrent dans le débat politique et affirmèrent une opinion publique genrée autonome.
410Oriol Luján, « Moyens de domination ou d’émancipation ? Une analyse comparée des pétitions adressées au Parlement en France et en Espagne au xixe siècle »
Ce texte examine le langage utilisé dans des pétitions au Parlement des citoyens français pendant la monarchie de Juillet (1830-1848) et de leurs homologues espagnols dans les premières décennies du règne d’Isabelle II (1837-1854). En dépit des limites à la participation politique dans ces pays, il conclut que les pétitionnaires ont utilisé les pétitions pour exiger le respect des droits que la Constitution et les différentes législations leur accordaient.
David Bellamy, « Écrire à l’Élysée sous la présidence de René Coty (1954-1959) »
L’étude du courrier reçu à l’Élysée sous la présidence de René Coty (1954-1959) permet de mieux connaître le rapport entre les citoyens et le chef de l’État avant le passage à une nouvelle République qui modifie profondément la culture politique du pays. Il manifeste que les Françaises et les Français attendent déjà beaucoup du premier magistrat de la République, personnalité éminemment populaire.
Grégoire Le Quang, « Toucher le cœur de l’État. Les lettres adressées au président de la République pendant l’enlèvement d’Aldo Moro (mars-mai 1978) »
L’enlèvement d’Aldo Moro au printemps 1978 ouvre en Italie une période d’incertitude. Les lettres envoyées au président de la République permettent d’entrouvrir une fenêtre sur la manière dont les citoyens ont pu s’impliquer dans cet épisode dramatique. Elles démontrent une variété de stratégies rhétoriques pour s’adresser le plus efficacement possible au chef de l’État, laissant entrevoir une parole singulière et touchante qui tranche avec les représentations publiques de l’Affaire Moro.
Claire Hugonnier et Geneviève Bernard Barbeau, « “Votez contre”, ou quand un mouvement contestataire s’adresse aux pouvoirs étatiques. Le cas du collectif Marchons Enfants ! »
La loi française visant à ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires a soulevé une vague de contestation sous 411la bannière du collectif « Marchons Enfants ! ». Parmi les actions mises en œuvre, les opposants et opposantes écrivent aux personnes qui détiennent le pouvoir d’influencer le processus législatif. Nous nous intéressons aux particularités de cette forme d’expression militante du point de vue des sciences du langage.
Quentin Verreycken, « As moost Cristen prynce whos clemens is to be noted. Tempérer la grâce du roi en Angleterre et en France (xiiie-xve siècles) »
Instrument majeur dans la construction de l’autorité royale en Angleterre et en France à la fin du Moyen Âge, le pouvoir de pardonner est aussi une pratique controversée. Dès le xive siècle, l’octroi régulier de lettres de rémission et de pardon est dénoncé au sein des assemblées représentatives des deux royaumes, ce qui contraint les monarques à promulguer une législation encadrant leur droit de grâce. Il en résulte un dialogue entre souverains et sujets autour de l’exercice du pouvoir royal.
Laurent Bourquin, « Se plaindre au gouverneur. Les requêtes présentées au duc de Nevers pendant les guerres de la Ligue (1589-1594) »
Les requêtes adressées pendant la Ligue au gouverneur de Champagne expriment l’inquiétude des notables qui sont confrontés aux violences de guerre. Elles témoignent aussi d’une exigence de justice, notamment chez les nobles royalistes qui réclament protection et arbitrage. Elles permettent enfin de négocier, voire de contester l’autorité royale à travers son dépositaire. Ce faisant, les requêtes contribuent, avec d’autres outils, à faire évoluer l’espace public à la fin du xvie siècle.
Antoine Ropion, « De la supplique au manifeste public. Les adresses au pouvoir des ouvriers en soie lyonnais (1744-1793) »
À partir d’une sélection de mémoires ou brochures publiés entre 1749 et 1790 par les ouvriers en soie lyonnais, cette étude veut éclairer les conditions de formation et de mobilisation de ce qui est aujourd’hui identifié comme l’« idiome corporatif », en le considérant non plus comme le creuset d’une idéologie, mais avant tout comme une ressource dont la souplesse illustre et favorise la capacité d’adaptation des travailleurs à la perpétuelle et complexe négociation des conditions de travail.
412Pierre Allorant, « Discours adressés aux préfets. Cibles ou médiateurs, de Napoléon à la Libération ? (1800-1945) »
Incarnation de l’autorité de l’État à la tête du département, seul grand corps de hauts fonctionnaires en province avec les ingénieurs des Ponts, les préfets attirent les manifestations de mécontentement, tant contre le régime et le gouvernement en place qu’à l’égard de leur comportement personnel ou de couple : leur vie publique, réceptions, bals et déplacements sont scrutés par l’opinion provinciale.
Erwan Pointeau-Lagadec, « Demander ou s’opposer au changement de statut légal du cannabis par voie de presse. De “L’appel du 18 joint” à “L’appel des 80 parlementaires Les Républicains” (1976-2021) »
En France, l’usage du cannabis est interdit depuis le vote de la loi du 31 décembre 1970. Six ans plus tard, 150 personnalités publiaient dans Libération le premier appel à la dépénalisation du produit, inventant du même coup une tradition toujours vivace : l’interpellation du pouvoir par voie de presse au sujet du statut légal du cannabis. S’appuyant sur l’analyse de 28 requêtes du même type, notre travail entend contribuer à l’étude du débat public sur les drogues en régime de prohibition.
Noëlline Castagnez et Laélia Véron, « Dix “emmurés vivants” de Clairvaux réclament à l’État français le rétablissement de la peine de mort. S’adresser au pouvoir quand on est détenu »
En 2006, une pétition, signée par dix détenus incarcérés à la maison centrale de Clairvaux, fait sensation : elle réclame le rétablissement de la peine de mort. Nous nous proposons, en retraçant l’histoire de la conception, des circulations, des lectures et des réponses de/à sa lettre, d’analyser ce texte comme exemple de l’ambiguïté de la saisie discursive du politique par ceux qui n’en ont, a priori, ni la légitimité, ni la possibilité légale ni les moyens matériels : les détenus.
Nolwenn Duclos, « La question prioritaire de constitutionnalité »
Prévue à l’article 61-1 de la Constitution, la question prioritaire de constitutionnalité peut s’analyser comme un discours du justiciable adressé 413au pouvoir juridictionnel, qui porte sur la violation, par une disposition législative, des droits et libertés que la Constitution lui garantit. Elle est aussi un discours du Conseil constitutionnel qui, lorsqu’il répond à la question qui lui est posée par le justiciable, s’adresse simultanément aux pouvoirs juridictionnel, exécutif et législatif.
Michel Offerlé, « Épilogue. Pourquoi et comment comprendre celles et ceux qui écrivent aux autorités »
Cette synthèse sur les discours d’adresse aux pouvoirs évoque d’abord les questions de méthode, les difficultés du comparatisme, puis s’intéresse aux destinataires, aux contraintes et aux stratégies des acteurs, à la réception des discours par les autorités lisant les requêtes, enfin à leur efficacité politique. Elle propose de nouvelles pistes d’investigation, concernant d’une part le cas de la prière à Dieu, d’autre part des problématiques liées au genre des requérants (gender studies).