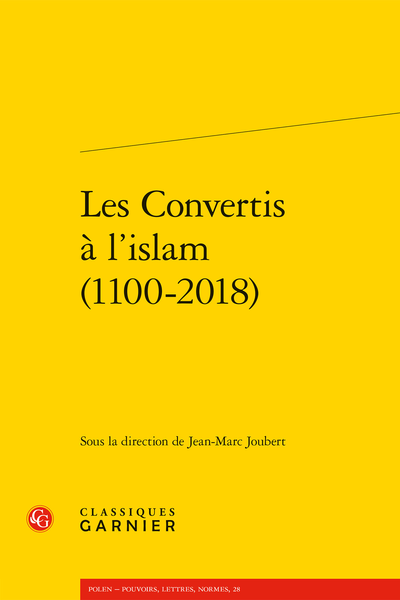
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Les Convertis à l’islam (1100-2018)
- Pages : 227 à 231
- Collection : POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n° 28
- Thème CLIL : 4051 -- RELIGION -- Histoire des religions -- Histoire de l'islam
- EAN : 9782406120285
- ISBN : 978-2-406-12028-5
- ISSN : 2492-0150
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12028-5.p.0227
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 10/11/2021
- Langue : Français
RÉSUMÉS
Jean-Marc Joubert, « Présentation »
La conversion religieuse a quelque chose de fascinant. Quand il s’agit de conversion à l’islam, son retentissement dans le contexte historique et culturel chargé de notre époque lui confère une dimension déjà moins « romantique ». De fait, l’analyse de conversions de types très différents, sur une très longue période (1100-2018), permet de rationaliser définitivement le phénomène pour le penser comme un fait humain relevant d’un certain nombre de lois : affectives, sociales, politiques, etc.
Olivier Hanne, « Mahomet, premier converti, modèle pour la conversion »
Toute conversion à l’islam se doit d’imiter le modèle original du Prophète, qui lui donne sens. Pourtant la conversion de Muhammad/Mahomet est très particulière et inimitable, puisqu’en basculant dans le monothéisme, il a aussi reçu la révélation coranique. Les deux événements sont donc indissociables dans la vie du Prophète. L’analyse des sources disponibles (Coran, Sunna, récits postérieurs) dévoile une évolution dans le statut du personnage et surtout dans la définition de sa conversion.
Paul B. Fenton, « Samaw’al Ibn ‘Abbâs Al-Maghribi, polémiste musulman d’origine juive (ca 1125-1175) »
Samaw’al Ibn ‘Abbâs al-Maghribi fut un des rares convertis d’origine juive à polémiquer contre leur religion antérieure dans son Ifhâm al-yahûd. Utilisant sa connaissance des sources juives, il tenta de convaincre les Juifs d’accepter l’islam en prétendant que leur loi avait été abrogée et falsifiée. Son traité devint un manuel de base pour les polémistes musulmans. Ses arguments furent réfutés dans les écrits de Maïmonide, Sa‘d Ibn Kammuna et des théologiens juifs postérieurs.
228Pierre A. Riffard, « Guénon, entre un islam unique et un ésotérisme universel »
René Guénon, théoricien de l’ésotérisme, est présenté comme un converti à l’islam puisqu’il appartenait à une confrérie soufie dès 1910 et vivait en musulman au Caire dès 1931. Or lui-même nie être converti. Comment est-ce possible ? Il pense en ésotériste. Il se rattache à ce qu’il nomme la Tradition universelle et pérenne. L’islam, dit-il, admet cette Tradition unique et il constitue, comme « sceau de la Prophétie », la « forme ultime de l’orthodoxie traditionnelle pour le cycle actuel ».
Alain Messaoudi, « Du caricaturiste à l’ermite de Sidi-Bou-Saïd. Jossot ou la conversion d’un artiste »
Caricaturiste reconnu, proche des milieux anarchistes, Henri Jossot (1866-1951) annonce en 1913, dans un quotidien de Tunis, sa conversion à l’islam. Il exprime ainsi son refus d’un matérialisme bourgeois et d’une bonne conscience colonisatrice. L’article revient sur le sens de cette conversion, trop vite qualifiée de « conversion d’artiste », et son impact sur l’œuvre de Jossot comme peintre.
Annie Laurent, « Michel Aflak, du panarabisme à l’islam »
Souvent présenté en Occident comme un mouvement laïque, le parti Baas (fondé en 1947), promoteur de l’unité et du nationalisme arabes, accorde une place prépondérante à l’islam. « L’arabisme est le corps dont l’âme est l’islam », selon Michel Aflak, son principal promoteur. Tout en retraçant le parcours politique de cet intellectuel chrétien, diplômé de la Sorbonne, l’article scrute les motifs qui le conduisirent à se convertir à la religion musulmane peu avant sa mort à Bagdad en 1989.
Gilbert Pons, « La conversion à l’islam chez les jazzmen noirs américains »
Durant les deux décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, et même au-delà, un nombre non négligeable de jazzmen noirs américains, quelques-uns parmi les plus notoires, ont abjuré la religion protestante pour devenir musulmans, jusqu’à modifier parfois tout ou partie de leur nom. Quels facteurs ont pu provoquer pareilles apostasies, et ont-elles entraîné des changements notables dans leur musique ? Tel est le propos de cet article.
229Muriel Roiland, « Eva de Vitray-Meyerovitch, le visage intérieur de l’islam »
Chercheuse au CNRS, spécialiste du soufisme, Eva de Vitray-Meyerovitch a voué une grande partie de sa vie à faire découvrir et à apprécier l’islam, celui des grands mystiques musulmans, notamment le poète du xiiie siècle Jalâl al-Dîn Rûmî, dont elle a traduit du persan la totalité de l’œuvre. Catholique dans sa jeunesse, elle devient musulmane au terme d’une longue quête intellectuelle et spirituelle, vécue comme un approfondissement de ses convictions religieuses et de sa vie intérieure.
Sylvie Paillat, « Maurice Béjart, la danse et l’islam. Conversion ou rencontre ? »
Initié à l’islam chiite par le soufi Ostad Elahi, Maurice Béjart se convertit à l’islam en 1973. Il avoue lui-même qu’il préfère les termes de « rencontre » et de « cheminement spirituel » à celui de « conversion », cette dernière impliquant l’abandon d’une croyance au profit d’une autre. Faut-il alors parler de conversion à l’islam ? Pour Béjart, en effet, elle n’est pas rupture, séparation, renonciation à ses anciennes convictions, mais embrassement et convergence dans un seul et même élan vers Dieu.
Adrien Minard, « “Venir à l’islam n’est pas pour moi renier Jésus ni Marx”. La (re)conversion polémique de Roger Garaudy »
Après avoir été le philosophe du PCF, Roger Garaudy est devenu, au début des années 1980, le plus célèbre des intellectuels convertis à l’islam. Sa conversion a fait polémique en France, mais lui a assuré une grande notoriété dans le monde musulman. Pourquoi ce décalage ? Cette conversion est-elle, dans sa trajectoire atypique, un revirement ou un aboutissement ? Cet article examine la cohérence de cet événement biographique en étudiant ses ressorts idéologiques et les réactions qu’il a suscitées.
Charlotte Borie, « Salman Rushdie et l’islam. Aversion, conversion, réversion ? »
Le 14 février 1989, l’Ayatollah Khomeiny prononce l’arrêt de mort de Salman Rushdie, écrivain anglo-indien, auteur du roman Les Versets sataniques, vu par un grand nombre de musulmans comme une insulte contre leur religion et leur prophète. S’ensuit pour Rushdie une tranche de vie faite de traque, d’angoisse et de ressentiment, pendant laquelle il épouse la foi de 230ceux qui le condamnent. Cette conversion, brève puis regrettée, reste dans sa biographie comme un paradoxe insoluble.
Yolène Dilas-Rocherieux, « La conversion de Carlos à l’islam »
Beaucoup s’interrogent sur la conversion du communiste Carlos à l’islam. Pour ce dernier, l’islam serait « le communisme avec Dieu ». Un syncrétisme entre islam et marxisme-léninisme, dont la dimension révolutionnaire serait décuplée par la fusion des cinq éléments nécessaires à l’anéantissement de l’Occident : 1) l’existence d’une avant-garde révolutionnaire ; 2) des combattants prêts au sacrifice ; 3) des masses désespérées ; 4) un ennemi identifié et 5) une orthodoxie religieuse et politique.
Jean Motte Dit Falisse, « Portrait de M. K., Africain, condamné à la peine criminelle, converti à l’islam »
M. K. fut arrêté et placé en détention provisoire à l’âge de 28 ans pour viol, en 2015, puis condamné à la réclusion criminelle. Il ne cessa pourtant de nier toute culpabilité, se présentant comme victime d’une injustice en raison de sa négritude. L’analyse des circonstances de sa conversion à l’islam et des significations qu’il donne à cette dernière dans le contexte de son incarcération ouvrent à une compréhension du sujet, tant d’un point de vue psycho-criminologique qu’ethnoculturel.
Jean-Marc Joubert, « Diam’s, un joyau pour l’islam ? »
La conversion ne répond pas qu’à un mouvement intérieur. Elle s’inscrit dans un contexte qui l’explique, au moins en partie. La conversion est aussi manifestation, revendication, proclamation. En portant témoignage de sa foi, le converti se persuade lui-même en même temps qu’il donne des gages à ses nouveaux coreligionnaires. C’est la nature et l’exemplarité de la conversion de la chanteuse populaire Diam’s que cet article se propose d’analyser.
Alain Le Gallo, « Soumission, ou le confort de l’islam »
Le New York Times affirmait en 2015 qu’il faudrait du temps aux compatriotes de Michel Houellebecq pour ne voir dans Soumission qu’une œuvre littéraire. 231Peut-on cinq ans plus tard, et sans que les circonstances paraissent plus favorables à l’impassibilité, se risquer à une telle lecture ? Elle éviterait pour commencer de confondre narrateur et auteur, tenterait de comprendre pourquoi le premier est prédisposé à se convertir à l’islam, et poserait la question des intentions du second, ironiques ou non.
Jean-Marc Joubert, « En guise de conclusion »
La conversion religieuse à l’islam marque une rupture radicale. Pour autant, est-elle l’expression d’une liberté absolue ou relève-t-elle d’une chaîne complexe de causes ignorées de son auteur ? Comment mesurer son « authenticité » ? Et à quelles logiques le converti se trouve-t-il confronté par rapport à ses communautés d’origine et d’accueil ? Il s’agit de s’interroger sur le statut et la destinée de la conversion à l’islam.