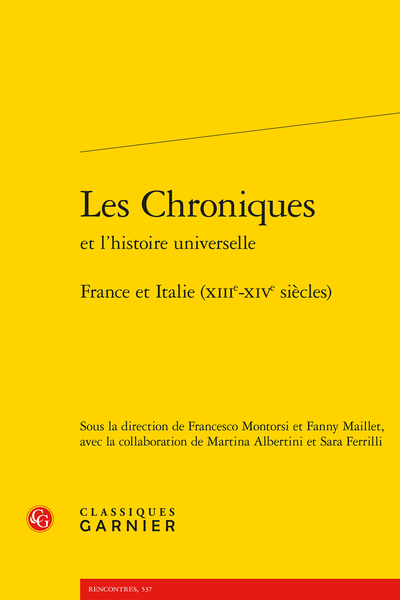
Préface
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: Les Chroniques et l’histoire universelle. France et Italie (xiiie-xive siècles)
- Authors: Montorsi (Francesco), Maillet (Fanny)
- Abstract: Après avoir passé en revue les origines chrétiennes et classiques du genre, la contribution identifie quelques défis majeurs qui attendent les chercheurs qui explorent le champ, encore à défricher, des chroniques universelles en langue vernaculaire.
- Pages: 7 to 13
- Collection: Encounters, n° 537
- Series: Medieval civilization, n° 46
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406119098
- ISBN: 978-2-406-11909-8
- ISSN: 2261-1851
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-11909-8.p.0007
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 12-15-2021
- Language: French
- Keyword: Chroniques universelles, langue vernaculaire, état de la recherche, desiderata, recherches
Préface
Visant à raconter le devenir du monde à partir d’un moment déterminant pour toute l’humanité, l’histoire universelle repose sur une conception globale de la chronologie et des espaces qui s’exprime dès l’Antiquité gréco-romaine dans la pratique historiographique. Celle-ci produit des œuvres majeures, comme la Bibliothèque historique de Diodore de Sicile ou les Histoires philippiques de Trogue Pompée. La première doit attendre les hellénistes du Quattrocento pour être redécouverte, la seconde est transmise à la postérité à travers l’abrégé latin de Justin, qui rencontre au Moyen Âge un succès étonnant.
Si l’aspiration à atteindre une totalité géographique et chronologique est liée, pour les auteurs antiques, à l’existence d’une puissance globale – l’empire de Rome ou celui de Macédoine –, il en va différemment pour la pensée chrétienne. Les Chrétiens adhéraient à l’idée d’une origine commune pour l’humanité issue tout entière d’Adam et Ève, et croyaient de même à l’union ultime des fidèles avec Dieu. L’histoire était la fille d’un projet divin impliquant tous les hommes. Telle qu’elle était et devait être pratiquée par les chrétiens, l’historiographie était toujours une historiographie de l’humanité.
Après les expériences liminaires d’apologètes tels que Julius Africanus ou Hyppolite de Rome, l’Occident reçoit dans l’Antiquité tardive des modèles achevés d’une historiographie moulée dans la vision chrétienne du temps. En traduisant du grec les Canons chronologiques d’Eusèbe, Jérôme met à disposition de nombreuses générations une chronologie détaillée, réunissant histoire profane et histoire sacrée, couvrant le monde habité depuis Abraham. En s’éloignant de la sécheresse chronologique des Canons pour embrasser le style narratif, Paul Orose retrace ensuite l’histoire de l’humanité depuis Adam dans une œuvre qui aura une influence extraordinaire sur les siècles à venir.
Désormais, à l’époque médiévale, tout écrit historique devient, pour reprendre les mots de Jacques Le Goff, un « discours sur l’histoire 8universelle1 ». De Bède à Isidore, de Fréculphe de Lisieux à Hugues de Fleury, de Sigebert de Gembloux à Vincent de Beauvais, en passant par Hélinand de Froidmont, pour ne citer que les plus illustres, la liste est longue de ces historiens qui écrivent une histoire de tous les temps et de tous les lieux. Cela sans compter les innombrables textes qui ne se laissent pas ranger stricto sensu dans la catégorie de l’histoire universelle mais qui ne manquent pas de s’inspirer de sa vision. Grégoire de Tours n’est pas le seul à faire commencer son œuvre par une création du monde et une histoire biblique, déroulant une chronique universelle que, d’ailleurs, les éditions modernes ont parfois pris soin d’escamoter.
Ce geste de censure éditoriale en dit assez sur l’incompréhension qui a accompagné et accompagne encore ces productions de l’esprit. Une méprise qui trouve sa lointaine origine dans la posture des historiens humanistes qui, fiers à juste titre des conquêtes d’une nouvelle méthodologie, dénonçaient sans ménagement la grossièreté et la crédulité de leurs prédécesseurs.
Ce mépris n’a pas été ébranlé par l’érudition du xixe siècle. Confrontés à l’immense tâche de recenser, analyser, éditer la production historiographique du Moyen Âge, les éditeurs de chroniques ont souvent négligé les portions de texte qui n’apportaient pas d’informations originales, pour se concentrer uniquement sur ces parties modernes, parfois réduites, où les informations étaient de première main. Certaines des chroniques publiées par les Monumenta Germaniae Historica ainsi que par d’autres collections nationales ne débutent, pour ainsi dire, que par leur fin, suivant un parti compréhensible dans le contexte de l’époque mais qui ne satisfait plus aux besoins de la recherche2.
Depuis le dernier quart du xxe siècle, et même avant pour certaines figures d’exception3, les historiens et les littéraires ont investi avec un nouvel intérêt le champ des chroniques universelles. Dans les études médiévales, la nécessité de mieux comprendre les dynamiques 9de l’historiographie est désormais chose acquise, en particulier pour ces siècles tardifs du Moyen Âge, dont la production historique est plus abondante mais aussi moins connue.
Forts de ce constat, il est heureux que des événements scientifiques reconnaissent les ferments qui animent la recherche dans ce domaine et en réunissent les acteurs, chaque jour plus nombreux mais aussi souvent isolés. Ainsi, en mai 2019, le Romanisches Seminar de l’université de Zurich a organisé des journées d’étude autour de la chronique universelle dans l’espace italien et français des xiiie et xive siècles. Le présent volume, publié grâce au soutien généreux et discret de Johannes Bartuschat et Richard Trachsler, donne la mesure des échanges qui ont eu lieu lors de ces deux journées.
Des voies diverses ont été parcourues par les chercheuses et chercheurs présents, dont on observe non sans se réjouir que la plupart appartient à la jeune garde des études médiévales. Dans la variété des objets et des méthodes employées, un certain nombre de thèmes indique a posteriori des points nodaux. Sans prétention d’exhaustivité, on citera ici l’analyse des traditions textuelles, la question des modèles, la compilation.
Des trois éléments, le premier est le plus immédiatement évident. Pour mieux comprendre l’écriture de l’histoire aux derniers siècles du Moyen Âge, la recherche doit s’appuyer sur des fondements solides, une cartographie fiable des productions historiques, qui font pour l’heure défaut. Les ressources existantes – du « Potthast » au Repertorium Fontium Historiæ jusqu’à la partie documentaire du Grundriss der romanischen Literaturen, pour ne citer que les principales – ne satisfont pas les exigences élémentaires de complétude et de précision4. Une heureuse initiative comme celle d’Anne Salamon de l’Université de Lanval qui se dédie, à travers le site HU15, au recensement et à la description des chroniques universelles françaises du xve siècle, prêche par l’exemple l’importance d’une campagne de recensement.
Ce recensement devrait s’appuyer sur une identification plus minutieuse du patrimoine écrit. Des chroniques universelles attendent encore 10dans les rayons des bibliothèques de bénéficier d’un inventaire qui viendrait élucider les descriptions laconiques des anciens catalogues5. Dans cette reconstruction de la culture historique dans sa matérialité on n’oubliera pas non plus l’intérêt des recueils manuscrits. Par la copie et la compilation d’ouvrages historiques au sein d’un même témoin, des copistes ont pu créer des recueils qui, par l’extension de leur empan chronologique, constituent de véritables chroniques universelles. Enfin, appliquée à ce domaine littéraire, la philologie précisera le panorama des écrits historiques, tout en l’enrichissant. Il est significatif, en effet, que l’on peine encore à démêler la tradition de certaines œuvres qui, malgré les titres unitaires des manuels, présentent des rédactions divergentes.
On peut souligner à ce propos que la comparaison systématique des témoins est cruciale pour un type d’écrits particulièrement sujet à la mouvance textuelle. Depuis que le genre de la chronique universelle existe, les historiens s’appliquent à continuer la trame laissée en suspens par leurs prédécesseurs. L’énergie qui fait évoluer l’œuvre au fil des rédactions n’exerce pas son pouvoir seulement vers l’avant, suivant cet élan prévisible qui comble l’espace séparant le passé de l’auteur et le présent du lecteur. La chronique universelle peut être complétée, pour ainsi dire, par le haut, en intervenant en amont, en deçà du point de départ. Des copies tardo-antiques de la Chronique d’Eusèbe et Jérôme introduisent des épisodes de l’histoire pré-abrahamique tandis que, plus près de nous, des témoins de la Chronique dite de Baudouin ajoutent des morceaux remontant à la Création6. Des gestes de remaniement peuvent porter sur le noyau narratif. Douée d’une structure modulaire, la chronique se fonde sur une succession d’épisodes pour partie juxtaposés au nom d’une chronologie surplombante. Il devient alors tout aussi facile de prolonger que d’éliminer et remplacer7.
11Fondés sur le principe du remploi textuel, ces procédés d’écriture nous renvoient à un autre thème central pour la compréhension de l’historiographie médiévale, à savoir la pratique de la compilation. Pendant les siècles médiévaux, il est impensable pour un historien d’écrire ex novo une narration sur les temps reculés alors que d’autres récits, composés par des modèles d’éloquence, en traitent déjà8. Dans un monde où l’archéologie et les sciences auxiliaires n’existent pas et où le savoir est essentiellement livresque, l’œuvre sur les temps anciens ne peut qu’être traduction ou reprise. Pour la partie qui précède ce qu’il a pu connaître par lui-même, l’historien est par la force des choses un compilateur. La chronique universelle est donc, si ce n’est pour une moindre portion finale, une vaste compilation.
Les hommes médiévaux ont une parfaite conscience de cet état qui est pour eux la condition normale de l’historiographe. Comme le dit le Ménestrel de Poitiers :
Et bien sache cil qui cest livre lira qu’il n’a rien du mien, ainz est tout des anciens, et de par eus dis je ce que je parole et ma voiz est leur meisme langue9.
Ma voiz est leur meisme langue, définition poétique du travail de l’historien dont la modestie est bien sûr seulement apparente. L’humilité cache la conscience de la profonde valeur d’un travail de mémoire.
Ce serait par ailleurs une erreur de penser que la compilation épuise sa fonction dans le but de communiquer les paroles des ancêtres. Cette activité fondée sur des gestes successifs complexes (sélectionner, couper, rassembler, souder) produit aussi une création qui dépend d’une singularité auctoriale qui se veut unique. Un texte ancien pour sa matière mais nouveau pour sa forme, antiquum certe materia et auctoritate, novum 12vero compilatione et partium aggregatione, comme le dit Vincent de Beauvais à propos de son œuvre10. Et le but de l’historien, qui est avant tout un homme de lettres à cette époque, est aussi d’écrire une œuvre harmonieuse, comme cette chronique compilée « de plusieurs volumes tendans a une fin en l’assemblement de une concordance, ainsi que plusieurs membres font en ung corps et tous ensemble ne sont que ung propre corps11 ».
Aujourd’hui les chercheurs résistent mieux qu’on ne le faisait naguère à la tentation de juger avec suffisance des pratiques qui ont été pendant longtemps l’objet de préjugés. Si la compilation médiévale est désormais mieux éclairée grâce à la compréhension de son ancrage historique, la variété des techniques mises en œuvre n’a en revanche pas encore été évaluée dans toute son ampleur. Dans ce domaine, des différences ont existé entre l’écrit en latin et celui en vernaculaire et il serait du plus haut intérêt de comprendre la nature et la raison de ces écarts.
Dernier point à évoquer, la question des modèles. Le genre de la chronique universelle constitue un rejeton tardif des lettres vernaculaires. En effet, les premiers ouvrages en langue romane qu’on peut dire historiques ont porté sur des temporalités, qui pour être variées, sont toujours particulières. À la fin du xiie siècle et au début du xiiie siècle, période d’éclat pour le genre en latin, les chroniques universelles ne sont cultivées que dans les cathédrales et les monastères12. En se frayant un chemin dans la langue maternelle, comme le remarquait jadis Paul Meyer, ces écrits se sont éloignés de leur matrice latine, pour adopter de nouvelles formes et exprimer de nouvelles tendances13. Un exemple de cette originalité est l’Histoire ancienne jusqu’à César, première chronique universelle en langue romane qui, tout en s’inspirant d’Orose, ne peut être véritablement comparée à aucune autre chronique. L’auteur anonyme lui-même a d’ailleurs ressenti l’audace de son geste lorsque, au seuil de son œuvre, il a écrit :
13Qui la matiere porsivra
e de cuer i entendera
oïr porra la plus haute ovre,
qui encor pas ne s’i descuevre,
c’onques fust en nos lengue traite14.
Donnera-t-on tort à ce clerc abandonnant l’humilité typique du prologue médiéval ? Cette Histoire ancienne est désormais bien connue grâce à de nombreuses contributions, qui en l’espace d’une vingtaine d’année ont profondément modifié l’état de nos connaissances. Or, loin de démentir l’audacieuse revendication de l’auteur, ces recherches semblent au contraire confirmer la singularité de l’œuvre.
Si l’Histoire ancienne est désormais bien mise en lumière, combien d’autres ouvrages restent encore entourés par une relative obscurité ? Face à l’ampleur du champ à défricher, des rencontres comme celles qui se sont tenues à Zurich invitent moins à tirer des bilans, par la force des choses, partiels, qu’elles n’encouragent à poursuivre les recherches. Le travail, n’ayons pas peur des mots, est parfois ingrat, mais les récompenses ne manquent pas. Dans ce domaine pendant longtemps négligé, de nombreuses découvertes attendent les chercheuses et les chercheurs de bonne volonté15.
Francesco Montorsi
Université Lumière-Lyon 2
Fanny Maillet
Université de Zurich
1 Jacques Le Goff, La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Flammarion, 1982 [1964], p. 141.
2 Un exemple parmi d’autres est celui des éditions partielles de la Chronique dite de Baudouin, parues dans MGH SS, t. 25, 1880, p. 419-467 (par Johann Heller) et dans Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. 21, Paris, 1855, p. 159-181 (par Dom Bouquet).
3 Une place de choix va à Anne-Dorothee von den Brincken, Studien zur lateinischen Weltchronistik bis in das Zeitalter Ottos von Freising, Düsseldorf, Michael Triltsch Verlag, 1957.
4 August Potthast, „Bibliotheca historica medii aevi“. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, 2. verbesserte und vermehrte Auflage, Berlin, W. Weber, 1896 ; Repertorium fontium historiae Medii aevi, Romae, Istituto italiano per il Medio Evo, 1962-2011, 11 vol. ; La littérature historiographique des origines à 1500 [GRLMA XI/1], éd. Hans Ulrich Gumbrecht, Ursula Link-Heer, Peter-Michael Spangenberg, Heidelberg, Carl Winter, 1987, 3 vol.
5 Il n’est donc pas rare que le hasard et la ténacité produisent, dans ce domaine, des découvertes, cf. Jeffrey H. Kaimowitz : « A Fourth Redaction of the Histoire ancienne jusqu’à César », Classical Texts and Their Traditions. Studies in Honor of C. R. Trahman, éd. par David F. Bright et Edwin S. Ramage, Chico, Scholars Press, 1994, p. 75-87.
6 Michael I. Allen, « Universal History 300-1000 : Origins and Western Developments », Historiography in the Middle Ages, ed. Deborah Mauskopf Deliyannis, Leiden ; Boston, Brill, 2003, p. 17-42, part. p. 23. Pour la Chronique dite de Baudouin, voir par exemple le manuscrit Gent, Universiteitsbibliotheek, 415.
7 Comme dans la deuxième rédaction de l’Histoire ancienne jusqu’à César, où le bloc sur la guerre de Troie a été remplacé par un autre morceau, équivalent sur le plan du contenu mais à la forme et aux dimensions fort différents. Voir Richard Trachsler, « L’Histoire au fil des siècles. Les différentes rédactions de l’Histoire ancienne jusqu’à César », Transcrire et/ou Traduire. Variation et changement linguistique dans la tradition manuscrite des textes médiévaux, éd. Raymund Wilhelm, Heidelberg, Carl Winter, 2013, p. 77-95.
8 « Roman history had been written by Livy, Tacitus, Florus, Suetonius, the Historia Augusta. There was no reason why it should be written again, because in the main it could be written only as Livy, Tacitus, Florus and Suetonius had written it. », Arnaldo Momigliano, « Ancient History and the Antiquarian », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 13, 1950, p. 285-315, part. p. 291 (passage sur les antiquaires des xve et xvie siècles).
9 Le prologue de cet ouvrage en large partie inédit, mais qui a été repris par les Grandes chroniques de France, est transcrit dans Natalys de Wailly, « Examen de quelques questions relatives à l’origine des chroniques de Saint-Denis », Mémoires de l’Institut Royal de France. Académie des Inscriptions et Belles Lettres, t. 17, partie 1 (1847), p. 379-407, part. p. 405.
10 Anna-Dorothee von den Brincken, « Geschichtsbetrachtung bei Vincenz von Beauvais. Die Apologia Actoris zum Speculum Maius », Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, vol. 34, 1978, p. 410-499, p. 469.
11 Jean de Courcy, Bouquechardière, ms Paris, BnF, fr. 20124, f. 1r-v.
12 Joseph De Ghellinck, L’Essor de la littérature latine au xiie siècle, Bruxelles ; Paris, Desclée de Brouwer, 1946, t. II, p. 93 .
13 Paul Meyer, « Discours de M. Paul Meyer, membre de l’Institut, président de la Société pendant l’exercice 1889-1890 », Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France, 27 (1890), part. p. 82-106, part. 90. L’intervention porte sur l’origine et les premiers développements de l’historiographie française.
14 Le passage est édité dans The Heard Word. A Moralized History, éd. par Mary Coker Joslin, Jackson, University of Mississippi Press, 1986, p. 76, v. 105-109 et The Histoire ancienne jusqu’à César. A Digital Edition, BnF, f. fr. 20125, ed. par Hannah Morcos, Simon Gaunt, Simone Ventura, Maria Teresa Rachetta, Henry Ravenhall, Natasha Romanova et Luca Barbieri, accessible sur le site http://www.tvof.ac.uk/textviewer/ (consulté le 14.04.2021).
15 Le volume publié s’inscrit dans les recherches menées grâce à un subside Ambizione (Écrire les Anciens. Enquête littéraire et historique sur les représentations du passé dans la France médiévale. 1150–1350) accordé par le Fonds national de la Recherche scientifique suisse.