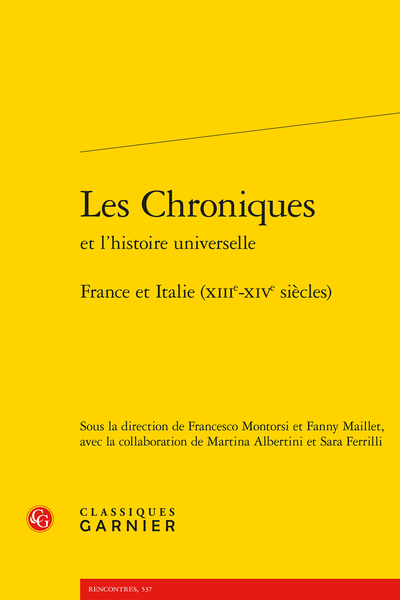
La chronique universelle au miroir de Renart Du Manuel d’histoire de Philippe de Valois à Renart le Contrefait
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Les Chroniques et l’histoire universelle. France et Italie (xiiie-xive siècles)
- Auteur : Fritz (Jean-Marie)
- Résumé : Renart le Contrefait est pour moitié constitué d’une chronique universelle. Si la première partie, en vers, est originale, la seconde, en prose, est la simple interpolation du Manuel de Philippe de Valois. La chronique universelle est présente à contre-emploi ; elle est source de désordres, introduisant de la prose dans le vers, et permet surtout d’opposer deux écritures de l’histoire : une écriture subversive pour l’Ancien Testament, une écriture canonique avec la seconde moitié du Manuel.
- Pages : 17 à 35
- Collection : Rencontres, n° 537
- Série : Civilisation médiévale, n° 46
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406119098
- ISBN : 978-2-406-11909-8
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11909-8.p.0017
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 15/12/2021
- Langue : Français
- Mots-clés : Œuvres, prose, vers, Ancien Testament, réécriture, histoire, tour de Babel, saint Martin
La chronique universelle
au miroir de Renart
Du Manuel d’histoire de Philippe de Valois
à Renart le Contrefait
Renart le Contrefait est l’un des textes les plus surprenants du premier tiers du xive siècle, dans cet âge de transition entre Jean de Meun et Guillaume de Machaut, entre ancien et moyen français, âge sans personnalité dominante, mais qui voit naître deux sommes qu’en apparence tout oppose, Renart le Contrefait donc et l’Ovide moralisé. L’un et l’autre ont en commun leur anonymat à une époque où il est de moins en moins de mise – les deux auteurs avancent masqués, comme l’auteur du Fauvel, mais pour des raisons sans doute bien différentes – et aussi leur démesure : près de 42000 vers pour Renart, 72000 pour l’Ovide moralisé. L’un et l’autre sont des textes-sommes au sens où ils font appel à toute sorte de savoirs et de matières, et à de multiples registres à partir d’un avant-texte bien connu, le vieux Roman de Renart ici, les Métamorphoses d’Ovide là : ils alternent narrations, développements encyclopédiques, gloses allégoriques, discours parénétiques, mais la ressemblance s’arrête là. Alors que l’Ovide moralisé tire sa cohérence et sa continuité de l’hypotexte ovidien qu’il suit et glose pas à pas, livre par livre, mythe par mythe, Renart le Contrefait déconstruit plus qu’il ne construit, déroute le lecteur par cette accumulation de matériaux hétérogènes et de registres hétéroclites, travestit et trahit à l’excès le matériau premier, les différentes branches du Roman de Renart primitif. La seule cohérence réside dans la figure de Renart, qui y devient un intarissable narrateur-orateur, une sorte de Pangloss ; il parle plus qu’il n’agit, il parle de tout, mais pour jeter en définitive le discrédit sur les savoirs et sur le monde lui-même, pour le contrefaire et finalement le défaire.
18Une chronique universelle insérée
Comment s’opère cette amplification jusqu’à la démesure, voire la nausée, de la matière renardienne ? L’anonyme de Troyes n’amplifie pas l’épopée animale elle-même et les aventures du goupil, il en conserve certes quelques scènes saillantes comme la scène du puits ou le pèlerinage de Renart, mais agrège à la trame renardienne toutes sortes de matériaux qui la rendent méconnaissable ou du moins difficilement lisible. L’on peut en distinguer quatre principaux :
–les matériaux encyclopédiques1 ; Renart parle comme un maître ès arts et s’inscrit dans la tradition du Roman de la Rose de Jean de Meun dont on connaît les développements finaux sur les météores ou les illusions d’optique. Le clerc de Troyes semble littéralement fasciné par Jean de Meun et, même s’il ne le cite jamais explicitement, l’on peut repérer au cours du Contrefait de nombreuses réminiscences de détail ou plus larges2 ;
–les matériaux bibliques et théologiques ; les citations scripturaires, tirées surtout des Psaumes et des livres sapientiaux, parfois en latin avec respect de l’octosyllabe3, émaillent le texte et se retrouvent aussi bien dans la bouche du narrateur que de ses personnages ; même Ysengrin au fond du puits allègue tour à tour Cicéron, Salomon et l’Ecclésiastique pour s’adresser à Renart, là où le texte du xiie siècle se contentait de noter sur un ton lapidaire son désespoir4 ;
19–le troisième type de matériaux consiste en narrations, fictions, récits brefs, fables, fabliaux ou exempla de tout horizon, qu’il s’agisse de matière antique (histoire d’Athis et Prophilias ou un dossier Virgile magicien particulièrement bien nourri), matière bretonne (Lais de Marie de France dans la seule première version avec la réécriture misogyne du Bisclavret et du Laüstic, histoire de Caradoc et du serpent) ou de récits biblique ou hagiographique (longue glose narrative de l’histoire de Samson et Dalila, histoire de sainte Marie l’Égyptienne à partir de Rutebeuf), sans oublier les nombreuses références mythologiques plus ou moins développées ;
–enfin et surtout les matériaux historiques : une grande partie de la branche II est constituée d’une chronique universelle entièrement placée dans la bouche de Renart qui s’adresse au Lion, d’abord en 16000 vers pour la période avant Jésus Christ, puis sous forme de prose pour l’ère chrétienne ; le total occupe 176 folios sur les 347 des deux volumes de la rédaction remaniée (ou rédaction B), éditée par Raynaud et Lemaître. Autrement dit, un peu plus de la moitié de Renart le Contrefait est formé par un discours continu de Renart à Noble, rarement interrompu par quelques répliques ou questions du Lion, et ce discours monumental prend la forme d’une histoire universelle. De plus, sur ces 176 folios, 62 sont la pure et simple interpolation d’une des plus importantes chroniques universelles vernaculaires du premier tiers du xive siècle, le Manuel d’histoire de Philippe de Valois. L’histoire et la chronique apparaissent donc comme une excroissance monstrueuse qui dénature le texte, qui cesse d’en faire une épopée animale ; le passé vide le présent de sa substance, le vampirise pour ainsi dire : le narrateur ne parle plus des actions et des ruses de Renart, mais Renart parle des faits et gestes d’Alexandre en 10000 vers. Le présent de la diégèse n’est que l’occasion de parler du passé de l’humanité. Que devient alors une chronique universelle dans ce texte contrefait ?
Il convient d’abord d’analyser comment s’organise cette immense deuxième branche, de très loin la plus importante des huit branches de la rédaction B, telles que les ont isolées les éditeurs modernes. Elle s’ouvre sur des bribes de narration dans la tradition des branches du vieux Roman de Renart. Alors que Tibert invite Renart à se rendre à 20la cour du Lion, la longue ekphrasis du pavillon de Renart, souvenir de la description de la tente d’Alexandre dans les romans du même nom, est une première occasion d’aborder l’histoire : les peintures y représentent successivement les quatre fleuves du Paradis, la prise de Troie, la destruction de Thèbes, la construction de la tour de Babel, le combat d’Hector et d’Achille, les histoires de Joseph et de ses frères, de Médée et de Jason, d’Absalon et de Salomon, de Caradoc et du serpent, le combat de Lancelot et de Méléagant, les plaies d’Égypte5. L’on saisit immédiatement le caractère particulièrement confus et chaotique de ce programme iconographique : on mêle sans ordre histoire biblique et histoire profane, on ne respecte pas la chronologie, les plaies d’Égypte interviennent après Salomon, Thèbes après Troie, on saupoudre le tout avec des fragments de fictions arthuriennes comme le conte de Caradoc, on tronque les épisodes bibliques comme Babel dont on n’évoque bizarrement que la construction, non sa destruction. Alors que l’ekphrasis est normalement l’occasion pour le narrateur de souligner la cohérence d’un savoir (arts du trivium et du quadrivium sur la robe d’Erec à la fin du roman de Chrétien de Troyes) ou l’harmonie du monde (comme la Mappemonde ou les saisons représentées sur la tente d’Alexandre6), elle est ici signe d’un chaos.
Finalement sur l’insistance de Grimbert, Renart se rend à la cour et se lance à la demande du Lion dans l’immense discours qui va occuper 176 folios, soit tout le reste de la branche II, et qui peut se lire comme une chronique universelle contrefaite, qui vise en même temps à retarder le jugement de Renart et sa condamnation. Cette chronique est une manœuvre dilatoire à la manière des récits des Sept Sages de Rome ou de Schéhérazade7. La première partie en vers peut se diviser nettement en trois étapes. Le goupil procède d’abord à un parcours cavalier à travers l’Ancien Testament, depuis la chute des anges et la création du monde jusqu’aux Macchabées (v. 5977-9230) ; sont évoqués le paradis 21terrestre, la chute, Nemrod et la tour de Babel (et cette fois sous l’angle de sa destruction), Abraham, la descendance de Noé, Moïse, David et Salomon. La perspective reste essentiellement biblique ; les parallèles avec l’histoire païenne sont rares, mais l’on évoque longuement des légendes apocryphes comme le voyage de Seth au paradis terrestre ou l’histoire des trois grains déposés dans la bouche d’Adam, d’où sera issu l’arbre dont on tirera le bois de la Croix. Surtout le point de vue est loin d’être toujours orthodoxe : l’hexaemeron est presque esquivé, la création du monde est précédée par la chute des anges rebelles. Une deuxième partie, pléthorique avec ses presque 10000 vers (v. 9231-19186), reprend en détail toute l’histoire d’Alexandre de sa naissance à sa mort ; tout un roman antique est ainsi placé dans la bouche de Renart, vaste insertion romanesque comme l’on a des insertions lyriques dans certains romans en vers ou en prose à partir du xiiie siècle. À la demande du Lion, Renart consacre un dernier développement (v. 19187-22212) aux quatre royaumes antiques selon la typologie d’Orose8 : Babylone, la Grèce, Carthage, enfin Rome avec sa fondation par Romulus, la royauté, la figure de Jules César et le début de l’histoire d’Auguste ; c’est au milieu du règne de ce dernier que se produit le basculement vers la prose.
Du vers à la prose
Pourquoi changer brutalement de forme au cours de l’histoire romaine ? Pourquoi abandonner l’octosyllabe, alors que l’auteur avait pris la peine de mettre en vers la geste d’Alexandre, qui à cette époque s’écrit d’abord en prose9 ? Même si cela n’est pas explicité, le moment n’est pas arbitraire : l’on bascule au cours du règne d’Auguste dans l’ère chrétienne. Le paragraphe en prose initial évoque conjointement les débuts de son règne, 22l’avènement d’Hérode, qui fut fait roy de Judee, et l’accomplissement de la prophétie de Jacob concernant Jhesucrist, qui nasqui de la Vierge Marie10. Autrement dit, l’Ancien Testament est en vers, le Nouveau Testament en prose. Ce basculement était absent de la première rédaction, qui achevait le parcours chronologique jusqu’aux temps présents par des octosyllabes sur une quinzaine de folios11. Pourquoi le choix de cette rupture formelle radicale pour le temps après Jésus Christ ?
Le changement est demandé par Lion, qui interrompt de manière surprenante Renart :
|
Regnart, de cest Octovïent |
22195 |
|
Voeul oÿr l’istore briefment |
|
|
Et des aultres qui sont aprez. |
|
|
Mais je te charge par exprez |
|
|
Que de rymer tu te deportes, |
|
|
Et qu’en prose tu le m’aportes, |
22200 |
|
Car y porras myeulx exprimer |
|
|
Leurs vyes et leurs fais compter |
|
|
Que en rymant tu ne feroyes, |
|
|
Car du langage y perderoyes. |
|
|
Pour ce d’eulx me conte briefment |
22205 |
|
La fin et le commencement. |
|
|
– Sire, puisqu’il vous vient a gré, |
|
|
D’Octovïen vous compteray |
|
|
Et des empereurs qu’aprez furent |
|
|
Avec les fortunes qu’ilz eurent, |
22210 |
|
Et en prose tout meteray. |
|
|
Or escoutez que vous diray. |
1. Le premier empereur qui fu a Romme par ellection aprez Julius Cezar, ce fu Octovïen […].
Plusieurs points sont à relever dans ce bref échange qui interrompt très provisoirement la logorrhée de Renart. La prose apparaît d’abord comme plus adéquate que le vers pour cette histoire récente, elle permet de myeulx exprimer cette nouvelle matière pour reprendre l’expression du Lion ; l’on y retrouve bien en filigrane le lieu commun de la vérité de la prose face à 23la facticité et l’artificialité du vers, topos présent dans le prologue de nombreux textes en prose au xiiie siècle12. Parler en prose, c’est dire la vérité, c’est éviter les feintes du vers ; la prose est la langue de l’histoire, des res gestae, comme le vers le serait de la fiction, des res fictae. La question de la vérité va de pair avec l’exigence de brevitas comme le soulignent les deux occurrences de briefment à la rime : la prose serait plus concise. Mais l’on peut en douter et y voir une pointe d’ironie, car elle va occuper 62 folios, donc près du cinquième de la totalité du texte. Renart n’a finalement que faire des exigences du Lion. L’idée de brevitas peut toutefois être amenée par la chronique en prose qui sera ensuite interpolée et qui se désigne explicitement dans bien des manuscrits comme des chroniques abrégées. Enfin, la dimension subversive du passage est peut-être discrètement suggérée par l’hystéron-protéron au terme des propos du Lion : il s’agira de dire la fin et le commencement, l’oméga avant l’alpha. Renart comme toujours en ce cas se soumet avec docilité aux exigences de Lion et s’exécute : il fait appel à l’expression mettre en prose que l’on peut aussi interpréter par rapport à la rédaction A ; de la première à la seconde rédaction, Renart passe du vers à la prose. Mais il ne s’agit nullement d’un dérimage, le clerc anonyme de Troyes, bien plus paresseux, interpole purement et simplement le Manuel d’histoire de Philippe de Valois, du moins toute la partie concernant l’ère chrétienne, comme l’a montré récemment Laurent Brun13.
Cette partie en prose, bien analysée par Margherita Lecco14, se divise en trois moments : histoire antique, histoire du haut Moyen Âge, puis, à partir du § 118, histoire contemporaine jusqu’à la pendaison de Pierre Rémy, trésorier du roi en avril 1328. Pourquoi avoir choisi cette chronique ? Le Manuel d’histoire de Philippe de Valois, encore inédit sauf pour sa partie très récente15, a été isolé dans la production historiographique vernaculaire par Camille Couderc dans un article paru en 189616 ; il a 24nommé cette chronique universelle Manuel d’histoire de Philippe de Valois, puisqu’il identifie le grand baron de France, commanditaire de l’œuvre dont parle le prologue primitif comme étant le futur roi Philippe VI de Valois, qui monte sur le trône le premier avril 1328. Depuis, André Surprenant, qui est le seul chercheur à s’être réellement intéressé à ce texte, a remis en cause cette identification et propose de revenir à un titre que l’on trouve dans de nombreux manuscrits, Chroniques abrégées ; il voit également dans son auteur un dominicain plutôt qu’un moine de Saint-Denis comme le pensait Couderc17. Certains témoins, comme les BnF fr. 693 ou 1368, nous proposent même un titre plus complet et plus intéressant : Les hystoires et croniques de Vincent abregiees, qui nous livre la source évidente du compilateur, le Speculum historiale de Vincent de Beauvais18.
Ce texte a en tout cas connu une large diffusion (presque une quarantaine de manuscrits conservés19) et se présente sous forme de deux versions, ce qu’explicite très clairement le double prologue de la seconde :
La cause de faire ceste compillacion fu la grant instance d’un grant baron de France, lequel, comme il eust desir de savoir en quel temps avoient esté li prophete Nostre Seigneur et li philosophe des paians, il pria le compileour qu’i li feist aucune oevre la plus brieve que il pourroit, par la quele il pourroit avoir aucune cognoissance des choses dessus dites, ensurquetout la succession des temps et la nessance des royaumes et les faiz plus merveillieus qui sont avenu en divers lieus, des le commencement du monde jusques au temps de maintenant […].
Il est assavoir que puis que le compileour ot ceste oevre compilee et escripte, comme il [l’]ot parleüe, il trouva aucunes estoires trop brievement touchié, lesqueles sont mult merveillieuses et delitables a ouir, si li sembla bonne chose a les y mettre parfectement. Et sont donques les choses qui sont ajoustees en ce livre et ne sont pas ou premier exemplaire, car il fu ravi 25de plusieurs quant il estoit encore es mains de l’escrivain avant qu’il pouist estre corrigiez : toutes les fables* Esope que je ay peu trouver, l’espitre que Abagares li roys d’Edisse envoia a Jhesus Crist [… 22r…], l’estoire d’Amis et Amiles, et plusieurs autres estoires bien beles et curieuses que on trouvera, qui voudra tout le livre lire20.
* ms. flabes
Dans le premier paragraphe, qui constitue le prologue primitif, l’auteur se présente comme un compileour : il n’apporte rien de neuf, mais se contente de reprendre des éléments antérieurs. Le compileour s’oppose au trouvère, comme le suggère le prologue des Croniques de touz les rois de France : « Je ne suis mie feiserres ne trouvierres de cest livre, ainz en sui compillerres, et ne sui fors que raconteres des paroles que li ancien et li sage ont dit21 ». Notre compilateur reste anonyme, mais indique bien ses deux sources principales dans son prologue : Pierre le Mangeur et Vincent de Beauvais. La chronique se construit sur la synopsis traditionnelle entre l’histoire biblique et l’histoire profane, ici avec le couple des prophètes et des philosophes. La matière est précisée : succession des temps, naissance des royaumes et surtout une troisième composante, les merveilles. Cette conjointure de l’histoire et de la merveille est importante : la chronique universelle est aussi dans ce contexte vernaculaire et essentiellement laïc un recueil de mirabilia. L’on retrouve enfin cette exigence de brevitas, que rappelait Lion à Renart ; Renart est un peu à l’image de notre compilateur anonyme, il raconte l’histoire universelle du monde à la demande de Lion, comme le compilateur écrit à la demande d’un grand baron de France.
Le second prologue précise les circonstances du remaniement : la première recension lui a échappé des mains et s’est diffusée sans son accord ; après l’avoir relue de bout en bout (parleüe), il écrit une seconde version en ajoutant des histoires mult merveilleuses et delitables a ouir : on peut noter l’insistance sur l’oralité (on écoute ces histoires plus que l’on ne les lit) ; surtout, il augmente la part du plaisir et de la merveille par rapport à la première version : la chronique universelle ne relève pas simplement du docere, elle doit aussi plaire. L’auteur introduit le 26terme d’escrivain qui complète et ne contredit pas celui de compileour ; il renvoie ici au sens très matériel de celui qui écrit de ses mains, et non au sens moderne d’écrivain-créateur. Il termine par la liste des ajouts, fables d’Ésope (déjà présentes dans le Speculum Historiale de Vincent de Beauvais), matériaux apocryphes comme la correspondance entre Abgar et Jésus (forme particulière de mirabilia) ou l’histoire d’Ami et d’Amile22. La chronique universelle se charge d’histoires, de micro-récits de toutes provenances qui tempèrent le côté austère de la matière.
Si l’auteur de Renart le Contrefait a choisi cette chronique en prose pour achever son histoire universelle, c’est qu’elle présentait à ses yeux plusieurs avantages. En effet, lorsqu’il commence sa réécriture de la première version, en 1328, la chronique de Philippe de Valois vient de paraître (elle s’achève en 1328). Elle lui permet donc de mettre à jour son récit et d’actualiser la matière historique ; de plus, ce Manuel d’histoire de Philippe de Valois sera diffusé très rapidement comme le souligne le prologue ; c’est la chronique à la mode autour de 1330. De plus, le choix de la brevitas exigé par Lion est aussi celui de l’auteur du Manuel : ces chroniques sont constituées de 1400 micro-unités de savoir historique recensées dans des tables alphabétiques qui accompagnent un certain nombre de manuscrits comme en ouverture du BnF fr. 19477. L’approche est à la fois complète et concise ; la sécheresse du propos et des listes dynastiques (la chronique suit classiquement l’ordo temporum et plus précisément la succession des empereurs romains, puis des rois pour la France) est compensée par l’insertion de petites histoires ou récits, même dans la première version ; la lecture en est donc plaisante. L’on s’adresse à des laïcs, peut-être à la cour, plus qu’à des clercs, tout comme Renart cherche à enseigner et divertir la cour de Noble. Citons quelques histoires qui agrémentent la partie interpolée dans Renart le Contrefait : Virgile magicien et ingénieur (§ 3), vie de Second le Philosophe (§ 34), vie de Mahomet (§ 74), nigromance du pape Gerbert (§ 105), histoire de 27la statue de Vénus qui plie son doigt (ancêtre de la Vénus d’Ille, § 117) ; le registre peut se rapprocher du fabliau avec le miracle scatologique de saint Gengoul, qui post mortem fait chanter et sonner hault et laidement le cul de son épouse adultère et homicide (§ 87)23. La forme prose contribue évidemment aussi à briser le déroulement monotone et lancinant des octosyllabes et permet d’introduire de la variété dans le long discours de Renart.
Du vers dans la prose
Cette longue interpolation soulève plusieurs questions. L’on peut d’abord se demander si l’auteur de Renart le Contrefait a mis à contribution la première partie du Manuel pour la partie versifiée. Ce ne semble pas être le cas. Comme le note Laurent Brun, alors que le Manuel écarte délibérément les faiz Alixandre pour la simple raison qu’ils sont mult communs24, Renart se lance à corps perdu dans toute la geste d’Alexandre. La même indépendance se vérifierait au niveau micro-structurel. Prenons le court exemple de Babel, moment essentiel dans toutes les chroniques universelles, puisqu’il est celui de la confusion des langues et de la dispersion des peuples. Renart le Contrefait l’expose ainsi : Dieu
Tous leurs langaiges eschanga,
Et leur parole leur mua ;
Ly ung l’autre n’entandoit,
Estrangé l’un de l’autre estoit :
Quant ly ung demandoit la terre,
28On lui aloit de l’eaue querre ;
L’un fut Alemant, l’autre Angloiz,
L’un Espagnol, l’autre François.
La furent trouvé ly langage,
Dont chascun parle a son usage25.
Le Manuel présente les choses de la sorte :
Et comme adonc il ne fut que .i. language, avant que la dite tour fut faite, Dieu confundi la langue du peuple, c’est a dire Dieu leur donna divers languages par quoy li uns n’entendit l’autre. Et ainsy, quant li uns demandoit de la pierre, l’autre li aportoit du mortier. Ainsy fut celle tour delaissee a faire26.
Dans les deux textes la confusion est présentée comme une décision divine et prend la forme d’un dialogue de sourds, mais cette parenté s’explique par des sources communes, notamment Vincent de Beauvais27. Renart – et donc le vers – est de fait bien plus bavard, qui actualise la scène en rajoutant une liste de langues vernaculaires : allemand, anglais, espagnol… Babel n’est pas un évènement du passé, il se vit au présent dans l’espace européen. La confusion va surtout de pair avec une trouveure : la perte est comme compensée par le fait que l’on trouve les langues à cette occasion.
Une autre question est celle de la part d’innovation de l’interpolateur : l’auteur de Renart le Contrefait intervient-il sur le texte interpolé ? L’adapte-t-il au cadre renardien ? La réponse est ici bien plus complexe et doit être nuancée en l’absence de toute édition du Manuel de Philippe de Valois. La tradition manuscrite n’a guère été étudiée depuis l’article pionnier de Camille Couderc et André Surprenant a certes proposé une analyse méticuleuse du Manuel, de son organisation et de ses sources, mais à partir du seul manuscrit BnF fr. 19477, un témoin de la seconde version28. Si l’on compare ce manuscrit au texte de Renart le Contrefait, force est de constater les écarts importants. Et la collation de manuscrits de la première version (BnF fr. 2128, BnF fr. 1406, BnF fr. 24910) montre qu’aucun ne recoupe complètement le déroulement du Contrefait, qu’il 29s’agisse de détails ou d’items entiers29. Faut-il interpréter ces divergences comme le signe d’une liberté de l’anonyme de Troyes par rapport à son modèle ? Ou que son modèle reste à retrouver ? La question est complexe, car, au-delà des deux versions, le Manuel, comme toute chronique universelle, est un texte souple et malléable ; on peut non seulement insérer ou supprimer tel ou tel item historique ou développement narratif, mais aussi abréger ou allonger tel ou tel règne. Marie-Madeleine Huchet a bien analysé comment le Manuel interpole la traduction partielle de deux traités latins de Jean Quidort, le De antichristo et le De adventu Christi qui figurent ainsi dans la prose de Renart le Contrefait (§ 6-7 pour le premier et § 8-13 pour le second). Catherine Gaullier-Bougassas avait remarqué l’absence du développement astrologique du § 10 (à partir de la citation des vers du De vetula) au § 13 dans le BnF fr. 1947730. Cette absence est en fait commune à toute la seconde rédaction, mais aussi à une partie de la première31 ; le passage est de fait bien présent dans un manuscrit du Manuel comme le BnF fr. 2128 (f 37vo – 41vo) ; le clerc de Troyes reste ici un compileour32.
Il prend pourtant son indépendance dans les quelques passages qui marquent le retour au vers. Le premier intervient autour des règnes d’Hadrien et d’Antonin (§ 36 et 37). Le clerc de Troyes suit le Manuel pour le règne d’Hadrien, évoqué en parallèle avec l’histoire de Second le Philosophe et les réformes liturgiques du pape Télesphore (§ 33-35 jusqu’à chantast en la messe), puis l’abandonne, avant de reprendre le fil de sa source au début du § 37, avec la mention de 30la mort d’Hadrien33. La partie ajoutée (fin du § 35 et tout le § 36) semble particulièrement maladroite, puisqu’elle évoque à l’intérieur du règne d’Hadrien celui d’un empereur Galien, qui était aussi moult notable fisicïen (§ 35). L’auteur confond le médecin Galien, que les chroniques universelles situent sous Antonin34, et l’empereur Gallien qui a régné plus tard, au iiie siècle. Renart y évoque la clergie de l’empereur-médecin et sa détestation de la chevalerie qu’il cherche à anéantir : « Icil empereur mist fort son entente a parler gregoiz et latin et avoit ceste nature qu’il haioit chevalerie et mettoit toute sa cure a le destruire », avant de lui donner la parole sous la forme d’octosyllabes :
Or est ce vray, combien me semble,
Chevalerie et paix ensemble
Ne seront ja bien hostellé
Ne qu’orgoeul et humilité,
Ne ja paix avec gentillesse,
Ne point scïence avec noblesse35.
Renart s’immisce dans le Manuel de Philippe de Valois et le pastiche habilement en imaginant le portrait d’un empereur-clerc hostile à la chevalerie et en ajoutant quelques vers de son cru sur le vieux débat entre clergie et chevalerie. Ces vers annoncent quelques lignes plus loin une rupture plus évidente dans la compilation, tout en rappelant la dénonciation de la chevalerie, vue comme une corporation d’assassins, à propos du règne de Ninus36 ; après un bref paragraphe sur la trans31mission de l’empire d’Hadrien à son gendre Antonin, Renart évoque le médecin Galien et en profite pour renouer avec l’octosyllabe et rétablir le contact avec son auditoire, tout en lançant contre la médecine une critique que partage le roi Noble :
Encores vivoit en ce tempz Galien qui estoit bon phisicien, qui fist pluseurs beaulx livres de sa science, dont pluseurs a present usent.
Sire, mon voulloir est que dye :
Trop croire phisique est folye.
– Certes, Regnard, tu as dit voir
[…].
– Cest Anthoine que je vous dis
En la main Galïen fu mis37.
Renart déchire provisoirement le voile de la chronique et donne en vers son point de vue sur la médecine, rappelant aussi au lecteur que cette chronique relève d’une performance orale devant la cour.
Le second retour de la rime est bien plus long et concerne saint Martin. Le Manuel n’évoque le célèbre saint qu’en un très court paragraphe, entre la notice sur Ambroise de Milan, introducteur du chant dans l’Église, et celle sur Barlaam et Josaphat ; un peu comme pour Alexandre, sa vie semble au chroniqueur trop connue pour être relatée38. Renart ne peut se contenter de cette ellipse. Il commence son hagiographie en prose, puis au bout de quelques phrases glisse au vers (Nous en traiterons ung petit en ryme) : il relate en 180 vers la scène canonique du manteau partagé (tout en la déplaçant d’Amiens à Tours), l’accession de saint Martin à l’épiscopat et surtout l’épisode fantaisiste de la mère incestueuse à qui il pardonne son lourd péché39. Le retour au vers est ici une manière pour 32l’auteur / Renart de signer son exposé : il ne compile plus, mais trouve, voire invente un nouvel épisode de la vie de saint Martin. L’octosyllabe fonctionne une fois de plus comme une signature.
Le vers fait une ultime apparition au terme de notre chronique universelle, assurant ainsi discrètement la transition vers la branche III et le retour définitif aux couplets d’octosyllabes40. On sait combien il est difficile d’assigner une fin à une chronique universelle, elle est par nature un genre in-fini : elle s’achève avec les événements contemporains de l’auteur, mais libre aux copistes de prolonger et d’actualiser leur texte à partir de chroniques plus récentes. Le Manuel de Philippe de Valois n’échappe pas à la règle et la plupart des manuscrits se prolongent au delà de 1328 et de l’accession au trône de Philippe de Valois, allant jusqu’en 1339, 1347, 138341 … Le BnF fr. 19477, que l’on cite le plus souvent depuis Couderc, présente l’intérêt d’être un témoin ancien (il a de plus fait partie de la librairie de Charles V), sans continuation, même s’il s’agit de la seconde version. Il s’achève sur la mort de Charles IV et l’accession au trône de Philippe de Valois, lequel regne a present42. Renart le Contrefait ne s’arrête pas là, il prolonge l’histoire par Pierre Rémy, trésorier du roi, accusé de malversation, qui sera pendu au gibet de Paris le 25 avril 1328, quatre semaines après l’accession au pouvoir de Philippe VI. Cet événement, qui revient de manière obsédante dans le Contrefait43, se veut exemplaire des jeux de Fortune et donne lieu à trois brèves insertions versifiées :
–un distique cliché sur Fortune : Qui plus hault mont qu’il ne doit / De plus hault chiet qu’il ne vouldroit ;
–un second distique noyé dans la prose par Raynaud et Lemaître : Et puis si povrement fenir / Et si honteusement morir ;
33–enfin une citation de saint Paul (I Co 7, 24) sous forme de quatrain à rimes croisées, puis d’un sizain en couplets séparé par une citation latine d’Isaïe (30, 21) :
Qui voeult estre de Dieu amys
Et soy a droit a lui vouer,
Cellui estat ou Dieu l’a mis
Il doibt tenir sans desvoier.
Hec via ambulate in ea, etc.
Iceste est bien de Dieu la voye ;
Qui la tient point ne se desvoye.
Or lui prions qu’il nous y tiengne
Et en s’amour tousjourz maintiengne,
Par quoy puissons si bien fenir
Qu’en sa glore puissons venir !
Amen !
Que penser de cette fin édifiante ? Ultime pied de nez, Renart achève sa chronique en prédicateur. Mais est-il ici encore un compileour ou un trouvère ? Cet épilogue versifié est de fait présent dans de nombreux manuscrits de la première version du Manuel et pourrait en constituer la clôture primitive44. Il permet en tout cas à l’auteur du Contrefait de clore habilement la branche II. On a souvent vu de la maladresse dans cette conclusion abrupte, qui, à la différence de la première version45, ne fait même pas retour vers la fiction renardienne et la cour de Noble. Mais cette conclusion empruntée présente bien des avantages : elle permet d’abord le retour discret vers le couplet d’octosyllabes ; elle nous livre surtout une leçon sur Fortune et sur la fin de l’histoire : l’histoire ne s’achève pas sur l’accession au trône de Philippe de Valois comme dans la deuxième version du Manuel, mais sur une pendaison, celle du trésorier du roi. L’Histoire ne s’achève pas sur le Jugement dernier (malgré l’ultime octosyllabe), mais sur un jugement tragique et bien humain. Si Pierre Rémy est condamné, parce qu’il « ne respondy pas souffisanment aulx articles propposees contre lui », Renart lui, par son 34immense chronique universelle, a souffisanment répondu au roi et à la cour. Il évitera le sort de Pierre Rémy et pourra continuer de prendre la parole dans les 20000 vers qui forment les branches ultérieures du roman.
Concluons sur deux points, et d’abord sur l’importance du Manuel de Philippe de Valois : il va permettre à côté de la traduction de Jean de Vignay la diffusion vernaculaire du Speculum historiale46 ; il sera donc mis à contribution par l’auteur de Renart le Contrefait, avant d’être repris dans les nombreuses compilations de la fin du Moyen Âge qui, sous le titre de Fleurs des Chroniques ou Tresor des Histoires, l’associent aux Flores chronicorum de Bernard Gui ou à la Chronique de Baudouin d’Avesnes47. De plus, fait notable, ce Manuel sera, comme l’a déjà été la Chronique de Baudouin d’Avesnes, traduit, on pourrait presque dire retraduit en latin avec nouvel abrègement, plus tard, vers 1395 par Guillaume Saignet, jeune étudiant en droit à Avignon, avant de devenir homme de confiance de Charles VII48. Le Manuel se présente donc comme un texte à usages multiples, modulable, adaptable ; son matériau est souple jusqu’à se retrouver, amputé de sa première moitié, dans une épopée renardienne. Revenons enfin à Renart le Contrefait : la branche II est la plus déroutante par sa démesure (elle est plus vaste que la somme des sept autres branches), par cette insertion de la prose dans le vers, par cette mise en performance insolite d’une chronique universelle à la cour de Noble, qui plus est, placée dans la bouche de Renart. La paresse de l’auteur anonyme ne saurait être une explication convaincante ; il semble jouer de l’antinomie entre l’art de Renart et l’esprit même de la chronique. La chronique universelle repose en effet habituellement sur une continuité, sur des filiations, des généalogies, des listes (d’empereurs, de rois, de papes …), ce n’est pas par hasard qu’elle peut s’inscrire sur des rouleaux49 ; elle est un discours du continu. Or le discours de Renart clive, scinde, 35segmente : le personnage est fondamentalement diabolos, « celui qui sépare » (du grec diaballein, « séparer »). La chronique universelle est ici présente à contre-emploi : elle introduit du désordre plutôt qu’elle établit une continuité, elle introduit comme par effraction de la prose dans le vers, puis des bribes de vers dans la prose. Elle permet surtout d’opposer deux écritures de l’histoire : une écriture subversive, contrefaite, voire hétérodoxe pour l’Ancien Testament, puisque Renart élude l’hexaemeron et commence par évoquer la chute des Anges rebelles, affirmant haut et fort que son art ou engin précède la Création ; une écriture canonique et orthodoxe avec la seconde moitié du Manuel de Philippe de Valois ; le contraste formel – vers versus prose – est aussi un contraste registral et idéologique. Et ce contraste se résout finalement dans la fonction ultime de cette double logorrhée de Renart : celle d’un alibi qui doit permettre à Renart d’éluder le jugement de la cour de Noble. L’histoire s’achève sur la mise à mort de Pierre Rémy, le trésorier du roi ; c’est ce destin bien réel que Renart veut éviter dans la fiction du récit.
Jean-Marie Fritz
Université de Bourgogne
1 Notamment l’Image du Monde de Gossuin de Metz et le Tresor de Brunet Latin : voir Silvère Menegaldo, « Histoire universelle, histoire individuelle : à propos des relations entre Renart le Contrefait et le Livre du Trésor de Brunetto Latini », Le miroir de Renart. Pour une redécouverte de Renart le Contrefait, éd. Craig Baker, Mattia Cavagna, Annick Englebert et Silvère Menegaldo, Louvain-la-Neuve, Institut d’Études Médiévales, 2014, p. 53-70 et Craig Baker, « Hubert de Milan et Gossuin de Metz : les emprunts à l’Image du Monde dans Renart le Contrefait (br. vii) », ibid., p. 73-93.
2 Voir Pierre-Yves Badel, Le Roman de la Rose au xive siècle. Étude de la réception de l’œuvre, Genève, Droz, 1980, p. 226-259.
3 Voir Le roman de Renart le Contrefait, éd. par Gaston Raynaud et Henri Lemaître, 2 vol., Paris, Champion, 1914, t. II, v. 25778-25782.
4 Renart le Contrefait, éd. citée, t. II, v. 28227 sq. L’auteur du récit du xiie siècle note simplement que « Ysengrins est en male trape » (Le Roman de Renart, éd. sous la direction d’Armand Strubel, Paris, Gallimard [« Bibliothèque de la Pléiade »], 1998, p. 174, Br. Va, v. 443).
5 Renart le Contrefait, éd. citée, t. I, v. 3759-4490.
6 Voir Alexandre de Paris, Le Roman d’Alexandre, éd. Laurence Harf-Lancner à partir du texte édité par E.C. Armstrong, Paris, Le Livre de Poche (« Lettres Gothiques »), 1994, branche I, laisse 95-96.
7 Voir Laurent Brun, « Maistre Regnart, enseignant et moraliste ? Renart le Contrefait et son contexte littéraire », La moisson des lettres. L’invention littéraire autour de 1300, éd. Hélène Bellon-Méguelle, Olivier Collet, Yasmina Foehr-Janssens et Ludivine Jaquiéry, Turnhout, Brepols, 2011, p. 291-305 (p. 299-300).
8 Renart se présente explicitement comme un lecteur d’Orose (v. 19239).
9 La source de ce roman d’Alexandre est la version J2 de l’Historia de praeliis, revue à partir de l’Alexandre en prose, comme l’a déjà noté Alfons Hilka dans son compte-rendu de l’édition de Raynaud et Lemaître (Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, 46 (1923), p. 238-241).
10 Renart le Contrefait, éd. citée, t. I, p. 227, § 1.
11 Le texte figure en appendice du premier volume de l’édition Raynaud/Lemaître (p. 344-367). Renart n’y fait appel à la prose que pour donner la liste en latin des villes conquises par Charlemagne (p. 354-355).
12 Voir Emmanuèle Baumgartner, « Le choix de la prose », Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 5 (1998), p. 7-13.
13 Voir Laurent Brun, « Maistre Regnart, enseignant et moraliste ? », art. cité, p. 301-303.
14 Margherita Lecco, « La parte in prosa di Renart le Contrefait : composizione e ipotesi di scrittura », Le miroir de Renart, op. cit., p. 39-51.
15 Voir Joseph-Daniel Guigniaut et Natalis de Wailly, « Fragment d’une chronique anonyme finissant en 1328 et continuée jusqu’en 1340, puis jusqu’en 1383 », Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XXI, Paris, Imprimerie Nationale, 1855, p. 146-158 (cette édition correspond aux § 147-164 de Renart le Contrefait).
16 Camille Couderc, « Le Manuel d’histoire de Philippe VI de Valois », Études d’histoire du Moyen Âge dédiées à Gabriel Monod, Paris, Cerf/Alcan, 1896, p. 415-444.
17 André Surprenant, « “Unes petites croniques abregees sur Vincent” : nouvelle analyse du manuel dit “de Philippe VI de Valois” », Vincent de Beauvais : intentions et réceptions d’une œuvre encyclopédique au Moyen Âge, éd. Monique Paulmier-Foucart, Serge Lusignan et Alain Nadeau, Paris, Vrin, 1990, p. 439-465 ; nous n’avons pas pu consulter son ouvrage Le « Manuel d’histoire de Philippe VI de Valois » et le « Speculum historiale » : relevé d’une lecture parallèle, Montréal, Institut d’études médiévales – Université de Montréal, 1988. Nous conservons toutefois le titre traditionnel de Manuel de Philippe de Valois, moins ambigu que Chroniques abrégées, qui peut s’appliquer à d’autres chroniques universelles.
18 Voir l’article de Laura Endress dans ce volume.
19 Voir la liste la plus récente dans Marie-Madeleine Huchet, « La diffusion de deux traités de Jean Quidort de Paris en ancien français : du Manuel d’histoire de Philippe de Valois au roman de Renart le Contrefait », Romania, 132 (2014), p. 412-427 (p. 416-417).
20 BnF fr. 19477, f. 21vo-22ro (manuscrit de la version II).
21 BnF fr. 2815, f. 1vob ; sur cette chronique voir Marianne Ailes, « Chronique anonyme des Rois de France finissant en 1286 », The Encyclopedia of the Medieval Chronicle, éd. Graeme R. Durphy, 2 vol., Leiden, Brill, 2010, t. I, p. 296.
22 Voir l’édition de Brian Woledge, « Ami et Amile. Les versions en prose française », Romania, 65 (1939), p. 433-456 (p. 444-452, édition du passage à partir du manuscrit de Toulouse, Bibliothèque municipale, 452 avec les variantes du BnF fr. 15219). Dans la première version du Manuel, et donc dans Renart le Contrefait, l’on a une simple allusion à cette légende épique (éd. Raynaud/Lemaître, p. 264, § 90). Même remarque pour Abgar (ibid., p. 245, § 42) ; les manuscrits de la seconde version du Manuel présentent ainsi assez maladroitement le contenu de la correspondance d’Abgar et de Jésus (BnF fr. 19477, f. 78vo-79ro) avant de revenir plus loin dans le § 42 à Abgar et Edesse (BnF fr. 19477, f 101rb avec renvoi en marge : Ceste espitre est ci dessus).
23 Le passage n’est pas une invention du clerc de Troyes ; le motif scabreux de l’anus sonans figure bien dans les deux versions du Manuel de Philippe de Valois (Version I : BnF fr. 2128, f 79vo et Version II : BnF fr. 19477, f 135vo – 136ro) et, en amont, dans les Vies latines (prose anonyme et vie métrique de Hrotsvita) : voir Monique Goullet, « Les Vies de saint Gengoul, époux et martyr », Guerriers et moines. Conversion et sainteté aristocratiques dans l’Occident médiéval, éd. Michel Lauwers, Antibes, Éditions APDCA (« Collection d’études médiévales de Nice », 4), 2002, p. 235-263 [p. 242] et l’édition récente du corpus latin avec traduction allemande de Paul Dräger, Das Leben Gangolfs, Trèves, Kliomedia, 2011. Garin, auteur du fabliau du Chevalier qui fist parler les cons, avait peut-être à l’esprit ce récit hagiographique.
24 Voir Laurent Brun, art. cité, p. 303.
25 Renart le Contrefait, éd. citée, v. 8113-8122.
26 Manuel de Philippe de Valois, BnF fr. 2128, f. 2vo.
27 Voir Jean-Marie Fritz, « Dialogues de sourds : Babel, Pierre de Beauvais et l’Ovide moralisé », Fleur de clergie. Mélanges en l’honneur de Jean-Yves Tilliette, éd. Olivier Collet, Yasmina Foehr-Janssens et Jean-Claude Mühlelthaler, Genève, Droz, 2019, p. 597-612.
28 André Surprenant est bien conscient de cette limitation (art. cité, p. 439-440).
29 Manquent par exemple dans le BnF fr. 2128 les martyres de saint Denis et de saint Jean l’Évangéliste (§ 30), le règne de Sévère Alexandre (§ 42), celui de Dioclétien (§ 47), etc. Le chiffrage précis du Manuel qui permet de dater la rédaction du texte en 1327 à partir de la conquête saxonne de l’Angleterre (335 + 992) et figure dans la plupart des témoins (voir Couderc, « Le Manuel d’histoire de Philippe VI de Valois », art. cité, p. 423-424), est sans doute volontairement écarté par le clerc de Troyes (Renart le Contrefait, éd. citée, p. 285a, § 133).
30 Catherine Gaullier-Bougassas, « Les sciences orientales selon Renart dans Renart le Contrefait : astronomie, astrologie et magie, entre l’affirmation de la foi chrétienne et le détournement maléfique du savoir », Le miroir de Renart, op. cit., p. 95-116 (p. 103-104).
31 Marie-Madeleine Huchet, « La diffusion de deux traités de Jean Quidort », art. cité, p. 416-417.
32 Tout ce passage (éd. Raynaud/Lemaître, p. 232b après les vers latins – 235b) est en fait une interpolation au quatrième degré : Renart le Contrefait interpole le Manuel, qui traduit le latin du De adventu Christi de Jean Quidort, qui lui même avait interpolé un petit texte astrologique de Roger Bacon.
33 Version I, BnF fr. 2128, f. 51vo : « [quasi-fin du § 35] … et ordena que on le chantat a la messe. Aprez la mort Adrien fut emperor Anthoyne le Debonnaire qui regna .xxii. anz. On temps Anthoyne nulle persecucion ne fu. Aprez sa mort tint l’empire Marque Aurele Anthonins qui regna .xix. ans [début du § 38] » ; même ellipse dans BnF fr. 24910, f. 31voa et BnF fr. 1406, f. 58vo. Version II, BnF fr. 19417, f. 98roa : « …et ordena que on le chantast a la messe. De l’empire Anthoine le Debonnaire. Aprés la mort Adrian fu empereur Antonins le Debonnaire qui regna .xxii. ans. De Galian le phisician. U temps duquel fu Galians, un vailliant phisicien. Cil Galians exposa Ypocras et fist mains livres de medicine. U temps Antonins nule persecucion ne fu. De l’empire Marques Aureles et de la persecucion qui fu a Lyons. Aprés sa mort tint l’empire Marques Aureles » (texte proche dans Toulouse, BM, 452, f. 39rob).
34 Voir Vincent de Beauvais, Speculum historiale, X, 92, éd. Douai, 1624, p. 400b.
35 Renart le Contrefait, éd. citée, p. 244b ; curieusement les éditeurs ne numérotent pas ces vers insérés dans la prose.
36 Renart le Contrefait, éd. citée, v. 8211-8346.
37 Renart le Contrefait, éd. citée, p. 244, § 37 ; ces 12 vers sont par contre numérotés (= v. 22213-22224).
38 BnF fr. 2128, f. 60ro : « Car devant (avant Ambroise), en Ytalie et en Galle, qui a present est appellee France, et en toutes les esglises d’Occident, on les (= les services de l’église) disoit sanz chant. En cely temps fut saint Martin evesque de Tours qui fu de si grans merites comme chascun scet. En cely temps avint ce que l’istoire Barlaam et Josaphat raconte […] », texte très voisin dans le BnF fr. 19417, f. 109vob. Nous soulignons. Vincent de Beauvais évoquait par contre longuement la vie de saint Martin (Speculum historiale, XVII, 10-19).
39 Renart le Contrefait, éd. citée, p. 253-255, § 55. L’épisode de la femme incestueuse a tout d’une invention du clerc de Troyes. Il est en tout cas absent des Vies latines (Sulpice Sévère, Paulin de Périgueux et Venance Fortunat) et de la vie romane du xiiie siècle due à Péan Gatineau de Tours (Das altfranzösische Martinsleben, éd. par Werner Söderhjelm, Helsingfors, Wentzel Hagelstam, 1899). Il illustre le sens extrême de la compassion dont parle après d’autres Jacques de Voragine à propos de saint Martin (« Grande fut la compassion qu’il témoignait aux pécheurs, car tous ceux qui voulaient se repentir, il les recevait dans le sein de sa compassion, en vue de la pénitence », La Légende dorée, trad. sous la direction d’Alain Boureau, Paris, Gallimard [« Bibliothèque de la Pléiade »], 2004, p. 924).
40 Renart le Contrefait, éd. citée, p. 297, § 164.
41 Voir Couderc, « Le Manuel d’histoire de Philippe VI de Valois », art. cité, p. 437-438.
42 Cela correspond à la quasi-fin du premier paragraphe du § 164 de l’édition de Renart le Contrefait.
43 Pierre Rémy est évoqué un peu plus haut dans la prose (§ 159, p. 295). Il apparaît dès la branche I (v. 2921-2944) et se retrouve mentionné dans les branches III (v. 23228), IV (v. 23456, 25606, 27209, 27753) et VI (v. 30925).
44 Voir l’édition citée de Guigniaut et Wailly, dans le tome 21 du Recueil des historiens des Gaules et de la France, qui s’achève bien sur ces vers et s’appuie sur quatre manuscrits de la première version (BnF fr. 1406, 1410, 4939, 4948) ; même passage dans les BnF fr. 4940 ou BnF Naf. 1159. Le problème est qu’à l’exception du BnF fr. 1410, tous ces manuscrits possèdent des continuations.
45 Renart le Contrefait, éd. citée, p. 367b.
46 Serge Lusignan, « La réception de Vincent de Beauvais en langue d’oïl », Wissensorganisierende und wissensvermittelnde Literatur im Mittelalter, éd. Norbert Richard Wolf, Wiesbaden, Ludwig Reichert, 1987, p. 34-45.
47 Voir Couderc, « Le Manuel d’histoire de Philippe VI de Valois », art. cité, p. 443-444. Voir aussi l’article de Laura Endress dans ce volume.
48 Il n’en existe qu’un seul manuscrit, autographe, avec petits dessins en marge, le BnF lat. 5042 (voir Couderc, art. cité, p. 427-433 et Nicole Pons, « Guillaume Saignet lecteur de Gilles de Rome », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 163 (2005), p. 435-480 [p. 457-460]).
49 Voir François Fossier, « Chroniques universelles en forme de rouleau à la fin du Moyen Âge », Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 1980-1981 [1982], p. 163-183.