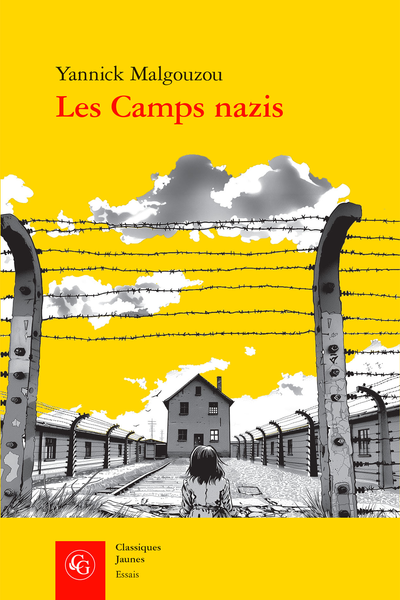
Conclusion
- Publication type: Book chapter
- Book: Les Camps nazis. Réflexions sur la réception littéraire française
- Pages: 479 to 481
- Collection: Classiques Jaunes (The 'Yellow' Collection), n° 773
- Series: Essais, n° 40
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406166597
- ISBN: 978-2-406-16659-7
- ISSN: 2417-6400
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-16659-7.p.0479
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 05-03-2024
- Language: French
Conclusion
Lorsque les portes des camps s’ouvrent sous le regard halluciné des libérateurs, c’est un monde à l’intérieur du monde qui se découvre. Un espace que les nazis souhaitaient invisible entre ainsi en communication avec une population qui n’avait jusqu’ici qu’une vague idée de la signification réelle de ce voyage sans retour qu’était la déportation. Un nouveau monde se découvre donc, un monde avec ses propres codes, sa propre imagerie, avec sa propre intensité, un nouveau monde qui devait se communiquer sur le mode du parcellaire et, pour un temps, sur le mode de l’inimaginable. En effet, comment rendre compte d’une destruction radicale de la figure humaine ? Comment donner à ressentir une expérience extrême de déshumanisation ? Comment percevoir un génocide qui, au moment de la libération des camps, était déjà en partie achevé ? Parce qu’elle faisait événement, l’expérience concentrationnaire et génocidaire nazie survenait au monde sous le signe de l’irréductible : irréductible aux médias traditionnels (quels qu’ils soient) incapables d’en donner une représentation pleinement transparente et compréhensible, irréductible aux cadres d’intelligibilité et d’interprétation traditionnels, pris en défaut par un événement contredisant la plupart des assises morales et philosophiques de ce monde de la première moitié du xxe siècle qui reste encore, et par-delà la blessure nazie, notre monde.
Or, le propre de l’événement et plus particulièrement de cet événement est d’instaurer une béance, une coupure au cœur même de l’Histoire, coupure qui nécessite alors un travail de suture, d’intégration, de narration. Bien évidemment, ce travail aurait pu passer au premier abord comme impossible tant les théologies négatives attachées à l’histoire du génocide et de la déportation ont pu se nourrir des catégories mêmes de sa réception : le génocide, plus encore que l’expérience concentrationnaire, serait arrêt de l’histoire et de l’effort d’interprétation, achèvement de la quête du sens, scandale éthique définitif, l’argument de l’inimaginable venant parachever cette sacralisation d’un événement qui reste, malgré 480tout, un événement à hauteur d’hommes, fait et subi par des hommes. Plutôt que de valider ce constat d’irréductibilité, il m’est apparu bien plus intéressant de penser l’après-coup non pas comme un simple ressassement de l’impossibilité à dire ou à imaginer, mais bien plutôt comme une histoire et une mémoire en marche. L’événement concentrationnaire et génocidaire est certes coupure, coup d’arrêt, mais il est aussi appel au recommencement, à l’imagination de nouvelles continuités. Il est surgissement qui affecte un monde, il est l’élément perturbateur d’une culture appelée à le penser, à le représenter, à le transmettre. Ces trois dimensions qui ne cessent de se mêler, j’ai essayé de les penser ensemble à travers une démarche interdisciplinaire combinant différents champs de savoir et par le détour d’une archéologie des discours. L’archéologie, c’était ici différencier les strates mémorielles et discursives, c’était remonter au temps de la découverte des camps pour ensuite penser ce que cette découverte allait devenir, ce qu’elle était devenue, ce qu’elle avait produit et ce qu’elle était encore en train de produire. C’était donc mêler dimension synchronique et dimension diachronique de l’analyse pour mettre à jour un fil discursif, un ordre du discours qui permettrait de mieux penser les difficultés inhérentes à la réception de l’événement. L’inimaginable tout comme l’impossibilité supposée de la représentation des camps nazis ne sont ainsi en rien une fatalité, mais les produits d’une histoire de la réception des camps, une histoire qui ne cesse de construire un espace de dialogue entre paroles intérieures et paroles extérieures à l’événement, entre représentations directes et indirectes.
Cet espace de dialogue, c’est celui de la culture qui recueille, interprète, transforme. Au cœur de ce champ infini, la Littérature comme histoire, comme institution, mais surtout comme pratique créative et créatrice joue un rôle prépondérant. Il existe en effet une littérature issue des camps, ou plutôt des littératures issues des camps avec, d’un côté, des témoignages qui trouvent dans la pratique littéraire des moyens de transcender les limites inhérentes à l’acte de communication et au témoignage brut et, de l’autre, une littérature de fiction, la plupart du temps suspecte et suspectée, qui fait de la déportation un argument, une question ou un élément à représenter comme toute autre réalité. Il existe ensuite une littérature française d’après les camps, hantée par l’événement, par le poids de la faute et par ses significations passées et à venir, littérature d’après-coup donc, qui exige la prise en compte de 481contextes mémoriels, sociaux et institutionnels en perpétuelle évolution. Sur ce point, une histoire plus complète reste à écrire, la périodisation pouvant et devant encore s’affiner.
C’est que l’événement, bien qu’achevé dans le temps, n’en reste pas moins une réalité qui vit, qui demeure en perpétuel mouvement du fait de la diversité des réponses culturelles et artistiques qu’il peut susciter, et c’est précisément cet ajustement perpétuel de son unicité historique avec sa représentation naturellement déceptive qu’il s’agit d’interroger continuellement. Le génocide et l’expérience des camps comme héritages culturels et historiques, cela signifie très concrètement une nécessité d’appropriation à travers des expressions artistiques et culturelles diverses ne se conformant pas systématiquement à l’ordre du discours en vigueur. Cette appropriation implique le dépassement de certains présupposés discursifs qui, s’ils peuvent être cohérents ou sembler valides aux plans théorique et philosophique, nécessitent néanmoins des résolutions et des rectifications, que le registre esthétique peut apporter. À l’exploration du génocide et de l’univers concentrationnaire comme événement passé et achevé doit donc s’ajouter l’exploration de son potentiel herméneutique. L’art comme mise en valeur de l’événement peut jouer un rôle de premier plan dans cette vocation, puisqu’il peut le maintenir vivant par le renouvellement constant des points de vue et des perspectives qui lui sont appliqués. Si la problématique inhérente à la théorie de l’événement est affaire de conjugaison, la question de ses déclinaisons n’en demeure pas moins essentielle.