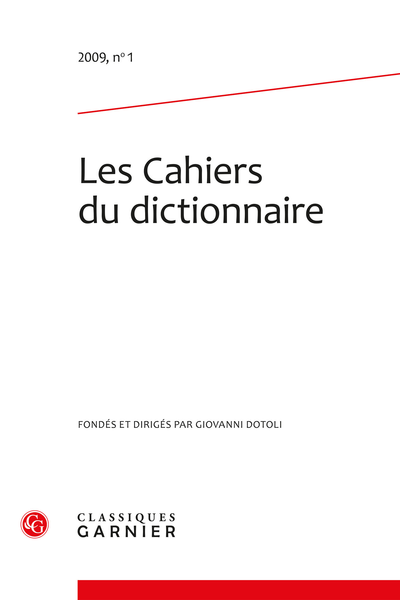
Éditorial Le Livre du Monde
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Les Cahiers du dictionnaire
2009, n° 1. varia - Auteur : Dotoli (Giovanni)
- Pages : 7 à 9
- Revue : Les Cahiers du dictionnaire
- Thème CLIL : 3147 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage
- EAN : 9782812439810
- ISBN : 978-2-8124-3981-0
- ISSN : 2262-0419
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3981-0.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 22/11/2011
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
9
ÉDITORIAL
LE LIVRE DU MONDE
Le dictionnaire de la langue française de notre époque vise un large public, français et francophone. Il représente la langue de France et des autres Pays qui l'ont choisie en partage. Le métalangage du dictionnaire de la langue française doit désormais respecter cet élargissement de pers- pective, cet espace à l'échelle mondiale, en suscitant la participation active du lecteur.
Le dictionnaire de la langue française est un laboratoire permanent et une fabrique interactive. Il est indispensable que celui du XXIe siècle trouve un équilibre entre humanisme et nouvelles technologies, pour transmettre le sens de l'histoire, du présent et du futur.
Le dictionnaire de la langue française est le symbole de la réalité, par un lexique vivant, projeté sur le changement, à partir du mot vedette. Josette Rey-Debove précise' : « Mais en fait, le lexique est ouvert, un mot est `plus ou moins mot' selon sa fréquence, et peut-être faudrait-il introduire une pondération dans l'étude des structures lexicales. [...] Toute la description structurale du lexique, si elle est immanente, dépend du volume lexical choisi et de sa réduction structurée : le partage des sens, si on les fonde sur la synonymie lexicale, les mots, si on dégroupe les séries de dérivés pour fonder l'homonymie, la définition si l'on construit le sémème par l'analyse componentielle de groupes d'unités ».
C'est un sens global, celui de la langue française tout entière, dont le dictionnaire est la photographie la plus claire et la plus profonde. Si d'un côté « le lexicologue n'a plus tout à fait les mêmes certitudes »2 qu'autre- fois, de l'autre il a acquis une conscience plus forte du dictionnaire comme miroir du monde. Ainsi pourra-t-il voir le dictionnaire de la langue française comme une archive du sens et un dépôt du mouvement de la langue, comme le remarquent André Collinot et Francine Mazière3 : « En termes foucal-
1 JOSE11'E RaY DEBOVE, Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contem- porains, The Hague -Paris, Mouton, 1971, p. 313.
z JOSE11'E RaY DEBOVE, La linguistique du signe. Une approche sémiotique du langage, Paris, Armand Colin, 1998, p. 116.
s tlxnx~ COLLINOT - Fxaxc~ Mnz~, Un prêt à parler : le dictionnaire, Paris, Presses Universitaires de France, 1997, p. 209.
10 diens, l'archive est l'effet d'une détermination des énoncés qui se lisent en fonction de leur positivité et d'un a priori historique. Par positivité, enten- dons la prise en compte de la valeur de vérité des énoncés, laquelle se déci- de dans un espace de circulation et de dispersion de ces mêmes énoncés. L'a priori historique est un moment de stabilisation provisoire de cette vérité énoncée dans un espace-temps déterminé ».
Mot vedette et entrée, macrostructure et microstructure sortiront de la syntaxe pure, pour archiver la langue française dans une machine-diction- naire qui aura son inquiétude, celle du sens de la langue totale. Ce sera la preuve que le dictionnaire est un corps vivant, axé sur l'actualité, les pieds dans la tradition-construction de la langue, par confirmations, dialogues, emprunts, niveaux et néologismes.
Le dictionnaire n'appartient plus à la catégorie des « illustres inconnus »4. Ce n'est plus une ceuvre un peu naïve. Il appartient à la catégo- rie d'« un art transcendant »5, d'après le juste mot d'Alain Rey, cet homme- phare du dictionnaire, qui est mon et notre point de repère numéro un. Le dictionnaire de la langue française appartient à l'art. « Chaque mot [y] est un univers virtuel que la parole et l'écrit actualisent », dans « une unité de sens »6. Il élargit son optique, dans la conscience de « la complexité de l'ob- jet », qui reste lié à un travail d'« intuition », malgré les grandes inventions de la technologie. Il est toujours en ceuvre ouverte. Nous pourrions même « prévoir des modèles inexistants »'. « ouvre temporelle, mais aussi cultu- relle et interculturelle, le bon dictionnaire s'inscrit alors foncièrement dans l'avenir », remarque Jean Pruvost8.
Michael Zock invite lexicographes, psycholinguistes et chercheurs à tra- vailler ensemble, pour la construction du dictionnaire de demain9 : « En ma- tière d'accès lexical, plusieurs communautés scientifiques semblent être concernées :celle des lexicographes, celle des psycholinguistes, et, bien en- tendu, celle des chercheurs travaillant en génération automatique. Pourtant, chose étonnante, ces gens ne semblent jamais se parler. Même si leurs ob- jectifs ne sont pas rigoureusement identiques, on a du mal à croire qu'ils
° ALAnJ REV; De l'artisanat des dictionnaires à une science du mot. Images et modèles, Paris, Armand Colin, 2008, p. 13.
s ALAnJ REV; L'art des dictionnaires : un art transcendant, in Dictionnaires monolingues et bilingues. Langue, culture, littérature, Actes de la journée d'étude, University of Chicago, Centre de Paris, édités par G. Dotoli, 19 janvier 2007, « Cahiers Parisiens / Parisian Notebooks », sous la direction de PHILIPPE DESAN, 4, 2008, p. 19.
6lbid. et passim.
~ Ibid., pour toutes ces citations.
8 JEAN PRUVOST, Le dictionnaire, oeuvre d'auteur et oeuvre intereulturelle, in Dictionnaires monolingues et bilingues. Langue, culture, littérature, oit., p. 53-54.
9 MICHAEL ZOCK, Le dictionnaire mental, modèle des dictionnaires de demain ?, « Revue de linguistique appliquée », X, 2, décembre 2005, p. 113.
11 n'aient rien à s'apporter les uns aux autres. Pourtant, les psycholinguistes travaillant sur l'accès lexical ne mentionnent pour ainsi dire jamais Word- Net. La communauté de WordNet, malgré sa taille, semble complètement ignorer les travaux sur l'accès lexical. Serait-ce parce que les psychologues travaillent dans un cadre connexionniste où l'on effectue des calculs sur des valeurs numériques, forme de représentation peu parlante pour un être hu- main, àqui il faut présenter une interface interprétable ? Enfm, pour les spé- cialistes de la génération, le problème d'accès lexical semble tout bonne- ment ne pas exister : ce qui est stocké en machine est accessible. Quelle illusion ! ».
Naviguer dans l'espace du dictionnaire de la langue française nécessite d'une coopération à plusieurs niveaux, pour ne pas nous « perdre dans un la- byrinthe »10. Un modèle de travail est sans aucun doute Le dictionnaire cul- turel en langue française inventé et dirigé par Alain Rey. Il y trace les lignes inspiratrices du dictionnaire de la langue française de l'avenir, qui parlera avec tous les hommes et toutes les femmes qui ont choisi cette langue en par- tage, tel un patrimoine d'or, de culture, de tradition et d'amour.
Comme le précise l'inspirateur de ce dictionnaire", le dictionnaire construira le sens dans l'obsession d'un work in progress.
Cette nouvelle revue, que j'ai simplement voulu appeler Les Cahiers du Dictionnaire, pour ne lui fermer aucune porte, suivra cette philosophie. Ce sera un chantier pour les jeunes chercheurs et pour les moins jeunes. Ce sera un lieu de dialogue, d'ouverture, de construction, de réflexion sur la langue française, d'hier et d'aujourd'hui, en réseau international, dans la perspecti- ve de l'Europe, de la France et des Pays Francophones, et du Monde, parce que le dictionnaire de la langue française est le Livre du Monde, par le Trésor de sa langue ouverte sur l'azur.
Giov~ Do~roLi
Université de Bari, le 17 septembre 2009
io Ibid., p. 115.
u ALnrnr RaY L'art des dictionnaires : un art transcendant, cit., p. 30.
LE LIVRE DU MONDE
Le dictionnaire de la langue française de notre époque vise un large public, français et francophone. Il représente la langue de France et des autres Pays qui l'ont choisie en partage. Le métalangage du dictionnaire de la langue française doit désormais respecter cet élargissement de pers- pective, cet espace à l'échelle mondiale, en suscitant la participation active du lecteur.
Le dictionnaire de la langue française est un laboratoire permanent et une fabrique interactive. Il est indispensable que celui du XXIe siècle trouve un équilibre entre humanisme et nouvelles technologies, pour transmettre le sens de l'histoire, du présent et du futur.
Le dictionnaire de la langue française est le symbole de la réalité, par un lexique vivant, projeté sur le changement, à partir du mot vedette. Josette Rey-Debove précise' : « Mais en fait, le lexique est ouvert, un mot est `plus ou moins mot' selon sa fréquence, et peut-être faudrait-il introduire une pondération dans l'étude des structures lexicales. [...] Toute la description structurale du lexique, si elle est immanente, dépend du volume lexical choisi et de sa réduction structurée : le partage des sens, si on les fonde sur la synonymie lexicale, les mots, si on dégroupe les séries de dérivés pour fonder l'homonymie, la définition si l'on construit le sémème par l'analyse componentielle de groupes d'unités ».
C'est un sens global, celui de la langue française tout entière, dont le dictionnaire est la photographie la plus claire et la plus profonde. Si d'un côté « le lexicologue n'a plus tout à fait les mêmes certitudes »2 qu'autre- fois, de l'autre il a acquis une conscience plus forte du dictionnaire comme miroir du monde. Ainsi pourra-t-il voir le dictionnaire de la langue française comme une archive du sens et un dépôt du mouvement de la langue, comme le remarquent André Collinot et Francine Mazière3 : « En termes foucal-
1 JOSE11'E RaY DEBOVE, Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contem- porains, The Hague -Paris, Mouton, 1971, p. 313.
z JOSE11'E RaY DEBOVE, La linguistique du signe. Une approche sémiotique du langage, Paris, Armand Colin, 1998, p. 116.
s tlxnx~ COLLINOT - Fxaxc~ Mnz~, Un prêt à parler : le dictionnaire, Paris, Presses Universitaires de France, 1997, p. 209.
10 diens, l'archive est l'effet d'une détermination des énoncés qui se lisent en fonction de leur positivité et d'un a priori historique. Par positivité, enten- dons la prise en compte de la valeur de vérité des énoncés, laquelle se déci- de dans un espace de circulation et de dispersion de ces mêmes énoncés. L'a priori historique est un moment de stabilisation provisoire de cette vérité énoncée dans un espace-temps déterminé ».
Mot vedette et entrée, macrostructure et microstructure sortiront de la syntaxe pure, pour archiver la langue française dans une machine-diction- naire qui aura son inquiétude, celle du sens de la langue totale. Ce sera la preuve que le dictionnaire est un corps vivant, axé sur l'actualité, les pieds dans la tradition-construction de la langue, par confirmations, dialogues, emprunts, niveaux et néologismes.
Le dictionnaire n'appartient plus à la catégorie des « illustres inconnus »4. Ce n'est plus une ceuvre un peu naïve. Il appartient à la catégo- rie d'« un art transcendant »5, d'après le juste mot d'Alain Rey, cet homme- phare du dictionnaire, qui est mon et notre point de repère numéro un. Le dictionnaire de la langue française appartient à l'art. « Chaque mot [y] est un univers virtuel que la parole et l'écrit actualisent », dans « une unité de sens »6. Il élargit son optique, dans la conscience de « la complexité de l'ob- jet », qui reste lié à un travail d'« intuition », malgré les grandes inventions de la technologie. Il est toujours en ceuvre ouverte. Nous pourrions même « prévoir des modèles inexistants »'. « ouvre temporelle, mais aussi cultu- relle et interculturelle, le bon dictionnaire s'inscrit alors foncièrement dans l'avenir », remarque Jean Pruvost8.
Michael Zock invite lexicographes, psycholinguistes et chercheurs à tra- vailler ensemble, pour la construction du dictionnaire de demain9 : « En ma- tière d'accès lexical, plusieurs communautés scientifiques semblent être concernées :celle des lexicographes, celle des psycholinguistes, et, bien en- tendu, celle des chercheurs travaillant en génération automatique. Pourtant, chose étonnante, ces gens ne semblent jamais se parler. Même si leurs ob- jectifs ne sont pas rigoureusement identiques, on a du mal à croire qu'ils
° ALAnJ REV; De l'artisanat des dictionnaires à une science du mot. Images et modèles, Paris, Armand Colin, 2008, p. 13.
s ALAnJ REV; L'art des dictionnaires : un art transcendant, in Dictionnaires monolingues et bilingues. Langue, culture, littérature, Actes de la journée d'étude, University of Chicago, Centre de Paris, édités par G. Dotoli, 19 janvier 2007, « Cahiers Parisiens / Parisian Notebooks », sous la direction de PHILIPPE DESAN, 4, 2008, p. 19.
6lbid. et passim.
~ Ibid., pour toutes ces citations.
8 JEAN PRUVOST, Le dictionnaire, oeuvre d'auteur et oeuvre intereulturelle, in Dictionnaires monolingues et bilingues. Langue, culture, littérature, oit., p. 53-54.
9 MICHAEL ZOCK, Le dictionnaire mental, modèle des dictionnaires de demain ?, « Revue de linguistique appliquée », X, 2, décembre 2005, p. 113.
11 n'aient rien à s'apporter les uns aux autres. Pourtant, les psycholinguistes travaillant sur l'accès lexical ne mentionnent pour ainsi dire jamais Word- Net. La communauté de WordNet, malgré sa taille, semble complètement ignorer les travaux sur l'accès lexical. Serait-ce parce que les psychologues travaillent dans un cadre connexionniste où l'on effectue des calculs sur des valeurs numériques, forme de représentation peu parlante pour un être hu- main, àqui il faut présenter une interface interprétable ? Enfm, pour les spé- cialistes de la génération, le problème d'accès lexical semble tout bonne- ment ne pas exister : ce qui est stocké en machine est accessible. Quelle illusion ! ».
Naviguer dans l'espace du dictionnaire de la langue française nécessite d'une coopération à plusieurs niveaux, pour ne pas nous « perdre dans un la- byrinthe »10. Un modèle de travail est sans aucun doute Le dictionnaire cul- turel en langue française inventé et dirigé par Alain Rey. Il y trace les lignes inspiratrices du dictionnaire de la langue française de l'avenir, qui parlera avec tous les hommes et toutes les femmes qui ont choisi cette langue en par- tage, tel un patrimoine d'or, de culture, de tradition et d'amour.
Comme le précise l'inspirateur de ce dictionnaire", le dictionnaire construira le sens dans l'obsession d'un work in progress.
Cette nouvelle revue, que j'ai simplement voulu appeler Les Cahiers du Dictionnaire, pour ne lui fermer aucune porte, suivra cette philosophie. Ce sera un chantier pour les jeunes chercheurs et pour les moins jeunes. Ce sera un lieu de dialogue, d'ouverture, de construction, de réflexion sur la langue française, d'hier et d'aujourd'hui, en réseau international, dans la perspecti- ve de l'Europe, de la France et des Pays Francophones, et du Monde, parce que le dictionnaire de la langue française est le Livre du Monde, par le Trésor de sa langue ouverte sur l'azur.
Giov~ Do~roLi
Université de Bari, le 17 septembre 2009
io Ibid., p. 115.
u ALnrnr RaY L'art des dictionnaires : un art transcendant, cit., p. 30.