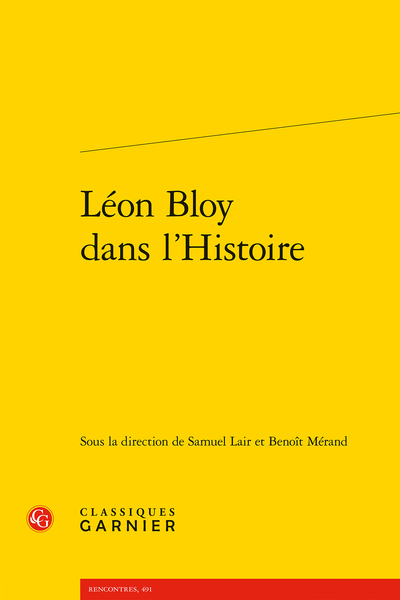
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Léon Bloy dans l’Histoire
- Pages : 357 à 362
- Collection : Rencontres, n° 491
- Série : Études dix-neuviémistes, n° 55
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406108719
- ISBN : 978-2-406-10871-9
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-10871-9.p.0357
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/02/2021
- Langue : Français
Résumés
Samuel Lair et Benoît Mérand, « Léon Bloy, “explanateur historique” »
Saisir un rapport de Léon Bloy à la marche de l’Histoire est une entreprise qui nécessite d’envisager ses choix anthropologiques et théologiques, avant d’en mesurer les implications littéraires. Sa compréhension d’une Histoire toute hérissée de symboles éclaire la part idéologique présente dans son projet totalisant, ce que d’aucuns appellent son « catholicisme politique », mais jette aussi une lumière plus vive sur l’une des composantes de son discours et de son évolution, l’amour.
Paul Mattei, « Les affinités patristiques dans l’exégèse symbolique de Léon Bloy »
Comparaison de la pensée de Léon Bloy avec l’allégorisme des Pères, la Cité de Dieu d’Augustin et l’apocalyptique. À travers héritages et similitudes, l’analyse décèle un déplacement, plus marqué par l’esprit du xixe siècle que ne l’imaginait le pamphlétaire ; et l’écrivain, qui postule un sens global caché, est dans l’incapacité de le donner à voir autrement que par bribes ou par réfraction romanesque.
Romain Debluë, « Léon Bloy ou l’Histoire au miroir »
C’est l’essence même de l’histoire selon Léon Bloy que nous aimerions éclairer ici, en prenant notre point de départ dans l’interprétation par Bloy du speculum paulinien, et en montrant que cette interprétation implique la pensée singulière et originale d’un rapport de Dieu avec sa création comme rapport de correspondance renversée, avec tout ce que cela suppose de difficultés théologiques en contexte chrétien.
358Fanny Arama, « L’homme séparé. Léon Bloy et les signes »
Le recours de Bloy aux symboles fait-il de lui un homme séparé du monde ? Le symbole lui permet de se situer dans un espace référentiel biblique permanent. L’écrivain l’emploie en outre pour sa charge polémique clivante, donnant naissance à une « esthétique antirationaliste », qui conjugue au refus de la lecture cartésienne du monde la souveraineté du plaisir de recourir à l’ambiguïté des signes.
Jean-Félix Lapille, « Déchiffrer le “palimpseste de douleur”. Épistémologie et écriture de l’histoire chez Léon Bloy »
Léon Bloy porte un grand intérêt à la discipline historique. Au travers du Révélateur du globe ou du Désespéré, il développe de nouvelles conceptions de la philosophie de l’histoire, de la recherche documentaire et de la poïétique historique. Si Léon Bloy rejette la raison comme instrument historiographique, il prétend ne pas en amoindrir la scientificité.
François Gadeyne, « Notre Dame des Temps. Du Symbolisme de l’apparition à Symbolisme de l’Histoire »
L’idée étonnante d’appliquer à l’histoire les lois de l’exégèse patristique n’est pas propre à Léon Bloy : elle possède elle-même une histoire, faite d’ombre et de lumière. Bloy la cultive en faisant preuve d’une audace singulière, avec une figure essentielle – Marie, aqueduc reliant le passé et l’avenir –, un événement – La Salette –, un maître – l’abbé Tardif de Moidrey – et son secret.
Michaël de Saint-Chéron, « Bloy face au judaïsme et aux Juifs »
Le Salut par les Juifs a affaire à la question de la honte, qui a si longtemps frappé d’opprobre le peuple juif, et Léon Bloy très paradoxalement y a participé pour mieux, disait-il, l’expurger, la détruire, dans l’esprit des antisémites. Mais il a aussi affaire à la question théologique du peuple juif et les difficultés que posent les thèses de Bloy sur ce sujet.
359Samuel Lair, « Le Léon Bloy de Maurice Bardèche. Le mensonge et l’Histoire »
Dans le parcours du biographe Maurice Bardèche, le récit de la vie de Léon Bloy, en 1989, reflète une sorte de malentendu. Face à une histoire qu’il ne comprend pas, Bloy fait preuve d’une cécité qui condamne son rapport au monde à une forme d’intransitivité. Et si Bardèche reconnaît à Bloy de belles rencontres avec l’histoire, l’effort exégétique pèche par symbolisme interprétatif, par excès d’arbitraire, pire, par un abandon à la notion d’absolu à laquelle le biographe dénie toute valeur.
Thomas Gueydier, « Léon Bloy, lecteur de François de Sales. Littérature, histoire et spiritualité »
À mi-chemin entre dérision et fascination, François de Sales occupe une place paradoxale dans l’œuvre de Léon Bloy. Une telle ambiguïté est à comprendre à la lumière des équilibres constitutifs de la spiritualité salésienne mais, aussi et surtout, par un jeu subtil qui démultiplie – sur le plan énonciatif – les tensions contradictoires entre le narrateur, le personnage et l’auteur bloyens.
Lydie Parisse, « Bloy dans l’histoire des idées. Nouveaux regards sur la mystique »
Au point d’articulation entre l’écriture et la quête spirituelle se situent les textes des écrivains mystiques, qui sont pour Léon Bloy des références incontournables. L’intérêt pour ces textes s’inscrit dans le contexte du renouveau catholique, mais Bloy dépasse les positions de ses contemporains en s’engageant, à son insu, dans un processus qui sera celui de la littérature moderne, et en influant indirectement sur le renouveau du discours critique sur la mystique.
Graciane Laussucq-Dhiriart, « Léon Bloy et le renouveau catholique. Une relation complexe »
Écrivain et catholique intransigeant, Léon Bloy apparaît comme une des figures de proue du renouveau catholique. Pourtant, force est de constater qu’il n’a collaboré à aucune des initiatives d’un mouvement qui l’admira autant qu’il s’en méfia. Il s’agira donc ici d’interroger son appartenance au renouveau en essayant de dégager la place complexe qu’il y occupa.
360Édouard Garancher, « L’esthétique figurative comme riposte au réalisme. L’exemple de Marchenoir dans Le Désespéré »
Caïn Marchenoir, le héros du Désespéré, est représentatif de l’esthétique figurative que Léon Bloy élabore en réaction au réalisme. Entre son onomastique de fantaisie, sa marginalité et son anachronisme, il subvertit la sémiologie et l’anthropologie réalistes. Étranger à toute mimesis sérieuse, il se présente comme une fiction théologique, croisant références christiques et mythe paracléto-luciférien.
Jean-Louis Benoît, « Métaphysique de l’adjectif dans les romans de Léon Bloy. Tradition et postérité »
Les adjectifs surabondent dans les romans de Léon Bloy. Il a un goût prononcé pour les adjectifs rares et précieux. Cette richesse, cette virtuosité, rappellent l’art du trésor au Moyen Âge. Rien n’est trop beau pour célébrer Dieu. L’emploi de l’adjectif permet de percer le mystère de la réalité. Il peut viser le sublime ou dénoncer le grotesque. Bloy pratique beaucoup l’antéposition. Il en tire, parfois, des effets de poéticité inspirés de « l’écriture artiste ». Proust semble avoir lu Bloy.
Gaëlle Guyot-Rouge, « Bloy et la modernité picturale. Autour de Georges Rouault et George Desvallières »
L’amitié de Desvallières et de Rouault a fait de Léon Bloy un observateur attentif des avant-gardes picturales, globalement honnies, malgré des convergences de façon et d’intention, particulièrement manifestes dans La Femme Pauvre : refus du vérisme, chromatisme puissant et réduit, déconstruction de la perspective classique, réhabilitation du trait, traitement cosmique et spirituel du paysage.
Natacha Galpérine, « “L’amie de mon âme”. Jeanne Léon Bloy »
À l’occasion de la parution de son essai sur Jeanne Léon Bloy, l’article retrace les grandes étapes de la vie de cette « Fille du Nord » venue rejoindre en une improbable rencontre ce « Fils du brûlant Midi ». Cet essai complète utilement la Correspondance, en mettant en lumière le rôle joué par Jeanne Léon Bloy non seulement dans la vie mais surtout dans l’œuvre de l’écrivain.
361Jean-Auguste Poulon, « Léon Bloy et Paul Léautaud. Deux “esprits libres” au Mercure de France »
L’article propose d’observer comment deux hommes au caractère si différent, Paul Léautaud et Léon Bloy, ont pu se côtoyer au Mercure de France. Il étudie aussi la façon dont les collaborateurs du Mercure accueillent celui qui se dit pourtant l’objet d’une « conspiration du silence ». Bloy a toujours été soutenu par Alfred Vallette et Rachilde, qui ont su voir derrière le personnage de l’infatigable « démolisseur » la figure éminemment sympathique du Pauvre.
Benoît Le Roux, « André et Valentine Dupont. Deux jeunes amis du vieux Léon Bloy ».
André Dupont est sans doute le plus mal connu des amis de Léon Bloy et d’Apollinaire. On a cherché ici à restituer sa personnalité, en recourant aux archives, ainsi qu’aux lettres inédites à Henriette Charasson. La figure de Valentine, son épouse, s’en trouve éclairée elle aussi. Tous deux méritaient de trouver place dans l’histoire des lettres et du journalisme parisien des années 1900-1920.
Laure Meesemaecker, « Louis Massignon, lecteur de Léon Bloy. L’oiseau bleu et la pauvre reine »
Léon Bloy appelait de ses vœux « l’oiseau bleu » qui pourrait écrire un livre vraiment catholique sur Marie-Antoinette : il n’est pas certain que Massignon, dans son grand texte « Un vœu et un destin », remplisse ce programme, mais sa lecture infidèle ouvre des perspectives spirituelles et poétiques essentielles pour la réception du texte bloyen au xxe siècle.
Sylvain Guéna, « Bloy et Maritain ou la Révolte baptisée »
Maritain a beaucoup hérité des intuitions de son parrain. En premier lieu une même foi profonde, combative. D’ailleurs les deux hommes ont eu à leur actif beaucoup de conversion. Chez Léon Bloy comme chez Maritain, le monde moderne est ravagé par des énergies monstrueuses qu’il faut combattre – se révolter contre le monde de l’argent et le capitalisme pervers sauvage, l’imbécillité d’un monde sans Dieu, l’odieux antisémitisme profondément anti-chrétien qui verra Maritain s’engager vigoureusement.
362Yoann Colin, « Léon Bloy, une présence souterraine de la pensée levinassienne. L’exemple de la figure du bourgeois »
Il s’agit de montrer ce qui rapproche la pensée de Léon Bloy et celle du philosophe Emmanuel Levinas qui l’a lu et le cite parfois, en insistant particulièrement sur la figure du bourgeois, telle qu’elle apparaît principalement dans l’Exégèse des lieux communs de Bloy et De l’évasion de Levinas.