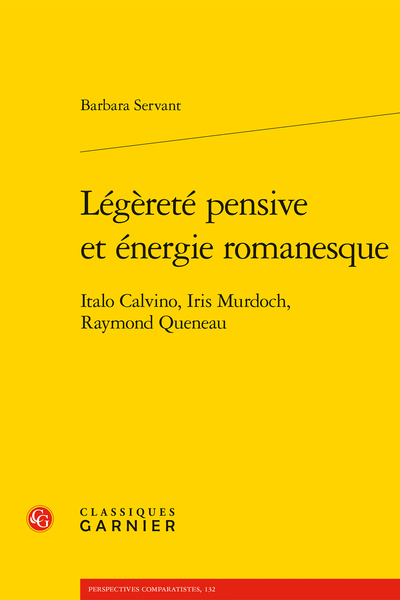
Table des matières
- Publication type: Book chapter
- Book: Légèreté pensive et énergie romanesque. Italo Calvino, Iris Murdoch, Raymond Queneau
- Pages: 637 to 645
- Collection: Comparative Perspectives, n° 132
- CLIL theme: 4028 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes de littérature comparée
- EAN: 9782406147893
- ISBN: 978-2-406-14789-3
- ISSN: 2261-5709
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-14789-3.p.0637
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 08-02-2023
- Language: French
Table des matières
Abréviations 9
Italo Calvino 9
Iris Murdoch 10
Raymond Queneau 11
Avertissement 13
Introduction 15
PREMIÈRE PARTIE
ALLÉGER LE ROMAN
PAR LA DÉCONSTRUCTION LUDIQUE
DES CONVENTIONS
Introduction à la première partie 45
La disparition de l’auteur ? 47
De la sur-représentation à la disparition de l’auteur 48
L’auteur, un personnage ridiculisé 48
Représentations de l’auteur au travail 48
Des personnages ridicules au service de l’auto-dérision 50
Conditions de la création :
questions matérielles et rivalité littéraire 53
Autorité et paternité :
les problèmes de la singularité et de l’originalité 55
Fantasmer la disparition de l’auteur 58
638Dissolution de l’auteur,
écrivain fantôme et machine littérature 58
Sur-représenter une persona d’auteur 65
Se nourrir des autres.
Intertextualité et traduction 69
Queneau, Calvino et Murdoch,
romanciers et traducteurs 70
Queneau, traducteur 70
Queneau, intraduisible ? 72
Traduction et formation 76
Le personnage romanesque du traducteur 78
Le traducteur, figure ambivalente 78
Le rival 79
Personnage romanesque 84
Incarnation d’une nouvelle forme d’autorité ? 85
Sous le patronage d’Hermès : vol et création 87
La figure du conteur 94
Alléger les conventions
Entre le maintien du romanesque
et sa déconstruction ludique 99
Parodier les conventions.
D’un côté du miroir à l’autre 100
Désir de nouveauté,
plaisir de la répétition 100
Jouer avec le pacte de lecture :
prendre conscience du cadre 103
Démonter le cadre :
jouer avec la déception possible du lecteur 114
Bildungsroman parodiques.
Continuité et écart 118
Des romans de formation 120
Épisodes de duel parodiques 122
Confronter le personnage à un type,
le héros de formation 128
Avatars burlesques et parodiques
du type qu’est le héros de romans de formation 132
Alléger le personnage ? 143
Métamorphoses, travestissement et masques.
Des personnages à l’identité mouvante 146
Quelle « consistency » pour les personnages ? 155
Mise en question de l’intégrité corporelle :
des figures de la légèreté 156
Refrains, voix ou regards 160
Qfwfq et Palomar :
personnages-voix, personnage-regard 160
Réinvention du chœur antique chez Queneau 163
Les personnages de Queneau :
fantoches doués de parole ? 167
Des personnages présentés comme littéraires 171
Le lecteur face à la construction des personnages 171
Des personnages réflexifs,
conscients de leur caractère littéraire 175
Pour une cohérence ludique 179
DEUXIÈME PARTIE
RETROUVER UNE ÉNERGIE ROMANESQUE
Introduction à la deuxième partie 189
« C’est en écrivant qu’on devient écriveron »
Portrait de l’écrivain en cultivateur ou en mécanicien 193
Pour une technique du roman 194
L’auteur en architecte/constructeur 194
La contrainte oulipienne, moteur romanesque 196
Le roman à l’orée de la poésie ? 200
Contre l’inachevé :
le travail de correction et de réécriture 203
Lent et patient labeur ou intuition fulgurante.
La double temporalité de la création romanesque 205
640La métaphore de la danse :
l’énergie productrice de légèreté 206
Mercure et Héphaistos 207
La recherche de la vitalité 213
La métaphore végétale dans les œuvres 214
Intertextualité, innutrition et vitalité de la langue 218
Queneau et le néo-français 219
Calvino et l’italien 221
Imitation et métaphore mécanique :
la main de Flannery 224
De l’organique au mécanique 226
Maîtrise mécanique vs jaillissement spontané
de l’organique ? 226
Abstraction mécanique vs précision organique :
l’héritage philosophique 229
Entrelacement de l’abstraction mécanique
et de la précision organique au sein du roman 232
Précision et abstraction 232
Le cristal, emblème de l’écriture calvinienne 237
Insuffler de l’organique au mécanique 239
Pour une mécanique ludique 243
Penser la création à la lumière du jeu 244
Gratuité apparente du divertissement/sérieux de la règle 245
La métaphore ludique pour penser la création littéraire 251
Mimicry et réflexion sur l’illusion romanesque 254
Le pari 255
Witz et jeu de mots 260
Jouer au roman comme on joue aux échecs ? 261
Jeu de cartes, échecs, énigmes 262
Méfiance à l’égard de la métaphore ludique 265
Le lecteur joueur ? 269
Le lecteur joueur, un écrivain en puissance ? 270
Le lecteur intrigué 273
641Retrouver un élan romanesque
Manque, discontinuité, vitalité 281
Représenter le désir du lecteur 283
Ménager des effets de suspense 284
Frustrer le lecteur voyeur 285
Désir et lecture 287
Manque et impulsion de l’intrigue 289
Personnages qui échappent et envol de l’intrigue 290
Séduction de l’insaisissable 292
Fugue, chasse et course poursuite 296
Queneau : l’art de la fugue 297
Calvino : triangles amoureux fantaisistes 298
Murdoch : course-poursuite 300
Sentiment d’incomplétude et création 302
Manque, déchirement et discontinuité 306
Neverland, Cimmerie et dinosaures :
fascination pour les disparus 307
Trouer le texte 311
Blancs narratifs et ouverture de l’œuvre au lecteur 314
La discontinuité aux frontières du roman 317
Energeia et exploration du romanesque 322
Queneau et Calvino : courir après le temps 323
Rapidité, légèreté et énergie 323
Jouer avec la temporalité 325
Murdoch et l’art de la digression 329
Concision et multiplicité 330
Queneau et Murdoch : puiser un nouveau rythme
romanesque dans l’écriture dramaturgique 333
TROISIÈME PARTIE
VISIBILITÉ
Introduction à la troisième partie 343
S’inspirer des arts visuels
pour créer des images romanesques 345
Influence et tentation des arts visuels 345
Influences réciproques 345
Complémentarité entre peinture et écrit 352
Ekphrasis et sources d’inspiration picturales 356
Ekphrasis structurantes chez Murdoch 356
Forme minimale et parodique
de l’ekphrasis chez Queneau 363
Référer par touches aux tableaux
et ekphrasis imaginaires chez Calvino 364
Reprendre les images du folklore et des mythes 370
S’inspirer des images animées ou narrativisées.
Rechercher l’énergie du trait et de l’esquisse 372
Créer des images 378
Vision myope de Pierrot
et regard indirect de Persée 385
Contre le regard objectivant de Méduse.
Apprendre à voir 390
Méduse et Persée 390
Une vision altérée ? 395
« Regarder devenait un jeu, une fête » 403
Déplacer le regard 406
Regard depuis l’écart 406
À distance 406
Des personnages marginaux 409
Revenir 411
643Côme dans les arbres 411
Côme, nouveau Persée ? 415
Varier les regards 418
Jeux sur les points de vue 418
Points de vue et défamiliarisation 418
Narrateurs antipathiques chez Murdoch 420
Défamiliariser la voix narrative 422
Personnages d’animaux, ostranenie
et inquiétante étrangeté 425
Étrangisation de la langue chez Queneau 432
Le français et les langues étrangères 432
Périphrases 432
Varier les registres 434
Jeux étymologiques 434
Le sourire triste de Pierrot 439
« Bouffons mélancoliques »,
« héros candides, pauvres diables à la Chaplin » 442
Naïfs en scène 442
Dupes, rêveurs, idiots 448
Réenchanter le regard 454
Marcovaldo et Charlot 454
Figures lunaires : rêveurs et Pierrot.
Incarnations du poète ? 459
La naïveté comme masque ? 465
Rire, légèreté et corporéité 471
Le corps contrarié 471
Pleurire avec les Naïfs 481
644QUATRIÈME PARTIE
POUR UNE PENSÉE DU ROMAN
Introduction à la quatrième partie 493
Fascination et méfiance pour la théorie 497
Tension bénéfique entre discours philosophique et littéraire 499
Philosophes et romanciers 499
Deux rapports différents au langage
pour une même quête tournée vers le savoir 505
Le roman ne doit pas être une illustration de la théorie 511
Le philosophique au cœur du romanesque.
Représentation et réinvestissement narratif 525
La philosophie comme moteur de la fiction,
outil romanesque 525
Des personnages romanesques de philosophes 529
Engagement éthique des romanciers 538
Un rire métaphysique 538
Refus du moralisme et nouvelle forme d’engagement 540
Équivocité et nuance 551
User de la contradiction pour déployer la pluralité 551
Préserver la complexité 552
Dualité 555
Multiplicité 557
Clarté, limpidité, superficialité 562
Murdoch : La clarté contre la transparence 562
Calvino : la limpidité et la légèreté 567
Oignon, artichaut, dune, hiéroglyphes, labyrinthe 569
Entrelacement de l’image et de la narration
pour une pensée romanesque 577
L’image est intuitive et polysémique 578
Mythes et contes, discours par images 583
Penser par images 588
645Conclusion 597
Remerciements 603
Bibliographie 605
Index des noms 629
Index des Œuvres 633