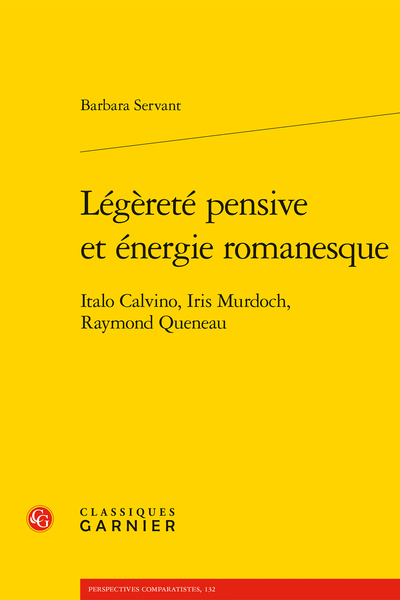
Introduction à la troisième partie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Légèreté pensive et énergie romanesque. Italo Calvino, Iris Murdoch, Raymond Queneau
- Pages : 343 à 344
- Collection : Perspectives comparatistes, n° 132
- Thème CLIL : 4028 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes de littérature comparée
- EAN : 9782406147893
- ISBN : 978-2-406-14789-3
- ISSN : 2261-5709
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14789-3.p.0343
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 02/08/2023
- Langue : Français
Introduction
à la troisième partie
Selon Calvino, l’un des trois objectifs d’une œuvre douée de littérarité, est de « donne(r) à voir quelque chose et, si possible quelque chose de nouveau1 ». Au sein d’un tel projet esthétique, l’image occupe une place centrale2, et les arts visuels sont sollicités pour l’influence qu’ils peuvent exercer sur la création romanesque.
Queneau, Calvino et Murdoch s’inspirent des arts visuels pour produire une enargeia romanesque, faux étymon que l’on peut traduire par « évidence » ou visibilité et qui se rapproche dans cette perspective de l’evidentia ciceronienne3. Dès lors, elle participe également à une certaine forme de légèreté. D’une part, les images répondent à leur recherche d’une représentation efficace, à la fois dense et concise, qui fonctionnerait comme un miroir dans lequel se projette ou que développe la narration. Calvino choisit ainsi avec grand soin les couvertures de ses livres, avec la conviction qu’elles peuvent fonctionner comme un résumé de l’œuvre4. Mais en amont de l’écriture déjà, l’iconographie peut être revendiquée comme modèle d’inspiration. La pratique de l’ekphrasis est structurante chez l’auteur italien comme chez Murdoch. Dans les œuvres de cette dernière, les tableaux décrits fonctionnent souvent comme un point de fuite qui symbolise et reflète les nœuds réunissant les différents personnages. D’autre part, les trois auteurs prennent pour modèles des œuvres 344visuelles en mouvement, en s’appuyant sur un fonctionnement narratif, comme le cinéma ou le dessin animé. Queneau et Calvino y puisent une energeia de l’esquisse, une énergie sautillante et légère, qui rappelle l’esthétique du conte, également chère à Murdoch. Enfin, produire des images, des vignettes (soit par le dessin, soit par la focalisation sur des objets, soit par le recours à la couleur et à la lumière), c’est aussi créer du mémorable, une façon pour les trois auteurs d’éviter la dilution, la dispersion qui ont souvent été associées au romanesque. Se référer constamment aux arts visuels pour s’en inspirer, est-ce finalement toujours revendiquer la supériorité de ces derniers ou au contraire révéler la toute-puissance du roman, capable d’intégrer différentes formes ?
Par ailleurs, les trois romanciers sont conscients que l’image est saisie par un regard, celui de l’écrivain qui la produit, celui du lecteur qui la saisit. Ils mettent de fait constamment en scène des regards, qu’ils soumettent à des difficultés ou auxquels ils imposent des variations de distance. Dès lors, ils invitent à prendre conscience des automatismes de pensée, en recourant à l’ostranenie, pour renouveler la vision. Nous verrons donc comment ils métamorphosent la myopie de Pierrot en outil pour recouvrer l’agilité du regard indirect de Persée.
L’oscillation entre myopie et clarté de la vision recoupe celle de la naïveté et de la lucidité, sur laquelle jouent également les trois auteurs en représentant des personnages de Naïfs souvent inspirés du cinéma burlesque. Comment ce type de personnage, d’inspiration en partie cinématographique, participe à la fois d’une forme comique de légèreté et d’énergie, tout en portant une certaine gravité ?
1 Comme il est rappelé par : Philippe Daros, Italo Calvino, op. cit., p. 45. (I libri degli altri, Lettere 1947-1981, lettre du 5 octobre 1964, p. 483.)
2 Dans son article « Esattezza » il parle des images scientifiques comme « stimulants pour [l’]imagination ». « stimoli per l’immaginazione » (« Exactitude », DII, 64 ; « Esattezza », SI, 688.)
3 Cf. Emmanuel Bouju, « Énergie romanesque et reprise d’autorité (Emmanuel Carrère, Noémi Lefebvre, Jean-Philippe Toussaint) », L’Esprit Créateur, no 54/3, numéro dirigé par Oana Panaïté(University of Minnesota, États-Unis), septembre 2014, p. 92-105.
4 Les dernières pages de l’Album Calvino présentent plusieurs couvertures des œuvres de Calvino publiées en Italie (Album Calvino, a cura di Luca Baranelli, Ernesto Ferrero (éd.), Milan, Mondadori, 2003.)