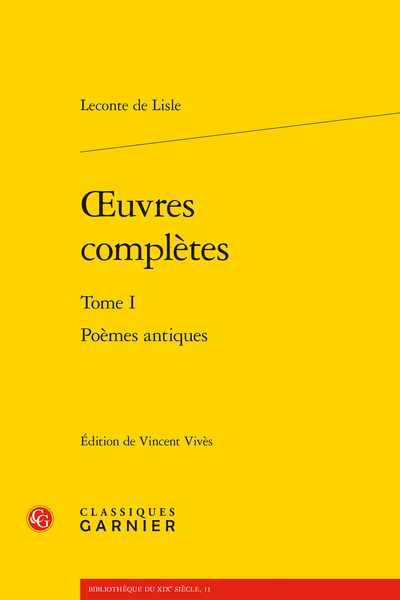
Note sur la présente édition
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Œuvres complètes. Tome I. Poèmes antiques
- Pages : 43 à 45
- Collection : Bibliothèque du xixe siècle, n° 11
- Série : Leconte de Lisle, n° 1
- Thème CLIL : 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN : 9782812440373
- ISBN : 978-2-8124-4037-3
- ISSN : 2258-8825
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4037-3.p.0043
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 14/10/2011
- Langue : Français
NOTE SUR LA PRÉSENTE ÉDITION
Comme le notait Edgard Pich, il est rarement possible de venir à la source d’un manuscrit dans le cas de Leconte de Lisle. Les documents autographes, à l’exception des poèmes de jeunesse intégrés dans la correspondance, sont souvent postérieurs, copiés en vue de dons amicaux ou pour des Keepsakes. Force est donc d’en rester, le plus souvent, aux différentes éditions parues du vivant de l’auteur. Pour l’établissement des Poèmes antiques, nous avons donc choisi d’avoir recours aux huit éditions conçues par l’auteur (de 1852 à 1891), qui présentent l’évolution de son projet. Si les transformations sont majeures en ce qui concerne les poèmes de la période phalanstérienne, qui sont quelquefois amplement modifiés, il n’en est pas de même pour les poèmes dont la rédaction est ultérieure à 1852. On notera, et ce sera un trait qui ira en s’accentuant dans la création du poète, que les principales variantes des poèmes concernent d’une part l’orthographe des noms propres et de l’autre la ponctuation. Les premières variantes tracent le parcours intellectuel de Leconte de Lisle à travers la mise en place de son « système » scientifique et intellectuel. Les secondes, moins importantes de ce point de vue, mais très nombreuses, éclairent la précision formelle à laquelle le poète s’attache. N’apportant en général aucune modification sémantique, la ponctuation relève sans doute chez Leconte de Lisle d’une activité rythmique à laquelle la critique ne s’est pas encore intéressée. Nous avons décidé de les présenter ici dans leur intégralité pour les Poèmes antiques. Pour les poèmes de jeunesse, nous n’indiquerons que les variantes qui nous ont paru significatives.
Le présent tome s’ouvre avec la préface des Poèmes antiques. On pourra nous reprocher de contredire à une certaine logique, puisque la préface disparaît de l’édition définitive de 1891, établie par le poète lui-même, celle-là même que nous choisissons de suivre ici. Il nous a semblé pourtant judicieux de présenter la préface en ouverture : c’est par elle que Leconte de Lisle entre véritablement dans la littérature, qu’il présente
l’état de l’élaboration de ses idées esthétiques, qu’il commente son œuvre ; c’est elle qui appelle les additions et les transformations postérieures du recueil. Nul doute que sa lecture est des plus enrichissantes pour qui veut entrer dans une œuvre dont les références et la logique sont fort éloignées des habitudes de lecture qui sont les nôtres. Le recueil est suivi des poèmes de jeunesse et de formation intellectuelle, composés jusqu’en 1852, qui permettent de suivre l’évolution esthétique du poète. De valeur fort inégale, ces pièces allant de la bluette fade et de la mièvre romance romantique aux odes mystiques et politiques, tracent un parcours et éclairent les choix que, peu à peu, tant sur le plan esthétique que politique, le poète a faits.
La présente édition des Poèmes antiques se compose d’un appareil critique motivé en grande partie par la somme des références mythologiques qui participent au matériau épique. Il fallait aussi donner les variantes du texte, apporter quelques éléments susceptibles de préciser le cadre intellectuel et littéraire qui les sous-tend. L’apparat critique se présente ainsi :
– suivant une numérotation en chiffre arabe, les notes de bas de page précisent la date et le lieu de la première publication du poème, ainsi que les éléments relatifs au contexte de l’écriture, nécessaires à la compréhension.
– suivant une numérotation prenant une base alphabétique, les notes philologiques (variantes) sont regroupées en fin de volume.
– suivant un ordre alphabétique, un index présenté en fin de volume explicite le lexique des différentes mythologies, Grecque, latine et hindouiste.
Pour les variantes, l’édition suit le principe suivant : les changements de mots, de syllabes ou de lettres sont portés en italiques. Chaque édition d’où provient la variante est précisée par les chiffres de la décennie et de l’année mis entre parenthèse. Ainsi l’édition des Poëmes antiques de 1852 est-elle répertoriée : (52).
Les éditions modernes des Poèmes antiques de Madeleine et Vallée, tout comme celle d’Edgard Pich, sont résolument philologiques et ne proposent pas de notes critiques ou interprétatives. L’édition d’Edgard Pich aux Belles Lettres avait cependant été conçue dans le prolongement
de la thèse que le même auteur avait fait paraître en 1974, soit trois ans après l’édition des Articles, préfaces et discours, deux ans avant les Poèmes barbares et trois ans avant les Poèmes antiques. Leconte de Lisle et sa création poétique, Poèmes antiques et Poèmes barbares, 1852 – 1874 présentait ainsi, dans un volume séparé, le commentaire anticipé des œuvres publiées. L’édition de Claudine Gothot-Mersch quant à elle choisit de faire figurer en fin d’ouvrage des notes explicatives. Celles-ci ont le grand mérite de rappeler les différentes interprétations majeures que la poésie de Leconte de Lisle a suscitées, laissant cependant le lecteur perplexe devant tant de lectures contradictoires et de contresens singuliers. Nous avons choisi de nous en tenir à des notes d’élucidation contextuelles, sans nous aventurer dans l’interprétation ponctuelle de tel ou tel poème, puisqu’il nous semble que le sens majeur des pièces est dialectique et tributaire du projet épique de Leconte de Lisle. Aussi les notes de cette édition souhaitent-elles humblement donner les moyens intellectuels permettant au lecteur de produire sa propre interprétation et de parcourir le rêve de Leconte de Lisle – tour à tour extasié et angoissé – perdu dans les multiples visages de la condition humaine.