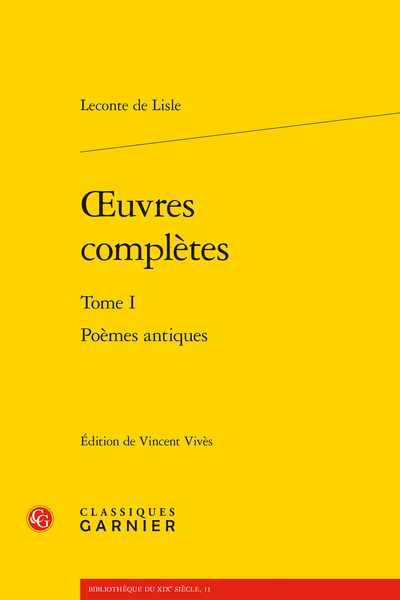
Avant-propos
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Œuvres complètes. Tome I. Poèmes antiques
- Pages : 7 à 12
- Collection : Bibliothèque du xixe siècle, n° 11
- Série : Leconte de Lisle, n° 1
- Thème CLIL : 3440 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- XIXe siècle
- EAN : 9782812440373
- ISBN : 978-2-8124-4037-3
- ISSN : 2258-8825
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4037-3.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 14/10/2011
- Langue : Français
Avant-propos
PRÉSENTATION DE L’ÉDITION
Été 1885, à Nice : Friedrich Nietzsche, absorbé par la lecture des écrivains français avec lesquels il se trouve en communauté d’esprit, note : « Ce qui fleurit en France en fait de poètes est sous l’influence de Heine et de Baudelaire, à l’exception peut-être de Leconte de Lisle1. » À Sils-Maria, Haute-Engadine, le philosophe errant discute des Poèmes antiques et des Poèmes tragiques avec Hélène Vacaresco, filleule du poète. Il lit l’étude que Paul Bourget consacre à ce dernier, le 15 janvier 1885, dans La Nouvelle Revue. À n’en pas douter, Leconte de Lisle suit un chemin difficile et original, personnel dans son « impersonnalité » programmatique, maintenant avec force la puissance de la forme et s’éloignant des esthétiques romantiques qui – le poète et le philosophe s’accordent sur ce point – mènent la France dans la décadence européenne à laquelle le christianisme a ouvert la voie.
L’œuvre de Leconte de Lisle eut, de 1852, date de la première version des Poèmes antiques et de leur impressionnante préface, jusqu’au début des années 1880 (l’édition des Poèmes tragiques date de 1884), une place incontournable dans la poésie de la seconde moitié du xixe siècle, ainsi qu’une influence majeure sur toute une génération de poètes (Catulle Mendès, Coppée, Verlaine, Dierx, Heredia etc.) dont la plupart fréquentaient le modeste salon du 8, boulevard des Invalides. Baudelaire écrit sur lui un article en 1861, Mallarmé ébauche une étude sur le maître l’année suivante. En 1869, Rimbaud découvre la deuxième livraison du Parnasse contemporain qui place « Qaïn » en ouverture afin de souligner le caractère moderne de la publication et d’estomper, par le sujet et la
mise en valeur de Leconte de Lisle, fervent républicain, les marques d’inféodation au Second Empire. Sur les cent-vingt vers que comporte le poème, le jeune Rimbaud en souligne quatre-vingt-douze d’un trait vertical dans la marge. Nul doute que c’est par ce poème qu’il découvre que Leconte de Lisle est un « voyant », comme il l’écrit dans la fameuse lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871.
La poésie de Leconte de Lisle, avant tout épique, contredit à notre goût contemporain. Elle cherche une voie distincte de celle du romantisme qui a baigné les années d’adolescence du poète à l’Île Bourbon puis ses années d’étudiant à Rennes, et propose une conception de l’Histoire fondée sur la lutte. Elle récuse, à partir du Christianisme qu’elle condamne avec une violence égale à celle que l’on rencontre chez Proudhon, le monde moderne, utilitariste, qui a abandonné l’idéal. Avançant par grandes synthèses, Leconte de Lisle joue avec l’abstraction. Ces vers s’agencent pour faire apparaître les vastes formes de la vie collective, et ne s’arrêtent pas aux soubresauts individuels. Son univers investit les grands symboles par lesquels l’idéal, religieux, philosophique ou esthétique, s’est réalisé dans toutes les civilisations. Aussi ce grand peintre en fresques néglige-t-il le pittoresque et les sujets singuliers pour couvrir, avec l’appui de l’étude et de la science, l’Histoire de l’humanité comprise comme invention et déploiement, métamorphose et extinction des idées rectrices que chaque culture, puisant dans un sol particulier son génie original, conçoit, avant de retourner à la poussière matérielle dont elle est issue. L’œuvre affirme son originalité dans une poétique systématique qui, de la conception du statut de l’art jusqu’au traitement du vers, répond à la pensée dogmatique qui y préside. Cette systématicité est l’une des originalités de la poétique de Leconte de Lisle. Paul Verlaine, évoquant le travail de transcription du grec ou du sanscrit, parle dans sa correspondance du « système Leconte de Lisle2 » ; Paul Bourget évoque une méthode métaphysique3 et parle d’un regard poétique se posant sur des hypothèses scientifiques tentant de synthétiser l’histoire des déterminismes où convergent causes naturelles, conscience humaine, structures politiques, élaboration des systèmes religieux et, comme leur couronnement, l’invention des belles formes.
Depuis la fin du xixe siècle, le rayonnement de Leconte de Lisle s’est progressivement transformé en lumière crépusculaire : rares sont les écrivains ou théoriciens qui, comme Paul Valéry en 1927, attachent encore du prix à sa poésie. Le disciple de Mallarmé prend acte de la désaffection du public envers l’œuvre, rappelant cependant la force de cette dernière :
« Leconte de Lisle me semble un peu trop abandonné maintenant. Il me semble que nous n’avons plus d’hommes de cette allure. Nul n’a été plus ferme que lui dans la volonté de puissance en ce qui concerne l’art poétique et le grand style4. »
L’œuvre de Leconte de Lisle, venue à l’une des époques les plus riches de la poésie française, a été progressivement éclipsée par d’autres œuvres monumentales. Venant clore les grands chants épiques et les petites épopées, les trois grands recueils poétiques que sont les Poèmes antiques, les Poèmes barbares et les Poèmes tragiques rivalisent avec La Légende des siècles de Victor Hugo. Sur le terrain du renouvellement esthétique qu’on peut résumer par le terme de postromantisme, ils côtoient Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud. Leconte de Lisle s’arrête certes à l’orée des révolutions dans lesquelles certains de ses contemporains ou de ses cadets engagent la poésie. Cela n’invalide pourtant pas son projet radical et ses vers qui, à bien des égards, recèlent des séductions intellectuelles et formelles qu’il faut aujourd’hui redécouvrir. Jean-Paul Sartre, l’un des derniers grands critiques à s’intéresser à Leconte de Lisle, lui consacre bon nombre de pages dans la fin de son essai sur Flaubert, L’Idiot de la famille. Mais l’étude, par delà sa lucidité et ses traits lumineux, est un réquisitoire. Ensuite, c’est le quasi silence, à l’exception de quelques études universitaires que l’on trouvera référencées dans ces présentes Œuvres complètes. Pendant longtemps, Leconte de Lisle a survécu dans l’école de la République, à travers quelques poèmes animaliers. Aujourd’hui, sa voix se fait entendre presque uniquement dans les récitals de mélodie française grâce à Fauré, Duparc, Chausson ou Debussy, qui ont su trouver leur inspiration dans des vers dont l’éthos formel offrait la possibilité d’un renouvellement esthétique délié du modèle lyrique romantique qui s’était imposé dans la trinité musicale de la romance, du Lied germanique et de l’opéra.
Août 1918, Londres : Virginia Woolf, qui trois ans plus tôt a écrit son premier roman, La Traversée des apparences, note lapidairement son enthousiasme pour un poète français : « Plutôt que d’attendre de faire l’achat d’un
cahier où consigner mes impressions d’abord sur Christina Rossett, puis sur Byron, mieux vaut que je les note ici. Premièrement, il ne me reste plus d’argent, car j’ai exagéré avec Leconte de Lisle5. » Les auteurs qui entreprennent ici de redonner le goût de Leconte de Lisle seront heureux si, de page en page, l’enthousiasme que connurent Gustave Flaubert, Friedrich Nietzsche, Marcel Proust ou Virginia Woolf se communique aux lecteurs.
PLAN DES ŒUVRES COMPLÈTES
Nous avons souhaité rendre accessible l’ensemble de l’œuvre de Leconte de Lisle. L’édition de Madeleine et Vallée, datant de 1928 (reprise en 1974 dans la collection des Slatkine reprints), est depuis longtemps introuvable ailleurs que dans quelques librairies spécialisées en livres rares, et l’édition d’Edgard Pich, publiée aux Belles Lettres (Articles, Préface, Discours – Poèmes barbares – Poèmes antiques – Poèmes tragiques, Derniers poèmes – Œuvres diverses), sans aucun doute la plus complète à ce jour, et référence de la présente édition, est épuisée. Il faut cependant noter qu’Edgard Pich travaille à la réactualisation de ses travaux dans de nouvelles œuvres complètes de Leconte de Lisle. Le tome I de cette édition, L’Œuvre romantique (1837-1847) a paru en 2011 aux Éditions Champion. Il faut enfin mentionner l’édition des Poèmes antiques (1994) et des Poèmes barbares (1985) entreprise par Claudine Gothot-Mersch aux éditions Gallimard, édition qui hélas n’a pas été poursuivie. Les présentes œuvres complètes de Leconte de Lisle comprennent les trois recueils dont les éditions ont été revues et corrigées par le poète lui-même, Poèmes antiques, Poèmes barbares et Poèmes tragiques (ceux-ci suivis par les Derniers poèmes, recueil posthume édité par le Vicomte de Guerne et José-Maria de Heredia en 1895, soit un an après la mort du poète). Le recueil des Poèmes et poésies n’est pas présenté ici : l’œuvre publiée par un éditeur complaisant n’est en fait, pour le Leconte de Lisle de 1855, qu’un moyen de rendre publiques des pièces au statut hétérogène qui viendront s’adjoindre pour certaines dans le premier recueil, et pour les autres s’intégrer dans le deuxième.
Leconte de Lisle est peu connu pour sa prose. On lui doit pourtant quelques contes, des articles de critique littéraire et des écrits polémiques dont la nature est propre à remettre en cause l’image du poète enfermé dans sa tour d’ivoire. Les présentes œuvres complètes consacrent un tome aux proses de fictions et textes polémiques, auxquels viendront s’adjoindre des œuvres dont le caractère littéraire s’efface quelquefois devant le souci pédagogique et les nécessités financières qui y présidèrent : Histoire populaire de la Révolution, Histoire populaire du christianisme. On découvrira là un Leconte de Lisle à la fois fin ironiste, narrateur subtil, mais aussi enthousiaste dogmatique, comme dans le Catéchisme populaire républicain qui montre l’attachement de l’auteur des Poèmes antiques à une pensée politique au centre de laquelle la lutte contre l’injustice, les déterminismes économiques et autres carcans de l’idéologie libérale mercantile, doit toujours être perpétuée, dans le cri de l’activiste ou, sur un mode plus silencieux, dans l’étude critique et érudite.
Cette édition présente les écrits (publiés ou non du vivant de l’auteur) dont l’élan poïétique les poussait à être rendus publiques. Les poèmes de jeunesse ont certes été condamnés par le poète, mais il n’en reste pas moins qu’ils recèlent un caractère universel dans leur lyrisme naïf et leur appel aux idéaux de la sensibilité et de l’imagination humaine. Nous les présentons donc. La correspondance de Leconte de Lisle, qui s’est toujours refusé à entretenir ses contemporains de sa propre personne, n’a pas sa place dans cette édition. Toujours confinées, dans l’esprit de leur auteur, à une très stricte intimité, ses lettres n’ont pas le statut littéraire qui justifierait leur publication ici. Cette édition, et ce sera sans doute sa plus grande originalité, présente les traductions des auteurs grecs et latins que le poète a réalisées, qui font date dans l’histoire de la traduction du xixe siècle et dont certaines, comme celle de L’Iliade et de L’Odyssée, comptent parmi les plus intéressantes. Ainsi l’édition permettra-t-elle, dans ce vaste ensemble constitué, de montrer la richesse et la cohérence d’un esprit curieux, complexe, et d’une œuvre polymorphe, pluridisciplinaire, exigeante, dont le souci scientifique, le questionnement métaphysique et le projet esthétique donnent tout son relief, sa singularité et son originalité.
Caroline De Mulder
& Vincent Vivès
NOUVELLE ÉDITION DES ŒUVRES COMPLÈTES
DE LECONTE DE LISLE
Tome I : Poèmes antiques, suivis de poèmes divers.
Tome II : Poèmes barbares, suivis de poèmes divers.
Tome III : Poèmes tragiques, suivis des Derniers poèmes.
Tome IV : Textes critiques, récits, contes en prose et œuvres polémiques.
Tome V : Idylles de Théocrite et Odes anacréontiques (traduction).
Tome VI (vol. 1 et 2) : Homère, Iliade, Odyssée, Hymnes, Épigrammes, Batrakhomyomakhie (traduction).
Tome VII : Hésiode, Théocrite, Bion, Moskhos, Tyrtée, Odes anacréontiques (traduction).
Tome VIII : Œuvres d’Eschyle (traduction).
Tome IX : Œuvres d’Horace (traduction).
Tome X : Œuvres de Sophocle (traduction).
Tome XI : Œuvres d’Euripide (traduction).
1 Friedrich Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes, tome XI, Juin-Juillet 1885, NRF/Gallimard 1982, p. 334.
2 Lettre de Paul Verlaine à Armand Gouzien, oct. 67 ou mars 68, Correspondance générale I, 1857- 1885, éd. Michael Pakenham, Fayard 2005, p. 120.
3 Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine, « Leconte de Lisle », éd. André Guyaux, Gallimard, coll. « Tel », 1993, p. 275 sq.
4 Paul Valéry, Variétés, Œuvres I, Gallimard, coll. « La Pléiade », 1957, p. 777.
5 Virginia Woolf, Journal intégral, 1915-1941, trad. C.-M. Huet et M.-A. Dutartre, Stock, 2008, « 4 août 1918 », p. 174.