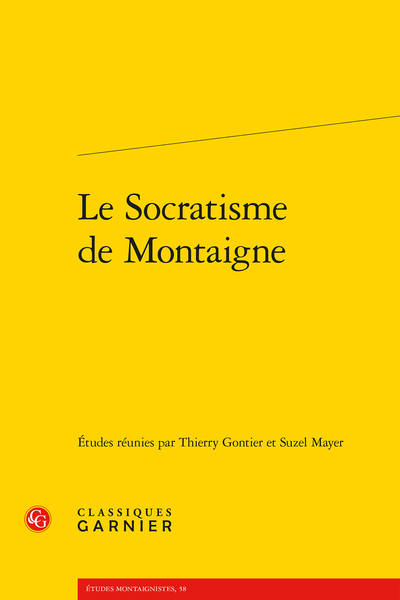
Préface
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: Le Socratisme de Montaigne
- Authors: Gontier (Thierry), Mayer (Suzel)
- Pages: 7 to 13
- Collection: Studies on Montaigne, n° 58
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782812445125
- ISBN: 978-2-8124-4512-5
- ISSN: 1775-349X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-4512-5.p.0007
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 12-03-2010
- Language: French
Préface
Socrate, au prisme de Montaigne
L’importance du personnage de Socrate dans les Essais a été relevée par la plupart des commentateurs de Montaigne. Socrate y est désigné comme « l’âme […] la plus parfaite qui soit venue en ma connaissance », « le plus sage homme qui fut oncques », « le plus digne homme d’estre cogneu et d’estre presenté au monde pour exemple », un « exemplaire parfaict en toutes grandes qualitez », une « si saincte image de l’humaine forme » ou encore le « maistre des maistres1 ». Cette importance ne cesse de croître d’une couche de rédaction à l’autre des Essais : la Concordance de Leake énumère 16 références nominatives pour l’édition de 1580, 32 supplémentaire entre 1580 et 1588 (toutes, sauf trois, étant situées dans le livre III), 65 supplémentaires après 1588 ; les deux tiers environ de cette centaine de références appartiennent ainsi à la dernière couche de rédaction, alors même que décroit le nombre des références, si importantes dans les premières couches, à Sénèque et à Plutarque.
Montaigne n’est certes pas le premier à faire de Socrate un parangon de sagesse. Il synthétise en quelque façon les différents portraits, quelquefois contradictoires, que nous ont laissés les auteurs antiques, les refaçonnant à sa manière, complétant et corrigeant les uns à l’aide des autres, pour forger son propre Socrate. Aussi importante que soit la lecture de Platon (plus encore après 1588), faite dans la traduction latine de Marsile Ficin, Montaigne se sert aussi de Xénophon et de Diogène Laërce, et, à travers ce dernier, des penseurs cyniques, voire
stoïciens, pour opposer à une figure par trop intellectualiste de la vertu socratique une vertu pratique, tournée, comme le montre Louis-André Dorion, vers l’usage de la vie. Autant que les penseurs antiques, les penseurs de la Renaissance avaient loué Socrate jusqu’à le diviniser. Montaigne se situe en partie dans leur continuité. Mais, comme d’autres commentateurs l’ont dit à juste titre, et comme le montre ici Pierre Magnard, les raisons pour lesquelles Montaigne admire Socrate ne sont pas les mêmes que celles de ses prédécesseurs. Montaigne épure en particulier la figure socratique des scories métaphysiques dont l’avaient recouvert les premiers renaissants : extases, démon, mission divine, mystérisme, etc.
A travers cette opération de reprise, de correction et de transformation d’un matériau complexe, voire disparate, Montaigne accomplit une véritable réappropriation de la figure de Socrate. Celle-ci commence par une réappropriation de la parole socratique elle-même à l’intérieur d’une écriture. Opération paradoxale, et peut-être impossible, tant la philosophie socratique fait corps avec son expression orale. Il reste que, comme le montre Pierre Servet en s’appuyant sur les réécritures successives des Essais (les « allongeails »), l’essai montaigniste est une tentative de « socratisation » de l’écriture – comme avaient pu l’être à un autre niveau le dialogue platonicien, la diatribe cynique ou l’épitre sénéquéenne. « Socratiser » l’écriture, c’est emprunter au discours socratique son naturel et sa franchise, sa « parrhèsia », comme le montre Olivier Guerrier, en comparant le socratisme de Montaigne à celui de Foucault. C’est aussi se réapproprier sa dimension dialogique, comme le montre Nicola Panichi, en inscrivant l’essai montaigniste dans une tradition renaissante de la « conversation civile » – cette civilité qui, pour Hegel, constitue « la plus haute preuve d’un esprit libéral ». Une telle entreprise de « socratisation » du discours a aussi ses limites, et Philippe Desan montre chez Montaigne l’élaboration d’un compromis entre la spontanéité et de la parole socratique et les nécessités de la vie publique qui ne saurait faire l’économie d’une certaine rhétorique et d’un certain mode de dissimulation ; Socrate, comme le rappelle François Roussel, a fait l’épreuve de ces limites dans la plaidoirie de son procès : mais l’ironie – qui est une forme de dissimulation – n’est-elle pas elle aussi un trait du discours socratique ?
Dans l’écriture de l’essai, Montaigne vise la production d’un mode de discours non « doctrinal » (au sens péjoratif que Montaigne donne à ce
terme), et qui conserve du dialogue socratique sa dynamique « maïeutique ». L’écriture de soi est pour Montaigne l’un des modes privilégiés de la pratique de la connaissance de soi. Marc Foglia montre que cette connaissance de soi ne signifie plus chez Montaigne la découverte en soi d’une vérité transcendante, mais l’épreuve, dans son immanence même, d’un « moi » toujours singulier, à travers le double acte de l’essai du jugement et de l’expérience du corps. Le « gnosce te ipsum » prend dès lors une valeur éthique. Comme le montre Edward Tilson, cette valeur morale de la connaissance de soi permet à Montaigne, au fur et à mesure des différentes couches d’écriture de l’essai II, 12, de dépasser les références initiales et sceptiques à la critique augustinienne de l’orgueil.
La formation du « socratisme » de Montaigne passe ainsi par une nouvelle compréhension de la relation du savoir à la vie humaine. Si Cicéron symbolise pour Montaigne le divorce entre un savoir de pure ostentation et le mouvement de la vie, Socrate en est le reflet inversé, représentant un savoir fait de « preceptes qui reelement et plus jointement servent à la vie2 ». Montaigne réinterprète en ce sens les traits fondamentaux du socratisme. En tout premier lieu, la nescience : celle-ci est amplifiée par Montaigne pour exprimer une expérience, tant politique que métaphysique, du chaos et du néant. Le Socrate de Montaigne est ici pyrrhonien, mais le Pyrrhon de Montaigne, qui ne connaît ni l’indifférence (adiaphora), ni la suspension du jugement (aphasia), ni l’absence de trouble (ataraxia), ce Pyrrhon qui « n’a pas voulu se faire pierre ou souche », mais « homme vivant, discourant et raisonnant, jouïssant de tous plaisirs et commoditez naturelles, embesoignant et se servant de toutes ses pièces corporelles et spirituelles en regle et droiture3 », n’est-il pas en retour profondément socratique ?
Socrate est sans doute pour Montaigne un exemple de vertu. Il n’en reste pas moins un exemple paradoxal. Comme le montre Sophie Peytavin, il n’y a pas à proprement parler de « vénération » de Socrate dans les Essais : la leçon socratique est peut-être qu’il n’y a pas d’exemple en morale. Christian Nadeau poursuit cette réflexion, en montrant ce qui sépare l’éthique montagniste de l’éthique contemporaine « de la vertu » telle qu’elle est représentée par un Alasdair MacIntyre en tant
qu’éthique perfectionniste qui se nourrit de l’imitation des exemples. Sans doute Montaigne suit-il Socrate, mais il n’hésite pas non plus à le critiquer, en particulier pour son intellectualisme, comme le montre Emiliano Ferrari en faisant valoir chez Montaigne un dynamisme propre de la volonté circonscrit par une expérience du corps. Ce dynamisme de la volonté est aussi mis en valeur par Thierry Gontier, pour qui le « naturel » socratique renvoie chez Montaigne non à un « naturalisme » moral, mais à une nature prolongée par l’effort, et à une institution sur la base de semences innées de vertu.
La constance de la référence à Socrate ne s’accompagne pas seulement de quelques réticences, mais elle conduit à une véritable transformation de sa figure. Suzel Mayer souligne ainsi les traits d’inspiration cyniques que Montaigne attribue à Socrate et met en lumière chez Montaigne une « revendication de marginalité », qui, tout en s’appuyant sur la figure de Socrate, rejette le respect quasi religieux des lois civiles qu’il défend dans le Criton. C’est cette relecture du socratisme en un sens cynique que met encore en valeur Thomas Berns, en voyant paradoxalement dans le cosmopolitisme « sédentaire » de Socrate une source d’inspiration de la plaidoirie de Montaigne en faveur de son voyage romain. Le Socrate de Montaigne présente aussi des traits stoïciens, comme le montre ici Sébastien Prat. La constance socratique n’est pas la constance stoïcienne, faite de rigidité et de crispation, mais est tempérée par la volupté. La versatilité socratique n’en répond pas moins – et de façon plus efficace – au projet moral des stoïciens d’adaptation à l’ordre (vicissitudinal) du monde et d’égalité à soi dans la durée. Pour y parvenir, le Socrate de Montaigne ne cherche pas, à la différence de Caton ou de Sénèque, à se hisser au-dessus de la nature humaine, mais conjugue la constance à une certaine forme de nonchalance.
Cette alliance des contraires introduit un nouvel humanisme, à même de prendre en compte tant la dignité de l’homme et de son agir que la finité de sa condition. C’est cette finité qu’avaient souvent ignorée les penseurs de la Renaissance. Ceux-ci n’avaient pas seulement loué Socrate, ils l’avaient divinisé. On connaît la célèbre formule du Convivium religiosum d’Érasme, « Sancte Socrates, ora pro nobis », et, pour Rabelais aussi, Socrate possède un « entendement plus qu’humain ». Par contraste, comme le montre ici Pierre Magnard, la sagesse de Socrate ne consiste pour Montaigne qu’à « faire dûment l’homme ». Frédéric Brahami montre quant à lui pourquoi Socrate n’appartient pas, comme Homère,
Alexandre ou Épaminondas, aux « plus excellents hommes », c’est-à-dire ceux qui ont exploré l’humanité dans ses limites, mais constitue un modèle de l’humanité pour ainsi dire commune ou de l’humanité en son centre. C’est cette humanité qu’exprime le visage de Socrate, par-delà sa laideur légendaire, montre ici Bernard Sève – et c’est cette même expressivité du visage que Montaigne revendique pour lui-même.
Il n’y a pas pour autant d’ontologie de l’homme chez Montaigne, comme le rappelle Paul Mathias : « faire l’homme », ce n’est que s’ajuster à l’être, pris dans son caractère opaque, mouvant, et contradictoire, et réaliser ainsi sur un nouveau mode (le mode des modernes) l’harmonie entre l’homme et le monde. C’est à tort qu’on a pris pour de l’inspiration démonique la capacité socratique (et donc humaine) à faire face aux situations incontrôlées et à réagir à la vicissitude, comme le montre André Tournon en partant de la lecture critique, mais aussi partielle, et finalement convergente sur l’essentiel, que Montaigne fait de Plutarque. L’homme se caractérise autant par cette capacité de son esprit que par ses limites. C’est là le double sens, nous dit Alain Legros, du « Selon qu’on peut », expression socratique dont Montaigne avait fait sa devise, prise au double sens de l’affirmation d’une limite, mais aussi de l’affirmation d’une authentique capacité à l’intérieur de ces limites, permettant à l’homme de vivre « à propos ».
Il y ainsi un « humanisme » montaigniste, que tente de définir Bruno Pinchard en le distinguant de l’humanisme rabelaisien. Montaigne récite l’homme au présent, alors que Rabelais a le projet de le former pour l’avenir. À ces deux humanismes correspondent deux socratismes : un socratisme de la réflexion pour Montaigne, un socratisme de l’inspiration pour Rabelais. Ces deux socratismes, ralelaisien et montaigniste, tracent les deux grandes voies de notre humanisme contemporain.
Les commentateurs ont souvent vu dans le portrait de Socrate des Essais, un portrait de Montaigne lui-même. Ainsi, pour Hugo Friedrich, « Montaigne se peint lui-même quand il peint Socrate ». Si Frederick Kellermann nous prévient que « Le Socrate de Montaigne n’est ni Montaigne ni Socrate, mais l’impact de la personnalité de Socrate sur la personnalité de Montaigne4 », il n’en écrit pas moins qu’« on a
l’impression que quand Montaigne décrit Socrate, il se décrit aussi lui-même » ou encore que « Socrate est le porte-parole de Montaigne dans les Essais5 ». Albert Thibaudet nous semble ici ouvrir un champ d’investigation peut-être plus stimulant en écrivant dès 1933 que « Montaigne est notre Socrate6 ». Car c’est en grande partie par la médiation de Montaigne que Socrate devient un interlocuteur privilégié de notre modernité. Et ce que nous nommons le « socratisme » désigne sans doute un certain idéal incarné par Socrate, mais par un Socrate revu au prisme des Essais.
Pierre-Maxime Schuhl écrivait en 1960 que « Sans doute n’eût-on pu faire plus grand plaisir à Montaigne qu’en l’appelant : le Socrate français7 ». Ce qui frappe, justement, est qu’il n’était pas si clair aux contemporains de Montaigne que celui-ci fut un « Socrate français ». Si, comme le rappelle Suzel Mayer, l’expression se trouve dans l’acte de citoyenneté romaine accordée à Montaigne en 1581, elle ne se trouve pas chez Juste Lipse, qui, dans sa lettre élogieuse de 1583 (donc sur la base des deux premières éditions, de 1580 et de 1582, des Essais), le nomme le « Thalès français8 » pour avoir fait de la connaissance de soi-même l’essence même de la sagesse. Montaigne sera encore nommé par Étienne Pasquier, ou encore par François Garasse (à l’époque où il défend encore Montaigne contre Charron), un « autre Sénèque en notre langue » ou le « Sénèque françois », pour avoir ramené la philosophie à son objet moral. Ces traits, nous les prêtons aujourd’hui comme naturellement à Socrate bien plus qu’à Thalès ou même à Sénèque : mais n’est-ce pas en grande partie parce que « notre » Socrate a été pour une large part « inventé » par Montaigne – et ce principalement dans la dernière couche de rédaction de ses Essais ? Ce que nous nommons l’idéal socratique ou le « socratisme » n’est-il pas en grande partie inspiré par cette magnifique fiction peinte par Montaigne ? Et n’est-ce pas au fond avec Montaigne que Socrate (plus que Platon ou Aristote) devient la figure tutélaire de la philosophie ?
Ce recueil d’articles constitue l’aboutissement d’un travail commencé lors du colloque de Lyon de novembre 2008, et préparé par un premier colloque organisé en 2006 par Suzel Mayer sur la « Réception de la figure de Socrate de l’Antiquité au début de la Renaissance9 ». Le colloque de 2008 et la publication de ce collectif n’ont été rendus possible que grâce à l’aide financière du Conseil scientifique de l’Université Jean Moulin-Lyon 3, du Collège International de Philosophie, du Conseil Général Rhône-Alpes et de la Mairie de Lyon.
Thierry Gontier
Suzel Mayer
[1]Cf. Essais, II, 11, p. 423 [A] ; II, 12, p. 501 [C] et p. 1038 [B] ; III, 12, p. 1057 [B] ; III, 12, p. 1054 [C] ; III, 13, p. 1076 [C].
[2]Essais, III, 12, p. 1037.
[3]Essais, II, 12, p. 505 [A].
[4] « Montaigne’s Socrates », The Romanic Review, New-York, Columbia University Press, 1954, p. 171.
[5] « The Essays and Socrates », Symposium, New-York, University of Syracuse, X (1956), p. 215.
[6] « Portrait français de Montaigne », Nouvelle revue française [NRF], Paris, avril 1933, p. 650.
[7] « Montaigne et Socrate », Études platoniciennes, Paris, PUF, 1960, p. 166.
[8] J. Lipse, Lettre à Michel de Montaigne du 15 avril 1588, trad. O. Millet, La Première Réception des Essais de Montaigne (1580-1640), Paris, H. Champion, 1995, p. 51.
[9] Ce colloque a fait l’objet d’une publication dans la revue Diagonale F, revue de l’Institut de recherches philosophiques de Lyon (IRPhiL) no 2 (2008).