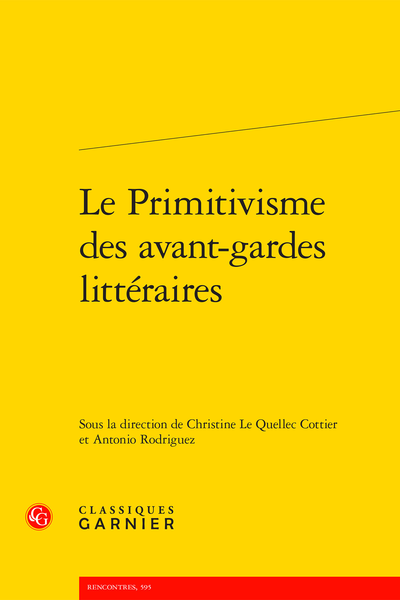
Préface Une esthétique primitiviste face à la pluralité des avant-gardes littéraires
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: Le Primitivisme des avant-gardes littéraires
- Authors: Le Quellec Cottier (Christine), Rodriguez (Antonio)
- Abstract: Le « primitivisme » suscite aujourd’hui des réserves face à un modèle foncièrement asymétrique, même s’il a été un ressourcement pour les avant-gardes qui puisaient dans les marges de l’imaginaire social. Les apports et les écarts du primitivisme littéraire sont à cartographier au xxe siècle, car cette esthétique ne naît pas d’une relation directe à un autre modèle original, « primitif », mais investit une multitude d’objets, de traditions, de styles ou de thèmes, à situer contextuellement.
- Pages: 7 to 28
- Collection: Encounters, n° 595
- Series: Twentieth and twenty-first century literature, n° 46
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406151203
- ISBN: 978-2-406-15120-3
- ISSN: 2261-1851
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15120-3.p.0007
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 09-20-2023
- Language: French
- Keyword: Esthétique, darwinisme social, oralité, canon, sources, marges
Préface
Une esthétique primitiviste face à la pluralité
des avant-gardes littéraires
Le « primitivisme » enrichit le débat actuel sur les arts et la littérature en diverses langues, même s’il suscite d’emblée une réactivité morale et plusieurs réserves face à un modèle avant tout fondé sur une asymétrie. Sans aucun doute, il nous faut désormais considérer cette notion avec une distance contextuelle indispensable, alors qu’elle continue à sourdre dans les arts contemporains. Elle rassemble dans le temps, l’espace ou les groupes sociaux, des approches esthétiques souvent traitées de manière séparée, monographique ou hétérogène. Car la notion se rapporte à une construction de l’Autre au sein de l’ethnocentrisme occidental, dans les milieux de l’art et des lettres, tout particulièrement au moment de la seconde vague de mondialisation par la colonisation1, portée par la révolution industrielle. Des visions de la littérature consolident alors l’identité nationale et l’influence impériale. Aussi, afin de construire cet Autre « primitif », les références à des « sources », des « objets », des « traditions orales » se révèlent aussi multiples qu’hétérogènes, incluant les artefacts et les rites exotiques des colonies (Afrique, Océanie, Amérique précolombienne), des civilisations archaïques hors de la culture classique (Égypte, Sumer par exemple), mais également l’art rupestre, les dessins d’enfants, la sexualité ou encore la fécondité des femmes2. Le primitivisme s’inscrit dans un « darwinisme social » qui souligne combien « l’altérité artistique était en voie de colonisation, en dehors de l’Europe certes, mais 8aussi sur son propre territoire3. » Un tel rapport asymétrique peut être compris aussi bien sous le signe d’une ouverture que d’une clôture, d’une médiation des cultures que d’un asservissement des colonies.
La notion de « primitivisme littéraire » offre une réelle opérativité pour considérer les œuvres littéraires modernistes ou d’avant-garde au xxe siècle, notamment dans une des principales capitales des arts et des lettres : Paris. Afin de lever d’emblée quelques malentendus, le geste critique fondamental consiste ici à distinguer le « primitivisme » en esthétique de l’attribution du terme « primitif » à des œuvres, comme pour les « sculptures primitives », le « cinéma primitif » ou, avec des euphémismes, les « arts premiers ». Le « primitivisme » des écrivains et des artistes ne se confond nullement avec des objets, des œuvres ou des civilisations qui étaient qualifiés alors de « primitifs », mais il s’appuie et transforme ces éléments comme des sources d’une esthétique singulière. Le terme reste imprégné par l’historisme romantique du progrès et également par le darwinisme appliqué à la littérature, notamment après l’essor des théories de Ferdinand Brunetière4. L’esthétique avec des composantes primitivistes touche différentes avant-gardes sans que le terme apparaisse forcément dans le contexte d’origine5. C’est pourquoi une telle esthétique pourrait parfois ressembler à une « illusion d’optique » construite a posteriori6, comme l’a indiqué Jean Dubuffet. Pourtant, elle met en évidence un élément fondateur et transversal des avant-gardes littéraires occidentales.
9Les objets hétérogènes du primitivisme
Alors que Cendrars ou Tzara optent pour des traditions africaines, Guillaume Apollinaire choisit davantage des sources médiévales, tandis que Max Jacob considère le folklore breton ou la poésie pour les enfants. D’aucuns retrouvent ainsi des formes originelles dans des contes, dans des formats littéraires pour grand public comme Fantômas ; d’autres dans des arts dits « populaires » comme le cinématographe naissant, le cirque des saltimbanques, le music-hall. Les sources du primitivisme se révèlent nombreuses, mais elles ne divergent pas d’une esthétique commune et identifiable. Adopter le pluriel avec « les primitivismes » ne résout pas le faisceau de problèmes de cette notion. Comment en garantir la singularité alors qu’il existe une pluralité d’œuvres, de déterminations différentes ? Au lieu de dire que les sources sont « primitivistes » en tant que telles, nous devons souligner combien elles relèvent d’un environnement culturel, dans lequel elles sont considérées comme « primitives ». À partir de là, des artistes et des écrivains transforment ces sources selon une esthétique, que nous qualifions de « primitiviste », et qui instaure une relation particulière. Les créations littéraires primitivistes se distinguent alors de la relation ethnographique, scientifique, face à ces « documents ». Par le choc qu’elle suscite, cette relation ne se confond pas avec la délectation désintéressée, mais elle implique des actions, des évaluations pour celui qui l’expérimente.
Afin de mieux définir la notion, nous devrions éviter trois écueils qui sont autant de tentations critiques pour la consolider. Tout d’abord, nous devrions éviter d’homogénéiser les objets pour généraliser la notion à partir d’un corpus trop délimité : par exemple, prétendre que le primitivisme ne s’applique qu’aux colonies africaines et océaniennes. La généralisation, ensuite, par des caractéristiques transhistoriques (du « barbare » chez les Grecs à l’« appropriation culturelle » aujourd’hui) ne permet pas de comprendre dans quelles circonstances précises, dans quels réseaux la notion elle-même a pris une ampleur esthétique (début, développement et fin éventuelle). Dernier point, la notion se consolide dans des situations et des imaginaires géographiques et sociologiques : dans notre cas, les milieux littéraires au contact des 10milieux artistiques, à Paris principalement, comme dans d’autres capitales impériales.
Les œuvres littéraires primitivistes adoptent plusieurs types de « ressourcement ». Si elles se tournent systématiquement vers ce qui est primordial ou premier, elles le font à partir de cinq modalités principales, que nous pouvons dégager de nos études. Elles s’appuient parfois sur un imaginaire spatial (comme les colonies, les nouveaux mondes, les espaces extrêmes, les utopies), mais aussi sur un imaginaire social (par le biais de la sociologie et de l’ethnologie), un imaginaire historique (pour retrouver les sources par-delà la lignée, avec un caractère archaïque), un imaginaire esthétique ou médiologique (les genres littéraires, les formes, les arts populaires) ou encore à partir de catégories logiques qui s’opposent à l’identité rationnelle. Lors de nos recherches collectives, nous avons tenté de rassembler les termes associés à nos objets pour parvenir à un ensemble de mots. Le tableau ci-dessous, non exhaustif, montre justement autant de termes de différentes époques, que les rédacteurs du présent volume ont pu considérer dans leurs études.
À partir de ce lexique, des sources différentes sont mobilisées et produisent des œuvres en apparence bien hétérogènes. Pourtant, derrière cette multiplicité se tient une forme de « primitivisme littéraire » qui instaure une relation esthétique particulière7, tant pour les auteurs que pour les lecteurs. Ces principes se trouvent enrichis d’un contexte non seulement historique, mais également géographique et institutionnel. En effet, la création littéraire adepte du primitivisme est fortement associée aux réseaux artistiques, voire au marché de l’art. Une telle esthétique se trouve alors valorisée par des peintres, des sculpteurs, des musiciens, mais aussi par des collectionneurs d’art et d’objets tribaux. Si Paris occupe une place déterminante pour cette esthétique en peinture et en littérature, il ne faudrait pas oublier la forte circulation qui a lieu entre les capitales impériales à ce moment-là. La littérature en français participe ainsi à des mouvances plus larges, polycentrées, dont les liens aux arts visuels ont été déjà souvent commentés. Tout comme les objets pluriels du primitivisme, les contextes gagnent alors à être traités plus subtilement.
11|
Imaginaire spatial |
Imaginaire social |
Imaginaire historique |
Imaginaire esthétique |
Imaginaire logique |
|
Afrique Colonies Cosmopolite Désert Exotisme Grand Nord Grand Ouest Océanie Orient Extrême-Orient Nouveau Monde Transatlantique Ur Utopie |
Amérindiens Amulette Animisme Bohème Bretagne Chaman Cosmique Démiurge Enfance Esprits Exorcisme Femme Folie Folklorique Foule Magie Mysticisme Noir/« Nègre8 » Orphisme Paysan Populaire Religion Rite Sauvage Sexualité Vaudou |
Adamique Aède Anti-tradition Archaïque Barbare Barde Non canonique Commencement Édénique Moyen Âge Originel Premier Précolombien Préhistoire Primitif Primordial Rupestre Source |
Arts décoratifs Brut (art brut) Collage Cinéma Conte Corps Cri Danse Épopée Idéogramme Légende Masque Manuscrit Matière Oralité Performance Poupée Sculpture Statuette Voix |
Alogisme Altérité Bestialité Débilité Décentrement Élémentaire Fragmentaire Imaginaire Inconscient Instinctif Intuitif Juxtaposition Marge Naïveté Palimpseste Préréflexif Pulsion Pureté Renversement Spontanéité Vitalisme |
Tab. 1 – Liste de termes fréquemment associés au primitivisme littéraire.
12Un écart vers le primordial
Longtemps constitutive d’une relation aux arts plastiques qui la cantonnait à une fonction d’« archaïsme salvateur9 », la notion de primitivisme gagne à être pensée en tant qu’écart au début du xxe siècle, que celui-ci soit d’ordre culturel ou chronologique, pour reprendre une terminologie utilisée par Lovejoy et Boas dès 193610. Le philosophe et l’anthropologue qualifiaient le primitivisme de culturel pour désigner les expressivités extra-européennes et de temporel pour les cultures populaires, rurales, archaïques, mais aussi préhistoriques mises au jour en Europe. Cependant, le lien au « primordial » a des formes multiples et ne cesse de traverser temps et espace, sans que la remontée du temps soit un attribut nécessaire : il importe parfois de regarder autour de soi, autrement. L’attrait artistique pour un monde premier, ou supposé tel, souligne une volonté de distanciation des référents canoniques qui imposent une lecture figée des valeurs artistiques, celles fondées en Occident par le goût séculaire de la figuration réaliste11. Par contraste, le détournement du regard, orienté vers des créations « considérées comme des œuvres primitives12 » – qu’il s’agisse d’un folklore européen ou d’une statuaire souvent africaine – a généré des métamorphoses dans la mesure où les artistes ont été transformés par les productions qu’ils découvraient : le primitivisme est un processus qui engage un mouvement d’interaction, mouvement de translation qui met à mal le « mythe fondateur de l’art moderne » bâti sur l’idée que les musées 13d’ethnographie « recelaient des trésors dont leurs gardiens étaient inconscients jusqu’à ce que les artistes, puis, guidés par eux, marchands et collectionneurs, en découvrent la valeur13 ». La critique du mythe n’annule pas le processus de découverte mais le réoriente, car elle oblige à tenir compte de l’impact de la rencontre, en tant que modification de chacun des acteurs, tant l’artiste que l’objet projeté dans un nouveau circuit de sens. Pour l’anthropologue Philippe Descola, il s’agit d’un processus de « re-connaissance14 » mutuelle, bien qu’inégale, ce que le philosophe S. Bachir Diagne soutient quand il évoque les artistes en tant que médiateurs, ayant accompli un « geste de réciprocité » grâce à une forme de « traduction » qui ne pouvait, de fait, « combler l’écart entre équivalence et adéquation totale15 ».
Ainsi, reconnaissons l’écart comme générateur de représentations symboliques qui animent les modalités de création, qu’il s’agisse de motifs ou de formes poétiques. Les esthétiques littéraires primitivistes ne sont pas une forme redondante des créations picturales dont la naissance a souvent précédé celle des fictions. La démarche littéraire procède avec un autre scénario, car elle n’a pas de relation directe avec des créations littéraires dites primitives, notamment lorsqu’elles sont extra-européennes. L’aspect anti-mimétique se manifeste donc dès l’origine de la relation : l’inspiration littéraire primitiviste se fonde sur une projection qui n’est pas liée à une source originelle, puisque celle-ci était souvent inaccessible ou reconstituée par des savants ou des missionnaires. De fait, les formes de la création littéraire sont sa force même, aniconique, et son agencement se perçoit par les spécificités de sa composition16. Nous postulons donc, à l’inverse de Dagen, que la figure de style ne dégrade pas la figuration17, car la rhétorique est, dans le cas du primitivisme littéraire, une 14invention chaque fois renouvelée – une figuration nouvelle – et non la reprise d’un motif ou d’une forme supposée « primitive ».
Dès lors, qu’en est-il d’un « primitivisme littéraire » ? La relation à une esthétique dite primitiviste convoque les traditions populaires orales – folkloriques (chants, contes) – que ce soit en Europe, en Afrique ou sur d’autres continents – dans un mouvement qui cumule primitivisme culturel et chronologique. La transmission orale séculaire a été convertie en transposition écrite par les détenteurs d’un savoir ethnographique : l’accès à une prétendue primitivité de l’expression et de la langue est donc dépendant d’un filtre savant. Si Picasso peut déclarer « Tout ce dont j’ai besoin de savoir sur l’Afrique se trouve dans ces objets18 », la source textuelle pour l’auteur rend caduque ce contact immédiat : il n’y a pas d’accès direct à un écrit primitif au même titre qu’aucune langue n’est en soi primitive. Cet écart, créé par la saisie scientifique d’une culture jugée décadente, en Europe, et primitive, hors des métropoles occidentales, place immédiatement les sources dans une situation de « défaillance » puisqu’elles ont le statut de réécritures et recyclage d’un matériau alors inaccessible. Les auteurs ont conscience de ce palimpseste, et à leur tour vont composer en ne cherchant nullement une adéquation à un supposé référent réaliste ou mimétique19 : l’écriture fictionnelle et poétique conforte une mise à distance du réel, motivée par les sources fabriquées. De fait, le processus créatif rejoue l’écart reconnu entre signifiant et signifié, propre à l’écriture. L’arbitraire du signe est rejoué par l’abstraction de la figuration.
Dans le cas du modèle extra-européen, comme l’a démontré Jehanne Denogent20, les écrivains souvent associés à des mouvements « per15turbateurs » se sont révélés de patients érudits passant des heures en bibliothèques pour recopier des contes, des récits, des chants, qu’ils ont ensuite souvent transformés : l’acte primitiviste s’avère bel et bien un rapport transmédial. C’est en ce sens que Denogent a proposé le terme « palimpsestes africains » pour évoquer la relation particulière à cet ailleurs spatial et culturel, une « Afrique de papier » construite à partir de sources ethnographiques ou de représentations fantasmées du continent décrit de longue date comme une altérité absolue, avant de devenir l’espace nécessaire à une réinvention de soi. Le primitivisme littéraire est ainsi à définir a contrario de l’exotisme, caractérisé par un « imaginaire préconstruit où la représentation de l’altérité obéit à des structures fantasmatiques collectives21 » ; l’exotisme se veut une altérité positive « dans le contexte de l’expansion européenne » cautionnée en fonction d’une hiérarchie des peuples, devenue « synonyme d’artificialité » dès la fin de la Première Guerre mondiale, avant que Lévi-Strauss ne le désigne comme une « scorie de la mémoire22 ». La diversité des pratiques se matérialise au sein d’un réseau et de sociabilités23 où le goût pour une création marginale favorise des appartenances et des reconnaissances transversales ; ainsi, comme a pu l’écrire Henri Meschonnic, le primitivisme est bel et bien une part constitutive de la modernité24.
Les textes primitivistes du début du xxe siècle, temps des avant-gardes historiques, ont conscience de générer un écart et se veulent transgressifs par le choix de leurs motifs et celui de leur expressivité : leurs modèles alternatifs renvoient autant au monde rural, archaïque, qu’à celui des fous et celui des enfants, à la préhistoire qu’au monde extra-européen. L’intérêt esthétique pour ce dernier est en 1900 perçu 16comme « une provocation25 », car la statuaire puis les récits « nègres26 » glissent du statut d’artefacts à celui d’arts27. Les écrivains d’avant-garde qui s’emparent d’un objet primitif, conscients des usages discursifs pour fabriquer des imaginaires et des formes, inventent des motifs et des esthétiques. Diverses pratiques ont été explorées, qui toutes ont valorisé l’expressivité contre la représentation : l’oralité, la performance et la contestation de la structure de la langue fondent une relation sensible au langage. Les auteurs s’approprient avec jouissance et ironie les traits caractéristiques des sociétés extra-européennes dites « pré-logiques » et donc « primitives » qu’un Lévy-Bruhl s’évertuait à décrire28. Ce monde artistique européen affirme une altérité pour transformer le système axiologique, sans pour autant qu’une forme concrète d’engagement politique soit présente29. L’Orientalisme, par Edward Saïd, puis L’Invention de l’Afrique par Valentin Mudimbe30, ont mis en évidence les présupposés structurels, tant idéologiques et philologiques, d’une époque de domination impériale. Mais face à la violence et au mépris, les poètes n’ont pas toujours pris leurs distances ; leur engagement s’affirme par leurs choix esthétiques, valorisant des objets, sans lien avec ceux qui les avaient générés, des « sujets ». Le primitivisme littéraire, parce qu’il 17ne réfère à aucune réalité tangible ou accessible, est une adresse de l’Europe à l’Europe.
Une recherche internationale
sur le primitivisme : état des lieux
La notion de primitivisme mobilise désormais de nombreux chercheurs issus de contextes culturels différents. Ce « retour » d’une notion à laquelle restent attachés des « prémisses et présupposés racistes et colonialistes31 » s’avère significatif d’un temps où la légitimité des discours se négocie souvent en fonction des appartenances des uns et des autres : il importe cependant d’éviter les anachronismes et les amalgames, car parler d’« appropriation culturelle » pour qualifier la relation des artistes de l’avant-garde historique à ces productions mérite discussion32. Les travaux récents qui ont aussi nourri nos recherches participent à cette réévaluation, en contextualisant une dynamique créative qui s’est souvent voulue émancipatrice et engagée. Ce postulat marque une distance avec la lecture primitiviste des arts plastiques qui s’est appliquée à décontextualiser les productions extra-européennes pour les intégrer à un marché de l’art, en les détachant de tout enjeu politique ou social33. Le tournant du xxie siècle peut être retenu comme moment de ré-émergence et de questionnement – dans la sphère française et francophone – d’un rapport à l’autre dans les sociétés européennes, pointant des inégalités et des hiérarchies implicites, des sources de tension : celles-ci, politiques et sociales, ont impliqué un regard rétrospectif pour faire face aux écueils historiques qui les ont 18générées. L’ouvrage collectif Retour du colonial ?, paru en 2008 sous la direction de Catherine Coquio, en est à ce titre un exemple saisissant, permettant de lire en filigrane les conséquences du modèle assimilationniste français et, par contraste, les enjeux d’une politique de la diversité culturelle. En 2007, l’essai de Benoît de L’Estoile, Le Goût des Autres. De l’Exposition coloniale aux arts premiers, met au jour les fondements idéologiques, culturels et politiques de l’Exposition de 1931, à Paris, en analysant les discours qui traversaient le monde colonial : l’un, évolutionniste, soutenant la hiérarchie des peuples, l’autre, primitiviste, valorisant la différence pour rompre avec les valeurs occidentales bourgeoises. L’auteur analyse les mises en scène de l’exposition et discute de l’imprégnation primitiviste34, en remontant dans le temps : « Dès la fin du xviiie, des artistes s’affirment “primitifs” afin de contester le modèle de l’Antiquité classique […]. C’est effectivement au xviiie siècle que s’est mis en place un récit de l’histoire de l’humanité où les peuples de l’Antiquité et les peuples sauvages sont mis en parallèle35 ». Les plus récents ouvrages Discours sur le primitif36 et Les Savoirs des barbares, des primitifs et des sauvages37, en associant plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales, du xviiie au xxe siècle, permettent de saisir ce phénomène dans toute sa diversité.
L’actualisation du « débat primitiviste » en littérature – incluant une « renaissance de l’archaïsme38 » quand il s’agit de commenter les inspirations régionalistes – a été marquée par l’essai fondateur de Jean-Claude Blachère, Le Modèle nègre. Aspects littéraires du mythe primitiviste au xxe siècle chez Apollinaire, Cendrars et Tzara39, paru en 191981, dont nos réflexions ont hérité à propos des poètes modernistes. L’intérêt s’est renouvelé en 1992 avec Primitivismes, numéro spécial de la Revue des Sciences humaines dirigé par Bernard Mouralis, où plusieurs études abordent le succès de la figure du primitif parmi les écrivains de la fin du xixe siècle, alors que parallèlement s’érige en Europe la hantise de la « dégénérescence », jugement de valeur d’une société conservatrice récusant l’éclectisme de modes de vie dits sauvages, dont les écrivains seraient les complices40. En 1995, le dictionnaire de Joachim Schutze, Wild, irre und rein : Wörterbuch zum Primitivismus der literarischen Avantgarden in Deutschland und Frankreich zwischen 1900 und 1940, présente la notion comme un « champ sémantique, rassemblant une pluralité de motifs (le sauvage, le barbare, le fou, l’enfant, mais aussi les idées de “pureté” et d’authenticité) qui circonscrivent une relecture éminemment moderne du mythe du bon sauvage, une sorte de miroir renversé et de paradis perdu par une société occidentale égarée par l’industrialisation, le matérialisme et la foi aveugle dans le progrès41 ». Ce spectre très large prend source avec Rimbaud dont la trace est suivie jusqu’à la Seconde Guerre mondiale : les figures du sauvage et du barbare y sont partie prenante de la société européenne qui les dénonce, ou les revendique, selon des enjeux esthétiques et politiques divergents.
La diversité du modèle primitiviste est au cœur des essais majeurs de Philippe Dagen, Primitivismes. Une invention moderne (2019) et Primitivismes II. Une guerre moderne (202042) où la césure éditoriale est motivée par le surgissement de la Première Guerre mondiale, confrontation violente des sociétés, des individus et des cultures, point de bascule d’une relation à soi et aux autres. Proposée au pluriel, la notion de primitivisme ne doit pas, selon Dagen, être restreinte au domaine des arts plastiques, mais bel et bien être envisagée dans sa pluralité, à 20la fois politique, sociale, philosophique et littéraire, afin de mettre à nu les tensions qui cristallisent les sens et les enjeux transversaux d’une perception de l’homme et de ses origines, source de cette « passion du primitif43 ». Le primitivisme – dans toute sa diversité, puisque les catégories de Schutz et de L’Estoile sont appliquées44 – est ainsi constitutif de la modernité techniciste, réactif puissant qui oblige à se définir a contrario. Les analyses – qui dans le premier volume se concluent sur la quête des primitifs, mélanésiens ou bretons, par Gauguin – amplifient celles proposées dans le volume Le Peintre, le Poète, le Sauvage. Les voies du primitivisme dans l’art français dont l’orientation, en plaçant Gauguin en amorce de la réflexion, ciblait principalement les arts visuels. Ainsi, vingt ans après cet essai incontournable, Dagen propose un cheminement pour comprendre les « circonstances intellectuelles des primitivismes45 » et, grâce à l’analyse de sources nombreuses, perçoit les primitivismes comme « un ensemble d’arrachements ». Pour les artistes qui manifestent leur détachement du monde rationnel en remettant en question une perception univoque du monde, ce « renversement du regard » vise à « se détacher d’une civilisation moderne dont ils mesurent combien elle sépare l’être humain de la nature, de sa nature, de lui-même donc46 ».
En questionnant cette orientation dans le monde germanique, Nicola Gess a proposé dans son dernier essai, traduit en anglais en 2022, Primitive Thinking47, une réflexion fondée sur la dialectique primitiviste pour en dégager les enjeux philosophiques au début du xxe siècle, à partir des écrits de Carl Einstein et Max Weber48. Elle met en évidence quatre points de convergence qui modifient la relation au monde des intellectuels et artistes. Ceux-ci admettent la présence de « forces » perturbant la maîtrise du temps, et donc d’un devenir dont le contrôle est inopérant. Le 21primitivisme, alternative à la désillusion, prend ainsi corps à la fois en un récit de l’origine, en un outil discursif pour une critique de civilisation, en une utopie littéraire et un diagnostic du temps présent. Ce dernier point fait la jonction entre l’utopie archaïque et le temps vécu, impliquant le caractère politique de cette pensée primitiviste dans le champ allemand, où Carl Einstein affirmait en 1919 que la reconnaissance de l’art primitif signifie « un refus de l’art inféodé au capitalisme49 ». Cet engagement politique qui caractérise les avant-gardes germaniques50 se lisait déjà en 1908 dans l’essai de Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung « pour lequel l’homme est aujourd’hui, par rapport à l’image du monde, aussi perdu et impuissant que l’homme primitif51 ».
Les recherches récentes se consacrent aux formes des discours et des représentations symboliques, indépendantes de l’histoire de l’art : l’hétérogénéité du primitivisme a élargi la recherche vers des « figurations » arbitraires, des discours formels plutôt que des motifs. Ceux-ci avaient été saisis dès 2006 par Isabelle Krzywkowski, dans l’indispensable essai comparatiste « Le Temps et l’Espace sont morts hier ». Les Années 1910-1920. Poésie et poétique de la première avant-garde, qui a postulé l’existence et la spécificité d’un primitivisme littéraire n’étant ni un exotisme, ni une forme de retour au primitif : « Le primitivisme ne saurait être réduit à l’exotisme, mais on ne peut nier que son développement dans les années 1910-1920 s’accompagne d’un nouvel essor de la littérature de voyages, qui peut faire l’objet de réalisations très diverses : reportages d’esprit 22cosmopolite, romans d’aventures, récits coloniaux, poèmes en vers ou en prose se rapprochant volontiers chez certains du projet d’épopée moderne qu’avaient relancé les années 1905-191052 ». La démarche de la chercheuse s’est concentrée sur les créations formelles des poètes, sous-tendues par la quête d’une langue première qui « n’est ainsi pas celle qui est à l’origine des langues, mais celle qui origine la langue poétique53 ». De fait, cette quête implique un détachement de l’indiscuté, car « les langues européennes, perverties par “l’universel reportage”, comme par une approche du langage fondée sur la signification et la représentation, ont perdu cette richesse plastique qui est aussi puissance illocutoire54 » privilégiant l’expression, grâce aux sons et aux rythmes. Ainsi, l’étrangeté prend forme avec la poésie sonore, le bruitisme, le photomontage, la performance corporelle et la déclamation ; gestes qui mettent à mal la structure de la langue. Les expressivités corporelles sont perçues comme une autre langue, instinctive, à associer aux mots connus ou inventés, car la littérature doit redevenir une forme de vie, partie prenante d’une spiritualité et d’une liberté que les institutions méconnaissent : en 1902, déjà, René Ghil offrait « Le Pantoun des pantoun » ; en 1916, Hugo Ball proposait la « poésie des mots inconnus » et tant Cendrars que Tzara fabriquaient ou traduisaient des « poèmes nègres ».
Cette présence d’un primitivisme littéraire est l’enjeu discuté par Ben Etherington dans Literary Primitivism, paru en 2018, dont le postulat innovant est que le primitivisme n’est pas un projet spécifique à l’Occident. Etherington étudie le primitivisme littéraire en tant que fiction contestataire opposée à l’impérialisme capitaliste55. Il présente historiquement les traces de ce qu’il nomme un « philo-primitivisme » – dès le xviie siècle dans la littérature anglo-saxonne – repérable à la présence d’un « motif » primitiviste, par exemple le noble sauvage, déjà porteur d’« enjeux narratifs critiques vis-à-vis de la conquête coloniale de l’Occident56 ». Mais cette stratégie contestataire devient un « pri23mitivisme emphatique » avec la montée de l’impérialisme capitaliste à la fin du xixe siècle : les avant-gardes européennes font de la quête du « primitif » un leitmotiv expressif et poétique, et celui-ci dépasse selon Ethrington tout clivage racial : ainsi le Cahier d’un retour au pays natal est perçu comme un acte primitiviste, historiquement situé et engagé par un sujet écrivant. De façon inattendue, l’analyse d’Etherington récuse une lecture décoloniale de la notion associée encore souvent à un principe actif de domination structurelle. D’un point de vue intersectionnel, le chercheur déplace les critères de référence en éliminant celui de la race au profit de la classe, et poursuit l’analyse d’une pratique primitiviste hors du référent chronologique des avant-gardes historiques57. Cette analyse transculturelle noue des liens avec « l’ensemble d’arrachements » considéré par Dagen, en proposant la lecture située d’une notion connotée. Dans cet essai, qu’il s’agisse de D. H. Lawrence, Césaire ou Damas, la création littéraire est un accès alternatif au plaisir d’être primitif.
Le primitivisme littéraire s’avère une dynamique transculturelle, internationale et cosmopolite dont les expressions ont essaimé dans toute l’Europe au début du xxe siècle, en Russie aussi bien, comme le montre avec force le collectif Les Primitivismes russes de la revue Slavica Occitana, paru en 2021. Les poètes russes caractérisés par ce goût primitiviste, bien qu’attentifs aux cultures d’Afrique subsaharienne, ont un lien plus puissant avec le monde paysan et toutes les formes de traditions populaires intérieures à cet empire dont l’altérité se trouve d’abord en allant vers l’est, en « Extrême-Orient ». Le constat archaïsant – proche de l’idiot dada – conforte des expressivités qui valorisent le simple, l’innocent, l’enfantin, non limité à un temps colonial. Cette caractérisation esthétique – impliquant formes et motifs – reconnaît aussi un primitivisme littéraire hors du temps des avant-gardes historiques, puisqu’il implique un rapport au monde qui se lit telle une phénoménologie, une relation au monde sensible58 qui dépasse tout carcan chronologique.
24Le développement d’une civilisation occidentale, fondée sur son pouvoir national, colonial et par l’essor conjoint de l’industrie littéraire, de la recherche, de l’éducation tout comme des institutions culturelles et muséales, amène à s’interroger sur les fondements d’un primitivisme fait par les mots, par le papier bien souvent, ou par des performances. En quoi les mots, par-delà la peinture, la musique ou la sculpture, renouvellent-ils la capacité de raconter, de décrire ou d’évoquer ? Le primitivisme s’inscrit face au développement sans précédent des sciences de l’esprit (psychologie, psychanalyse, phénoménologie), des sciences sociales (sociologie, ethnologie) et des sciences naturelles (physique, chimie). Les écrivains reflètent à travers les avant-gardes les doutes permanents d’une société soumise au fonctionnalisme, à la rationalité instrumentale et à un capitalisme industriel particulièrement violent59. Les avant-gardes, qu’elles soient révolutionnaires ou non, adoptent le primitivisme comme un moyen de contester les valeurs institutionnalisées et de proposer un ressourcement de la société. En littérature, l’hybridation passe par les contes, les fables, les comptines, les récits populaires, mais aussi par un traitement du cirque, de la danse, du cinéma, de la chanson ou de la presse. En somme, les textes littéraires prennent appui sur une intertextualité et un ensemble de discours, de mises en forme préexistantes. Ces sources renvoient souvent à d’autres lieux ou à d’autres époques, comme si l’horizon temporel de l’évolution s’inscrivait dans une géographie projetée sur d’autres continents : les temps passés se retrouvent au même moment, mais ailleurs dans l’espace. Pourtant, au lieu de comprendre l’asymétrie comme une faiblesse, les écrivains tout comme les artistes y trouvent une énergie nouvelle de création. Les sociétés impériales occidentales semblent scinder cette énergie au nom de la raison, de l’exploitation, mais aussi des canons littéraires et de l’héritage traditionnel à reproduire.
Dans le primitivisme des avant-gardes se trament des innovations littéraires qui ont marqué l’histoire littéraire du xxe siècle pour différents genres : les premiers élans de la poésie sonore, l’oralité dans le roman, la narration à la première personne, les techniques de dialogue à outrance, 25les temporalités simultanées, la superposition des voix, les cris chez Artaud sont autant d’éléments qui donnent un relief singulier à la notion de primitivisme en littérature et en font un outil indispensable pour mieux comprendre le modernisme. Et quand Henri Michaux s’adresse avec amitié à la figure de Charlot, celui qui « suit toujours son idée » et « fait triompher poétiquement son principe de plaisir », il n’hésite pas à reconnaître le primitif au cœur de la projection cinématographique : « Charlie, pour tous, tu es notre frère. / Charlie simple, primitif. / Un chapeau melon et une badine, et voilà Charlie. […] / Ô simplicité60 ». La quête du primitif n’est plus une provocation ou un propos décentré, elle occupe le cœur des formes et figures du renouvellement des arts. Il s’agit d’une performance qui englobe toutes les formes d’expressivité, spécialement celles dissociées des arts occidentaux canoniques au début du xxe siècle, tels que le music-hall, le cirque, la danse, le cinéma.
Mais la spécificité du primitivisme littéraire s’observe dans sa production même : il se constitue à partir d’une lecture approfondie de sources scientifiques, avec la conscience de l’inexistence d’un « référent primitif » et en savourant sa propre capacité à créer un décentrement initiatique.
Le primitivisme à l’ère du livre
Notre recherche a été soutenue par le Fonds national suisse de la recherche scientifique61. Elle a permis d’engager divers travaux sur le primitivisme littéraire, notamment deux thèses de doctorat62 et cet ouvrage collectif. Les cadres de ce projet étaient concentrés sur la ville de Paris, de 1898 (avec les premiers textes d’Apollinaire) à 1924 26(la naissance du surréalisme). Mais l’objectif de ce volume dépasse un ensemble d’études sur cette période. Le cadre historique s’étend en effet du milieu du xixe siècle (avec Walt Whitman et sa réception européenne) jusqu’à la fin du xxe siècle (avec les poèmes-actions de Julien Blaine). Ce déploiement temporel met en évidence l’esprit sans cesse renouvelé d’avant-gardes qui ont créé ou rediscuté la nécessité d’un ressourcement primitiviste. Bien que tenant compte de la situation dans la capitale française, les chapitres ne cessent de souligner les ramifications entre capitales européennes, occidentales, tout en englobant par l’imaginaire le monde entier. Nous avons en effet pu nous concerter pendant une semaine dans les Alpes suisses, à Leysin, afin d’élaborer cet ouvrage dépassant l’alignement d’études multiples. Cela a permis de montrer la nécessité théorique, les fondements historiques et les maillages sociologiques qui sous-tendent une telle esthétique littéraire. La transversalité de la notion, par les disciplines, les langues et les médias, y est valorisée afin que les lecteurs puissent sortir de cet ouvrage avec une notion probante, des outils opératoires pouvant être déployés avec de multiples sources.
Les études qui composent ce volume63 s’organisent en deux parties : l’une sur les usages, les définitions et les paradoxes de la notion ; l’autre comme autant d’études de cas dans l’histoire contemporaine. En ouverture de la première partie, les analyses d’Isabelle Krzywkowski montrent que le primitivisme littéraire cherche à sortir du temps linéaire, par son appel constant à un ailleurs spatial et temporel. Elle observe cette extraction au sein des avant-gardes historiques, tout en contextualisant les usages du terme « primitivisme ». La relation à l’espace est quant à elle au cœur du propos d’Antonio Rodriguez qui met en évidence la participation d’écrivains modernistes au réseau international du marché de l’art, avec une volonté de briser par le primitivisme la « lignée nationale » de la littérature et d’intéresser les collectionneurs, puis un plus large public. Cette tentation du primitivisme, comme l’observe Émilien Sermier, se retrouve chez les poètes modernistes des années 1920, métamorphosés en conteurs de récits vocalisés, où l’oralité s’associe aux cultures extra-européennes ou aux terroirs proches. Les auteurs modernistes installés dans les villes – Paris dans le cas le plus fréquent des études présentées – découvrent aussi les possibilités primitivistes dans l’intermédialité : dès 27les premières années du xxe siècle, le cinématographe naissant, avec des projections animées et populaires, devient une source, dont Nadejda Magnenat explore l’impact sur les textes poétiques. Christine Le Quellec Cottier considère les ambivalences de cette « présence primitiviste » au milieu des années 1920, lorsque les « arts industriels » affirment leur esthétique par un utilitarisme et un retour à l’ordre bien éloignés d’un ressourcement initiatique. Ces écarts de réception sont actualisés dans l’entretien que nous a accordé Souleymane Bachir Diagne à propos des intentions des avant-gardes historiques, à Paris, ainsi que de leur réception dans notre monde contemporain.
Dans la deuxième partie, les études de cas emblématiques associent plusieurs périodes du primitivisme et plusieurs continents. Bacary Sarr met en perspective ce que l’on peut considérer comme des médiations, avec Carl Einstein, Blaise Cendrars et Léopold Sédar Senghor. Néanmoins, à l’aune de Cheikh Anta Diop, un palimpseste européen porteur d’une axiologie spécifique ne peut être négligé. Cet écart interprétatif est envisagé par Jehanne Denogent sur le travail d’érudition de Tristan Tzara tout comme sur la construction éditoriale posthume du recueil Poèmes nègres, source d’un « mythe » primitiviste. L’ambiguïté de l’interprétation des actes et des créations primitivistes se joue aussi à propos de la réception américaine de Longfellow et Whitman, comme le montre Delphine Rumeau, en relevant la distance entre l’idéal du noble sauvage et le cri de la révolte. Et, bien qu’éloigné de la « sauvagerie » américaine, le monde rural est privilégié dans les romans de C. F. Ramuz que Laura Laborie perçoit comme une phénoménologie qui enrichit la portée de cette œuvre. Parmi ces études de cas, il nous a paru essentiel d’accorder une place aux créations primitivistes conçues par des femmes. L’article d’Estela Ocampo, paru en espagnol en 2015 et traduit pour ce volume, est centré sur des œuvres textuelles, picturales, photographiques et des performances féminines. Il tisse un lien entre la femme et les primitifs, d’abord perçus comme des figures consubstantielles, puis transformé par un retournement primitiviste, lorsque les artistes féminines prennent elles-mêmes en charge, en tant que sujets créateurs, cette association afin de dénoncer un statut de minorité et de subalternité. Le surgissement du féminin primitiviste, dès les années 1920, a gagné sa pleine expressivité durant le siècle, au fur et à mesure que les voix féminines européennes se sont fait entendre. Cette ouverture chronologique se retrouve dans 28l’étude de Serge Linarès consacrée à trois écrivains « scripteurs » (Michaux, Dotremont et Blaine) dont l’action première consiste à questionner les fondements de l’alphabet, source de la langue écrite. Une telle démarche lie des temps – l’origine des lettres – et des espaces – celui des supports –, en confortant notre compréhension du primitivisme littéraire. Ainsi, cette notion ne constitue pas une mouvance explicite, un groupe défini, mais traverse les imaginaires et les esthétiques contestataires, spécifiquement durant le premier quart du xxe siècle. Nous associons à ces esthétiques des pratiques plus tardives, réactives à l’air de leur temps, usant d’autres stratégies64. Cette mobilité ouvre selon nous un registre et un lexique de profusion, signes de diverses esthétiques primitivistes liées à la mondialisation culturelle depuis l’Occident.
Les ressources visuelles rattachées aux différents articles de ce volume se trouvent sur le site www.primilitt.ch.
Christine Le Quellec Cottier
et Antonio Rodriguez
Université de Lausanne
1 Voir Christian Grataloup, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du monde, Paris, Armand Colin, 2011.
2 Comme l’a récemment montré Philippe Dagen dans Primitivismes. Une invention moderne, Paris, Gallimard, 2019 ; Primitivismes II. Une guerre moderne, Gallimard, 2020. Ces ensembles sont commentés dans des traités d’époque, tel que celui de G.-H. Luquet : L’Art primitif, Paris, G. Doin et Cie, coll. « Encyclopédie scientifique », 1930.
3 Baptiste Brun, Jean Dubuffet et la besogne de l’Art Brut. Critique du primitivisme, Paris, Les presses du réel, 2021, p. 16.
4 Ferdinand Brunetière a publié Évolution des genres littéraires en 1890 (Paris, Pocket, 2000). Voir à ce propos : Béatrice Grandordy, Charles Darwin et « l’évolution » dans les arts plastiques de 1859 à 1914, Paris, L’Harmattan, coll. « Sciences et société », 2012.
5 La formule n’a jamais été une auto-désignation d’auteurs se reconnaissant dans un cénacle primitiviste, à Paris ou en Europe. Mais le volume collectif Primitivismes russes met en évidence que cette appellation était revendiquée par des poètes d’avant-garde russe (Les Primitivismes russes, Slavica Occitana, C. Gheerardyn et D. Rumeau (dir.), no 53, 2021, p. 21). Par contraste, le « Manifeste du primitivisme » paru à Toulouse en 1909 – imprégné de valeurs conservatrices et nationalistes par ses attachements à la terre et ses fondements originels – est une réaction au « Manifeste du futurisme » de Marinetti.
6 « Je crois pour tout dire que cette notion de “primitivisme” ne répond à rien sinon à une illusion d’optique », lettre de Jean Dubuffet à Françoise Choay, [11 fév. 1961], Prospectus et tous écrits suivants,t. II, Paris, Gallimard, 1967, p. 335.
7 Jean-Marie Schaeffer, L’Expérience esthétique, Paris, Gallimard, coll. « NRF essais », 2015.
8 Dans ce volume, principalement consacré aux pratiques en langue française, le terme « nègre », comme dans les expressions « art nègre » ou « contes nègres », a été utilisé contextuellement. Nous employons ce terme entre guillemets afin de rendre compte de la distance historique et idéologique qui nous sépare des propos d’époque.
9 Philippe Dagen, Le Peintre, le Poète, le Sauvage. Les voies du primitivisme dans l’art français, Paris, Flammarion-Champs, 1998, p. 247.
10 Cité dans l’introduction du collectif Les Primitivismes russes, op. cit., p. 24. Il s’agit d’une référence au célèbre volume : Primitivism and Related Ideas in Antiquity, Baltimore, Johns Hopkins Press ; London, Oxford University Press, 1935.
11 Tel que W. Rubin l’a explicité dans son ouvrage fondateur ‘Primitivism’ in 20th century art : affinity of the tribal and the modern, New York, Museum of Modern Art, Boston, 1984 ; éd. française : William Rubin, Jean-Louis Paudrat (dir.), Le Primitivisme dans l’art du xxe siècle. Les artistes modernes devant l’art tribal, Paris, Flammarion, 1991. Éléments discutés par Isabelle Krzywkowski dans « Le Temps et l’Espace sont morts hier ». Les Années 1910-1920. Poésie et poétique de la première avant-garde, Paris, L’Improviste, 2006, p. 193-214.
12 Introduction par C. Gheerardyn et D. Rumeau du collectif Les Primitivismes russes, op. cit., p. 16.
13 Benoît de L’Estoile, Le Goût des autres. De l’Exposition coloniale aux Arts premiers, Paris, Flammarion, 2007, p. 32.
14 Philippe Descola, Les Formes du visible, Paris, Seuil, 2021, p. 630.
15 Souleymane Bachir Diagne, De langue à langue. L’hospitalité de la traduction, Paris, Albin Michel, 2022, p. 102.
16 Philippe Descola use du terme « agence » (op. cit., p. 45) en se référant à « agency » selon Alfred Gell (Art and Agency, 1998). Il spécifie la figuration aniconique par les mouvements de symétrie et inversion, de translation et de rotation.
17 À propos de la rhétorique, Dagen considère que sa pratique est tel un effet d’emprunt et non d’observation, donc une dégradation (op. cit., 1998, p. 91).
18 Cité par Benoît de L’Estoile, ibid., p. 324.
19 Il faut d’ailleurs relever qu’aucun auteur ne maîtrise une langue parlée dans les pays colonisés et leurs lectures se font principalement à partir du français, de l’allemand et de l’anglais. Le voyage en Afrique subsaharienne, tel qu’il était pratiqué en Orient au xixe siècle, n’est pas une activité commune. Le peintre Emil Nolde a accompagné une expédition ethnographique en Nouvelle-Guinée (1912-1913) à l’ouest de l’océan Pacifique. Max Jacob, quant à lui, naît et passe son enfance à Quimper en Bretagne, territoire considéré comme archaïque depuis la capitale, mais il ne maîtrise pas parfaitement le breton et a certainement demandé l’aide d’un spécialiste pour traduire vers le breton ses poèmes de La Côte, parus en 1911.
20 Jehanne Denogent,Palimpsestes africains. Le Primitivisme littéraire et les avant-gardes (Paris 1901-1924), thèse issue du projet FNS Le Primitivisme dans les avant-gardes littéraires (1898-1924), soutenue à l’Université de Lausanne le 24 juin 2022.
21 Jean-Marc Moura, Lire l’exotisme, Paris, Dunod, 1992, p. 44.
22 Anaïs Fléchet, « L’Exotisme comme objet d’histoire », Paris-Sorbonne, Hypothèses, 2008-1, p. 15-26 : https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2008-1-page-15.htm (consulté le 16/07/2022). Voir p. 19-20. La « Poétique du divers » de Segalen, auteur de Stèles (1912), voulant revaloriser le terme exotisme, est présentée ici comme un échec inévitable.
23 À ce propos, se référer à : Anna Boschetti, Ismes. Du réalisme au postmodernisme, Paris, CNRS éditions, 2014 ; Anthony Glinoer, La Bohème. Une figure de l’imaginaire social, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Socius », 2018 ; Jehanne Denogent, « Portrait de famille. Les Poupées de Marie Vassilieff et le primitivisme », Les Primitivismes russes, op. cit., p. 209-224.
24 Henri Meschonnic, « Le Primitivisme vers la forme-sujet », Modernité modernité, Lagrasse, Verdier, 1988, p. 273.
25 Philippe Dagen,Primitivismes. Une invention moderne, op. cit., p. 133.
26 Comme indiqué en note de notre tableau lexical, nous reprenons le terme en usage au début du xxe siècle, en le plaçant entre guillemets pour signaler la distance avec ce mot aux connotations raciales et racistes. L’expression « art nègre » est utilisée en 1912 dans l’essai du critique André Warnod, Le vieux Montmartre, mais l’expression est proposée une première fois par F. Regnault en 1896 dont le « critère de jugement est l’imitation naturaliste » (Ph. Dagen, op. cit., 2019, p. 78). Il est aussi une construction occidentale. C’est en 1913 que Paul Guillaume et Guillaume Apollinaire fondent la « Société des Mélanophiles ». Voir : Dada Africa, catalogue d’exposition, musée d’Orsay et de l’Orangerie, Paris, Hazan, 2017, p. 78.
27 Nous nous référons aux propositions de James Clifford dans Malaise dans la culture. L’ethnographie, la littérature et l’art au xxe siècle (trad. Marie-Anna Sichère), Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, coll. « Espaces de l’art », 1996 [1988].
28 Les recherches du sociologue et anthropologue Lucien Lévy-Bruhl aboutissent en 1922 à la publication de l’essai resté célèbre La Mentalité primitive, où il distingue les peuples pré-logiques et logiques.
29 C’est en 1931, lors de l’exposition coloniale, que le groupe des Surréalistes prend position contre cette démonstration de force et crée une contre-exposition. Paru en 1902, Ubu Colonial, d’Alfred Jarry, semble un cas rare de satire littéraire et politique, au début du siècle.
30 Edward Saïd,Orientalisme. L’Orient crée par l’Occident, Paris, Seuil, 1980 [1978] ; Valentin-Yves Mudimbe, L’Invention de l’Afrique, Gnose, philosophie et ordre de la connaissance, Paris, Présence africaine, 2021 [1988].
31 Introduction au collectif Les Primitivismes russes, op. cit., p. 9-10.
32 Voir supra l’interview de S. B. Diagne. Dans son essai De langue à langue, le mouvement de transfert de forces, dû à l’incorporation des objets d’art africains par les artistes et l’élan vital que ceux-ci ont produit dans leur « terre d’emprunt », est considéré comme un geste « décolonial » (op. cit. p. 102).
33 Jean-Luc Aka-Evy cite Apollinaire à propos des « objets » qui doivent être « en quelque sorte déracinés, flottants et dépouillés de leur histoire », Créativité africaine et primitivisme occidental, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 54.
34 « Le primitivisme n’est pas directement présent à l’exposition, sinon par quelques tableaux de Gauguin exposés dans la “rétrospective de l’art colonial”, aux côtés de Matisse et Delacroix ; mais son influence y est perceptible de façon diffuse. » Benoît de L’Estoile, Le Goût des Autres. De l’Exposition coloniale aux arts premiers, Paris, Flammarion, 2007, p. 58-59.
35 Ibid., p. 313-314.
36 Fiona McIntosh-Varjabédian (dir.), Villeneuve d’Ascq, Université Charles-de-Gaule – Lille 3, coll. « UL 3 Travaux et recherches », 2002. La dernière partie de l’ouvrage est consacrée au xxe siècle, sur plusieurs aires géographiques.
37 Françoise LeBorgne, Odile Parsis-Barubé, Nathalie Vuillemin (dir.), Les Savoirs des barbares, des primitifs et des sauvages. Lectures de l’Autre aux xviiie et xixe siècles, Paris, Classiques Garnier, 2018. De riches chapitres consacrés au lexique et sa portée permettent ensuite d’organiser les parties du collectif.
38 L’orientaliste Raymond Schwab cité (1936) par Benoît de L’Estoile, op. cit., p. 324.
39 Paru aux Nouvelles éditions africaines à Abidjan et Lomé.
40 Le best-seller de Max Nordau, Dégénérescence, traduit de l’allemand dès sa parution en 1882, associe les écrivains, par leur « hallucinations pathologiques », à un groupe dangereux et barbare.
41 Hubert Roland, « Le “primitivisme littéraire” à l’heure de la modernité. Contribution à une grammaire des avant-gardes historiques », Plurilinguisme et avant-gardes, Franca Bruera et Barbara Meazzi (dir.), Bruxelles, Peter Lang, 2011, p. 385-400, p. 387. L’auteur se réfère à Joachim Schultz,Wild, irre und rein : Wörterbuch zum Primitivismus der literarischen Avantgarden in Deutschland und Frankreich zwischen 1900 und 1940, Lahn-Giessen, Anabas, 1995.
42 Les deux volumes ont paru aux éditions Gallimard.
43 Phillippe Dagen, op. cit., 2019, p. 47.
44 Ce que Dagen développe dans le chapitre « Le système du primitif », op. cit., 2019. Les primitifs sont ainsi techniquement inférieurs (le sauvage et le préhistorique), socialement limités (le paysan ou berger européen) ou encore n’ont pas un développement abouti (l’enfant et le fou).
45 Ibid., p. 326.
46 Idem, p. 132 et 177.
47 Nicola Gessa dirigé en 2013 le collectif Literarischer Primitivismus (Berlin/Boston, De Gruyter) et vient de faire paraître : Primitive Thinking. Figuring Alterity in German Modernity (Translated by Erik Butler and Susan Solomon), Berlin,De Gruyter, 2022.
48 Dialectique marquée par les contrastes entre centre et marge, attrait et répulsion. L’auteure présente son essai dans la vidéo disponible sur notre site http://primilitt.ch/.
49 Carl Einstein, « Sur l’art primitif », publié pour la première fois en français dans Carl Einstein et les primitivismes, Gradhiva, Isabelle Kalinowski et Maria Stavrinaki (dir.), Musée du quai Branly, 2011, p. 185.
50 Particulièrement berlinoise avec Huelsenbeck, Gross, Jung et Hausmann (revues Die Aktion & Revolution), selon le catalogue DadaAfrica, op. cit., p. 35.
51 Catalogue Dada Africa, op. cit., p. 35. I. Krzywkowski met aussi en évidence que Worringer « en proposant de considérer les arts byzantins et médiévaux ou non occidentaux, non comme des arts antérieurs et inférieurs, mais comme le fruit d’un choix esthétique, d’une approche particulière des relations de l’art et du réel, celui-ci rend possible un nouveau regard sur les arts “premiers” qui, renforçant le rejet des codes de représentation réalistes amorcé par le symbolisme, accompagnant le passage d’une convention fondée sur la perception visuelle à la conceptualisation, sera l’un des éléments sur la voie de l’abstraction ». Isabelle Krzywkowski, « Le Temps et l’Espace sont morts hier ». Les Années 1910-1920. Poésie et poétique de la première avant-garde, Paris, Éditions L’Improviste, 2006. Le chapitre « Le primitivisme dans la poésie des avant-gardes historiques » est disponible en ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00634798/document (consulté le 16/07/2022), voir p. 6-7.
52 Ibid., p. 4.
53 Ibid., p. 16.
54 Ibid., p. 13.
55 Ben Etherington,Literary Primitivism, Stanford, Stanford University Press, 2018. Cet axe anti-capitaliste est sans doute à nuancer parmi les écrivains français des années 1920, par exemple chez Apollinaire ou Cendrars au Brésil.
56 Nadejda Magnenatet Jehanne Denogent, Décoloniser le primitivisme, compte rendu du volume d’Etherington, 2020 : https://www.fabula.org/lodel/acta/document12628.php (consulté le 18/07/2022).
57 Premier quart du xxe siècle où les voix colonisées n’étaient pas encore entendues. Le Cahier de Césaire date de 1939.
58 C’est ce qu’a défendu Laura Laborie dans sa thèse intitulée Aspects du primitivisme littéraire aux xxe et xxie siècles. C. F. Ramuz, Claude Simon, Richard Millet, soutenue à l’université de Toulouse et publié en 2023 chez Minard, Paris.
59 Ils préfigurent en cela bon nombre de constats menés en 1948 sur la rationalité instrumentale. Voir : Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, La Dialectique de la Raison : fragments philosophiques (trad. Éliane Kaufholz-Messmer), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », 1974.
60 Maire-Annick Gervais-Zaninger, « Façon d’idiot/Face d’idiot chez Henri Michaux », Bêtise et idiotie(xixe-xxie siècle), Marie Dollé et Nicole Jacques-Lefèvre (dir.), Paris-Nanterre, RITM 40, 2011, p. 188 et 189. Sur les liens entre primitivisme et cinéma, voir Nadja Cohen, Les Poètes modernes et le cinéma (1910-1930), Paris, Classiques Garnier, 2013 et la thèse en cours de Nadejda Magnenat, issue de notre projet FNS et consacrée aux liens entre poésie moderniste et cinéma des premiers temps.
61 Notre site www.primilitt.ch est consacré à cette recherche FNS, et s’y trouvent des ressources visuelles associées à ce volume collectif.
62 Par Jehanne Denogent, op. cit. et Nadejda Magnenat, op. cit.
63 Les résumés des contributions sont placés au terme l’ouvrage.
64 Peut-être au risque d’une usure du processus, du fait d’un recyclage, comme l’a relevé Émilien Sermier : « […] d’abord valorisé en tant que forme “sauvage” ou “barbare”, n’est-il pas progressivement condamné à l’usure en s’institutionnalisant, en se “désensauvageant” et en tournant malgré lui en “pittoresque” ? », « Le Sacre du primitif. Musiques russes et imaginaires littéraires », Primitivismes littéraires, op. cit., p. 193-207, p. 206. Le volume collectif Paradoxes de l’avant-garde. La modernité artistique à l’épreuve de la nationalisation [Thomas Hunkeler (dir.), Paris, Classiques Garnier, 2014] offre un cadrage significatif de ces ambiguïtés, au début du siècle. D’un point de vue contemporain, le recyclage marqué d’un prétendu retour aux sources est ce que dénonce avec virulence l’anthropologue Jean-Loup Amselle dans son essai Rétrovolutions. Essai sur les primitivismes contemporains[Paris, Stock, 2009], en évoquant un imaginaire éculé et récupéré.