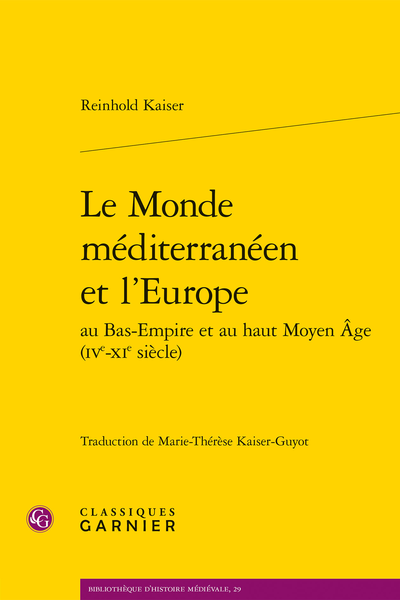
Glossaire
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Le Monde méditerranéen et l’Europe au Bas-Empire et au haut Moyen Âge (ive-xie siècle)
- Pages : 515 à 521
- Collection : Bibliothèque d'histoire médiévale, n° 29
- Thème CLIL : 3386 -- HISTOIRE -- Moyen Age
- EAN : 9782406119425
- ISBN : 978-2-406-11942-5
- ISSN : 2264-4261
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11942-5.p.0515
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 06/10/2021
- Langue : Français
Glossaire
Adoptianisme : doctrine qui présente le Christ comme fils adoptif de Dieu, elle se rencontre déjà aux premiers temps du christianisme. Elle réapparaît à la fin du viiie siècle en Espagne et est réfutée, entre autres par Alcuin ainsi que par le synode de Francfort en 794.
Annona : dérivé du latin annus = an. Au Bas-Empire, impôt le plus important sous forme d’une redevance annuelle en nature pour l’entretien de l’armée, des fonctionnaires et de la cour. À partir de la fin du ive siècle, elle est convertible en argent.
Arien, arianisme : doctrine remontant au prêtre alexandrin Arius († 336) qui enseigne une différence d’essence, à la rigueur une ressemblance d’essence (homoios) entre Dieu et le Christ, en niant la consubstantialité (homo-ousios, consubstantialis) du Fils avec le Père. La majorité des Germains de l’Est, Vandales, Goths, Burgondes, Lombards, a d’abord embrassé l’arianisme.
Arimanni : dans le royaume lombard, les hommes libres (homines exercitales) obligés au service militaire et aux services publics ainsi qu’à la présence au tribunal.
Autel de la Victoire : autel de la déesse romaine de la Victoire qui se trouve depuis l’époque d’Auguste dans la salle de réunion du Sénat, la curie (curia) ; symbole de la religion païenne dans la deuxième moitié du ive siècle et objet de controverses entre les fidèles de la déesse romaine et les chrétiens.
Autocéphalie : dans l’Église orientale, indépendance d’une église locale particulière par rapport à une direction supérieure universelle, d’après le principe : État indépendant = Église indépendante.
Avoué, avouerie : latin : advocatus = avocat, défenseur, représentant. À l’origine, dans les affaires temporelles, laïc qui remplace un ecclésiastique, une église ou un monastère, notamment devant le tribunal, et exerce, au nom des ecclésiastiques, des droits judiciaires ou s’occupe de la protection par les armes. Liée à l’immunité d’une façon permanente, l’avouerie est prise en main par des seigneurs puissants, des avoués nobles, et est devenue héréditaire ; elle a contribué à la formation des principautés territoriales.
Basileus : dans l’Empire d’Orient, à partir de l’époque de Constantin, dénomination dans la langue courante de l’empereur ; elles est utilisée aussi dans les textes officiels à partir d’Héraclius (629) et à partir de la reconnaissance par Byzance de Charlemagne en tant que basileus en 812, pourvue de l’ajout de Rhomaion. Au xe siècle, le chef des Bulgares s’appelle également basileus.
516Beneficium : mot latin désignant un bienfait. Le bénéfice est une forme avantageuse de concession de terres contre un cens ou contre divers services ou redevances, souvent stipulés dans un contrat. Combiné avec la vassalité, le bénéfice est une des racines du régime féodal.
Bogomiles, bogomilisme : doctrine dualiste appelée d’après le prêtre bulgare Bogomil, répandue au xe siècle dans les Balkans. Elle admet deux principes égaux, le bon et le mauvais, et refuse la liturgie, les sacrements, la hiérarchie ecclésiastique, etc. Elle a influencé les mouvements hérétiques ultérieurs des Cathares.
Capitulaires : actes du pouvoir des rois francs, divisés en chapitres (capitula), comprenant des édits et des décrets promulguant des mesures législatives, administratives et des admonitions religieuses.
Catépan : en Italie byzantine, commandant militaire et gouverneur du Catépanat d’Italia, ayant pour siège Bari.
Cathare : nom dérivé du grec katharos = pur, d’où l’allemand « Ketzer », désignant les adhérents d’une hérésie dualiste, remontant aux traditions manichéennes et bogomiles, répandue aussi en Occident à partir du xiie siècle.
Césaropapisme : slogan pour étiqueter la soumission de l’Église au pouvoir temporel à partir de Constantin le Grand, notamment dans l’Église de l’Empire d’Orient, mais aussi en Occident jusqu’à la Querelle des Investitures.
Chorévêque : évêque de la campagne (grec : chora = place, territoire, pays), évêque auxiliaire qui exerce sa fonction dans la campagne sous l’autorité de l’évêque principal résidant dans la cité ; en Orient, responsable des communes sans droit municipal. À partir du ive siècle, sa compétence juridictionnelle et son pouvoir de bénir sont de plus en plus restreints. En Occident, les chorévêques sont répandus chez les Anglo-Saxons et les Francs, notamment au ixe siècle ; ils sont évincés peu à peu et, en quelques endroits, remplacés par les archidiacres.
Christologie : doctrine du Christ, oint du Seigneur et rédempteur. Du ive jusqu’au viie siècle, le problème de la personne du Christ et de son rapport avec Dieu domine, en Orient surtout, la discussion théologique. Cf. adoptianisme, monophysisme, nestorianisme.
Colon : latin : colonus = cultivateur, fermier, colon. Au Bas-Empire, paysan locataire rattaché à la terre et dépendant d’un propriétaire terrien. Juridiquement libres, les colons ressemblent de plus en plus aux servi chasés, également économiquement indépendants, et se confondent avec ceux-ci pour former la condition médiévale des serfs.
Comes (pluriel comites) : latin : compagnon, membre de la suite impériale (comitatus), comte. Titre de fonctionnaires supérieurs de l’administration de la cour, des provinces et des affaires civiles et militaires. À partir de Constantin, membre du conseil impérial (consistorium) ; en tant que militaire supérieur au dux. En Gaule mérovingienne, le comes civitatis exerce les pouvoirs militaires, judiciaires et administratifs dans la civitas ; en Neustrie il est appelé grafio. Sous les Carolingiens, le comes = comte représente le pouvoir royal au niveau des 517comtés qui tendent à recouvrir tout l’Empire.
Controverse sur l’Eucharistie : première controverse sur l’Eucharistie, déclenchée au ixe siècle par Paschase Radbert. Il affirme que le corps eucharistique et le corps historique du Christ sont identiques. Les théologiens de son époque, cependant, ont refusé cette thèse. La deuxième controverse a éclaté au xie siècle à propos de la doctrine de Bérenger de Tours qui a déclaré impensable que le corps et le sang du Christ soient réellement présents dans la nourriture eucharistique. Cette question de la Présence réelle a été controversée plus tard, à l’époque de la Réforme, et a entraîné la division du protestantisme en plusieurs confessions.
Curiales : latin : décurions. Membres par la naissance ou fonctionnaires d’une curie municipale (curia) appelés aussi decuriones. Au Bas-Empire, chargés en tant que notables de l’administration urbaine dont ils sont financièrement responsables.
Décrétales : réponses pontificales concernant des questions de droit et de discipline ecclésiastique qui ont force de loi et qui, à côté des textes des conciles et des Pères de l’Église, constituent une grande partie des collections canoniques.
Denier : à l’origine, monnaie romaine d’argent ; à partir de la réforme monétaire des Carolingiens, monnaie d’argent courante d’environ 1,22 g à 1,65 g ; depuis le xe siècle répandu en Allemagne en tant que « Pfennig », en France en tant que denier.
Diocèse : diocèse ecclésiastique = évêché ; depuis la réforme de Dioclétien et de Constantin, diocèse séculier = district administratif intermédiaire de taille moyenne, qui regroupe plusieurs provinces sous la direction d’un vicarius, remplaçant du préfet.
Domesday Book : liste des impôts et des redevances dus au roi anglais ainsi que des possessions des vassaux royaux, rédigée sous Guillaume le Conquérant en 1086.
Dux, duces, duché : latin : guide, chef, détenteur d’une fonction ou d’un rang militaire. À partir de l’époque de la Tétrarchie, commandant des troupes aux frontières (limitanei). Dans les royaumes successeurs, chef militaire des troupes d’une province ou de plusieurs civitates, ayant de plus en plus de fonctions juridiques et administratives dans son district (ducatus) ; il est supérieur aux comites. Dans les zones marginales du royaume des Mérovingiens et des Lombards, son district se transforme en duché.
Éparque : grec : eparchos, préfet de la ville de Constantinople.
Exarque, exarchat : latin : exarchus,grec : exarchos,remplaçant de l’empereur, avec des pouvoirs civils et militaires, notamment dans la partie byzantine de l’Italie centrale (Ravenne).
Fédéré : partenaire de droit international public qui a conclu un traité (latin foedus) avec l’Empire romain pour assurer la sécurité des frontières provinciales ; à partir du ive siècle, les fédérés sont des peuples, des tribus, des troupes établis aussi à l’intérieur de l’Empire selon le droit romain de l’hospitalité (hospitalitas), obligés au service des armes et avec une autonomie relativement grande.
518Féodal, féodalisme : dans la première moitié du xixe siècle, mot clé pour désigner la structure des sociétés surannées du Moyen Âge caractérisées par des dépendances personnelles et hiérarchisées fortement accentuées. Dans la périodisation du matérialisme historique, féodalisme est la dénomination de la période du Moyen Âge succédant à l’époque esclavagiste de l’Antiquité.
Fisc : latin : fiscus = trésor impérial, fisc. Tous les revenus et possessions de l’Empire ou des rois des États successeurs de l’Empire ; entre le viie et le ixe siècle, fiscus a de plus en plus une signification territoriale dans le sens de domaine royal ou de domaine fiscal = district domanial de la couronne.
Gnose : grec : gnosis = connaissance. Éclectisme philosophique élitaire prétendant expliquer les mystères divins grâce à une connaissance ésotérique ; répandu, notamment au iie et au iiie siècle, dans la partie orientale de la Méditerranée, mélangé avec des éléments païens, chrétiens et juifs. Par l’intermédiaire du manichéisme, la gnose a influencé les Pauliciens, les Bogomiles et les Cathares.
Iconoclasme : grec : eikon = image, klao = rompre. Querelle à propos des images religieuses et de leur vénération qui a secoué l’Empire byzantin et l’Église au viiie et au ixe siècle.
Immunité : exemption d’individus, de groupes professionnels ou de propriétés des services publics (latin munus, pluriel munera) ; à partir de l’époque mérovingienne, privilège concédé notamment à l’Église comprenant l’interdiction d’entrer dans le domaine de l’immuniste, l’exclusion du pouvoir de contrainte et d’imposition par des fonctionnaires extérieurs au domaine. En liaison avec le pouvoir judiciaire, l’avouerie et le droit d’asile se forment des zones immunitaires ayant un droit particulier et des immunités étroites.
Investiture, Querelle des Investitures : latin investitura = investiture, saisine, mise en possession d’une propriété, d’une charge, etc. L’introduction dans une possession ou dans un office est accompagnée par la remise symbolique d’un objet. L’utilisation de l’anneau et du bâton lors de l’investiture d’un ecclésiastique est critiquée, dès le milieu du xie siècle, par les réformateurs de l’Église et provoque, sous Henri IV et Grégoire VII, la Querelle des Investitures. Cette controverse fondamentale concernant le rapport entre le regnum et le sacerdotium entraîne finalement la séparation des notions de temporalia (possessions et droits séculiers) et de spiritualia (fonctions spirituelles).
Khagan : dérivé du turc : khan = prince, commandant. Titre turc d’un grand khan, chef supérieur, utilisé aussi pour les chefs des Avars et des Khazars.
Limes : latin : limes = sentier, chemin de limite, limite, frontière. L’ensemble d’un système de contrôle des frontières comprenant des bâtiments, des troupes stationnées en permanence pour protéger l’Empire romain, notamment en Grande-Bretagne, à la frontière du Rhin et du Danube ainsi que de l’Euphrate.
Livres pénitentiels : catalogues de délits avec indication des tarifs de pénitence 519ecclésiastique, répandus à partir de l’Irlande dès le vie et le viie siècle, en même temps que la pratique de la confession privée.
Maire du palais : latin : maior domus. À l’origine, préposé de la domesticité. Par l’administration du domaine royal et par la direction des fidèles du roi, il obtient, dans le royaume des Mérovingiens, un rôle dominant à la cour royale et devient, au viie siècle, le représentant de la noblesse des différents royaumes. Grâce à cet office, les Carolingiens réussissent, au viiie siècle, à accéder à la royauté.
Maître de la milice : latin : magister militum. Office du commandant général de l’armée, créé par Constantin le Grand ; doté du titre de patricius à partir du ve siècle et occupé souvent par des membres des familles barbares dominantes, liées entre elles par mariage. Dans la phase finale de l’Empire romain d’Occident, le détenteur de cet office obtient de fait le pouvoir suprême. En tant que signe de légitimation, ce titre a été donné aussi aux rois fédérés gothiques ou burgondes.
Manichéisme : doctrine dualiste, appelée d’après son fondateur Mani († 276). Sur une base gnostique, elle distingue deux principes, l’esprit et le corps, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. En Orient, répandu jusqu’en Chine, en Occident, interdit par les édits impériaux. Des idées manichéennes et la division des croyants en electi, perfecti (« élus ») et simples laïcs se retrouvent chez les Bogomiles et les Cathares.
Mausolée : monument funéraire représentatif de Mausole de Carie († 353 av. J.-C.), en grec Maussolleion, près d’Halicarnasse, une des Sept Merveilles du monde, est devenu le modèle des tombeaux monumentaux antiques.
Mensa (fratrum) : latin : « table des frères ». Revenu ecclésiastique (la mense), partie de la fortune globale d’une église monastique ou collégiale réservée à l’entretien des moines ou des chanoines.
Métropolite : évêque résident dans le chef-lieu d’une province romaine ; il dirige les synodes provinciaux et contrôle les évêques de sa province ; à partir de l’époque carolingienne, il est appelé archevêque.
Monophysisme, monophysite : à partir de la fin du vie siècle, nom utilisé pour désigner la doctrine qui voit dans le Christ, après l’union de la déité et de l’humanité, une seule nature (grec monos = unique, physis = nature), doctrine qui contredit le dogme des deux natures fixé par le concile de Chalcédoine, en 451. Répandue aux ve et vie siècles, notamment dans les patriarcats d’Alexandrie, de Jérusalem et d’Antioche, elle est devenue le fondement théologique des Églises copte, syriaque orthodoxe, arménienne et éthiopienne.
Mozarabes : arabe : musta’rib = arabisé. Désigne les habitants chrétiens de la partie musulmane de l’Espagne, leur art, leurs chants et leur liturgie (en vieil espagnol).
Nestorianisme : doctrine, appelée du nom de Nestorius († vers 451), patriarche de Constantinople, qui insiste sur l’humanité pleine et entière du Christ et sur l’autonomie des deux natures dans le Christ, selon la formule acceptée encore aujourd’hui par les Églises nestoriennes : deux natures, deux 520hypostases, une personne dans le Christ. Répandu à partir de la région de la Syrie orientale et de la Perse, le nestorianisme est devenu le fondement de l’Église nationale autocéphale de l’Empire perse.
Patriarche, patriarcat : titre des recteurs des cinq grandes régions ecclésiastiques de l’Empire romain. Les patriarches, en principe de rang égal, observent, dès le ve siècle, une hiérarchie fixe : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem (la pentarchie). Ils garantissent l’unité de l’Église à l’intérieur de l’Empire. En Occident, les fondations des patriarcats d’Aquilée et de Grado restent un épisode ; le patriarcat établi au xe siècle pour la Bulgarie est devenu, au xie siècle, un archevêché autocéphale.
Patricius : titre honorifique créé par Constantin (dérivé de latin pater = père). Dès le ve siècle, titre officiel du maître de la milice, donné souvent à des chefs non romains, par exemple Théodoric ; titre de l’exarque de Ravenne, qui en tant que dux de Rome doit protéger l’Église de Rome. Par le titre de patricius Romanorum conféré par le pape, Pépin et ses successeurs assument l’obligation de l’ancien exarque de protéger l’Église romaine. Dès 774, ajouté au titre royal par Charlemagne, supprimé après son couronnement impérial, le titre est repris au xe siècle comme titre des seigneurs de la ville de Rome.
Patrimonium sancti Petri : latin : « bien de Saint-Pierre ». À partir du vie siècle, nom donné aux propriétés de l’Église romaine, qui sont à la base de la position temporelle du pape et de la formation de l’État pontifical.
Patrocinium : latin : « patronage, protection, défense ». Dépendance des colons et des petits paysans qui, au Bas-Empire, se sont mis sous la protection de puissants fonctionnaires ou de grands propriétaires terriens pour se soustraire au pouvoir des fonctionnaires impériaux, notamment des collecteurs d’impôts.
Polyptyque : grec : polys = beaucoup, ptyssein = plier. Au Bas-Empire, liste d’impôts, puis liste détaillée des propriétés, des revenus, des redevances perçus par les seigneurs fonciers ecclésiastiques.
Pontifex maximus : latin : « grand pontife ». À partir d’Auguste, titre, réservé à l’empereur, président du collège des pontifes, chargé du culte public dans la Rome antique, doté de quelques droits de contrôle des affaires religieuses. Abandonné par les empereurs chrétiens à partir de Gratien, le titre est repris occasionnellement par des empereurs de l’Empire d’Orient et par des papes.
Prédestination : latin : prædestinatio = prédestination divine. Doctrine remontant à saint Augustin. Le rapport entre la prédétermination et la grâce, le libre arbitre, les œuvres et les mérites de l’homme est controversé : au ixe siècle, dans la lutte autour du moine Gottschalk et de sa doctrine d’une double prédestination, au xvie siècle, par les Réformateurs.
Primatie pontificale : prééminence dans l’Église universelle réclamée par les évêques de Rome dès l’époque paléochrétienne qui se manifeste notamment dans la juridiction, la législation et la fixation du dogme.
521Reconquista : espagnol : « reconquête » des parties de l’Espagne dominées par les Arabes, liée à la repoblación, le repeuplement des régions conquises sur les musulmans.
Régime féodal : en allemand « Lehnswesen » (vieux haut allemand lehan = « leihen », prêter), allie l’élément matériel d’un bénéfice à l’élément personnel de la vassalité qui, elle, repose sur la commendatio (la soumission à la protection d’un seigneur) et sur le vœu de fidélité du vassal. C’est tout un système politique et économique lié à une société hiérarchisée.
Sedes regia : latin : résidence royale. Résidence ou capitale dans les royaumes successeurs de l’Empire.
Simonie : commerce des affaires spirituelles, notamment l’achat des offices ecclésiastiques, tirant son nom de Simon le Magicien qui a voulu acheter des Apôtres leur pouvoir (Actes des Apôtres 8,18-25).
Solidus : latin : stable, fort. Monnaie d’or introduite par Constantin, valant 1/72 de la livre romaine (= 4,55 g). Monnaie principale du Bas-Empire et de l’époque byzantine, imitée dans les royaumes germaniques successeurs de l’Empire, rarement frappée par les Carolingiens. Au Moyen Âge, monnaie de compte (une livre = 20 solidi = 240 deniers). Dans le royaume des Mérovingiens, le tiers de sous (triens) est utilisé comme monnaie courante jusqu’à la fin du viie siècle.
Suffragant : latin : suffrageneus, dérivé de suffragium = suffrage. Désigne, à partir du ixe siècle, les évêques et les évêchés qui à l’intérieur d’une province ecclésiastique sont soumis à un métropolite ou à un archevêque.
Taïfas : arabe : muluk at-tawa’if. Espagnol : reinos de taifas. Désignation de la quarantaine de pouvoirs locaux et régionaux de l’Espagne islamique, qui se sont formés après la fin du califat de Cordoue et qui appartiennent aux trois groupes (ta-ifa’s) des Arabes, des Berbères et des Saqaliba (Slaves/esclaves).
Tétrarque, Tétrarchie : grec : gouvernement à quatre. Désignation moderne du système créé par Dioclétien, de deux Augusti et de deux Cæsares, qui gouvernent l’Empire d’une façon collégiale.
Thème, thèmes : grec : thema, pluriel : themata. Unité militaire supérieure, district de recrutement. District administratif byzantin qui remplace la division ancienne en provinces à partir du viie siècle et dans lequel le pouvoir militaire et le pouvoir civil sont unis dans une seule main.
Vassal, vassalité : dérivé du celtique gwas = valet. Rapport de dépendances hiérarchisées, structurées et personnelles entre le seigneur et son vassus, obligé au service et à l’obéissance. Combiné avec la fidélité et le bénéfice, la vassalité devient un fondement du régime féodal.