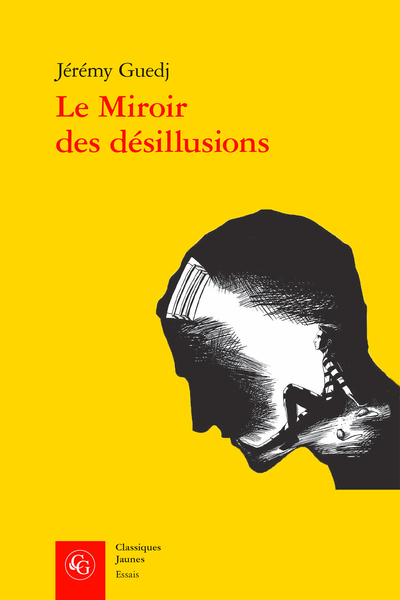
Conclusion de la quatrième partie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Le Miroir des désillusions. Les Juifs de France et l’Italie fasciste (1922-1939)
- Pages : 347 à 347
- Collection : Classiques Jaunes, n° 763
- Série : Essais, n° 33
- Thème CLIL : 3378 -- HISTOIRE -- Histoire générale et thématique
- EAN : 9782406150428
- ISBN : 978-2-406-15042-8
- ISSN : 2417-6400
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15042-8.p.0347
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 12/07/2023
- Langue : Français
ANTISÉMITISME D’ÉTAT
ET SÉPARATION DES « SŒURS LATINES » :
LA FIN DE L’EXCEPTION ITALIENNE
Mes chers collègues,
Je reviens d’Italie et désire vous faire part sans retard de la pénible impression que je ramène de mon voyage. Je visite ce pays chaque année depuis 40 ans, et je constate, pour la première fois, une campagne antisémite, qui s’affirme de jour en jour plus agressive. Son origine n’est pas douteuse, la presse italienne est de plus en plus sous l’influence de l’Allemagne. La propagande allemande s’y exerce de toutes les façons […].
Ainsi s’ouvrait la lettre qu’Edmond Dreyfus, du Comité local de l’Alliance israélite universelle à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, envoyait aux instances parisiennes de l’organisation, le 25 septembre 19361. On ne saurait imaginer plus claire expression du revirement des Juifs face aux rapports entre l’Italie fasciste et Israël. Et pourtant. Cette perception du changement paraissait, surtout à cette date, tout sauf représentative d’un état d’esprit général prévalant chez les Juifs.
Sur des sujets touchant à la politique extérieure de l’Italie, les Israélites français avaient réussi tant bien que mal à parler d’une seule voix, ou du moins sans trop de discordances. Était-il d’ailleurs possible de réagir différemment ? L’attitude des fascistes en Éthiopie et en Espagne, assortie de leur rapprochement avec l’Allemagne nazie, ne laissait pas grand espace aux esprits sereins et optimistes. L’image de l’Italie était bien écornée. Le ton se durcissait à l’égard de ce pays, avec des intensités variées selon les tendances, groupes et individus.
Alors que la nouvelle orientation diplomatique mussolinienne et la genèse de l’antisémitisme d’État en Italie étaient concomitantes, la majorité de l’opinion juive nationale adoptait pourtant une posture assez différente face à ces deux questions. La politique extérieure d’un pays, était-il légitime de penser, dépendait d’une combinaison de circonstances 298appelées à évoluer, mais les aspects intérieurs, découlant directement en Italie de la doctrine des faisceaux, paraissaient révéler de manière aiguë les ressorts d’un système de pensée. L’on se consolait en constatant qu’il ne s’agissait là, comme l’affirme clairement Edmond Dreyfus, que d’une maladroite copie de l’antisémitisme nazi. Les enjeux idéologiques à l’œuvre étaient donc bien trop cruciaux pour que tout pragmatisme de la part de l’opinion juive les occultât. Car l’adoption de l’antisémitisme en Italie risquait de ruiner le modèle chanté – et même façonné en certains points on l’a vu – par une grande fraction des Juifs de France, tandis qu’elle confirmerait la position progressiste selon laquelle le fascisme induit nécessairement le racisme. Les diagnostics ne pouvaient que converger, mais chacun brandissait haut ses convictions traditionnelles.
La dégradation brutale de la condition juive en Italie toucha les Juifs de France au plus profond de leur cœur, à une période où la tragédie qui s’inaugurait pour leurs frères sous le ciel européen les conduisit à opérer un retour sur leur propre condition et à réexplorer l’identité qu’ils partageaient avec ces infortunés. Les Juifs ne scrutaient pas simplement la situation de l’extérieur, ils se sentaient concernés. Le sentiment plus tard éprouvé et décrit par Albert Memmi pourrait parfaitement s’appliquer aux Israélites de ces années : « Que cela me flatte ou m’humilie, mon sort est lié à celui de tous les autres juifs2 ».
Espérant ardemment un rapide retour à la normale, les sectateurs du modèle italien tardèrent à complètement se résigner. En deux temps – de la campagne de presse antisémite à l’instauration d’une législation antisémite – les Juifs de France se mobilisèrent. Étaient-ils seuls ? L’attitude des Juifs de France face à l’ostracisme dont étaient victimes leurs coreligionnaires d’outre-monts, rencontra-t-elle un écho au sein de l’opinion française en général, voire plus, en Italie, alors que la guerre était proche ?
Prolégomènes : La campagne antisémite de la presse italienne (1936-1938), un accident de l’histoire ?
L’ensemble de cette étude a tenté de le montrer : dès les origines du fascisme, une profonde dichotomie marqua la question juive en Italie. 299Dans les années 1920, la dualité était géographique : l’Italie révélait son philosémitisme dans ses frontières, en Europe ainsi qu’en Palestine, et laissait libre cours à des tendances antisémites en Libye et en Tunisie. Après l’avènement d’Hitler, l’antisémitisme s’invita au sein même de la péninsule sans parvenir toutefois à l’emporter sur les soutiens des Israélites. Tout conduit à dire que la sérieuse campagne contre Israël à laquelle se livra la presse transalpine dès 1936 n’émergeait pas ex nihilo mais contribuait à amplifier et à unifier les voix éparses des ennemis du judaïsme. Un renversement de tendance se produisait. Il ne s’agit pas ici de revenir en détails sur la manière dont l’antisémitisme entra dans la doctrine et les objectifs du fascisme, ce que de nombreuses études ont retracé souvent très brillamment, d’autant que selon les écoles historiques, les analyses de l’antisémitisme italien divergent. L’interprétation qu’en proposaient les Juifs français semble cependant constituer à nos yeux une pièce de valeur à intégrer dans ce dossier complexe et toujours ouvert. Continuaient-ils à adhérer à l’image des « Italiani brava gente », même après la volte-face antijuive de l’Italie ?
La campagne de presse au prisme de l’opinion juive
Le caractère brusque et jugé artificiel de la campagne lancée outre-monts contre les Israélites invitait légitimement à s’interroger sur sa durée et sa réelle prise sur l’opinion italienne. Depuis 1922, les Israélites de France s’étaient habitués aux palinodies intempestives de Mussolini. Voilà pourquoi il ne fallait pas réagir séance tenante et conserver un nécessaire recul face aux événements. Avec une ironie désabusée, un éditorial de l’hebdomadaire Samedi traduisait cette attitude : « l’observation quotidienne de la politique italienne nous a appris qu’elle est sujette à des fluctuations qui restent souvent incompréhensibles au commun des mortels3 ».
Or, devant l’alourdissement de la vague d’antisémitisme – « le plus effréné4 » – en Italie, force était de constater le caractère sérieux des événements, prise de conscience révélée par l’accroissement du nombre d’articles s’y rapportant dans la presse communautaire. Tous notaient que le monopole de l’antisémitisme était pour le moment détenu par la presse, dirigée par quelques hiérarques fascistes. Paix et Droit l’affirmait : « Depuis 300un certain temps, un mouvement antisémite semble se dessiner en Italie. De nombreux journaux, en effet, tels que le Tevere, le Quadrivio, la Vita Italiana ont publié des articles violemment antijuifs. Tout récemment encore, le Popolo d’Italia et la Tribuna de Rome ont consacré d’importants articles au problème juif en Italie5 ». Que l’antisémitisme se cantonnât au stade verbal avait de quoi rassurer. Dans un régime totalitaire où la propagande n’était pas un simple soutien mais le moteur de toute action politique, surtout quand elle pouvait avoir des répercussions sur le monde extérieur, la presse était-elle pour autant privée de toute autonomie ? Ne pouvait-elle que porter la voix des plus hautes autorités ? Samedi fut l’un des seuls à s’interroger sur cet élément et concluait à un musèlement de la presse, pour mieux soutenir que l’antisémitisme qu’elle véhiculait ne traduisait en aucun cas le sentiment populaire :
Il faut dire que les attaques en question se sont produites dans le Popolo d’Italia, que l’on regarde comme le porte-parole même de Mussolini et qui est d’ailleurs dirigé par le neveu du Duce, et aussi dans le Regime fascista, dirigé par M. Farinacci, l’ancien secrétaire du Parti Fasciste6.
L’évolution de Samedi depuis 1936 était claire. À cette date, Jean Hassid soutenait dans le même journal la thèse inverse : « Mussolini a tenu à déclarer que Farinacci était seul responsable de ses dires et n’exprimait nullement un point de vue officieux7 ». L’idée d’une action autonome de la presse emportait l’adhésion des grands organes de presse français comme Le Temps8 ; de fait, ceux qui pensaient comme Jean Hassid avaient raison et ce ne fut qu’à l’été 1938, lors du lancement de l’antisémitisme d’État, que la presse reçut des consignes officielles, avant quoi elle semblait jouir d’une relative marge de manœuvre9. Faut-il voir dans ces deux positions de Samedi des tentatives de minimiser ce qui se déroulait en Italie, en insistant sur l’imperméabilité de l’opinion italienne ? Toujours était-il que la presse juive ne dissimulait à ses lecteurs aucun indice de l’évolution de la situation transalpine. La campagne de presse antisémite dont l’Italie fut le théâtre prit d’ailleurs bientôt les Juifs de 301France pour cible. C’était la première fois, relativement à l’Italie, que les Juifs de France, à l’heure où le Front populaire incarnait aux yeux des hiérarques italiens la victoire de l’« antifascisme juif », eurent à juger d’attitudes et déclarations dont ils étaient eux-mêmes l’objet10. En janvier 1937, à la suite de la publication quelques jours auparavant dans Il Popolo d’Italia d’un article critiquant le nombre, nettement exagéré et avancé sans vérification, de Juifs siégeant au gouvernement Blum, Elia Arié, juif de Trieste, demanda confirmation auprès de l’Alliance israélite universelle. Il revenait également sur le problème des liens entre ce journal et Mussolini :
Le journal Il Popolo d’Italia de Milan du 31 décembre 1936 publie l’article ci-joint sur l’antisémitisme, dans lequel il cite une longue liste de fonctionnaires juifs attachés à divers Ministères français, liste qu’il emprunte au dernier numéro de Gringoire. Cet article a été reproduit en gros caractères par plusieurs autres journaux italiens et vu que le journal milanais, fondé par le propre frère de Mussolini passe pour être l’organe personnel du Duce, la tendance de l’article est symptomatique11.
Sylvain Halff répondit qu’il lui était impossible de répondre exactement à la requête de son correspondant car il ignorait si toutes les personnes citées faisaient effectivement partie de ces ministères ; il était cependant certain que toutes n’étaient pas juives. Quand bien même, ajoutait-il, Léon Blum n’était pas le premier à faire appel à des Juifs12. Transparaissent ici clairement le rôle central de la presse dans la diffusion de stéréotypes haineux tout autant que l’implication de certains Israélites français comme cibles de la campagne antisémite italienne.
Phénomène inquiétant, l’antisémitisme s’élargissait au monde de l’édition. Hautement symbolique apparut la réimpression en italien des Protocoles des Sages de Sion par Giovanni Preziosi, en 1937. Ceux qui se souvenaient que le Duce avait toujours interdit la publication de cet 302ouvrage en Italie et puni les contrevenants, pouvaient prendre la mesure du retournement total qui se profilait. L’Univers Israélite rapportait que la préface du livre présentait les Protocoles comme un document authentique ; La Vita Italiana, quant à elle, critiquait le Professeur Pincherle, un Juif italien qui avait évoqué le caractère fallacieux de l’ouvrage dans l’Enciclopedia Italiana13. Preuve que l’antisémitisme peinait à imprégner l’opinion, notamment les intellectuels, plusieurs esprits éminents réaffirmèrent haut et fort l’aspect mensonger de l’ouvrage14. Malgré cette maigre consolation, les Israélites français devaient constater avec stupeur et déception que l’Italie, en publiant les Protocoles, reprenait à son compte les moyens les plus éculés de la propagande antisémite15. Les ennemis des Israélites en Italie franchirent un pas supplémentaire en incitant à la haine du Juif dans des discours publics : Roberto Farinacci16 excellait dans l’exercice, remarquait-on souvent17. Ainsi, les Israélites, bien qu’ils fussent gagnés par l’inquiétude, se montraient lucides : l’imprimé, loin de refléter l’état de l’opinion publique, voulait préparer celle-ci à une radicalisation raciste18.
Deux explications principales de l’antisémitisme se retrouvaient fréquemment dans la presse juive française, sans que l’une fût exclusive de l’autre : l’on évoquait ainsi un alignement de l’Italie sur le modèle nazi pour les besoins de l’axe Rome-Berlin ou, plus gravement, l’expression au grand jour de l’antinomie entre fascisme et judaïsme. Choisir l’un ou l’autre facteur n’était pas anodin : retenir le premier amenait quelque 303peu à minimiser l’ampleur et la portée de l’antisémitisme italien ; prôner l’autre explication induisait le pessimisme quant à l’avenir des Israélites transalpins. Le choix ne semblait pas dicté par les idées politiques, mais plutôt par les sensibilités de chacun puisque selon les auteurs, l’on retrouvait parfois dans la même revue les deux conjectures. Ceux qui soutenaient davantage la première hypothèse possédaient une vaste gamme d’arguments. Il apparaissait en effet frappant que, bien qu’il eût à plusieurs reprises critiqué les théories et agissements allemands, Mussolini introduisît le racisme en Italie au moment où il tournait le dos aux démocraties et se rapprochait diplomatiquement des nazis. Tandis que se consolidait l’axe Rome-Berlin, cette opinion gagna du champ parmi les Israélites de France : « Depuis quelque temps déjà, on signal[e] en Italie un certain désaxement dû sans doute à une trop rigide conception de ce fameux axe Rome-Berlin », rappelaient les modérés19. Dans un article fouillé du Droit de Vivre, Pierre Péral expliquait que « l’axe Berlin-Rome passe par l’intolérance », et clamait : « Le Duce sacrifie à Wotan20 » ; l’auteur ajoutait :
L’aspirant César, promu Duce et Auguste par la grâce de Volpi-Fiat, abandonne ses muses romaines pour les dieux de la Walhalla germanique. La famille aryenne se trouve ainsi enrichie d’un nouveau membre. Le nouveau membre est tenu de faire ses preuves21.
De même, pour Jean Hassid, les thèses des antisémites italiens semblaient « calquées sur les textes nazis22 ». Aux yeux des Israélites français ainsi, la haine du Juif n’était rien d’autre qu’une importation en provenance d’Allemagne et artificiellement inoculée au sein d’un peuple incapable de la produire par lui-même. Cela correspondait-il à la réalité ? Ne menait-on pas, parmi les Juifs de France, une analyse plus subtile ? De fait, comme avait commencé à le percevoir l’opinion juive dès 1934, on l’a vu, l’Internationale fasciste que voulait mettre en place l’Italie induisait nécessairement, à terme, une convergence idéologique23, mais là où se trompaient les Juifs français, LICA mise à part, c’était quand ils considéraient les récriminations italiennes à l’égard de l’antisémitisme 304allemand comme la marque d’une incompatibilité idéologique. Les points communs entre fascisme et nazisme apparaissant plus nombreux que ce que l’on pensait, un terreau fertile existait sur lequel pouvait lever une forme d’uniformisation doctrinale, y compris sur la question juive. Il est par ailleurs reconnu que l’Allemagne ne fit jamais pression sur l’Italie pour que celle-ci épousât les conceptions raciales nazies. Or, l’Allemagne joua bien un rôle particulier, que seuls quelques Israélites décelèrent : un « transfert culturel » s’était produit entre le nazisme et le fascisme24. Alors qu’ils se trouvaient embourbés en Éthiopie, que les résultats intérieurs promis tardaient à apparaître, les Italiens trouvèrent dans le modèle nazi les moyens de surmonter leurs difficultés25. Que Mussolini adhérât sincèrement à l’antisémitisme ou se servît plutôt de ce dernier pour donner un élan nouveau à la marche vers la fascisation26, il comprit que lancer une grande et révolutionnaire campagne contre les Juifs pourrait retarder les difficultés nées de l’effritement du consensus au lendemain de la guerre d’Éthiopie, aggravé par la permanence des difficultés économiques27. Seuls certains Israélites progressistes, intéressés par les rouages de l’État fasciste, percevaient cet aspect ; la position de Pierre Péral représentait cette tendance de l’opinion :
La consécration officielle de l’antisémitisme en Italie […] est une nécessité politique pour le régime transalpin. On peut déjà l’annoncer sans crainte de se tromper. C’est la solution correcte d’un problème classique. […] En reprenant les vieilles menées antisémites, les légendes du crime rituel et la conception raciale, Hitler a su unir, dans une seule haine, les éléments les plus hétéroclites de la réaction allemande. En adoptant ses procédés, le Duce tente de rejeter sur une minorité les fautes d’un régime. C’est contre le Juif qu’il s’efforce de refaire l’Union Sacrée des Italiens, qu’il n’a pas pu réaliser dans le fascisme28.
305Loin d’une vision simple des événements, d’aucuns affirmaient ainsi que le fascisme avait repris les méthodes allemandes non pour des besoins diplomatiques, mais bien dans un but interne, répondant au raidissement totalitaire de l’Italie fasciste29.
Autre interprétation retenue par l’opinion juive pour expliquer la vague d’antisémitisme en Italie : la lutte contre le Juif, bolchevique ou bourgeois libéral, antifasciste dans tous les cas. Les Juifs de France qui insistaient sur cette dimension de l’antisémitisme italien semblaient acquis à la conviction que la campagne menée outre-monts contre les Juifs n’était pas un simple feu de paille. L’argumentation relative à l’identité du judaïsme ne se distinguait pourtant pas par sa clarté dans le discours des antisémites italiens. Dans les pamphlets parus en Italie à partir du milieu des années trente, les Juifs se voyaient reprocher de ne pas avoir de patrie et d’œuvrer à la ruine des pays qui les accueillaient30, thème alors récurrent dans toute l’Europe, notamment en France comme l’a montré Ralph Schor31. L’on notait ainsi que les Italiens reprochaient aux Juifs de participer à une organisation tirant les leviers de la finance internationale – les Protocoles n’étaient pas loin – et proche de l’Angleterre, donc hostile à l’Italie. Jean Hassid pointait l’ineptie de telles accusations en remarquant que les antisémites italiens les brandissaient dès que la diplomatie transalpine se trouvait en mauvaise posture : « On a observé ces derniers mois que de semblables campagnes étaient menées en Italie chaque fois que le pays, à Genève ou ailleurs, se trouvait placé dans une situation difficile au point de vue international. On voyait alors réapparaître les vieux clichés, qui en Italie plus qu’ailleurs peut-être sonnaient faux, sur la “puissance occulte juive” ou “la puissance juive internationale”32 ». Le journaliste de Samedi soulignait que c’était particulièrement après 1935 – avec la guerre en Éthiopie et donc avant l’axe Rome-Berlin – que les antisémites développèrent ces idées : « Au moment de la guerre italo-éthiopienne, on accusa ainsi le “Judaïsme mondial” d’avoir déclenché les sanctions contre l’État agresseur. Aujourd’hui, la 306“finance anglo-juive” mènerait le jeu anti-italien en Méditerranée33 ». D’où, par un de ces glissements fréquemment observés chez les antisémites de tout pays, l’accusation d’antifascisme adressée à Israël34. À ce propos réapparaissaient les oppositions parmi les Juifs de France. Observateur sur place, très écouté parmi les Juifs, dont il n’était pas, Paul Gentizon, invitait à la prudence :
Le fait que le judaïsme international se dresse en Europe non seulement contre le national-socialisme allemand, mais aussi contre le fascisme italien en tant que dictature à base nationaliste, suscite parfois quelque réaction en Italie. […] Mais il est possible que, si le judaïsme international agit comme tel contre les intérêts de l’Italie fasciste, son attitude ne sera pas sans conséquence35.
La LICA quant à elle se félicitait de ce que le fascisme considérât Israël comme son ennemi mais comprenait bien, à la différence des plus modérés, que les Israélites d’Italie eux-mêmes étaient visés36. Aussi la campagne antisémite, annonçant les lois de 1938, prit-elle une nouvelle fois comme cible le sionisme des Juifs italiens. D’après les fascistes, « tout appui donné au sionisme est opposé aux intérêts italiens37 », rapportait Samedi en précisant, au sujet du Popolo d’Italia, que « le journal fasciste demande aux Juifs italiens, soit de rompre publiquement tous les liens avec le Judaïsme international, soit de renoncer à la citoyenneté et au séjour en Italie38 » ; en d’autres termes, il fallait « choisir entre Rome et Jérusalem39 », un thème rebattu depuis la crise antisioniste de 1928-1929 mais nettement renouvelé puisqu’on faisait de plus en plus l’amalgame entre Juif et sioniste, ce qui ne mettait personne à l’abri des foudres de la haine40. Très sensible à cette question, comme on a déjà pu le constater, l’opinion juive française réagit pourtant diversement. L’on défendait les Israélites italiens : « Le Sionisme ne saurait avoir aucune tendance anti-italienne », pensait Jean Hassid rendant hommage au judaïsme italien « dont la loyauté pourtant n’a jamais fait aucun doute41 ». Ironique, la 307LICA détournait le débat et se demandait si certains Israélites français pourraient encore, après l’antisémitisme italien, défendre le modèle transalpin et se réclamer du fascisme42 :
Nous sommes curieux de connaître […] l’avis des nobles Israélites bien-nés. Ces Israélites « patriotes », dans le sens exagéré du terme, ces chauvins impénitents de la dernière heure, commencent-ils à voir clair ? Ou bien, réfugiés sous les bannières du PSF et du PPE, croient-ils comme l’autruche de la fable, sauver leur bourse en fermant les yeux et en se reniant ? […]
Il est temps encore de réfléchir sur ces vérités. Que les Juifs, fascistes parce que fortunés, y pensent de temps à autre. L’exemple de l’Italie va-t-il enfin éclairer43 ?
De la sorte, la haine des Juifs, en Italie comme ailleurs, se nourrissait d’un agrégat de thèmes épars et artificiellement rassemblés pour les besoins de la cause fasciste. Mais n’y avait-il pas plus ?
Forts de l’ensemble de ces remarques, les observateurs les plus avisés se demandaient si l’antisémitisme des Italiens se cantonnait à des aspects sociaux et politiques ou revêtait au contraire des aspects raciaux proprement dits. Les rares textes s’y intéressant révèlent à ce sujet de précieux indices. « L’idée du racisme intégral, à la mode du national-socialisme, reste totalement absente de la pensée fasciste44 » : il était encore possible de penser cela en 1936, mais les années suivantes amenèrent à réviser cette impression. Alors que les antisémites européens cherchaient depuis le xixe siècle à mettre au point une théorie de la race juive45, l’Italie ne fut pas imprégnée de pareilles idées : seul le monde de la science, préoccupé par les problèmes démographiques italiens et réfléchissant sur les modalités d’une éventuelle révolution anthropologique, fut amené à poser les questions de l’ethnie et de la race, assez tardivement tout de même46. Nul ne parvenait à se prononcer définitivement sur un éventuel 308tournant racialiste de l’antisémitisme italien. En mars 1937, Paix et Droit se fit l’écho d’une conférence du scientifique Nicolo Castellino, président de l’Union des éditeurs de journaux italiens, où celui-ci, opposant sur le problème juif Italie et Allemagne, récusait toute application de la théorie des races outre-monts ; il déclara « que la théorie raciale allemande est sans fondement aucun et que le principe biologique du sang ne peut absolument pas fixer la notion de nation et de communauté des peuples. La théorie raciste allemande, a-t-il dit, est une chimère47 ». Mais voilà que deux mois plus tard, Samedi publia, sans commentaire, un extrait du Quadrivio où l’on pouvait lire : « Un Juif restera toujours juif dans le sens ethnique de ce mot48 ». Prémices d’un racisme biologique ? Il fallait encore attendre pour le savoir.
Sans toujours percevoir les dessous de la campagne antisémite qui éclata dès 1936 en Italie, les Israélites français lui accordèrent une surface éditoriale pour le moins significative. Ils firent preuve de modération mais « le fait seul que de telles discussions s’ouvrent dans la presse italienne, suffit à marquer le danger réel d’une poussée antisémite dans l’État fasciste », pensait-on à juste titre49. La campagne de presse pourrait-elle contaminer tout le pays et mettre fin à la paisible condition du judaïsme italien ?
L’Italie toujours immunisée ?
Les hésitations du temps se retrouvaient dans les esprits, qui ne savaient plus que penser. Ne percevant pas le tournant qui se profilait, certains s’en tenaient à l’attitude régulièrement observée depuis 1922 : angoissé par la dégradation de sa politique intérieure et extérieure, le fascisme prenait le Juif comme cible afin de détourner l’opinion italienne des problèmes50 ; comme à l’accoutumée, le calme finirait par reprendre ses droits. On retrouve en somme chez ceux qui soutenaient cette thèse la théorie de l’antisémitisme comme recherche d’un bouc 309émissaire passager51. Pour les autres, plus lucides, il devenait évident que le fascisme, nouvellement acquis aux vues nazies, irait plus loin et que la situation se révélerait autrement plus inquiétante que par le passé. De là à en inférer que l’antisémitisme serait érigé en doctrine d’État comme chez l’allié allemand, et que le peuple italien – grand absent à ce moment des propos tenus par les Israélites – se plierait aux ordres d’un Mussolini qui avait « toujours raison », il y avait un pas important, que tous ne franchissaient pas. Selon les tendances de l’opinion juive, l’on se demandait ainsi quels facteurs pesaient en faveur d’un ralentissement ou d’un bond de l’antisémitisme. Il importait de savoir si la violence des attaques contre Israël n’avait pas atteint un seuil de tolérance impossible à dépasser en Italie, ou si, au contraire, il s’agissait d’un prélude à la généralisation de la haine antijuive.
Déceler, comme une décennie auparavant, les moteurs profonds de la politique fasciste hors des frontières de l’Italie amorçait la réflexion. À la charnière entre 1936 et 1937, la Libye fut au cœur des préoccupations. Dans les années 1920, en 1923 particulièrement, l’opinion juive française vit dans les débordements antisémites de Tripoli des actes isolés ne constituant en aucun cas un exemple de la politique juive de l’Italie. Les Israélites français révisèrent-ils leurs positions en prenant acte de la dégradation de la condition juive en Libye ? L’antisémitisme dans une partie de l’Empire colonial italien constituait-il un avant-goût d’une politique sur le point de se réaliser et s’exporterait-il dans la mère-patrie ? La nouvelle situation des Juifs en Italie amenait à 310prendre au sérieux les agissements transalpins en Libye, d’une manière nettement plus marquée qu’en 1923. Les profondes vexations infligées aux Juifs de cette colonie italienne causèrent une profonde émotion parmi les Israélites de France. Étonnante apparut l’interrogation posée par le mensuel Paix et Droit qui semblait tenir pour peu les débordements antisémites dont la péninsule italienne fut le théâtre bien avant Tripoli :
L’antisémitisme commence-t-il à s’infiltrer également en Italie, ce pays qui jusqu’à présent, en était exempt ? La récente loi sur le repos hebdomadaire dominical en Libye et les incidents auxquels elle a donné lieu à Tripoli […] semblent justifier cette appréhension52.
Sans doute une telle question traduisait-elle l’impression que le fascisme se livrait à une escalade décisive dans l’antisémitisme, telle que nulle autre auparavant. Le gouverneur de Libye, Italo Balbo, justifiait la décision imposée aux Juifs par le renforcement de l’italianisation que nécessitait la Tripoli moderne ; « Tripoli n’est pas Tel Aviv », lança clairement Balbo53 ; ceux qui souhaitaient continuer à observer le repos sabbatique s’exposaient à de lourdes poursuites ou devaient s’installer dans les quartiers indigènes. L’ordonnance prévoyant cette interdiction entra en vigueur le samedi 5 décembre 1936 et de nombreux Israélites refusèrent d’obtempérer ; c’est alors qu’éclatèrent les incidents. Les troubles s’étendirent sur plusieurs jours : l’on arrêta des centaines de Juifs, dont plusieurs furent flagellés en place publique, et d’autres incarcérés54. La réprobation fut unanime au sein du judaïsme de France ; fait d’importance, les Juifs français soulignaient que l’émotion gagnait même les non-Juifs et la presse française générale accorda une attention particulière à ces événements55 car la violence avait 311atteint un paroxysme jamais égalé jusque-là. Les Israélites modérés et conservateurs insistaient sur la violation de la liberté religieuse56. À l’opposé, les propos des progressistes s’intéressaient à la nature de l’antisémitisme en Libye ; tout comme pour ce qui se passait en Italie même, Bernard Lecache attribuait les événements au rapprochement avec l’Allemagne : « L’axe Berlin-Rome tracé par Goering et Mussolini passe par Tripoli57 ». L’attitude italienne ne ferait d’ailleurs qu’aliéner Israël, de même que toutes les confessions attachées à la liberté, au fascisme :
Que cela vous plaise ou non, fascistes et fascisants, votre Mussolini et son Balbo sont des assassins, ce que l’on savait, et des imbéciles ! Car le fouet, lorsqu’il est mis au service d’un régime, risque fort de retomber sur les épaules du fouetteur58.
La perception que l’on avait des événements libyens variait selon les tendances et les sources d’information : pour Lecache, « les plaintes des suppliciés, les coups de lanière sur la peau déchirée, furent couverts par les applaudissements59 » ; cela visait à montrer que les fascistes étaient puissants en Libye et que les sympathies entre Juifs et Italiens ne se révélaient pas assez fortes pour éviter l’humiliation des Israélites. Un rapport du comité local de l’Alliance israélite universelle remarquait plus sobrement qu’« une foule nombreuse assistait à la punition infligée à nos deux coreligionnaires60 », sans plus de précisions. Malgré ces légères divergences, tous reconnaissaient un point essentiel : la situation à Tripoli devait être rapprochée de celle de la péninsule. Il ne s’agissait pas d’actes isolés mais d’une campagne d’antisémitisme virulent, organisée par la presse fasciste :
Le journal local, à l’exemple de certains organes de la métropole, mène depuis peu une campagne des plus acharnées contre les israélites de Libye61.
La presse fasciste de Tripoli est déchaînée contre la population juive, dont la résistance veut faire de « Tripoli, ville deux fois italienne, dit-elle, une ville sioniste, et lui donner l’aspect vulgaire de Tel Aviv62 ».
312En situation coloniale, les fascistes, qui voulaient montrer par l’exemple qu’ils maîtrisaient l’espace tripolitain d’une main répressive, avaient pourtant intérêt à ce que le calme revînt rapidement. Ce fut chose faite. L’Alliance israélite universelle prônait l’apaisement : « il ne conviendrait peut-être pas d’attribuer à ces faits, sans doute assez troublants en eux-mêmes, mais d’un caractère plutôt local, une portée qui les dépasse », affirmait Paix et Droit63. Un rapport local soulignait, en contraste avec les éléments fascistes antisémites, le grand philosémitisme de la majorité des Italiens64. Quelques mois plus tard, lors du voyage de Mussolini en Libye de mars 1937, sur lequel on reviendra, les Israélites locaux réservèrent un accueil très chaleureux au Duce qui signifia au rabbin de Tripoli l’expression de ses meilleurs sentiments65, ce à quoi s’ajoutait le revirement de Balbo : « Le maréchal Italo Balbo, gouverneur général de Libye, a prononcé dernièrement, lui aussi, des paroles pleines de sympathie à l’égard de l’élément juif tripolitain66 ». Si l’Alliance israélite universelle recevait de fréquents échos laissant entrevoir une amélioration de la situation en Libye, les autres tendances de l’opinion quant à elles s’en tenaient à leurs premières impressions : à Tripoli s’était jouée l’avant-première de la nouvelle politique juive de l’Italie. L’on ne pouvait plus réagir comme en 1923 ; l’heure paraissait grave aux Juifs de France. L’antisémitisme s’implantait profondément parmi les fascistes ; rien ne retiendrait Mussolini, pas même ses intérêts en Méditerranée.
C’était en effet sur un autre front extérieur que, à la fin de l’année 1937, l’on pouvait voir plus clair dans l’attitude italienne à l’égard d’Israël : la Palestine. Tant que Mussolini pratiquait encore un double langage, il lui restait possible de jouer en toute sécurité la carte sioniste : le revirement de l’Italie à l’égard des Juifs pouvait-il se concilier avec le maintien de liens privilégiés avec les sionistes et d’intérêts non négligeables en Palestine ? Surpris par l’incohérence de la politique italienne, les Israélites remarquaient que le Duce ne rompait pas le cap de sa politique méditerranéenne dans laquelle la Palestine faisait office de pivot, mais un élément central venait modifier la donne : la nouvelle politique arabe de l’Italie. Mussolini, qui avait pris ombrage des récriminations de nombreux milieux juifs de New York, Londres et Paris au moment 313de la guerre d’Éthiopie, craignait de plus en plus que la présence juive en Palestine nuisît aux intérêts italiens dans la région ; au contraire, les Arabes pourraient l’aider à repousser l’hégémonie anglaise au Proche-Orient. Au Grand Mufti de Jérusalem, Hadj Amin-Al-Husseini, Mussolini affirmait qu’il fallait s’opposer à la naissance d’un État juif en Palestine, déclarations en tout point contraires à celles prononcées à Rome devant les représentants sionistes. L’acte d’officialisation de ce tournant arabe de la politique extérieure italienne se produisit en mars 1937, à Tripoli : Mussolini brandit « l’épée de l’Islam » qui symbolisait la protection offerte par l’Italie à l’ensemble du monde musulman67. Les conséquences immédiates de cet acte ne correspondirent pas aux attentes de l’Italie. Aussi se demanda-t-on si la protection accordée au monde musulman nécessitait de rejeter toute alliance avec les sionistes ; à l’occasion de la Foire du Levant, à Bari, L’Univers Israélite soutenait le contraire :
Dans les milieux officiels italiens on ne cache pas l’intérêt que représente pour le commerce italien le marché palestinien. On espère que les commerçants et industriels juifs de Palestine prendront une part active à la Foire du Levant […] où un pavillon spécial sera réservé à la Palestine.
Dans les milieux autorisés, on estime que le fait de s’être proclamé « protecteur de l’Islam » ne doit pas empêcher le gouvernement du Duce de favoriser les relations commerciales et culturelles avec les Juifs de Palestine68.
Le journal ne précisait cependant pas ce qu’il pensait d’une telle acrobatie diplomatique. L’on ne s’encombrait parfois pas de prudence : « il ne semble pas […] que M. Mussolini ait pu donner aux Arabes l’occasion de penser qu’il porte une trop grande amitié aux Juifs », écrivait Samedi69. En fait, toutes les tendances de l’opinion juive s’accordaient sur cette question : l’Italie, qui craignait une mainmise de la Grande-Bretagne sur la zone de Suez, avait plus intérêt à défendre les Arabes en lutte contre les Britanniques que les Juifs. Toutefois, ajoutait-on, avec les Arabes, comme avec les sionistes auparavant, Mussolini suivait son propre intérêt : l’idéologie ne favorisait le rapprochement que de très 314loin ; si l’Italie défendait les musulmans, c’était moins par amitié que pour obtenir des concessions de la part des Anglais70. Ces impressions se confirmèrent lorsque l’on observa que la politique italienne en Palestine prenait un tour nouveau en ce qu’elle s’alignait sur les intérêts allemands ; il ne s’agissait plus tout à fait de la politique méditerranéenne italienne de la décennie précédente : la propagande en arabe émise par les organes italiens71 levait sur ce point toute ambiguïté72. Si bien que les fractions modérées et conservatrices de l’opinion juive rejoignaient tardivement les vues des sionistes et des Juifs d’extrême gauche qui, dès 1936, avaient imputé à l’Italie la responsabilité des troubles survenus en Palestine73. Contrairement à ce qui prévalait encore avant le rapprochement entre Rome et Berlin, Mussolini n’avait plus besoin des Juifs pour sa politique méditerranéenne : il ne fallait donc pas espérer qu’elle freinât ou adoucît sa campagne d’antisémitisme à l’intérieur même de la péninsule. Un profond paradoxe disparaissait : Mussolini semblait aligner sa politique juive sur le territoire italien et hors de ses frontières.
C’est avec la plus vive prudence qu’il convient d’analyser, à partir des précédents développements, l’évolution de l’opinion juive en 1936-1937. Il ne se produisit pas encore à cette date et sur cette question de revirement complet à l’égard de l’Italie – mais celui-ci était en bonne voie –, comme pour la guerre d’Éthiopie. Plus qu’à une phase transitoire entre la bienveillance et la sévérité, l’on assista à un éclatement de l’opinion juive face aux sujets transalpins. À l’exception des progressistes de la LICA, chaque tendance n’évoluait pas clairement et il n’était pas rare de trouver, dans un même titre de presse, des positions contradictoires à quelques jours ou articles d’intervalle. Certes, l’Italie, comme toujours, adoptait une attitude chancelante qui pouvait inviter à corriger son jugement, mais cela ne suffit pas à expliquer la fluctuation des réactions. Il semble donc qu’aucun consensus, même au sein des fractions particulières de l’opinion, ne fût trouvé. Est-ce à dire que certains restaient fidèles aux positions qu’ils avaient observées dans les années 1920 et au début des 315années 1930 ? Personne ne pouvait ignorer l’émoi qui s’était emparé du judaïsme italien et nier les signes tangibles de la réalité, pas même les Juifs les plus amoureux de l’Italie. Ceux-ci, de plus en plus minoritaires toutefois, minimisaient les événements : les débordements ayant éclaté ça et là ne représentaient pas le sentiment général et n’étaient pas le fait d’une politique solidement établie ; la campagne antisémite se réduisait à la presse et n’avait aucun caractère officiel ; enfin, argument massue, l’Italie était bien loin d’égaler l’Allemagne. Aussi, le clan des optimistes mit-il du temps à se désintégrer et, croyant dans la force profonde du philosémitisme italien qui, in fine, l’emporterait, il s’attachait à tout indice positif. Alors même que certains remarquaient l’extrême désorganisation du judaïsme italien face à l’antisémitisme qui le touchait de plein fouet avec une virulence encore inconnue74, une partie de l’opinion juive française pensait que l’on ne dépasserait pas le stade verbal ; en janvier 1937, donc quelques jours après les incidents de Tripoli, Samedi annonçait : « L’Italie ne sera pas antisémite75 ». De telles déclarations furent publiées également en 1938, à la suite d’un démenti paru dans L’Informazione Diplomatica et de la suspension du farouchement antisémite Giornalissimo ; selon Samedi :
Le gouvernement fasciste n’a jamais pensé qu’il était nécessaire, – et ne le pense pas à présent non plus, – de prendre des mesures politiques, économiques, ou sociales, dirigées contre les Juifs comme tels ; excepté naturellement le cas d’agissements dirigés contre le régime fasciste76.
Tandis que les suspicions se confirmaient un peu plus chaque jour, l’on distinguait Italie et Allemagne. Certes, la condition des Israélites transalpins se détériorait, mais « de toute façon, on peut être persuadé qu’une tragédie semblable à celle du problème des juifs d’Allemagne n’éclatera pas en Italie77 ». Au même moment, les conservateurs se demandaient : « Fin de la campagne de presse antisémite78 ? » ; l’annonce du soutien du gouvernement fasciste aux Juifs italiens résidant hors de la péninsule ne 316fit que rassurer davantage ceux qui prédisaient un retour à la normale79. On prend ici la mesure de l’étonnement qui frapperait plus tard les optimistes. Aux antipodes de cette partie des Israélites figurait la LICA, persuadée que l’adoption d’un antisémitisme d’État était inscrite dans le fascisme ; dès 1937, Pierre Péral prophétisait : « La consécration officielle est une affaire de pure forme. […] L’Italie est contaminée80 ». Entre ces deux pôles extrêmes figurait un groupe difficilement délimitable qui, sans partager les explications proposées par la LICA, parvenait aux mêmes conclusions.
Le débat vivait ses dernières heures. À l’été 1938, l’Italie finit par donner raison aux plus lucides et aux plus pessimistes, qui avaient la victoire bien triste. Elle mit en place une sévère législation antisémite appuyée par une solide machine administrative. Même les plus critiques vis-à-vis de l’Italie ne s’attendaient sans doute pas à un tournant si radical. Pour l’écrasante majorité de l’opinion juive française, l’antisémitisme d’État signait l’arrêt de mort d’un sincère et profond rêve d’assimilation. Toutes les idées défendues depuis l’avènement des Chemises noires par les Juifs admirateurs de l’Italie, au risque parfois de se mettre à dos une partie de leurs coreligionnaires, se trouvaient brutalement invalidées. La réalité se révélait difficile à affronter ; mais le rêve s’était-il complètement éteint ?
La législation antisémite de 1938 :
la mort du rêve d’assimilation ?
« Depuis dix ans nous avions raison, Mussolini avoue son racisme81 » ; « la LICA, depuis dix ans, a eu raison de proclamer que le fascisme était un et indivisible, qu’il est porteur, partout où il naît, de racisme et d’antisémitisme82 ». Si pour les Juifs progressistes le tournant législatif 317de l’antisémitisme italien apparut presque comme une formalité prévue de longue date, le reste de l’opinion juive ressentit la nouvelle comme un choc ; bien que l’on eût perçu la radicalisation fasciste, l’on ne pensait pas sa traduction si brutale. Comment l’opinion juive s’expliquait-elle ce tournant ? Le mettait-elle en regard des débordements observés depuis 1922 ? S’en tenait-elle aux analyses formulées depuis 1936 ou évoluait-elle ? Sous un angle différent, réagissait-elle comme elle l’avait fait face à tous les cas de ce type en Europe (Allemagne, Europe centrale…) ou les liens privilégiés qui unissaient Juifs français et italiens induisaient-ils une attitude particulière ? Dans l’ensemble, des progressistes aux conservateurs, les analyses se rejoignaient en dépit de quelques ponctuelles variantes, ce qui n’empêchait pas l’instrumentalisation de la question juive en Italie à des fins de politique interne.
Une indignation triste, sincère et unanime
Tout commença – ou presque – par la publication d’un « Manifeste des scientifiques racistes » paru le 14 juillet 1938 dans un article d’Il Giornale d’Italia portant le titre « Le fascisme et les problèmes de la race » : ce texte, rédigé par « une dizaine d’universitaires obscurs », d’après Sam Lévy83, était présenté comme une réalisation collective afin de lui donner un cachet scientifique, mais portait surtout l’empreinte de Mussolini et de l’anthropologue Guido Landra84. Était clairement affirmée l’existence d’une race italienne pure, d’origine aryenne et raciste, à laquelle Israël, agent de l’antifascisme mondial, n’appartenait pas. Pour soutenir ces idées nouvelles, parut le 5 août 1938 le bimensuel La Difesa della razza (« La défense de la race »), tenu par Telesio Interlandi, déjà détenteur du très antisémite Il Tevere : une propagande antijuive, s’appuyant sur un magma d’arguments politiques, historiques, religieux et pseudo-scientifiques disparates, remplissait les colonnes de cette revue afin de faire pénétrer les idées antisémites au sein de l’opinion. Cette haine, et 318ce fut le plus important, se traduisit dans les faits par l’adoption d’une législation discriminatoire. Le 1er septembre, le Conseil des ministres promulgua une première série de lois antisémites : expulsion des Juifs étrangers, retrait de la citoyenneté italienne à ceux l’ayant obtenue après 1918, interdiction aux enfants juifs de suivre leur scolarité dans des établissements d’État. Le Grand Conseil du 6 octobre franchit un nouveau pas, puis, le 10 novembre, les mariages mixtes85 furent interdits, les Juifs exclus du service militaire, de toutes les charges publiques et ceux-ci virent leur participation limitée dans le domaine économique, malgré quelques régimes d’exception86. Approuvée par les sénateurs et députés, puis contre-signée par Victor-Emmanuel III, cette législation pouvait entrer en vigueur87. Proportionnellement, la plus importante partie des sources à notre disposition fut naturellement consacrée à cet événement : au total, sur les deux années 1938 et 1939, 177 articles sur les titres retenus l’abordèrent. La presse juive française rapportait souvent en détail les lois susexposées et se faisait l’écho, avec quelques approximations parfois, de l’arsenal juridique mis en place pour les appliquer.
La brutalité de la prise de décision, qui dénotait son caractère artificiel, frappait les esprits. Le caractère de la nouvelle législation confirmait des idées esquissées depuis 1936 : l’on n’insistait plus que sur la volonté de copier le modèle nazi, tandis que l’accusation d’antifascisme adressée à Israël semblait en fait un prétexte pour s’aligner sur Hitler. Il est frappant de remarquer que même les Israélites les plus à gauche concluaient également à l’uniformisation des politiques fascistes ; nul ne conférait avant tout à l’antisémitisme italien des racines purement internes. Prospero, de la LICA, parlait ainsi dès février d’un « antisémitisme “made in 319Germany”88 » ; d’où le caractère hâtif de cette législation, selon St Bradu, aux yeux duquel « l’antisémitisme italien fut décrété dans un seul jour89 ». Certes, de telles déclarations visaient à montrer l’unité des fascismes, mais il n’en demeurait pas moins que la LICA et d’autres niaient qu’il existât un profond germe italien d’antisémitisme90. Les conservateurs et les modérés allaient encore plus loin et, dans des raisonnements qui sonnaient presque comme des circonstances atténuantes, estimaient que Mussolini ne jouissait d’aucune marge de manœuvre autonome et n’avait pas choisi lui-même d’officialiser l’antisémitisme, comme le pensait Alfred Berl :
Mussolini est plus ou moins prisonnier d’Hitler. S’il fait de l’antisémitisme, ce n’est pas par conviction, mais par procuration, et en cette conjoncture, l’Italie semble jouer le rôle de second, sinon de satellite de l’astre germanique. Il fallait à Hitler plus qu’une alliance politique et militaire ; il voulait un gage officiel et visible de solidarité morale dans une question où le Reich était le seul grand État qui eût pris une position contraire au droit, à la justice, à l’humanité. Il a fait de Mussolini son complice. Le Latin a dû céder au Germain, et vendre son âme au Démon. Le voulût-il, pourra-t-il jamais se reprendre ? Et quelle sera la durée de l’antisémitisme italien ? À cette question ne peut répondre qu’une autre question : quelle sera la durée de l’axe Rome-Berlin91 ?
Cette opinion ne fut jamais remise en question. B. Messino, revenant à la mi-1939 sur la législation, écrivait qu’« elle a été exigée par l’Allemagne […]. Il est évident que l’antisémitisme italien est calqué, dans sa propagande, dans son argumentation, dans ses lois, sur l’antisémitisme allemand. D’ailleurs le même phénomène apparaît chez toutes les nations qui tombent sous l’influence allemande92 ». Rien n’y fit, pas même les dénégations de Mussolini : le rôle de l’Allemagne dans la mise en place de la législation antisémite apparaissait comme une vérité 320absolue. Lorsque, le 18 septembre 1938, le Duce prononça à Trieste, qui abritait la troisième communauté juive d’Italie, son premier discours après la mise en place de l’antisémitisme d’État dans lequel il rappela avec ambiguïté la teneur des lois qu’il venait de promulguer, L’Univers Israélite retranscrivait sans y souscrire les propos suivant lesquels l’Italie n’avait pas obéi à une puissance étrangère et avait toujours considéré « l’hébraïsme mondial » comme un « ennemi acharné93 ». À cette même occasion, la propagande italienne dénonça un complot antifasciste mené par des Juifs : nul parmi les Israélites de France ne crut à une opération autonome de l’Italie ; Le Droit de Vivre titra : « Le “complot antifasciste” est de fabrication allemande94 ».
Si la perplexité l’emportait à ce point dans l’ensemble du judaïsme français, c’était parce que la persécution antisémite paraissait en totale contradiction avec la tradition italienne et même avec la politique jusqu’alors adoptée par le fascisme. Serge Weil-Goudchaux le notait sans ambages : « Ainsi donc le chef de ce pays […] renie tout un glorieux passé95 ». Les Israélites français tentaient de démanteler un par un les arguments fascistes destinés à replacer artificiellement l’antisémitisme italien dans une tradition millénaire. Ce fut le cas lorsque les antisémites d’outre-monts, en contradiction avec les déclarations de Mussolini prononcées dans les années 1920, affirmèrent par une relecture de la littérature latine que la Rome antique, en voie de restauration disaient les fascistes, rejetait les Juifs, assimilés aux « barbares96 ». Faisant écho, semble-t-il, à l’article de Cornelio Di Marzio, « La Rome antique et les Juifs », publié dans La Difesa della razza en janvier 1938, L’Univers Israélite rétorquait dans un long développement historique que certains enfants d’Israël étaient présents en Italie avant même ceux qui avaient engendré une partie des Italiens devenus antisémites : « L’historien ne peut que sourire quand il voit un Italien, dont les ancêtres sont venus des pays du Sud des Alpes dinariques, contester ou vouloir limiter les droits de cité d’un Juif, descendant d’un citoyen romain97 ». Il apparaissait également 321ridicule que Farinacci exhumât une bulle datant de Nicolas V, pape du xve siècle, pour montrer que l’Église avait toujours condamné les Juifs98, ou que d’autres fascistes voulussent jeter le discrédit sur l’Ancien Testament pour appuyer leurs thèses qui peinaient à trouver des fondements valables99. Mais les Israélites ne s’engageaient que timidement sur le terrain religieux100. Quand il s’agissait de l’« aryanisme » des Italiens, les Juifs se montraient nettement plus prolixes ; il y avait dans l’idée de race pure, a fortiori pour les Italiens, un contresens invraisemblable, aux yeux des progressistes :
L’interpénétration est telle qu’il n’y a pas de possibilité de réfuter ceux qui montrent l’inextricable liaison de tous les apports méditerranéens dans la fameuse « race italienne » découverte en juin 1938 par des Herre Docktor allemands. Juifs ou catholiques sont du même berceau, ethniquement ressemblants, psychiquement et psychologiquement identiques101.
Démonter la thèse de la race pure passait parfois par le sarcasme, tant il semblait aisé de faire la preuve que l’Italien était tout sauf « aryen ». Jules Braunschvig pointait l’inconséquence d’une telle idée : « Les Italiens : de grands aryens blonds, je veux bien, mais…, les exceptions sont très nombreuses102 ». Selon l’opinion juive, ce vocabulaire et ces nouveaux postulats raciaux, importés d’Allemagne, ne contredisaient pas seulement la tradition de l’Italie libérale, mais également celle de l’Italie fasciste. Aussi mettait-on en regard les propos tenus en 1932 par Mussolini à Emil Ludwig, qui avaient, l’on s’en souvient, marqué les Israélites français, et les déclarations postérieures à 1936 ; L’Univers Israélite faisait remarquer qu’un article de La Difesa della razza attribué à Mussolini « réfute tout ce que le duce a, naguère, pu dire ou écrire à propos de la race à Emil Ludwig. Argument principal : en 1932 “l’antifascisme hébraïque” (?) n’était pas encore né103 ! ». Le même journal rapporta la réaction d’Emil 322Ludwig en personne face à la législation antisémite : « Ces Entretiens, écrit-il, j’avoue aujourd’hui que je ne les aurais pas entrepris si j’avais prévu104… » ; mais l’historien allemand tenait à souligner qu’il ne voulait pas juger un homme au prisme de son attitude à l’égard des Juifs ; « Je garde cependant inchangée l’opinion que j’avais pu concevoir de sa personnalité105 » ; en outre, il fallait bien distinguer Mussolini d’Hitler, ajoutait Ludwig. Combien étaient-ils, ceux qui, parmi les Israélites français, adoptaient une pareille attitude et refusaient de rejeter le fascisme italien et son chef en bloc ?
Qu’ils révisassent complètement ou partiellement leur jugement sur le fascisme italien en général, les Juifs français devaient tirer les conclusions des précédentes observations : la législation nouvellement mise en place rompant avec tout le passé italien, celle-ci contenait approximations, incohérences et contradictions. En d’autres termes, selon l’opinion juive française, ne s’improvisait pas raciste qui voulait. La presse juive n’épargnait à ses lecteurs aucun des hiatus marquant la législation transalpine. Traitant de l’antisémitisme italien, Samedi se demandait ainsi « s’il est plus encore ridicule qu’odieux106 ». Nombre de points restaient en suspens dans la loi, comme la question des biens juifs107, à quoi s’ajoutaient des absurdités à même de frapper l’opinion. L’application des lois antisémites aux Juifs italiens de l’Empire et des grandes colonies italiennes, ceux-là même qui défendaient les intérêts transalpins en Méditerranée, se révélait, constatait Léon Abastado, contreproductive : « Les mânes de Garibaldi, de Cavour, de Victor-Emmanuel Ier et de tous les grands artisans du “Risorgimento” doivent frémir d’indignation à cause de cette atteinte portée à leur idéal de l’“Italia irredenta”108 ». Quand le Duce remit une médaille au lieutenant-colonel Giorgio Morpurgo, mort au combat pendant la guerre d’Espagne et issu d’une ancienne famille juive d’Italie, l’on ironisait : « Faut-il attendre maintenant la publication, dans le Journal Officiel italien, d’un décret nommant feu le lieutenant-colonel “Aryen d’honneur”109 ? ». Un autre acte, 323visant précisément des Israélites français, paraissait à lui seul révéler toute l’inconséquence de la politique italienne : l’appel de l’Istituto nazionale per i cambi con l’estero adressé à des banques et agences de tourisme parisiennes et les invitant à faire savoir à leurs clients israélites qu’ils pourraient entrer librement en Italie. Cette donnée, tout autant qu’elle met en relief les nécessaires accommodements apportés à l’application de la législation110, amène à suggérer qu’il était hautement probable que l’Italie s’intéressât à l’image qu’elle renvoyait à l’opinion juive française. Samedi interpellait les Juifs de France :
Donc, les Juifs français sont prévenus : à leur entrée en Italie, ils ne seront ni dépouillés de leur fortune, ni stérilisés, ni même envoyés aux îles Lipari. Ils peuvent donc, en toute tranquillité, aller en Italie.
Le feront-ils111 ?
Vraisemblablement pas. Car de dérisoires contradictions juridiques et politiques ne devaient pas masquer la détresse des Israélites d’Italie et l’insigne gravité de la situation. « La nouvelle orientation raciale en Italie a plongé dans la consternation les milieux juifs italiens », remarquait Serge Weil-Goudchaux112. La dégradation de la condition juive en Italie était d’autant plus injuste que le judaïsme italien passait pour le plus assimilé de ceux persécutés en Europe113 : « Inhumaines et lâches quand elles s’en prennent à la collectivité juive, les lois racistes deviennent révoltantes et infâmes quand elles s’appliquent à des hommes qui ont donné le meilleur de leur être à la patrie, qui n’ont vécu que pour elle », se révoltaient certains en ces termes114. Malgré un « brevet de latinité que leur conférait un séjour ininterrompu115 », les Juifs italiens devaient 324souffrir de leur naissance. Alfred Berl, après avoir rappelé la dette que l’Italie devait à Israël, s’indignait : « Après de telles preuves, les Juifs n’étaient-ils pas autorisés à croire qu’ils avaient bien et définitivement conquis l’italianité116 ? ». Des flots de lignes, rappelant les bienfaits que les Juifs avaient rendu à leur nation, se déversèrent sur la presse israélite : parmi tant d’autres exemples, Robert Hayem, un capitaine de réserve d’artillerie, prit la plume pour rappeler à Mussolini, dans les colonnes de L’Univers Israélite, la bravoure des soldats italiens nés d’Israël pendant la Grande Guerre117. En un sens, le judaïsme français, qui défendait l’assimilation comme meilleur remède contre l’antisémitisme devait constater l’invalidité du paradigme qu’il ne cessait d’afficher.
Les lois antisémites semblaient parfois plus dures que celles promulguées par les nazis118, et réduisaient les Juifs, dont certains avaient dirigé l’Italie, au rang de persécutés au ban de leur terre. Certains, ne supportant pas cette dégradation, ne trouvaient d’autre issue que la mort : « Beaucoup ne peuvent survivre à l’outrage fait à leur honneur et à leur conscience. Les cas de suicides de personnalités israélites des plus éminentes sont fréquents119 » ; l’on pensait à l’éditeur Formiggini ou à l’amiral Ascoli, déchus de leurs fonctions. Qu’adviendrait-il en outre des Juifs étrangers devant quitter la péninsule avant le 12 mars 1939 ? « Où pourront-ils aller ? C’est la question qu’ils se posent avec angoisse. Tous les pays leur sont fermés120 ». Angoisse qui gagnait également la petite et tranquille communauté de Rhodes121. En mai 1939, l’on signalait que 3 720 Juifs d’origine étrangère avaient quitté l’Italie ; 933 avaient reçu l’autorisation de demeurer en Italie, tandis que 128 demandes de prolongation temporaire de séjour sur 3 190 furent satisfaites122. En réalité, ces départs furent contrebalancés par des arrivées nombreuses ; 7 000 Juifs étrangers peuplaient l’Italie123. L’on crut un temps à un « adoucissement124 » de la législation, mais la réalité étouffait l’espoir : en mars 3251939, Paix et Droit annonçait à ses lecteurs que les fascistes édifiaient un camp de concentration sur une île du sud pour les Juifs étrangers n’ayant pas quitté le pays avant le délai fixé par les lois125.
Les Juifs de France réagissaient-ils à l’antisémitisme en Italie sur le même mode que lorsque ce fléau frappait d’autres pays ? Assurément non. La sœur latine demeurait unique. Quand il s’agissait de l’Italie, l’opinion juive parlait sur un ton différent de celui qu’elle avait adopté relativement à l’antisémitisme nazi par exemple126. Une tristesse sincère et profonde s’emparait des Juifs à l’idée que ce pays qu’ils aimaient tant et dans lequel ils fondaient tant d’espoir tombât dans l’obscurantisme ; les propos de Jules Braunschvig le laissaient percevoir :
Cette législation mensongère et révoltante est également sotte.
Je le dis avec une peine accrue parce qu’il s’agit de l’Italie, qui était pour beaucoup comme une seconde patrie européenne ; de l’Italie universelle de l’humanisme et de la Renaissance dont nous sommes imprégnés, que nous aimons passionnément et qui nous attirait souvent, naguère127.
L’on refusait d’assimiler l’antisémitisme à l’esprit italien. En juin 1939, L’Univers Israélite, afin de rappeler la véritable opinion qu’il avait de l’Italie, publiait un article de Margherita Sarfatti sur Amedeo Modigliani, afin de montrer que, outre-monts, la culture, qu’avaient contribué à forger beaucoup de Juifs, l’emporterait sur une éphémère politique : « Nous qui restons obstinément fidèles à la fois à la culture gréco-latine qui nous a nourris et à l’héritage sacré d’Israël que nous prétendons maintenir intact, ne pouvons concevoir que le racisme germanique paraisse conforme au génie italien128 ». Il n’était pas jusqu’au Droit de Vivre qui ne partageât une telle conviction : ne comprenant pas comment l’antisémitisme avait pu s’insinuer dans la péninsule, affirmait le journal, « bien des gens […] gardent au cœur (et ils ont raison), une grande tendresse pour l’Italie129 ». Même si des récupérations politiques avaient cours, les Israélites français ressentaient une peine profonde devant les événements d’Italie : il fallait s’unir, car l’on avait la chance de vivre en pays démocratique, et 326si le judaïsme italien avait pu être frappé, son pendant français n’était pas à l’abri130.
Fallait-il renoncer au rêve d’assimilation symbolisé jusqu’alors par l’« israélitisme » transalpin ? Certes, la fusion totale avec la nation ne semblait pas pouvoir épargner définitivement une dégradation de la condition juive. Mais, le fascisme, ce n’était pas les Italiens131. Ces derniers restaient fidèles à leur tradition philosémite. Comme pour adoucir sa peine, l’on se faisait bruyamment l’écho des réactions de toutes sortes à l’antisémitisme fasciste.
L’Italie raciste au ban des Juifs et philosémites du monde
Au premier rang des réactions étudiées figurait celle du peuple italien. S’était-il laissé aller lui aussi à la mode allemande, selon la terminologie d’alors ? Les Juifs de France étaient heureux et rassurés de pouvoir affirmer le contraire. En l’absence de toute liberté en Italie, il fallait se fier à des actes isolés, des anecdotes parfois qui, placés bout à bout, étayaient la thèse de l’immunité de l’opinion italienne. Certes, une poignée de hiérarques fascistes semblaient adhérer mollement au nouveau régime d’exception prononcé contre les Juifs132, comme Italo Balbo ou Nicola Pende, un des instigateurs du racisme qui fit machine arrière en constatant les exagérations dans son application133, mais dans l’ensemble les fascistes patentés se rangeaient aux idées du Duce. Il n’en allait pas de même, ajoutait-on de la population qui, restée fidèle à son ouverture d’esprit ancestrale, ressentait le Juif comme un semblable134. Ce sentiment apparaissait partagé par tous et en tout lieu ; préfaçant l’ouvrage de Giuseppe Gaddi, Le Racisme en Italie, Bernard Lecache décrivait son impression :
Gisueppe Gaddi, qui n’est pas Juif, qui est simplement un homme d’esprit libre, la [la législation italienne] dénonce, la flétrit, non seulement en son nom, mais au nom de tout un peuple, le sien, le malheureux et vaillant peuple italien.
Il en a le droit. Le peuple italien est avec lui, en dépit des apparences, et point avec le tyran.
327Le peuple italien ne cesse de protester, de s’indigner, et ce que j’aime dans cet ouvrage, c’est qu’on n’y rencontre à peu près point l’auteur, qui s’efface volontairement, mais, à tout instant, l’homme de Milan, de Florence ou de Palerme, celui qui est innombrable, si j’ose ainsi écrire, celui qui refuse la confiance au fascisme, qui bafoue le racisme, qui est des nôtres et reste des nôtres135.
Les Italiens semblaient totalement imperméables à la propagande antisémite, raison sans doute du renforcement de celle-ci au vu des effets médiocres qu’elle entraînait ; à la LICA, Geoffroy Fraser, de retour d’Italie, rapportait qu’« on ne peut trouver la moindre trace de sentiment antisémite dans la population italienne136 ». Opinion identique à celle de l’Alliance israélite : « Malgré la propagande antisémite très intense par la presse et la radio, les couches profondes du peuple italien semblent ne pas être touchées pas le virus antijuif137 ». Les exceptions n’étaient pour autant pas passées sous silence : il semblait que dans les petites villes, le racisme gagnât certains esprits ; des écriteaux antijuifs y fleurissaient à l’entrée des commerces et édifices publics. Plus gravement, à Ancône, les Juifs n’étaient plus admis dans les cinémas et ils furent rejetés des cercles culturels de Venise138. Edmond Dreyfus, dont les observations tranchaient avec celles de ses coreligionnaires français était inquiet et avait pris lui-même dès 1936 la mesure de l’infiltration antisémite ; de fait, la situation pouvait prendre des traits différents selon les régions :
Les Italiens sont très influençables, vous le savez certainement aussi bien que moi. Il ne s’est pas passé un seul jour, sans que j’entende dans les trains, dans les trams, les plus grandes absurdités recueillies dans la presse et inspirées par l’Allemagne et admises le plus souvent avec la plus grande naïveté, ou la plus grande ignorance. L’Italien est crédule, d’ailleurs la doctrine fasciste le lui ordonne, mais on lui présente les juifs comme les adversaires ou les ennemis du fascisme, et il n’en faut pas davantage pour déclencher un mouvement d’aversion qui dégénèrera en haine si on ne le combat pas énergiquement. L’origine de la campagne se trahit puisqu’elle va de pair avec la campagne antifrançaise, campagne à laquelle le Gouvernement français n’accorde pas toute l’attention qu’elle mérite139.
Ces manifestations jugées sporadiques par la majorité semblaient toutefois 328se noyer dans le flot du philosémitisme quotidien exprimé par les Italiens. Lors d’une représentation musicale, un chef d’orchestre juif reçut une ovation qui sonnait comme un soutien aux souffrances du peuple juif140. Un autre exemple paraissait sincère, éloquent et représentatif : un mécanicien de l’express Rome-Paris rapporta que l’administration des Ferrovie dello Stato avait demandé à ses employés s’ils avaient des ancêtres juifs ; or, l’une des personnes interrogées répondit : « Oui : Adam et Ève141 ». Ces manifestations de soutien ne faisaient que répondre à l’attitude observée au plus haut échelon : le roi d’Italie, Victor-Emmanuel III, qui avait pourtant contre-signé la législation antisémite, fit parvenir à la communauté juive de Rome un message de soutien142. Les intellectuels n’étaient pas en reste, ajoutait-on : dans la Camicia Rossa, Ezio Garibaldi, neveu du héros des deux mondes, n’eut pas de mots assez forts pour critiquer le tournant raciste du régime143. Faisait avec lui chorus, outre Croce, Marinetti, dont se réclamaient pourtant les fascistes, qui publia un article où il critiquait la législation antisémite ; « Chaque Italien aujourd’hui se demande quelle faute ont bien pu commettre les Juifs144 », affirma-t-il, propos qui « ont produit sur l’opinion publique une impression considérable145 » ; l’on regrettait toutefois le silence de Papini, qui s’était élevé avec force contre l’antisémitisme allemand en 1933. Un éminent professeur, membre de la Dante Alighieri mais resté anonyme, envoya à Sam Lévy un message dans lequel il faisait part de l’indignation de tous les intellectuels en Italie146 ; il ajoutait cependant que leur marge de manœuvre demeurait réduite :
Vous avez parfaitement raison. Tout ce que vous dites, les intellectuels italiens, nous le pensons comme vous et avec vous. […] Qu’il me suffise de vous dire que les esprits libres en Italie demeurent dans une impuissance totale147
Les Israélites français restaient en revanche généralement silencieux sur 329les réactions des Italiens exilés, sans doute parce qu’elles n’étaient pas marquées par un philosémitisme semblable à celui en vigueur dans les frontières de la péninsule148.
Il n’en demeurait pas moins qu’à l’étranger, l’on critiqua avec force la nouvelle législation. Les Juifs français, qui entendaient montrer qu’ils ne constituaient pas la seule communauté solidaire des Israélites italiens, se faisaient régulièrement l’écho de la manière dont le monde juif accueillait les lois raciales. Les archives du Centre de documentation juive contemporaine conservent deux témoignages d’éminentes figures nées d’Israël qui firent part directement à Mussolini de leur réprobation. D’Aix-les-Bains, Arthur Rubinstein, israélite d’origine polonaise, qui avait annulé ses concerts italiens renvoya au Duce la croix de Commandeur que ce dernier lui avait remise et signa « Arthur Rubinstein, pianiste juif149 ». Cela faisait écho à d’autres lettres envoyées à Mussolini, comme celle d’Henry Bernstein, dramaturge français qui avait été décoré de la distinction d’officier de l’ordre de Maurice et Lazare, et la restitua à Mussolini : « Je ne regarderais plus comme un honneur de la porter alors que Vous persécutez au nom d’un racisme d’invention toute récente des citoyens italiens sans reproche », écrivit-il150. Autant de gestes salués par la presse juive151. Ce qui retint toutefois le plus l’attention de l’opinion juive française fut la fronde d’Israël à l’égard du projet de colonisation juive en Abyssinie proposé par Mussolini : à la suite de l’officialisation 330de cet objectif dans l’Informazione Diplomatica, la perplexité gagna le monde juif152 ; les Israélites français purent à cette occasion prendre la mesure de l’opposition du Congrès juif mondial à l’Italie ; on peut lire dans un compte-rendu de la réunion du 16 janvier 1939 :
Le Congrès Juif Mondial rejette résolument l’idée de la création d’une colonie juive en Abyssinie. On ne saurait procéder à une œuvre de colonisation juive sur le territoire d’un gouvernement antisémite tel que le gouvernement italien153.
Plus loin, le même rapport ajoutait que « le véritable objet de cette proposition est de détourner l’immigration juive de la Palestine et de procurer des appuis financiers à l’édifice vacillant du crédit italien154 ». Les Juifs de divers pays sanctionnaient très nettement, mais sur le plan verbal, l’Italie.
Ce n’était pas parce qu’Israël se trouvait la principale victime qu’il était le seul à vilipender le pays de Mussolini, remarquait l’opinion juive. Tous les hommes épris de justice et de liberté amplifiaient le bruit de la contestation. Il n’était donc pas étonnant que le christianisme condamnât également les agissements italiens, et ce au plus haut niveau. Pie XI, malgré les accords de Latran, avait critiqué en juin 1931 la volonté d’embrigadement de la jeunesse par les fascistes dans une encyclique intitulée Non abbiamo bisogno, qui s’érigeait contre la « statolâtrie païenne », inconciliable avec les préceptes de l’Église ; en 1937, il fit lire dans toutes les églises allemandes l’encyclique Mit brennender Sorge, où il blâmait le racisme nazi. Constatant l’imprégnation de telles valeurs en Italie, le pape quitta le Vatican le 8 mai 1938, quand Mussolini reçut avec faste l’allié nazi ; par la suite, Pie XI multiplia les messages de protestation contre la législation antisémite italienne. Ces ripostes remplirent de joie les Israélites français qui virent en Pie XI l’un des plus farouches ennemis du fascisme, à telle enseigne qu’en août 1938, Le Droit de Vivre demanda : « Mussolini va-t-il exiler le pape155 ? » ; le Congrès juif mondial tint d’ailleurs à rendre hommage à l’action philosémite du pape156 et l’on 331sait depuis lors que ce dernier préparait l’encyclique Humani Generis Unitas, nouvelle condamnation de l’antisémitisme157. Les déclarations du souverain pontife contre l’antisémitisme italien retentirent dans l’ensemble du monde catholique où elles produisirent un vif effet158. Les Israélites s’en réjouirent et y virent la consécration du rapprochement judéo-chrétien : L’Univers Israélite, ainsi que Paix et Droit, publièrent un sermon du cardinal Schuster, archevêque de Milan, qui lors d’une de ses homélies dominicales critiqua les théories racistes allemandes, ce que tous comprirent comme une réprobation de la situation italienne également159. Les catholiques français n’étaient pas en reste : entre bien d’autres, les cardinaux Verdier, Liénart et Maurin, le Père Bonsirven, l’abbé Violet, Mgr Chaptal, Mgr Ruch, Mgr Saliège, Mgr Rémond160, Marc Sangnier ou encore Jacques Maritain condamnèrent l’antisémitisme en Allemagne et en Italie161. Les forces religieuses s’unissaient contre le rejet des Juifs en Italie.
Parmi les laïcs français en revanche, remarquait l’opinion juive, l’on ne retrouvait pas une aussi vibrante unanimité162. À un moment où la fièvre intérieure atteignait son paroxysme, la majeure partie de l’opinion juive n’abordait que peu les réactions françaises à l’antisémitisme italien, en dehors du monde catholique. Les conservateurs et les modérés traitaient 332souvent indirectement cette question en citant dans leurs colonnes des extraits de la presse nationale163. Tout en s’adonnant à des pratiques analogues, les Israélites les plus à gauche ne passaient cependant pas sous silence ceux qui applaudissaient à l’ostracisme des Juifs en Italie164. Dans l’ensemble, les mouvements français favorables au nazisme appréciaient l’alignement des fascistes sur Hitler tandis que les antisémites se réjouissaient de ce que la patrie du philosémitisme découvrît enfin les méfaits causés par Israël, selon un vocabulaire coutumier165 : aux yeux des antisémites, les Juifs italiens, malgré ce que proclamait une vulgate largement diffusée, ne s’étaient jamais assimilés ; cela n’empêchait pas que certains comprissent mal l’importation du racisme biologique et de l’idée d’aryanisme au sein d’un peuple latin et méditerranéen. Mais, surtout, si les Israélites français n’abordaient que timidement l’attitude de l’opinion française devant la nouvelle législation raciste en Italie, cela provenait du fait que se poserait inévitablement la question de l’immigration des réfugiés juifs transalpins ; adoptant un ton provocateur, les progressistes interpellaient ceux qui restaient sourds à la misère des Israélites d’Italie : « Encore des réfugiés ! s’écrieront d’aucuns. Eh ! oui, encore des réfugiés ! Faut-il les tuer tout de suite pour que l’on n’en parle plus166 ? ». Prenant très à cœur cette question, Bernard Lecache partit plaider la cause des réfugiés italiens auprès d’Albert Sarraut, ministère de l’Intérieur, qui lui fit une réponse en demi-teinte :
En dépit de sa lucide générosité, le ministre de l’Intérieur, Albert Sarraut, ne dissimule pas les difficultés supplémentaires que va rencontrer l’Administration devant ce problème lamentable.
Il faut aider la France en apportant votre aide aux proscrits167.
Le Droit de Vivre consacra un important article à l’arrivée des réfugiés italiens dans le Sud-Est de la France et en appela au devoir d’humanité et 333de solidarité168. Si les nouveaux arrivants ne bénéficièrent d’aucun soutien politique à une époque où l’on voulait fermer les frontières, ils purent compter sur l’aide des populations locales, souvent hostiles au fascisme, lequel voyait en Nice une terre irrédente, ainsi que sur le soutien de la communauté juive niçoise169. L’Italie n’était plus le paradis des Juifs.
Pour la première fois depuis 1922, la question italienne constituait la première préoccupation de l’opinion juive française. L’explosion de la production écrite relative à l’Italie, qui élargit significativement le cercle de ceux qui se prononçaient habituellement sur la situation transalpine, permet de valider les analyses précédemment établies : même quand l’Italie adoptait une législation antisémite, l’on réagissait de manière particulière, parfois indulgente, quand on reprenait le slogan : « discriminer, non persécuter » ; l’Italie n’était pas un pays comme les autres. Est-ce à dire pour autant que l’attitude juive française restait inchangée face au pays d’outre-monts ? Cette idée a parfois cours, mais nul ne pourrait valablement répondre par l’affirmative170. De fait, avec la promulgation de la législation antisémite se concrétisait un revirement de l’opinion juive esquissé depuis 1935, et même depuis le début des années 1930 pour certains de ses membres. Pour autant, si l’heure n’était plus à l’espoir ou 334aux louanges, le rêve d’assimilation ne fut pas réduit à néant : la totale fusion des Juifs avec la nation entraîna un sincère élan de soutien parmi les Italiens insensibles aux thèmes agités par la propagande fasciste. Paradoxalement, plus que jamais le modèle italien gardait sa valeur et, dans le tableau du judaïsme persécuté, l’exception transalpine demeurait. Une certaine candeur se dégageait ainsi d’une partie de l’opinion juive, ce que critiquait la LICA. Tous sans distinction éprouvaient cependant la même peine à l’égard des frères italiens, mais l’espoir était permis. Tandis que le judaïsme français se sentait lui aussi de plus en plus menacé, le pessimisme lui était interdit. De la sorte, émergeait l’idée que sitôt refermée la parenthèse du fascisme, le judaïsme transalpin brillerait de nouveau. Mais pouvait-on espérer la chute de Mussolini ? Dans quel état d’esprit l’opinion juive française se dirigea-t-elle vers une guerre contre l’Italie tant aimée ? L’union pouvait-elle s’établir autour de l’antifascisme, déjà engagé par les Juifs progressistes depuis le début de la décennie ? L’Italie semait l’antisémitisme et la guerre hors de ses frontières, nul ne pouvait faire le choix de l’apaisement ou de l’attentisme.
Contagion antisémite
et marche à la guerre : la résignation
L’épilogue de la relation entre les Juifs de France et l’Italie s’articula autour de la perspective d’une guerre fratricide entre les deux sœurs latines et sur le problème de l’éventuel combat à mener contre le fascisme. La paralysie et la division s’emparèrent du judaïsme français. Les progressistes se trouvaient une nouvelle fois en première ligne de l’action.
Munich, l’Afrique du Nord… :
la formation des camps antagonistes
Après l’invasion de l’Éthiopie, la création de l’axe Rome-Berlin, le soutien à Franco et, surtout, l’anathème lancé contre Israël, il n’était plus possible à l’opinion juive française de prêter quelque bonne intention à l’Italie. Mais les Juifs de France se révélaient tiraillés entre un puissant pacifisme et une volonté de dénoncer les agressions transalpines. Ces contradictions éclatèrent au grand jour au moment de Munich.
335L’année 1938 apparut décisive et critique pour la diplomatie italienne : après l’Anschluss, en mars, de nombreux hiérarques fascistes remirent en question la politique allemande de l’Italie ; mécontent malgré ce qu’il voulait bien affirmer, Mussolini émit en privé la possibilité d’une guerre avec l’Allemagne si cette dernière violait la frontière du Brenner et signa au mois d’avril les « accords de Pâques » avec la Grande-Bretagne, dernière tentative de rapprochement avec les démocraties, ce qui n’empêcha pas l’Italie de défendre les revendications allemandes dans les Sudètes. Lors des pourparlers de Munich, à la fin du mois de septembre, Mussolini, tout en soutenant l’Allemagne, joua le rôle de médiateur ; de fait, en jouant une double carte, l’Italie sortit auréolée des accords171. Comment les Juifs de France perçurent-ils le rôle transalpin lors de ces débats ?
Face à Munich, deux claires tendances se distinguaient au sein du judaïsme français : ceux qui, par « pacifisme idéologique172 », acceptaient l’idée d’une conciliation avec les dictatures et ne voulaient en rien entraver la diplomatie française173, et ceux, les plus progressistes souvent, qui dénonçaient toute compromission avec le fascisme et entendaient s’opposer à lui pour sauver la France et les Juifs de toute l’Europe. Proportionnellement, la judaïcité était moins pacifiste que l’opinion française prise en général. Ceux qui acceptaient Munich le faisaient à contrecœur : Pierre Lazareff, qui se souvenait que les munichois convaincus accusaient leurs adversaires d’être à la solde d’Israël174, avait éprouvé un sentiment de lâcheté175 – qui fait écho au « lâche soulagement » éprouvé par Léon Blum. Plus que l’espoir, l’attentisme prévalait : il valait mieux se rapprocher des fascismes, pensait-on, qu’engager le pays dans un sanglant conflit176. Daniel Halévy parlait toutefois d’une « vacillation des esprits177 ». Joseph Rovan se souvenait en ces termes du conflit intérieur qui le torturait : « Moi, aussi, je souhaitais ardemment éviter la guerre, mais je me sentais en moi-même profondément solidaire de ceux qui, 336à partir de quelque idéologie que ce fût, voulaient s’opposer à Hitler, au fascisme178 ». Puis, l’on trouvait les autres progressistes et ennemis du fascisme, qui eux aussi ne souhaitaient pas la guerre, mais critiquaient toute discussion entreprise avec des régimes hostiles à la paix et à la démocratie. Parmi eux, figurait André Suarès, selon lequel il ne fallait pas répondre à la guerre par la guerre : « On ne mettra pas l’Europe en feu ni pour punir les Allemands de leur fureur barbare contre les autres races, ni pour ramener à la raison et au sens du ridicule les Italiens qui délirent de Rome et d’empire romain179 ». Pour autant, il ne fallait pas montrer à ses ennemis que l’on n’avait pas les moyens de faire la guerre et, de surcroît, soutenir leur politique expansionniste :
J’affirme qu’en octobre 1935 il fallait couper l’Italie de l’Afrique, fermer le canal de Suez et enfumer au besoin trois cent mille Italiens dans le guêpier de la mer Rouge. […] Le Mussolin180 s’effondrait ; l’Italie cessait d’être l’esclave à tout faire de la Nazie181.
Telle était également la position de la LICA, ulcérée par l’attitude du gouvernement français et des Juifs conservateurs et modérés. Les ligueurs n’avaient pas attendu Munich pour manifester leur opposition à la politique menée par les démocraties : Giacomo-Abramo Tedesco, en mars 1938, vitupéra l’attitude de Chamberlain et en appela à l’opinion publique britannique afin de ne pas abandonner l’avenir de l’Europe aux « mégalomanes de Rome et de Berlin182 ». La LICA conserva sa ligne après Munich et interpella les Français : Daladier venait de donner un blanc-seing aux appétits fascistes et hitlériens ; Mussolini, loin de se rapprocher de la France, mènerait aux côtés d’Hitler sa conquête de l’Europe avec la bénédiction des démocraties :
Le jour même où se signe à Paris le chiffon de papier, les manifestations irrédentistes les plus violentes se déclenchent devant le Palais Farnèse. Imagine-t-on un seul instant que le Duce pousse son air de bravoure sans l’accompagnement en sourdine des maîtres-chanteurs de Berlin183 ?
337En définitive, concluait-on à la LICA, Munich n’avait fait qu’aggraver les choses : « Les faits crèvent les yeux. Rien de ce que nous avons prédit, avant et après Munich, ne s’est volatilisé, évanoui en fumées, de parlotes et de Congrès. Tout, au contraire, s’est précisé, gravé sur l’horizon européen. On a cru éloigner le cauchemar. Le voici revenu184 ». Mécontent de la politique italienne de la France, Bernard Lecache, dans un article intitulé « Munich, école de la servitude », jeta le discrédit sur Paul Baudouin, grand financier et sorte d’ambassadeur officieux du gouvernement français dépêché à Rome en février 1939 pour discuter avec Ciano, notamment d’éventuels accords sur Djibouti185. Lecache dénonçait les intérêts qui forçaient Baudouin à agir et fustigeait la tenue de négociations, qui plus est clandestines, avec l’Italie186. Aux yeux des progressistes ainsi, Munich revenait à mettre sciemment en péril l’avenir de la France et celui des Juifs. Les menées italiennes en Afrique du Nord le prouvaient.
La présence de fascistes extrémistes et d’une forte communauté juive – ces deux entités se heurtant de plus en plus fréquemment – faisait de l’Afrique du Nord, plus particulièrement la Tunisie, l’Algérie et la Libye, un terrain privilégié pour l’observation de la politique fasciste après Munich.
Ces questions passionnaient les Juifs français. Daniel Halévy ironisait sur la dimension théâtrale de l’attitude italienne :
À Rome, […], on mit en scène, […] une insultante parade : le comte Ciano évoquerait à la Chambre les aspirations légitimes de l’Italie en Méditerranée, et les députés aussitôt préciseraient sa pensée par des cris arrêtés d’avance : Nice, Corse, Tunisie ! La parade italienne se développa comme une pièce bien jouée, le discours fut bien dit, les cris bien poussés187.
Bernard Lecache remarquait quant à lui combien les revendications irrédentistes de Mussolini avaient frappé l’opinion publique188. Les Juifs de France furent particulièrement touchés par les prétentions transalpines 338sur la Tunisie. Ils liaient la promulgation de l’antisémitisme en Italie à la donne irrédentiste : la presse italienne affirmait en effet à l’envi que les Juifs italiens de Tunisie exploitaient l’ensemble de la colonie italienne, situation intolérable qui gonfla la propagande antisémite dans la péninsule, où l’on se montrait de plus en plus sensible aux affaires coloniales189. De fait, remarquait-on, le ralliement de nombreux juifs italiens à la France, par la naturalisation notamment, agaçait les fascistes, d’autant que, comme le rapportait Samedi, les Juifs « indigènes » se montraient attachés au protectorat français :
En somme, s’il fallait en croire le jeune comte Ciano, tout s’arrangerait très bien si ces maudits Juifs ne s’en mêlaient pas !
Mais au fait : est-ce que M. Mussolini s’étonne vraiment que les Juifs tunisiens aiment mieux leur régime actuel que le racisme germanique en vigueur ? Et que les Juifs tunisiens soient prêts à défendre la Tunisie et la France contre ses ridicules prétentions, – n’était-ce pas tout à fait naturel en temps normal ? À plus forte raison190…
De la sorte, si la France acceptait d’accorder en masse la naturalisation aux Italiens de Tunisie, elle infligerait un cinglant coup d’arrêt aux prétentions mussoliniennes, en amputant la colonie italienne locale de sa force ; c’était en ce sens que plaidait Marcel Gozland : « en privant la colonie italienne de Tunisie d’une bonne partie d’éléments de qualités qu’elle aura tôt fait d’assimiler et de rallier à sa propre cause, elle aura, par un geste intelligent, affaibli singulièrement la cause de l’“italianité” dans ce pays et consolidé d’autant la force et le prestige français191 ». Inéluctablement, les Juifs italiens de Tunisie prenaient donc la voie de l’antifascisme192 et pouvaient constituer un soutien de poids dans le combat contre l’irrédentisme en Tunisie. L’Alliance israélite universelle pouvait jouer un rôle, comme l’affirmait Jacques Tahar, à la tête des écoles de Tunisie :
L’Alliance rendrait certainement un signalé service aussi bien à nos coreligionnaires qu’à la France en obtenant du Ministère des Affaires Étrangères l’examen rapide des dossiers de naturalisation déposés par les juifs italiens de 339Tunisie ; la France y gagnerait dans la mesure exacte où l’Italie y perdrait ; c’est pourquoi […] L’Italie n’[a] aucun intérêt à détacher d’elle ses ressortissants juifs de Tunisie.
La naturalisation des juifs italiens ferait pencher chaque jour davantage, en faveur de la France, la balance du nombre de nationaux de chacun des deux pays installés en Tunisie, et diminuerait du même coup la valeur du principal argument sur lequel reposent les prétentions italiennes193.
L’Italie entendait faire régner le désordre : constatant que les Juifs italiens, comme une grande partie de la colonie italienne locale, souhaitaient que la Tunisie restât un protectorat français, les fascistes cherchèrent à faire naître les divisions entre Juifs et Musulmans, afin que ces derniers gagnassent le camp de l’Italie. Dans un article intitulé « En Tunisie, l’Italie se croit déjà chez elle… », Serge Moati alertait l’opinion sur les manigances italiennes en Tunisie, en total irrespect de la puissance administrante : « Alors que Juifs et musulmans vivent en Tunisie étroitement, fraternellement unis, cette presse fasciste exploite quotidiennement et tendancieusement les douloureux événements de Palestine pour amener si possible des événements sanglants dont le protectorat serait ensuite rendu responsable194 ». C’est que les fascistes déployèrent une intense propagande, à travers le journal L’Unione, Radio-Bari et les services consulaires italiens sur place : Mussolini, parlant en protecteur de l’Islam, voulait montrer aux populations musulmanes locales, particulièrement les nationalistes parmi elles, que les Juifs de Tunisie soutenaient activement la domination française et que leurs coreligionnaires du Moyen-Orient travaillaient, aux côtés des Britanniques, à ravir la Palestine aux Arabes195. Aux yeux de l’opinion juive, il apparaissait inconcevable et scandaleux que l’Italie ne se pliât pas aux règles françaises en Tunisie et cherchât à s’ingérer dans les affaires intérieures du pays en instaurant le désordre entre des communautés vivant en bonne intelligence. C’est pourquoi la LICA, qui n’ignorait pas les conséquences funestes que pourrait entraîner une guerre fratricide entre musulmans et juifs196 accueillit avec enthousiasme le voyage d’Édouard Daladier en Tunisie en janvier 1939 : par ce geste, la France, qui semblait abandonner ses espoirs de rapprochement avec 340l’Italie, manifestait sa fermeté face aux réclamations fascistes ; tandis que les revendications des nationalistes tunisiens s’accroissaient, Daladier devait mettre fin au climat de tension qui risquait de remettre en question les fondements du protectorat français. Avec soulagement, Le Droit de Vivre salua l’initiative du gouvernement français et pensait l’Italie définitivement éloignée de l’horizon tunisien : « Tunis, c’est la France. Mussolini a perdu la partie », clamait Maurice Uzan197. Italiens et Tunisiens, juifs, chrétiens et musulmans, avaient compris que l’Italie ne pouvait offrir que la guerre ; seule la France pouvait assurer le calme : « Il n’existe pas un Tunisien aujourd’hui qui ne s’indigne et ne proteste, devant les intolérables revendications de l’Italie mussolinienne198 ». Si bien que le conflit entre France et Italie s’était engagé en Tunisie bien avant l’Europe. La démocratie avait remporté une première bataille sur le fascisme.
Il ne fallait toutefois pas crier victoire ; l’Italie devait être désarmée sur d’autres fronts. Même si les Israélites progressistes se révélaient moins prolixes sur les menées italiennes dans les autres pays du Maghreb, ils les passaient également au crible de leur analyse. Là encore la question juive apparaissait au cœur des relations franco-italiennes. D’une manière assez similaire à celle observée en Tunisie, les fascistes publièrent en août 1938 dans Il Regime fascista un article sur les Juifs d’Algérie, dont Le Droit de Vivre se fit l’écho. Ces derniers, affirmait le journal italien, détenaient tous les pouvoirs du pays, 65 % du commerce, 60 % des capitaux en banque, l’ensemble de l’industrie, contrôlaient l’opinion publique grâce à la possession de nombreux titres de presse et incitaient les musulmans à la dépravation199. Que l’Italie attaquât des Juifs français ne pouvait qu’accroître l’antipathie éprouvée à l’égard de la sœur latine qui entendait lancer une croisade contre toute la judaïcité européenne200. C’était la seconde fois que les Israélites de France étaient attaqués frontalement par les fascistes italiens : cela prépara les premiers à la perspective croissante d’une entrée en guerre contre l’Italie. Les Juifs français n’étaient cependant pas dupes des considérations qui sous-tendaient les attaques et les regardaient en réalité moins comme une véritable haine du judaïsme que comme la volonté de rallier les peuples arabes, 341notamment contre les Britanniques en Palestine. Mais les musulmans succomberaient-ils à la propagande italienne et entreraient-ils dans une lutte fratricide avec les juifs, se demandait-on ? Les musulmans auraient tôt fait de se retourner contre l’Italie : n’avaient-ils pas l’exemple des juifs pour comprendre que Mussolini pouvait rejeter brutalement ceux qu’il avait ostensiblement courtisés ? Élie Gozlan, juif d’Algérie profondément attaché aux valeurs de la République française et ardent défenseur de la fraternité judéo-musulmane201, le pensait sincèrement au vu des relations entre Arabes et Italiens en Libye : tout semblait prouver que l’Italie voulait entreprendre une vaste colonisation du pays, ce que n’acceptaient pas les autochtones ; « Les nouvelles qui nous parviennent de tout le Nord de l’Afrique française nous dépeignent la profonde émotion qu’éprouvent les milieux musulmans du fait de l’envoi de 20 000 colons italiens202 ». Aucune compensation n’était d’ailleurs offerte aux peuples musulmans, remarquait Gozlan. L’avertissement était clair : les musulmans devaient rester liés à la France, ce que les récentes manifestations dans l’Empire colonial laissaient espérer203 ; en cas de conflit avec l’Italie, ils devaient assister leur mère-patrie. Le coup de force de l’Italie en Albanie ne faisait que lever le voile sur la véritable politique du Duce :
On sait que près de la moitié de la population albanaise, quatre cent mille personnes environ, sont d’origine musulmane. Mussolini, le grand « tuteur de l’Islam » n’en a pris cure : les musulmans albanais ont été attaqués, bombardés, et réduits à l’esclavage exactement au même titre que leurs compatriotes chrétiens. Le monde musulman s’en est ému204.
Les Israélites français restaient ainsi confiants dans la puissance française, mais suivaient avec attention les agressions mussoliniennes. L’Afrique du Nord prouvait selon eux que l’Italie poursuivait une politique bancale, dans laquelle les effets de voix masquaient en fait une criante faiblesse. Mais le consensus était loin d’être atteint.
Au sein de l’opinion juive, les uns croyaient fermement en la force du pacifisme et les autres concluaient à l’imminence de la guerre, bien qu’ils la craignissent. Espérer la paix nécessitait-il de s’emmurer dans l’attentisme ? Ne devait-on pas précéder l’Italie et faire obstacle à son 342bellicisme ? Trop sensible, ce sujet entraîna la crispation parmi les Juifs, atteints par une incurable désorganisation.
Si vis pacem, para bellum : l’introuvable union des Juifs
contre l’Italie
C’est un motif éculé d’antisémitisme : les Juifs poussaient la France à la guerre. Qu’en était-il réellement ? En quoi l’attitude face à l’Italie permet-elle de comprendre l’état d’esprit caractérisant les Juifs français dans les mois précédant une guerre qui décimerait le judaïsme français et européen ?
Si vis pacem, para bellum. Cet adage aurait assurément pu faire office de devise pour une partie des Juifs de France, ceux les plus à gauche. Quels résultats leur action entraîna-t-elle ? À la veille de la guerre, les antifascistes juifs français redoublèrent d’efforts dans le combat qu’ils avaient engagé dès 1933. Un événement les incita à poursuive dans cette voie : l’assassinat des frères Nello et Carlo Rosselli, de confession juive, le 9 juin 1937, qui marqua profondément les Juifs progressistes comme tous leurs compatriotes de même tendance205. Luigi Campolonghi, président de la Ligue italienne des Droits de l’Homme publia un hommage aux deux frères dans Le Droit de Vivre206. Hanns-Erich Kaminski, juif antinazi allemand exilé en France, dédia à Carlo son ouvrage sur le fascisme et l’antisémitisme, Céline en chemise brune ou le mal du présent : « Au souvenir de Carlo Rosselli. Révolutionnaire en Italie, soldat de la liberté en Espagne, assassiné par le fascisme international207 ». Les antifascistes israélites perdirent deux frères avec qui ils partageaient les idées et la foi. Sans qu’il s’agisse de vengeance, les Juifs progressistes, qui pouvaient prendre la mesure de la menace fasciste italienne, même sur le territoire français, se mobilisèrent contre l’Italie. Il fallait s’unir ; ainsi que le disait Bernard Lecache au sujet de Mussolini et d’Hitler, « ils ne sont pas éternels208 », il était possible de les défaire. Les peuples assoiffés de démocratie devaient se rassembler209, et surtout les Juifs parmi eux. Or, sur ce point, l’objectif semblait loin d’être atteint : « Nous nous demandons comment des juifs peuvent vivre tranquilles et vaquer 343à leurs affaires comme si de rien n’était quand ils savent […] ce que prépare Mussolini210 », lançait un ligueur juif. La propagande battit son plein : Samedi publia à la une du 21 janvier 1939 un appel lancé par le parti républicain et social qui accomplit une tournée dans vingt-trois départements pour sensibiliser l’opinion sur le péril fasciste ; le journal enjoignait ses lecteurs à « condamner l’agitation fasciste » :
En présence de l’agitation totalitaire et raciste de certaines dictatures, les auditeurs affirment la volonté qu’ont tous les bons Français, catholiques, protestants, israélites ou musulmans, de maintenir les traditions morales et les principes qui ont fait la grandeur séculaire de la France211.
De même, la LICA demanda au gouvernement français de fermer tous les fasci qu’abritait le pays212. En juin 1939, Le Droit de Vivre fut distribué gratuitement ; il présentait le « bilan des horreurs » perpétrées par l’Italie et l’Allemagne213 et ajoutait « partout où passent l’hitlérisme et le fascisme, c’est la ruine, la misère, la prison, les tortures, l’angoisse, la mort214 ». Les ligueurs juifs diffusèrent en outre des tracts incitant au boycott des produits italiens, allemands et japonais215.
Il semble que les résultats de l’action entreprise par les ligueurs fussent nettement plus probants que lors des années précédentes, notamment à l’intérieur de la judaïcité. Quelques jours après les propos tenus par le rabbin Julien Weil au Matin, qui suscitèrent la polémique, le rabbin Jacob Kaplan, désireux de défendre celui qui fut son maître, apporta le commentaire suivant : « Cette condamnation mondiale du fascisme ne se contente pas d’être platonique. Elle entend être agissante216 ». Sans doute ne faut-il pas y voir la claire imprégnation des idées de la LICA, mais l’usage par un rabbin conservateur du vocabulaire coutumier des progressistes, loin de la timidité ordinairement observée, ne manque pas d’étonner. Cette convergence de façade ne doit cependant pas occulter les profonds antagonismes qui déchiraient le judaïsme217. Selon les tendances 344et les sensibilités, l’on abordait la guerre diversement. Comment les Juifs de France percevaient-ils la séparation des sœurs latines ?
Le dernier acte de la relation des Juifs avec le pays d’outre-monts avait commencé. L’Italie devenait une ennemie au sens propre cette fois, et non plus au figuré. Était-ce un étonnement pour les Juifs de France ? La volte-face de Mussolini avait-elle laissé entrevoir une issue aussi funeste ? Tous les Juifs se révélèrent frappés par l’entrée en guerre. Les multiples appels à la paix lancés pendant les dernières heures précédant le conflit témoignaient de l’espoir, largement partagé, d’éviter le pire218. Philippe Erlanger reçut la nouvelle comme un intense déchirement219. Le moment de la guerre constitua pour certains l’occasion d’une redéfinition de leur propre identité. Le bien des Juifs et celui de la France étaient-ils conciliables ? Fils d’immigrés de Salonique, Edgar Morin choisissait le salut de la patrie qui avait accueilli sa famille : « J’étais même prêt à accepter l’immolation des juifs si le salut des autres Français était à ce prix – si la fatalité de l’Histoire l’exigeait », écrivait-il220. De fait, pour les Juifs, la guerre entraînerait un conflit des identités.
Si l’on ne réagissait pas « en juif221 », quels étaient les moteurs de la réaction et de l’analyse ? Parlait-on d’une guerre contre le fascisme222 ? Il faut ici se garder de toute généralisation. Les uns se révélaient pragmatiques, les autres emportés par la passion, mais cela se concrétisait différemment chez chacun. Raymon Aron rappelait que les considérations matérielles, relativement à l’Italie notamment, se trouvaient noyées par l’idéologie chez les plus engagés : « Les adversaires les plus résolus des régimes de Mussolini et de Hitler risquaient de négliger la donnée capitale, en temps de guerre : le rapport de forces223 ». Pour beaucoup, la France ne faisait pas le poids militairement face aux capacités conjointes de l’Italie et de l’Allemagne. Qu’importait. La guerre fournissait à certains, qui s’attendaient à la confrontation armée depuis 1933224, l’occasion d’abattre le fascisme225. Pour ce faire, la LICA entendait s’allier avec les immigrés 345italiens antifascistes présents en France et appelait au rassemblement des antifascistes de toute confession226. Mais tous les adversaires juifs du fascisme n’envisageaient pas pour autant la guerre avec enthousiasme, si bien que le lien entre antifascisme et bellicisme apparaissait loin d’être nécessaire parmi les Israélites français progressistes ; Hanns-Erich Kaminski opposait radicalement ces deux notions :
Qui nous dit que la fatigue, la détresse et le désordre, qui naissent fatalement des guerres, n’amèneraient pas un régime fasciste dans d’autres pays, même vainqueurs ? Il serait beau de payer la guerre contre le fascisme au prix du fascisme227 !
À ceux qui objecteraient que de nombreux antifascistes désiraient ardemment la guerre pour faire tomber les régimes qu’ils abhorraient, il rétorquait que cela n’avait pas valeur d’exemple :
Ceci n’empêche pas qu’un antifasciste digne de son nom soit l’ennemi le plus acharné de la guerre. Qui associe antifascisme et guerre peut être tout ce que l’on veut – le plus souvent il sera un réactionnaire ou un calomniateur – mais jamais un véritable antifasciste. L’antifascisme et la guerre s’excluent ; ils sont en contradiction absolue228.
Contrairement à l’idée en vogue à l’époque, et véhiculée par des enfants d’Israël parfois, les Israélites français étaient des pacifistes. Une ligne de partage, visible seulement de l’intérieur, séparait cependant des pacifistes intransigeants et d’autres, plus résignés à l’idée de guerre. Quand le bruit des canons se fit entendre, l’ensemble de la judaïcité française, autochtones et immigrés confondus229, accomplit massivement son devoir de patriotisme. Ces observations montrent que seule une poignée de Juifs souhaitait le combat contre l’Italie ; et ceux qui parlaient de guerre contre le fascisme semblaient d’ailleurs plus faire référence à Hitler qu’à Mussolini. Il n’existait donc aucune corrélation entre les discours favorables ou hostiles à l’Italie en temps de paix et la perception que l’on avait de l’entrée en guerre de ce pays contre la France : l’échelle et la nature des rapports entre les Juifs de France et l’Italie s’étaient modifiées. À de rares exceptions, l’on cessait de s’intéresser à l’Italie 346nommément et on l’englobait dans le camp plus vaste des ennemis : la relation privilégiée du judaïsme français avec l’Italie, désormais pays ennemi, s’était délitée.
La question italienne constituait un excellent révélateur des mécanismes, de l’état d’esprit et des conflits caractérisant l’opinion juive. Avant 1938, seuls les ligueurs progressistes voulaient s’opposer à l’Italie ; l’on aurait pu mettre l’absence d’unité d’action au compte de la bienveillance d’une majorité du judaïsme. Or, après cette date, un retournement massif de l’opinion juive s’opéra, qui n’ouvrit sur aucune action tangible à l’encontre du pays d’outre-monts. L’on pourrait objecter que l’Italie ne constituait pas le principal danger même à la veille de la guerre, mais l’écart béant séparant les réprobations des mesures concrètes pour s’opposer à l’Italie ne manque pas de frapper. Même quand elle se disait active face à un pays qui menaçait ouvertement la France, sur le sol tunisien par exemple, l’opinion juive française se révélait en réalité passive. Les inquiétudes justifiées qui gagnaient le judaïsme privèrent celui-ci de la capacité d’influer sur la politique extérieure de la France, à l’égard de l’Italie comme de n’importe quel autre ennemi. L’opinion juive n’avait que des mots pour armes.
1 AIU, France I – C 4. Lettre d’Edmond Dreyfus à l’Alliance israélite universelle, du Comité local de La Chaux-de-Fonds, 25 septembre 1936.
2 Albert Memmi, Portrait d’un Juif, Paris, Gallimard, 1969, p. 136.
3 « Politique italienne », Samedi, 3 juillet 1937.
4 Pierre Péral, « Mussolini livre la patrie de Dante à la barbarie raciste », Le Droit de Vivre, 12 juin 1937.
5 « Une note officieuse sur l’antisémitisme », Paix et Droit, mars 1937.
6 « Politique italienne », Samedi, 3 juillet 1937.
7 Jean Hassid, « Verra-t-on l’antisémitisme naître en Italie ? », Samedi, 14 novembre 1936.
8 Marie-Anne Matard-Bonucci, L’Italie fasciste et la persécution des Juifs, Paris, Perrin, 2007, p. 473. Le Temps corrigea son jugement quelque temps plus tard : Nadège Colombier, La Question juive sous le fascisme et la presse française, 1938-1939, mémoire de maîtrise sous la direction de Ralph Schor, Université de Nice, 1994, p. 92.
9 Marie-Anne Matard-Bonucci, op. cit., p. 22 et p. 130.
10 Les attaques contre les Juifs français devenaient courantes ; cf. pour la veille de la guerre, Telesio Interlandi, « Un francese piange », Il Tevere, 22-23 novembre 1938 ; A. Lancellotti, « La Francia e l’invasione giudaica », La Difesa della razza, no 7-5, février 1939. Cités par Francesco Cassata, « La Difesa della razza ». Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista, Turin, Einaudi, 2008, p. 145.
11 AIU, Italie, I – C 3. Lettre d’Elia Arié à Sylvain Halff, secrétaire général de l’Alliance israélite universelle, de Trieste, 1er janvier 1937. L’article s’intitulait « Il troppo storpia ».
12 AIU, Italie, I – C 3. Lettre de Sylvain Halff à Elia Arié, de Paris, 4 janvier 1937. Notons que la question des rapports entre judaïsme et Front populaire suscitait une certaine gêne chez une fraction des Juifs : cf. Ariel Danan, « Les Français israélites et l’accession au pouvoir de Léon Blum, à travers L’Univers Israélite », Archives Juives, no 37-1, 1er semestre 2004, p. 97-110.
13 « Les Protocoles des Sages de Sion », L’Univers Israélite, 19 novembre 1937. Cf. Paul Gentizon, « Fascisme et antisémitisme », Samedi, 18 avril 1936. La publication des Protocoles faisait écho à celle du pamphlet de Paolo Orano, Gli Ebrei in Italia, la même année.
14 « Une voix italienne sur les “Protocoles” », Paix et Droit, mars 1937.
15 Sur la dimension symbolique revêtue par les Protocoles au sein de l’opinion juive d’alors, cf. Catherine Nicault, « Le procès des Protocoles des Sages de Sion : une tentative de riposte juive à l’antisémitisme dans les années 1930 », Vingtième Siècle, no 53, janvier-mars 1997, p. 68-84.
16 Le nom de Roberto Farinacci revenait très souvent dans la presse juive française : télégraphiste et ancien socialiste réformiste, Farinacci, grâce à sa verve puissante, s’était spécialisé dans les attaques contre les pacifistes, les catholiques ou les socialistes. Fasciste de la première heure, très violent, il devint secrétaire du PNF entre 1925 et 1926 mais sa trop grande intransigeance l’éloigna des sphères du pouvoir. Revenant aux affaires au milieu des années 1930, il se montra favorable à l’Allemagne et fut à la pointe de l’antisémitisme italien. Voir l’ouvrage récent de Romano Canossa, Farinacci. Il superfascista, Milan, Mondadori, 2010.
17 Cf. par exemple, Samedi, 22 mai 1937.
18 Impression confirmée notamment par Enzo Collotti, Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia, Rome-Bari, Laterza, rééd. 2006, p. 56. Marie-Anne Matard-Bonucci y voit plutôt une phase d’expérimentation de l’antisémitisme en Italie (op. cit., p. 130).
19 « Italie, réveille-toi !… », Samedi, 5 juin 1937.
20 Pierre Péral, art. cit.
21 Ibid.
22 Jean Hassid, art. cit.
23 Sur ce point, Max Gallo, Contribution à l’étude des méthodes et des résultats de la propagande et de l’information de l’Italie fasciste dans l’immédiat-avant-guerre, 1933-1939, Thèse de 3e cycle d’histoire sous la direction d’André Nouschi, Université de Nice, 1968, p. 91 sqq.
24 Marie-Anne Matard-Bonucci, « L’antisémitisme fasciste, un “transfert culturel” de l’Allemagne vers l’Italie ? », Relations Internationales, no 116, hiver 2003, p. 483-494.
25 Le voyage de Mussolini et Ciano en Allemagne, en 1937, contribua fortement à la naissance de cet état d’esprit favorable à l’expérience allemande. Pierre Milza, Mussolini, Paris, Fayard, 1997, p. 697-699.
26 C’est la seconde hypothèse qui emporte l’adhésion de la plupart des historiens. Pierre Milza, op. cit., p. 749-757 ; Marie-Anne Matard-Bonucci, op. cit. ; Aaron Gillette, Racial Theories in Fascist Italy, Londres, Routledge, 2002.
27 Cf. André Nouschi, « Un siècle de croissance économique en Italie (1861-1965) : observations sur un paradoxe », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Âge, Temps modernes, no 90-1, 1978, p. 155 ; et plus généralement Simona Colarizi, L’Opinione degli italiani sotto il regime, 1929-1943, Rome-Bari, Laterza, 2e édition 2000, p. 274-282.
28 Pierre Péral, art. cit. Cf. Georges Gréciano, Europe, terre instable ?, Paris, Bossuet, 1937, p. 44.
29 C’est notamment la position d’un important courant historiographique. Voir Franklin Hugh Adler, « Pourquoi Mussolini fit-il volte-face contre les Juifs ? », Raisons politiques, no 22, mai 2006, p. 179.
30 Particulièrement représentatifs de cette tendance : Alfredo Romanini, Ebrei, cristianesimo, fascismo, Empoli, Casa editrice Arti grafiche dei comuni Ditta Caprarini, 1936 ; ou encore Paolo Orano, Gli ebrei in Italia, Pinciana, Rome, 1937.
31 Cf. Ralph Schor, L’Antisémitisme en France pendant les années trente, Bruxelles, Complexe, 1992, p. 117-128 (chapitre sur « Le Juif destructeur des États »).
32 Jean Hassid, art. cit.
33 Ibid. Il n’y avait rien de nouveau dans de telles accusations que l’on retrouve bien avant le fascisme, lors de la conquête de la Libye, Marie-Anne Matard-Bonucci, op. cit., p. 56.
34 Cf. Samedi, 22 mai 1937. Nul ne rappelait les accusations du même ordre qu’avaient eu à affronter les Juifs transalpins vers 1934, comme on l’a vu.
35 Paul Gentizon, art. cit.
36 Cf. Pierre Péral, « Le mal hitlérien sévit aussi à Rome », Le Droit de Vivre, 26 juin 1937.
37 « Italie, réveille-toi !… », art. cit.
38 Ibid.
39 Samedi, 9 octobre 1937.
40 Cf. Enzo Collotti, op. cit., p. 44.
41 Jean Hassid, art. cit.
42 Attitude en tous points identique à celle des antifascistes italiens non juifs exilés en France ; le réflexe de classe pouvait ainsi l’emporter sur la solidarité religieuse, cf. Éric Vial, « Les antifascistes italiens en exil en France face aux lois antisémites mussoliniennes de 1938 », Cahiers de la Méditerranée, no 61, décembre 2000, p. 236 sqq.
43 Pierre Péral, « Mussolini livre la patrie de Dante à la barbarie raciste », art. cit.
44 Paul Gentizon, art. cit.
45 Cf. Pierre-André Taguieff, « L’invention racialiste du Juif », Raisons politiques, no 5, février 2002, p. 29-51.
46 Voir à ce sujet Marie-Anne Matard-Bonucci, op. cit., p. 73-83 ; Sandrine Bertaux, « Démographes français et italiens : la construction du concept de “race juive” des années vingt aux années quarante », dans Marie-Anne Matard-Bonucci (dir.), Antisémythes. L’Image des juifs entre culture et politique (1848-1939), Paris, Nouveau monde, 2005, particulièrement p. 112-115.
47 « Le fascisme et la théorie des races », Paix et Droit, mars 1937. À Nice, le 5 janvier 1934, dans une conférence intitulée « Biologia delle razze ed unità spirituale medterranea », le scientifique Nicola Pende, plus tard signataire du « Manifeste de la race » avait présenté l’existence d’une « race blanche » pure comme une aberration. Marie-Anne Matard-Bonucci, op. cit., p. 458. Voir, d’une façon générale, Giorgio Israel, Il fascismo e la razza. La scienza italia e le politiche raziali del regime, Bologne, Il Mulino, 2010.
48 Samedi, 8 mai 1937.
49 Jean Hassid, art. cit.
50 Cf. Paul Gentizon, art. cit. ; Jean Hassid, « Ce que fut l’an 5696 », Samedi, 19 septembre 1936.
51 La vision de l’antisémitisme comme lutte contre un bouc-émissaire fait d’ailleurs l’objet de nombreuses controverses parmi les chercheurs en sciences humaines. Cf., outre René Girard, Le Bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982, Yves Chevalier, L’Antisémitisme : le Juif comme bouc émissaire, Paris, Le Cerf, 1988 ; et pour une déconstruction de cette image, Guillaume Erner, Expliquer l’antisémitisme. Le bouc émissaire : autopsie d’un modèle explicatif, Paris, PUF, 2005. Dans le cas de l’Italie comme dans d’autres, il semble que cette théorie, si on l’applique au phénomène général de l’antisémitisme, et non à certains acteurs singuliers de l’antisémitisme, ne résiste pas à l’analyse car, comme cela apparut aux yeux des Juifs de France, l’antisémitisme, qui put parfois être instrumentalisé cependant, apparut plus comme une fin que comme un moyen. En Italie, pour Mussolini, il pouvait être considéré comme une manière d’accélérer la fascisation du pays, mais le Duce ne se révélait pas moins convaincu que le judaïsme, qui représentait la bourgeoisie, le bolchevisme ou l’antifascisme, était l’antinomie du fascisme. À cela s’ajoute que plusieurs fascistes extrémistes, sur lesquels il faudra revenir, adhéraient aux théories du racisme biologique : loin de prôner un simple écartement du Juif de la vie publique, ils croyaient réellement que celui-ci, antinomie de l’italianité et de l’aryanisme, était – et resterait – un inférieur. L’idéologie et les convictions profondes de chacun jouaient un rôle trop important pour que l’antisémitisme en Italie fût considéré comme la simple nécessité de trouver un coupable aux maux de l’Italie.
52 Paix et Droit, janvier 1937.
53 Michele Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Turin, Einaudi, 2007 (2000 pour l’édition originale), p. 123. Il est intéressant de remarquer qu’Italo Balbo fut l’un de ceux qui, plus tard, manifestèrent le plus leur opposition à la promulgation des lois antisémites en Italie. Renzo De Felice, Ebrei in un paese arabo. Gli ebrei nella Libia contemporanea tra colonialismo, nazionalismo e fascismo (1835-1970), Bologne, Il Mulino, 1978, p. 264-265.
54 « Les incidents de Tripoli », Samedi, 2 janvier 1937. Sur le détail de ces journées sanglantes : Renzo De Felice, op. cit., p. 234-237.
55 L’on pouvait lire dans Paix et Droit (janvier 1937) que « certains organes de la presse française y voient même l’expression de tendances nettement antijuives ». À l’appui de cette assertion, étaient cités des extraits du Petit Parisien, du Figaro et de La Lumière. De même, Bernard Lecache écrivait : « Si vous ne me croyez pas, croyez le Petit Parisien » (« Benito, le père fouettard », Le Droit de Vivre, 6 février 1937).
56 « Les incidents de Tripoli », Samedi, 2 janvier 1937.
57 Bernard Lecache, art. cit.
58 Ibid.
59 Ibid.
60 AIU, Libye I – C 26. Lettre du comité de Tripoli au secrétaire de l’Alliance israélite universelle, 7 décembre 1936.
61 Ibid.
62 O. Vallon, « Les Juifs italiens sont brimés à Tripoli », Le Droit de Vivre, 2 janvier 1937.
63 Paix et Droit, janvier 1937.
64 AIU, Libye I – C 26. Lettre du comité de Tripoli au secrétaire de l’Alliance israélite universelle, 6 décembre 1936.
65 AIU, Libye I – C 30. Lettre de l’institution pour l’instruction et le travail au secrétaire de l’Alliance israélite universelle, 19 mars 1937
66 « Une mise au point », Paix et Droit, avril 1937.
67 Sur l’ensemble de cette politique, Renzo De Felice, Il fascismo e l’Oriente. Arabi, ebrei e indiani nella politica di Mussolini, Bologne, Il Mulino, 1988, p. 20 sqq. ; Romain H. Rainero, La Politique arabe de Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, Publisud, 2006, p. 44-49. Sur les fondements antérieurs de la politique arabe italienne, voir Daniel J. Grange, L’Italie et la Méditerranée (1896-1911) : les fondements d’une politique étrangère, Rome, École française de Rome, 1994, p. 1469 sqq.
68 « La Foire du Levant à Bari », L’Univers Israélite, 2 juillet 1937. Cf. « Le pavillon palestinien à la Foire de Bari », L’Univers Israélite, 1er octobre 1937.
69 « Protecteur de l’Islam et ami des Juifs ? », Samedi, 16 octobre 1937.
70 Ibid. ; ainsi que « M. Mussolini s’intéresse à la Palestine », L’Univers Israélite, 8 octobre 1937.
71 Cf. Daniel J. Grange, « Structure et techniques d’une propagande : les émissions arabes de Radio Bari », Relations Internationales, no 2, 1974, p. 166 sqq.
72 « La propagande italienne et allemande en Palestine et dans les pays de langue arabe », L’Univers Israélite, 31 décembre 1937.
73 Cf. « L’Italie responsable des troubles en Palestine », Le Droit de Vivre, 16 mai 1936 ; « Menées italiennes en Palestine », Samedi, 26 septembre 1926.
74 Voir, sur cet aspect, « Installation du grand rabbin Prato », Samedi, 27 février 1937, et dans le même journal, un commentaire de la réaction de la revue italienne Israël de Florence, le 8 mai 1937. Sur les détails de la crise du judaïsme italien dans les années 1936 et suivantes, cf. Michele Sarfatti, op. cit., p. 146 sqq. De fait, la division des Juifs italiens, qui se traduisit par un désordre institutionnel, fut le premier effet de la campagne antisémite puisque les sionistes se virent imputer la responsabilité des troubles.
75 « L’Italie ne sera pas antisémite », Samedi, 16 janvier 1937.
76 « L’Italie et les Juifs : pas d’antisémitisme officiel », Samedi, 26 février 1938.
77 « L’antisémitisme en Italie », Paix et Droit, mars 1938.
78 « Fin de la campagne de presse antisémite ? », L’Univers Israélite, 4 mars 1938.
79 « L’Italie sauvegarde les droits de ses nationaux juifs résidant en Allemagne », L’Univers Israélite, 3 juin 1938. Dans la réalité, dès cette époque, plusieurs mesures antisémites furent appliquées contre les Juifs : le 15 février 1938, le ministre de l’Intérieur demanda à tous ses préfets de signaler les employés israélites dans l’administration ; le 1er mars, le préfet de Ferrare, sur ordre des hiérarques fascistes, démit de ses fonctions le podestà de Ravenne, qui était de confession juive.
80 Pierre Péral, « Le mal hitlérien sévit aussi à Rome », art. cit.
81 « Depuis dix ans nous avions raison, Mussolini avoue son racisme », Le Droit de Vivre, 21 juillet 1938.
82 Ibid.
83 Anatole Leroy-Beaulieu, Sam Lévy, Benito Mussolini, L’Antisémitisme. Les Juifs d’Italie, Paris, Jouve, 1939, p. 36. Cet ouvrage compilait en fait des textes parus ou prononcés à différentes époques et rassemblés pour montrer l’inanité des arguments italiens : l’on y trouvait une conférence prononcée en 1897 à l’Institut catholique de Paris par Anatole Leroy-Beaulieu, mort en 1912 ; à quoi s’ajoutaient des extraits d’allocutions philosémites de Mussolini destinés à montrer l’aspect soudain de son revirement à l’égard des Juifs ; enfin, y figuraient des textes de Sam Lévy consécutifs à la législation de 1938. Cet ouvrage ne fut jamais publié à cause de l’entrée en guerre, mais a pu être consulté sur épreuves à la Bibliothèque Nationale de France (RES-G-1459).
84 Marie-Anne Matard-Bonucci, op. cit., p. 15-19.
85 La question de l’appartenance au judaïsme fit l’objet de règles précises : une personne née de parents juifs était juive même si elle ne professait pas le culte de Moïse ; était « aryen », celui qui même en pratiquant le judaïsme descendait de non Juifs ; « aryen » également celui dont un seul parent était juif et qui pratiquait une autre religion ; en cas de père inconnu, l’on était assimilé à la religion de la mère. Enfin, si le père, juif italien, était marié à une étrangère « aryenne », l’enfant était tout de même juif. Voir le beau livre mêlant histoire et mémoire de Giuliana, Marisa et Gabrielle Cardosi, À la frontière. La question des mariages mixtes durant la persécution antijuive en Italie et en Europe (1935-1945), Paris, Les Belles Lettres, 2006, p. 13 sqq.
86 Les Juifs blessés pendant la Grande Guerre et ceux inscrits au parti fasciste avant la Marche sur Rome n’étaient pas soumis de la même manière que leurs coreligionnaires à cette législation, notamment sur les questions foncières et économiques.
87 Sur la législation antisémite, cf. parmi une littérature foisonnante : Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Turin, Einaudi, 1993 (1961 pour la première édition) ; Michele Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’elaborazione delle leggi del 1938, Turin, Silvio Zamorani, 1994 ; Marie-Anne Matard-Bonucci, op. cit.
88 Prospero, « L’Italie au pas de l’oie : Rome se voue officiellement au racisme », Le Droit de Vivre, 19 février 1938.
89 St Bradu, « Le racisme italien à l’œuvre : merci à Mussolini », Le Droit de Vivre, 22 octobre 1938. Le titre de cet article peut frapper : en fait, la LICA, selon sa rhétorique habituelle, remerciait les fascistes et les antisémites qui se dévoilaient, car ceux-ci démontraient l’inconséquence des théories qu’il prônaient et servaient en ce sens le combat des Juifs progressistes.
90 On trouve toutefois une brève référence chez Alfred Berl selon lequel « sur le plan intérieur, il est permis de penser que l’économie italienne cause de graves soucis au gouvernement fasciste » (« En Italie : variations antisémites », Paix et Droit, octobre 1938).
91 Ibid.
92 B. Messino, « La situation des Juifs en Italie », L’Univers Israélite, 26 mai 1939. Cf. « En Italie : le racisme », L’Univers Israélite, 12 août 1938.
93 « M. Mussolini à Trieste », L’Univers Israélite, 23 septembre 1938.
94 « Le “complot antifasciste” est de fabrication allemande », Le Droit de Vivre, 22 octobre 1938. Voir aussi : « Complot antifasciste à Trieste », L’Univers Israélite, 21 octobre 1938.
95 Serge Weil-Goudchaux, « L’Italie adopte une politique raciste », Samedi, 30 juillet 1938.
96 Sur ce point, voir par exemple Philippe Foro, « Racisme fasciste et Antiquité : l’exemple de la revue La Difesa della razza (1938-1943) », Vingtième Siècle, no 78, avril-juin 2003, p. 121-131. Pour un autre exemple d’utilisation de l’Antiquité en régime fasciste, cf. Johann Chapoutot, Le National-socialisme et l’Antiquité, Paris, PUF, 2008.
97 « Les Juifs dans la Rome antique », L’Univers Israélite, 17 juin 1938. Cf. André Suarès, Vues sur l’Europe, Paris, Grasset, 1939, p. 56 et 76.
98 Sam Lévy, dans Anatole Leroy-Beaulieu, Sam Lévy, Benito Mussolini, op. cit., p. 38.
99 « Attaques contre la Bible », Le Droit de Vivre, 3 septembre 1938.
100 En l’absence de documents, il semble que, tandis que Pie XI défendait les Juifs (voir infra), les Israélites ne préféraient pas rappeler le passé antisémite de l’Église. Or, dans la propagande fasciste, le thème de l’antijudaïsme chrétien apparut comme un thème de choix ; cf. Marie-Anne Matard-Bonucci, « Les mises en scène de l’antisémitisme chrétien dans La Difesa della razza », dans Giovanni Miccoli, Catherine Brice (dir.), Les Racines chrétiennes de l’antisémitisme politique, Rome, École française de Rome, 2003, p. 347-368.
101 « Depuis dix ans nous avions raison, Mussolini avoue son racisme », art. cit.
102 Jules Braunschvig, « La question juive en Italie », L’Univers Israélite, 14 octobre 1938.
103 « En Italie : le racisme », L’Univers Israélite, 12 août 1938. Même opinion dans « Mussolini avoue son racisme », Le Droit de Vivre, 21 juillet 1938. L’opinion française générale releva elle aussi les contradictions de la nouvelle posture mussolinienne avec les déclarations faites à Emil Ludwig, dont on peut relever la dimension symbolique ; cf. Nadège Colombier, op. cit., p. 74-78.
104 « Pour du charbon », L’Univers Israélite, 6 janvier 1939.
105 Ibid.
106 « Mussolinades », Samedi, 11 février 1939.
107 « Le statut définitif des Juifs », Paix et Droit, décembre 1938.
108 Léon Abastado, « Fascisme d’exportation », L’Univers Israélite, 10 février 1939.
109 « Le Duce décore une Juive », Samedi, 3 juin 1939. De même, les anciens militaires juifs furent invités à assister en uniforme à la cérémonie du vingtième anniversaire de la révolution fasciste, les 23 et 24 mars 1939 (« La situation des juifs en Italie », Paix et Droit, mars 1939).
110 Cela fut particulièrement net sur les plans économique et financier ; afin d’éviter de trop lourdes conséquences de ce type, les banques italiennes trouvèrent de nombreux compromis pour conserver les liens qu’elles entretenaient notamment avec les Juifs étrangers : Roberto Di Quirico, « La Banca e la razza. Riflessioni sulle conseguenze del varo delle leggi razziali sull’attività delle banche italiane all’estero », dans Ilaria Pavan, Guri Schwarz (a cura di), Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintergrazione postbellica, Florence, Giuntina, 2001, p. 69.
111 « Bienvenu, le touriste ! », Samedi, 12 novembre 1938.
112 Serge Weil-Goudchaux, art. cit.
113 Opinion d’ailleurs reprise par l’historiographie ; voir notamment Asher Cohen, « La politique antijuive en Europe (Allemagne exclue) de 1938 à 1941 », Guerres mondiales et conflits contemporains, no 150, avril 1988, p. 46.
114 « Drames du racisme en Italie », Paix et Droit, mars 1939.
115 Anatole Leroy-Beaulieu, Sam Lévy, Benito Mussolini, op. cit., p. 35.
116 Alfred Berl, « En Italie : variations antisémites », Paix et Droit, octobre 1938.
117 Robert Hayem, « Avant le Congrès fasciste », L’Univers Israélite, 30 septembre 1938.
118 Cf. B. Messino, art. cit.
119 « Drames du racisme en Italie », Paix et Droit, mars 1939. Cf. « Mussolinades », art. cit. ; « Un colonel italien », Samedi, 29 avril 1939.
120 « La situation des juifs en Italie », Paix et Droit, mars 1939. René Lamy, « Le chantage au racisme italien », Le Droit de Vivre, 15 octobre 1938.
121 « Une poignée de Juifs sur une île… », Le Droit de Vivre, 7 janvier 1939. Cf. « Expulsion des Juifs de Rhodes », L’Univers Israélite, 20 janvier 1939.
122 « De nouvelles restrictions antijuives », Paix et Droit, mai 1939.
123 Renzo De Felice, Storia degli ebrei…, op. cit., p. 367 sqq.
124 « L’antisémitisme en Italie », Paix et Droit, novembre 1938.
125 « La situation des Juifs en Italie », Paix et Droit, mars 1939.
126 Cf. à titre de comparaison, Diane Afoumado, Conscience, attitudes et comportement des Juifs en France entre 1936 et 1944, thèse d’histoire sous la direction de Jean-Jacques Becker, Université Paris-X, 1997, p. 43 sqq.
127 Jules Braunschvig, art. cit.
128 L’Univers Israélite, juin 1939.
129 Le Droit de Vivre, 17 septembre 1938.
130 B. Messino, art. cit.
131 Cette idée avait d’ailleurs été agitée dès l’origine par les antifascistes : cf. Pierre Milza, « L’image de l’Italie et des Italiens en France du xixe siècle à nos jours », dans Maurizio Antonioli, Angelo Moioli (a cura di), Saggi storici in onore di Romain H. Rainero, Milan, Franco Angeli, 2005, p. 185.
132 Cf. Samedi, 15 août 1938.
133 « Un homme courageux… en Italie », Samedi, 12 novembre 1938.
134 Cf. sur cette assertion, Simona Colarizi, op. cit., p. 242-250.
135 Bernard Lecache, préface à Giuseppe Gaddi, Le Racisme en Italie, Paris, Le droit de vivre, 1939, p. 2.
136 Geoffroy Fraser, « Ce que j’ai vu à Rome », Le Droit de Vivre, 14 mai 1938.
137 « La politique raciste », Paix et Droit, janvier 1939.
138 Ibid.
139 AIU, France I – C 4. Lettre d’Edmond Dreyfus à l’Alliance israélite universelle, du Comité local de La Chaux-de-Fonds, 25 septembre 1936.
140 « Le chef d’orchestre juif et les Italiens », Samedi, 10 septembre 1938.
141 « Histoire italienne », Samedi, 28 janvier 1939.
142 « Un beau geste du roi d’Italie », Samedi, 24 décembre 1938.
143 « En Italie, le racisme soulève des protestations », L’Univers Israélite, 25 novembre 1938.
144 « Marinetti et Papini », L’Univers Israélite, 21 avril 1939.
145 Ibid.
146 La réaction des intellectuels et hommes de culture italiens fait débat. La question se pose de savoir si les réprobations de noms illustres ne cachait pas une forme de consensus de la part du plus grand nombre : voir la mise au point récente de Roberto Finzi, « La cultura italiana e le leggi antiebraiche del 1938 », Studi Storici, vol. 49, no 4, octobre 2008, p. 895 sqq.
147 Anatole Leroy-Beaulieu, Sam Lévy, Benito Mussolini, op. cit., p. 29.
148 Pour la réception de la législation antisémite parmi les Italiens des États-Unis : Stefano Luconi, « “The Venom of Racial Intolerance” : Italian Americans and Jews in the United States in the Aftermath of Fascist Racial Laws », Revue française d’études américaines, no 107, mars 2006, p. 107-109. On a vu que les antifascistes italiens en France, tout en rejetant l’antisémitisme, n’étaient pas dénués d’ambiguïté : Éric Vial, « Les antifascistes italiens en exil en France face aux lois antisémites mussoliniennes de 1938 », Cahiers de la Méditerranée, no 61, décembre 2000, p. 227-245. Cf. également Mino Chamla, « “La persecuzione antiebraica vista da vicino” : la stampa degli italiani liberi in Francia », Rassegna mensile di Israel, vol. 54, no 1-2, 1988 : l’auteur donne (p. 378-396) une recension de tous les articles de la presse antifasciste italienne en France qui donne une idée de la variété et de l’ampleur des thèmes abordés relativement à cette question. En 2002, Marie-Anne-Matard-Bonucci remarquait que l’on ignorait presque tout de la réception des lois antisémites par les Italiens vivant hors de leur pays natal. Ce constat reste parfaitement valable. Dans « Enjeux de la diplomatie culturelle fasciste : de l’Italien à l’étranger à l’Italien nouveau », Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, no 114-1, 2002, p. 178.
149 Archives du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), Archivio centrale dello Stato, CDL XXIV-20, Lettre d’Arthur Rubinstein à Mussolini, d’Aix-les-Bains, le 9 septembre 1938.
150 Ibid. Lettre d’Henry Bernstein à Mussolini, de Paris, le 5 septembre 1938.
151 Voir par exemple, Samedi, 10 septembre 1938.
152 « Colonisations et chimères », Paix et Droit, mars 1938 ; « L’Abyssinie sera-t-elle une nouvelle Palestine ? », Samedi, 5 mars 1938.
153 AIU, CDV, Ms 650, dossier 16. Session du comité administratif du Congrès juif mondial, 16 janvier 1939.
154 Ibid.
155 « Mussolini va-t-il exiler le pape ? », Le Droit de Vivre, 20 août 1938. Cf. Serge Weil-Goudchaux, art. cit.
156 AIU, CDV, Ms 650, dossier 16. Session du comité administratif du Congrès juif mondial, annexes (« Hommage au pape »), 16 janvier 1939
157 Il y a toutefois polémique sur cette question ; cf. Georges Passelecq, Bernard Suchecky, L’Encyclique cachée de Pie XI : une occasion manquée de l’Église face à l’antisémitisme, Paris, La Découverte, 1995, p. 43 sqq. On pourra mesurer l’ampleur de l’action menée officiellement et en coulisse par Pie XI en lisant Emma Fattorini, Pio XI, Hitler e Mussolini : la solitudine di un papa, Turin, Einaudi, 2007, p. 170-199.
158 Cf. Marc Agostino, Le Pape Pie XI et l’opinion (1922-1939), Rome, École française de Rome, 1991, p. 732.
159 « En Italie, le racisme soulève des protestations », L’Univers Israélite, 25 novembre 1938 ; « Les dignitaires de l’Église et le racisme », Paix et Droit, décembre 1938.
160 « Une lettre de Mgr Paul Rémond, évêque de Nice », L’Univers Israélite, 23 juin 1939. Il s’agissait d’un courrier envoyé par l’évêque niçois à Théo Kahn, président de l’Union et sauvegarde juives. Mgr Rémond avait déjà condamné l’antisémitisme nazi. Cf. Ralph Schor, Monseigneur Paul Rémond, un évêque dans le siècle, Nice, Serre, rééd., 2001, p. 91.
161 Sur la réaction de la presse catholique à l’antisémitisme italien, voir Ralph Schor, « La presse catholique et les Juifs dans les années 1930 », dans Annette Becker, Danielle Delmaire, Frédéric Gugelot (dir.), Chrétiens et juifs : entre ignorance, hostilité et rapprochement (1898-1998), Villeneuve d’Ascq, Éditions de l’Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, 2002.
162 Les réactions furent nombreuses dans les pays étrangers, particulièrement parmi les Juifs. Cf. pour les États-Unis, un article très fouillé de Joshua Starr, « Italy’s antisemites », Jewish Social Studies, vol. 1, no 1 ? janvier 1939, p. 105-124. Les Juifs, du moins leurs institutions, accordèrent un intérêt certain à la perception de l’antisémitisme fasciste par la presse française et européenne ; on trouve dans les archives de l’Alliance israélite universelle (AIU, CDV, Boîte 11), une revue de presse très intéressante.
163 Cf. pour une étude des réactions de la presse, Nadège Colombier, op. cit. ; et Gabriele Fasan, « La presse française et l’antisémitisme en 1938 », dans Jean-William Dereymez (dir.), Le Refuge et le piège. Les Juifs dans les Alpes (1938-1945), Paris, L’Harmattan, 2008, p. 41-53.
164 Par exemple, « Un qui applaudit le Duce », Samedi, 5 novembre 1938.
165 Cf. Sandrine Diallo, Le Judaïsme à travers l’Action Française de 1933 à 1939, Mémoire de maîtrise sous la direction de Ralph Schor, Université de Nice, 1989, p. 103 sqq. L’Action Française ne prêtait cependant pas foi à une conception biologique du racisme.
166 « Une poignée de Juifs sur une île », Le Droit de Vivre, 7 janvier 1939.
167 « Pour les réfugiés italiens, la LICA intervient auprès du gouvernement », Le Droit de Vivre, 18 mars 1939.
168 « Voici les réfugiés italiens », Le Droit de Vivre, 18 mars 1939. Cf. également, « Des Juifs fuyant l’Italie arrivent à la frontière française », L’Univers Israélite, 17 mars 1939.
169 Sur leur départ, et la place de la France dans l’émigration juive en 1938, Mario Toscano, « L’emigrazione ebraica italiana dopo il 1938 », dans Id., Ebraismo e antisemitismo in Italia dal 1848 alla guerra dei sei giorni, Milan, Franco Angeli, 2003, p. 193. Sur leur accueil, Ralph Schor, « L’arrivée des Juifs d’Italie dans les Alpes-Maritimes (1938-1940) », dans Jean-Baptiste Duroselle, Enrico Serra (a cura di), Italia, Francia e Mediterraneo, Milan, Franco Angeli, 1990, p. 104 sqq. ; Jean-Louis Panicacci, « Les Juifs et la question juive dans les Alpes-Maritimes de 1939 à 1945 », Recherches Régionales, no 4, 1983, p. 241 sqq. ; Vicki Caron, L’Asile incertain. La crise des réfugiés juifs en France, 1933-1942, Paris, Tallandier, 2008, p. 260-261.
170 L’ensemble des documents rassemblés permet de discuter l’interprétation proposée par David Weinberg, par ailleurs l’auteur d’un excellent et incontournable ouvrage sur le judaïsme. Celui-ci affirme en effet dans une note de son ouvrage que « l’attitude des Juifs envers l’Italie ne changea pas même après l’adoption d’une législation anti-juive par Mussolini à la fin de 1938 » (Les Juifs à Paris de 1933 à 1939, Paris, Calmann-Lévy, 1974, p. 125). D. Weinberg se fonde sur un article d’Afred Berl (Paix et Droit, octobre 1938) qui souligne que Mussolini ne versait dans l’antisémitisme que par nécessité politique. Cette idée fut certes répandue dans l’opinion juive mais elle apparaissait souvent sous des formes plus nuancées, comme l’opposition entre les modalités des antisémitismes fasciste et nazi, l’idée que la législation ne serait pas appliquée ou les réactions philosémites du peuple italien. Cela ne signifie pas que l’opinion juive ne changea pas face à l’Italie. Loin s’en fallait.Le fait que même les plus ardents défenseurs de l’Italie – et du fascisme parfois – prissent la parole pour s’opposer aux agissements transalpins prouve le contraire.
171 Serge Berstein, Pierre Milza, L’Italie contemporaine du Risorgimento à la chute du fascisme, Paris, Armand Colin, 1995, p. 331.
172 Ariel Danan, Les Réactions pacifistes des Français israélites durant la crise des Sudètes (septembre 1938), mémoire de maîtrise sous la direction d’Anne Grynberg et André Kaspi, Université Paris-I, 2003, p. 112.
173 Cf. les déclarations du grand rabbin de Paris Julien Weil au journal Le Matin, le 19 novembre 1938, et les acerbes polémiques qui s’en suivirent. Paula Hyman, De Dreyfus à Vichy. L’évolution de la communauté juive en France, 1906-1939, Paris, Fayard, 1985, p. 343 sqq.
174 Pierre Lazareff, De Munich à Vichy, New York, Brentano, 1944, p. 81.
175 Ibid., p. 73. Cf. Jéhouda Tchernoff, Dans le creuset des civilisations. T. 4 : Des prodromes du bolchevisme à une Société des Nations, Paris, Rieder, 1936-1938, p. 348.
176 L’Univers Israélite, 7 octobre 1938.
177 Daniel Halévy, 1938 : une année d’histoire, Paris, Grasset, 1938, p. 51.
178 Joseph Rovan, Mémoires d’un Français qui se souvient d’avoir été allemand, Paris, Le Seuil, 1999, p. 112.
179 André Suarès, Vues sur l’Europe, Paris, Grasset, 1939, p. 11.
180 Manière récurrente par laquelle Suarès nommait Mussolini.
181 André Suarès, op. cit., p. 7. Cf. Raymond Aron, Mémoires, Paris, Julliard, 1983, p. 133.
182 Giacomo-Abramo Tedesco, « Il faut précéder Rome et Berlin », Le Droit de Vivre, 16 avril 1938.
183 Giacomo-Abramo Tedesco, « Berlin et Rome d’accord », Le Droit de Vivre, 10 décembre 1938.
184 Bernard Lecache, « Le “Parti de la guerre siège à Rome” », Le Droit de Vivre, 14 janvier 1939. Yvon Lacaze a cependant montré qu’une grande frange de l’opinion publique a vu dans la réconciliation et l’alliance franco-italienne un gage d’espoir (L’Opinion publique française et la crise de Munich, Berne, Peter Lang, 1991, p. 155).
185 Cf. Jean-Baptiste Duroselle, « La mission Baudouin à Rome », dans Jean-Baptiste Duroselle, Enrico Serra (a cura di), Italia e Francia dal 1919 al 1939, Milan, Franco Angeli, 1981, p. 357 sqq.
186 Bernard Lecache, « Munich, école de la servitude », Le Droit de Vivre, 18 mars 1939.
187 Daniel Halévy, op. cit., p. 57-58.
188 Bernard Lecache, art. cit.
189 Cf. Giacomo-Abramo Tedesco, « Berlin et Rome d’accord », art. cit.
190 « Les Juifs et la Tunisie », Samedi, 31 décembre 1938.
191 Marcel Gozland, « Comment résoudre le problème italien », Le Droit de Vivre, 3 juin 1939.
192 Cf. Juliette Bessis, La Méditerranée fasciste : l’Italie mussolinienne et la Tunisie, Paris, Karthala, 1981, p. 192 ; ainsi que son article, « La question tunisienne dans l’évolution des relations franco-italiennes de 1935 au 10 juin 1940 », dans Jean-Baptiste Duroselle, Enrico Serra (a cura di), op. cit., p. 252 sqq.
193 AIU, France XIV – A 91 I. Lettre de Jacques Tahar au Président de l’Alliance israélite universelle, de Tunis, le 8 février 1939.
194 Serge Moati, « En Tunisie, l’Italie se croit déjà chez elle… », Le Droit de Vivre, 7 janvier 1939.
195 Michel Abitbol, Les Juifs d’Afrique du Nord sous Vichy, Paris, rééd. Riveneuve éditions, 2008, p. 56.
196 Ces derniers considéraient d’ailleurs de plus en plus favorablement le sionisme.
197 Maurice Uzan, « Tunis c’est la France. Mussolini a perdu la partie », Le Droit de Vivre, 11 février 1939.
198 Ibid.
199 « Le racisme italien est dirigé contre la paix française en Afrique du Nord », Le Droit de Vivre, 17 septembre 1938.
200 Ibid.
201 Informations tirées de Benjamin Stora, Les trois exils. Juifs d’Algérie, Paris, Stock, 2006, p. 67.
202 Élie Gozlan, « Les Italiens en Libye », Samedi, 7 janvier 1939.
203 Ibid.
204 « Émotion chez les Musulmans », Samedi, 15 avril 1939.
205 Cf. Nicolas Violle, « La réception de l’assassinat des frères Rosselli dans la presse populaire parisienne », Matériaux pour l’histoire de notre temps, no 57, 2000, p. 47.
206 Luigi Campolonghi, « Hommage aux Rosselli », Le Droit de Vivre, 19 juin 1937.
207 Hanns-Erich Kaminski, Céline en chemise brune ou le mal du présent, Paris, Excelsior, 1938, p. 7.
208 Bernard Lecache, « Ils ne sont pas éternels », Le Droit de Vivre, 7 août 1937.
209 Cf. G.A. Tedesco, « Il faut précéder Rome et Berlin », art. cit.
210 I.S, « Pour combattre le racisme, plus d’esprit de capitulation ! Les Juifs prenant conscience de leur force, doivent rendre les coups ! », Le Droit de Vivre, 25 juin 1938.
211 « Condamner l’agitation fasciste ! », Samedi, 21 janvier 1939.
212 « Pour l’ordre, la paix et l’union des Français, nous demandons une loi contre le racisme », Le Droit de Vivre, 7 mai 1938.
213 « Bilan des horreurs », Le Droit de Vivre, juin 1939.
214 Ibid.
215 Cf. Diane Afoumado, op. cit., p. 400 sqq.
216 Jacob Kaplan, « Lève-toi, ô Éternel », L’Univers Israélite, 2 décembre 1938.
217 Pour une vue générale de tous les motifs de dissensions, David H. Weinberg, op. cit.,. p. 253 sqq.
218 L’Univers Israélite, 1er septembre 1939. Cf. Ariel Danan, op. cit., p. 44.
219 Philippe Erlanger, La France sans étoile. Souvenirs de l’avant-guerre et du temps de l’occupation, Paris, Plon, 1974, p. 77. Voir aussi, sous un autre angle, le témoignage d’André Chouraqui, L’Amour fort comme la mort, Paris, Robert Laffont, 1990, p. 169.
220 Edgar Morin, Autocritique, Paris, Julliard, 1959, p. 28.
221 Ibid.
222 Cf. à ce sujet, les réflexions de Maurice Sachs, Le Sabbat. Souvenirs d’une jeunesse orageuse, Paris, Corrêa, 1946, p. 270.
223 Raymond Aron, op. cit., p. 103.
224 La Terre Retrouvée, 10 septembre 1939.
225 Ilex Beller, De mon shtetl à Paris, Paris, Éd. du Scribe, 1991, p. 155.
226 « Solidarité totale. 300 000 immigrés au service de la France », Le Droit de Vivre, septembre 1939.
227 Hanns-Erich Kaminski, op. cit., p. 62.
228 Ibid., p. 63.
229 Cf. Alfred Berl, « Le devoir présent d’Israël », Paix et Droit, juillet 1939.