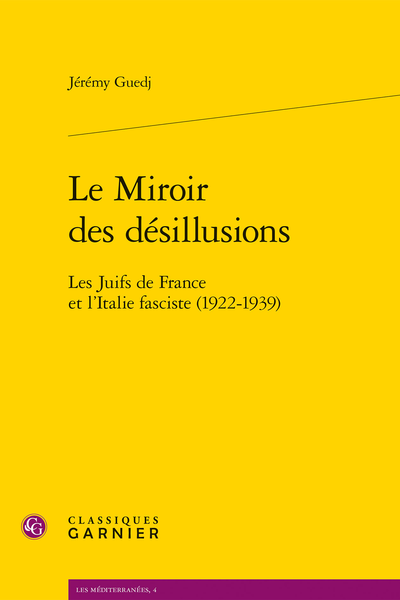
Conclusion de la première partie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Le Miroir des désillusions. Les Juifs de France et l’Italie fasciste (1922-1939)
- Pages : 151 à 152
- Collection : Les Méditerranées, n° 4
- Thème CLIL : 3378 -- HISTOIRE -- Histoire générale et thématique
- EAN : 9782812442018
- ISBN : 978-2-8124-4201-8
- ISSN : 2264-4571
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4201-8.p.0151
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 10/08/2011
- Langue : Français
L’ITALIE POLITIQUE :
QU’EST-CE QUE LE FASCISME ?
Imprégnés de l’idéal démocratique, du principe d’égalité et de pacifisme, les Israélites français ne pouvaient ignorer le bouleversement politique dont l’Italie fut le théâtre. Mais il se révélait gênant pour eux, du moins pour ceux qui s’exprimaient avant tout au nom de leur foi, de prendre clairement position car ils n’oubliaient pas l’accusation antisémite selon laquelle ils tiraient les leviers de l’État et dictaient à la France sa politique extérieure. Désireux de faire mentir de telles accusations, les organes communautaires semblaient ainsi souvent s’emmurer dans la neutralité et dans le mode descriptif relativement aux questions politiques, a fortiori quand la question juive était absente du débat1, ce qui rend l’analyse délicate, surtout si l’on compare la timidité de certaines prises de positions israélites à l’égard du fascisme aux opinions nettement tranchées et clivées de l’opinion française en général2.
À y regarder de près, l’attitude des Juifs de France – intellectuels exceptés – n’avait en réalité que l’apparence de la neutralité : d’un mot semblant anodin au détour d’une phrase, d’une digression ou même d’un silence, les avis transparaissaient. De plus, si tous les Israélites ne se livraient pas à une analyse précise de la nature du fascisme, ils étaient nombreux à consacrer des développements parfois conséquents à Mussolini, desquels ressortaient nécessairement des éléments sur le régime italien, peu architecturés et thématisés mais somme toute éloquents. Comment négliger enfin la voix des intellectuels juifs qui, justement en « situation d’homme[s] du politique3 », ne se sentaient bien entendu pas tenus par la neutralité, sans quoi l’appellation d’intellectuel les concernant eût paru usurpée ? La question de leur représentativité doit cependant être posée. On saisit ici l’opinion juive dans ses différentes 118strates, dont la perception se révèle souvent masquée par des noms illustres, qui occupent le devant de la scène et des analyses historiques. L’intérêt porté à des penseurs ou à des vecteurs de second plan, sans que cela soit ici péjoratif, fait pénétrer dans des cercles d’ordinaire peu explorés où la judéité portait une identité politique4 et confère à l’étude de cette opinion une épaisseur, une profondeur, une complexité à même de comprendre les errements qui caractérisèrent une importante fraction de la judaïcité française face au fascisme.
Il apparaît dès lors possible de reconstituer, en rassemblant tous les indices, traces et touches, le tableau du fascisme que les Israélites dépeignaient à l’époque, donnée essentielle lorsqu’on sait combien, en dépit de leurs dénégations, ceux-ci politisèrent leur perception de la question juive en Italie5. Malgré les cheminements multiples et contradictoires de ce mouvement et régime, l’image de la nature du fascisme évolua assez peu. C’est pourquoi il peut être utile de la présenter d’un seul tenant. Sur un sujet aussi politisé, qui faisait appel aux convictions profondes de chacun, l’admiration que suscitaient la culture et la place de la religion en Italie serait-elle toujours de mise ?
Le « fascisme dans son époque6 » :
une analyse tardive et incertaine
La majorité des organes représentatifs de l’opinion juive n’étaient pas tenus par des spécialistes, politologues, historiens, sociologues, mais souvent par des journalistes qui, bien qu’ils fussent éminemment cultivés, ne se lançaient pas dans une analyse systématique du phénomène 119ou du régime fascistes, ce qui ne devait d’ailleurs pas correspondre aux attentes du public auquel ils s’adressaient. Ils se contentaient ainsi, dans le meilleur des cas, d’en relever les traits les plus saillants. Seuls les intellectuels, au sens propre du terme, manifestaient une véritable vision d’ensemble.
« Leur triomphe a sans doute marqué leur mort » :
erreurs et silences
En 1919, éclata en Italie une crise qui couvait depuis la fin de la guerre et fut annoncée par une série de convulsions de taille. Les difficultés économiques étaient patentes, nées de la conjoncture mondiale et de l’incapacité des industries de guerre à se reconvertir ; l’intervention des pouvoirs publics, eux-mêmes handicapés par la pénurie des devises, ne suffit pas à enrayer le marasme, ce qui provoqua un intense malaise social. Les désordres se multiplièrent7. Les ouvriers s’emparèrent de nombre d’usines, dont certaines tombèrent dans le giron de milices ouvrières. La force de ce mouvement provenait de la poussée des syndicats, qui enregistraient au sortir de la guerre une envolée des adhésions. Dans tous les esprits, le souvenir de la révolution bolchevique demeurait vivace. Aussi put-on craindre ou espérer à un moment que le drapeau rouge flottât sur toute l’Italie. D’où la peur des grands possédants. Mais nul n’entrevoyait d’issue claire au conflit, étant donné l’instabilité du régime libéral : les gouvernements tombaient les uns après les autres. Même si la situation se décanta progressivement, certains éléments internes qui conduisirent le fascisme au pouvoir par la suite – le sentiment populaire que les gouvernements successifs n’honoraient pas leurs promesses et, d’autre part, la crainte d’une poussée des forces révolutionnaires – étaient réunis.
À l’automne, l’agitation se tassa ; la vie normale reprenait son cours. À la mi-mai 1921, l’on put organiser des élections. Benjamin Crémieux, dans une conférence prononcée le 30 mai devant le Comité national d’études sociales et politiques, en analysa les résultats depuis Paris et 120s’intéressa au devenir des formations politiques italiennes. Après l’examen des sociaux-démocrates, des démocrates-chrétiens, des communistes et des giolittiens, vint le tour des fascistes, rapidement évacués, alors qu’ils étaient 320 000 pour environ 120 000 inscrits à cette date et firent entrer 35 des leurs à la Chambre, à commencer par Mussolini. Le conférencier se justifiait en ces termes :
Les fascistes sont encore un de ces partis très mal connus en France et qu’il ne serait peut-être pas bien nécessaire de connaître parce que leur triomphe a sans doute marqué leur mort8.
Il tint d’ailleurs des propos analogues dans une revue à la vaste diffusion, L’Europe nouvelle, où, de la même manière, il fit preuve d’un « optimisme déconcertant », selon le mot de Pierre Guillen9. La position de Crémieux représentait parfaitement celle de l’ensemble des Israélites français. À aucun moment ils n’avaient pris la mesure du bouleversement qui se produisait outre-monts ; à aucun moment ils n’avaient vu venir le fascisme. Alors que leurs compatriotes craignaient pour les uns, espéraient pour les autres, que le vent révolutionnaire ne gagnât le pays et examinèrent dans le détail le cours des événements italiens10, les Juifs, eux, n’accordèrent pas une seule ligne de leurs revues ou écrits à la crise italienne. Cela provenait-il de l’absence de lien entre la crise en Italie et la question juive ? C’est une possibilité, mais elle est contredite par l’existence d’articles relatifs à des situations qui n’avaient trait en rien au judaïsme. Cela s’expliquait-il par la présence au premier plan d’un événement qui focalisait davantage l’attention ? Aucune observation ne va en ce sens : en 1920, la question de la paix dominait, de même que celle de la Palestine, mais elles n’éclipsèrent pas les autres sujets. Fallait-il y voir une erreur d’appréciation de l’ampleur de la crise ? L’explication serait valable si l’on ne tenait pas compte du haut degré d’information des organes juifs. Ainsi, aucune de ces hypothèses n’emporte pleinement l’adhésion ; les éléments de réponse sont quasiment nuls. Il en existe cependant un : le silence. Si l’on ne fit aucune allusion à ce qui se passait en Italie, la raison provenait sans 121doute de ce qu’on estimait la situation passagère et peu grave. La foi des Juifs de France en la force de la démocratie laissait espérer une résorption rapide de la crise, au sujet de laquelle il n’était nullement besoin d’alarmer l’opinion juive.
Meir Michaelis a montré que dans de nombreux pays, la presse juive s’était inquiétée avec grande émotion des perspectives que laissait entrevoir l’avènement du régime des faisceaux11. Nulle trace d’une pareille tendance dans la presse juive française. Dans leur écrasante majorité, les Israélites de France virent en fait s’installer le fascisme avec le plus grand étonnement. Cela ne rendait que plus malaisée l’analyse d’un phénomène aussi complexe. Avant de se prononcer sur la nature du mouvement que portait le nouveau régime italien, nature paraissant hybride et difficilement saisissable a priori, les Juifs consentirent à faire ce qu’ils n’avaient pas entrepris jusqu’alors : chercher les origines du fascisme. L’analyse était de cette manière souvent rétrospective ; elle estompait la part d’étonnement suscitée par l’observation contemporaine des événements, mais elle s’efforçait de mettre chaque fois son objet en perspective. Au moment des faits, les Juifs ne s’étaient nullement penchés sur les causes immédiates de la naissance et de l’avènement du fascisme ; ils offraient en revanche une analyse rétrospective – une reconstruction historique – des causes lointaines très poussée.
Naissance et essence du fascisme : une réflexion a posteriori
Une idée présidait à toutes les considérations : en dépit des affirmations de ses hiérarques, le fascisme versait peu dans le dogmatisme, l’action l’emportant souvent sur la doctrine, constituée d’un agrégat de théories piochées ça et là dans des courants antérieurs divers ou formées plus ou moins habilement à mesure que s’écrivaient les événements. Il fallait donc adopter une démarche empirique pour analyser le fascisme et ne pas se fier aux seules déclarations. Ce parti-pris est d’ailleurs largement admis par l’historiographie qui, pour définir le fascisme, ne s’ancre pas seulement dans l’histoire des idées mais cherche à étudier la traduction politique et sociale de celles-ci : Robert Paxton, choisissant d’accorder une place de premier ordre aux actes pour déterminer la nature du fascisme, peut ainsi écrire que « ce que les fascistes ont fait nous en dit au moins autant que ce qu’ils ont déclaré », si ce n’est plus12. La difficulté pour les 122observateurs contemporains, étrangers à l’Italie de surcroît, provenait de l’incapacité à rattacher l’expérience originale que constituait le fascisme à des courants, idées, schémas déjà existants et à l’inscrire dans des catégories connues13. De quoi, de qui les fascistes s’inspiraient-ils ainsi ? Analysant l’ouvrage de Curzio Malaparte, L’Italie contre l’Europe, Benjamin Crémieux soutenait en 1927 que certains modèles français avaient pu influencer le fascisme :
La substance même de sa doctrine dérive […] de deux idées françaises appliquées d’une façon originale à la psychologie et à l’histoire du peuple italien : l’une, celle de la décadence de l’Europe, résultat de la Réforme, empruntée à Charles Maurras ; l’autre, celle de la violence et du volontarisme syndicaliste, empruntée à Georges Sorel14.
L’on sait combien ce sujet divise les historiens15 ; la question des origines françaises du fascisme ne fut cependant guère débattue parmi les Juifs. Sans doute certains rejetaient-ils cette hypothèse en prenant acte de ce qu’en France, ceux qui cherchaient à établir une parenté entre le fascisme italien et les idées françaises se situaient à l’extrême droite de l’échiquier politique et exaltaient le nationalisme et l’antiparlementarisme, desquels dérivait souvent l’antisémitisme. Les Israélites français cantonnaient ainsi 123leur analyse au strict cadre italien. Le fascisme semblait s’inscrire dans la lignée des bouleversements qu’avait connus la péninsule depuis le xixe siècle. Il constituait une étape, brève espérait-on, de la consolidation de l’unité et de la politisation de l’Italie ; il poursuivait le mouvement historique amorcé depuis le Risorgimento : « L’Italie fasciste considère que l’œuvre du Risorgimento n’a été achevée ni par l’entrée dans Rome en 1870, ni même par les annexions de 191816 ». Nombreux étaient ceux qui insistaient à juste titre sur l’importance de la Grande Guerre, qui avait précipité la naissance du fascisme17. Pendant le conflit en effet, l’Italie connut ses premiers ébranlements, scindée en deux camps antagonistes : l’Italie giolittienne, celle des neutralistes, composée des masses paysannes et ouvrières, des socialistes et d’une partie des catholiques, qu’affrontait l’Italie interventionniste, peuplée des démocrates de tendance mazzinienne, des anarcho-syndicalistes, des socialistes, ainsi que d’une fraction importante des intellectuels18, dont les écrits façonnèrent l’opinion italienne et retentirent jusqu’en France. La frustration en Italie, notait-on, était d’autant plus grande au sortir du conflit que le sacrifice auprès des alliés – 670 000 Italiens tombèrent au champ d’honneur – se solda par une « Victoire mutilée », pour reprendre la célèbre expression de d’Annunzio. Aussi revenait-on en détail sur l’effet du tournant historique représenté par la guerre dans la formation du fascisme. Daniel Halévy rapportait ainsi les propos que lui tint Paolo Orano lors du Convegno Volta de Rome, en 1932 : « Avant 1914, me dit Orano, pour nous fascistes, il n’y a rien ; 1914 ; l’histoire commence19 ». Daniel Halévy avait cependant une vision autrement différente et écrivait : « je dirais : 1914, l’histoire finit ; quelque chose d’obscur et d’inconnu commence20 ». Différence de vision donc entre le cadre fasciste et l’intellectuel français : pour le premier, 1914 inaugura un monde nouveau ; pour le second, cette date marquait la mort d’un monde ancien. Considérations historiques qui amenaient Halévy à cerner la place omniprésente de la guerre dans l’imaginaire fasciste, que symbolisait la chemise noire, vêtement de deuil, mais également habit du paysan revêtu par les fascistes « pour prendre en main la direction de leur pays, le retourner comme on retourne un 124champ, le féconder21 ». Et les mots étaient bien choisis, car ils traduisaient parfaitement le bouleversement que représenta le fascisme aux origines duquel figurait une forme de révolution, et en premier lieu une révolution des esprits22. De sorte que les intellectuels avaient grandement contribué à refaçonner la mentalité italienne. L’on évoquait le rôle de Marinetti, l’apôtre du futurisme, qui propagea dans l’opinion italienne des idées avant-gardistes exaltant la vitesse et la modernité industrielle, aux antipodes d’images traditionnelles tournées vers le passé :
On peut dire que dans une large mesure le futurisme a préparé les voies de l’état d’âme fasciste, écrivait Crémieux. Entre 1919 et 1922, le futurisme a même été la grande littérature officielle du fascisme révolutionnaire et dynamique. […] À défaut d’une grande valeur littéraire, on ne peut nier que le futurisme ait eu une réelle importance spirituelle en Italie23.
Mais plus que Marinetti, l’on reconnaissait que d’Annunzio avait largement préparé le terrain que foulerait plus tard le fascisme. Plusieurs versaient d’ailleurs à plein dans le mythe d’Annunzio, au point d’en négliger la galerie des autres pères lointains du fascisme24. Le poète correspondait en effet véritablement à la définition de l’intellectuel engagé qui ne reste pas emmuré dans sa tour d’ivoire. Julien Benda, qui dans La Trahison des clercs s’intéressait aux rapports entre les intellectuels et la vie publique, comparait d’Annunzio à Maurice Barrès, unis par un nationalisme vibrant, et reconnaissait que le poète italien avait, parmi les premiers, fait de son art un outil au service d’un idéal politique25. Une preuve parmi tant d’autres suffisait à illustrer cette assertion : après la publication de La Nave, en 1908, la Ligue navale vénitienne avait adressé au poète un éloge de son œuvre, qui traduisait à la perfection, selon elle, le sentiment populaire ; Julien Benda voyait là un « prélude du mussolinisme26 ». Deux éléments prouvaient que les idées de d’Annunzio portaient particulièrement en germe les éléments constitutifs du fascisme : la glorification du sentiment nationaliste italien au sein du peuple, sorti de son inertie passagère et dont l’image à l’étranger, particulièrement 125en France, continuait d’évoluer ; loin du chanteur d’opérette dénigré par beaucoup au siècle précédent, l’Italien œuvrait à la grandeur nationale et se montrait prêt à tout pour défendre l’honneur de son pays. En ce sens, d’Annunzio contribua à confirmer et à amplifier une image qui se dessinait depuis la guerre de Libye en 191127. De plus, d’Annunzio, ajoutait-on, avait rendu à l’Italie et aux Italiens leur vocation méditerranéenne28. L’épisode de Fiume fournissait naturellement l’exemple le plus criant de la vigueur de cet élan national. Insatisfait des traités de Versailles et de Saint-Germain, exaltant l’expédition des Mille de Garibaldi, d’Annunzio occupa la ville de Fiume à la tête d’arditi et de nationalistes réunis sous le nom de Légion des volontaires fiumains : ils réclamaient Fiume, peuplée d’une majorité d’Italiens, au nom du principe des nationalités et y proclamèrent la libération du golfe de l’Adriatique, ou Quarnaro29. André Suarès célébra avec son verbe puissant la marche sur Fiume et le rôle de d’Annunzio quant à l’éveil de l’Italie :
L’Italie lui doit beaucoup de son honneur présent et peut-être même ses frontières. Il l’a rendue à l’Europe, d’où elle était absente ; il l’a ravie à cette secte de politiques usuriers et de vieillards rabougris, qui la gouvernaient comme un municipe de province. Nul n’a fait plus pour son peuple, depuis six ans, que ce Gabriel aux brûlants messages : il a trempé l’amère Adriatique dans le miel de la possession ; et si Fiume est italienne, c’est à cause de lui et de lui seulement30.
Moins admiratif, Julien Benda lisait cet événement d’un autre œil et s’interrogeait sur sa signification politique : il observait une forme de bellicisation du caractère italien en rupture avec l’idée latine de paix. La marche sur Fiume signait ainsi d’une manière l’acte de naissance du fascisme. Le culte du chef, la communion de ce dernier avec une foule électrisée, les principes corporatifs qui nourrissaient les Statuti della Regenza del Quarnaro, proclamés en 1920 à Fiume, tous ces traits se 126trouvaient, notait-on avec le recul, à l’origine du fascisme, qui voyaient les classes moyennes sortir de leur mutisme31. Et l’on se souvient d’ailleurs que d’Annunzio et Mussolini se disputèrent un temps la primauté sur le mouvement nationaliste en Italie, tant les principes qu’ils défendaient et le public qu’ils visaient tous deux étaient semblables32. Le Commandante concourut, il est vrai, à la diffusion d’une mentalité dérivant du bellicisme, mentalité nouvelle pour les Italiens et caractérisée par « la tendance à l’action, la soif du résultat immédiat, l’unique souci du but, le mépris de l’argument, l’outrance, la haine, l’idée fixe33 ».
In fine, comment analysait-on le mouvement qui avait découlé de ces différentes sources d’inspiration intellectuelles et culturelles, sur lesquelles on s’était en définitive peu attardé ? Quelle était, aux yeux des observateurs juifs, la nature, l’essence du fascisme en tant que mouvement34 ? La violence en semblait le pivot central35. Le fascisme, remarquait-on, revêtait d’ailleurs l’allure d’un agrégat informe de mécontents vouant l’État libéral aux gémonies. Ainsi, même s’il se présentait comme un mouvement hostile au bolchevisme, il accueillit nombre d’éléments d’extrême gauche dans ses rangs, mélange insolite et alliance stratégique mais contre-nature, comme s’en faisait l’écho Alfred Berl ; on décèle dans ces propos la même réprobation à l’égard des communistes que des fascistes :
En Italie, le parti fasciste a recruté de nouveaux adhérents parmi les communistes désabusés. […] Étant tous, à droite comme à gauche, des agents de violence révolutionnaire et de chambardement social, ils sont interchangeables et oscillent, selon l’heure, les uns à l’égard des autres, entre la coopération et la guerre civile36.
C’était donc finalement la conjonction de frustrations poussées à leur paroxysme qui créait ce climat explosif et conférait au style fasciste son 127aspect « vif, direct, brutal37 ». De sorte que, lorsque cette issue se précisa, l’accession du « fascisme-mouvement » au pouvoir constituait une étape supplémentaire dans la progression de la violence et débridait les mécontents, ce dont s’inspiraient les autres pays, dont l’Allemagne, selon un journaliste de Paix et Droit : « Le succès du fascio en Italie, surexcita ces gens, qui ne parlent, dans leurs diatribes, que de détruire, incendier, écerveler, et qui joignent l’acte à la parole38 ».
Mais c’était bien le « fascisme-régime » qui faisait l’objet de toutes les observations, par son aspect inédit comme par son actualité : il se révélait toutefois plus délicat d’en distinguer la nature. D’autant plus délicat qu’il revêtait un aspect multiforme et oscillait entre les diverses tendances qui l’avaient façonné. Révolutionnaire à l’origine, le fascisme parvint par la suite à s’associer les classes moyennes effrayées par le bolchevisme, si bien qu’il se trouvait tiraillé entre son désir de renouveau intégral et l’apparence réactionnaire qu’il se donnait dans un but stratégique. Revenant sur l’état du fascisme dans les premiers temps de son installation aux affaires, le très prolifique Benjamin Crémieux évoquait cette ambivalence :
Le fascisme, à cette époque, désireux de se définir, de se trouver des justifications historiques et philosophiques, hésitait entre le traditionalisme (qui répugnait à sa soif de nouveauté) et le futurisme. Les deux années 1924 et 1925 semblèrent marquer le triomphe du futurisme, non pas sous la forme marinettienne d’une adoration moderne, mais sous forme d’une adoration de l’actuel39.
Malgré cette multiplicité d’aspects, un constat emportait l’adhésion, lequel se rapportait à la fois à la nature et aux manifestations du régime fasciste : la force de la dictature. Les hommes de gauche étaient les plus enclins à la critique. L’éminent philosophe Élie Halévy, en voyage en Italie, envoyait à son ami Alain la lettre suivante : « Je t’écris du pays de la tyrannie. C’est un régime, pour le voyageur, extrêmement agréable, où les trains partent et arrivent à l’heure, où il n’y a grève ni des ports ni des tramways40 ». Et, à Xavier Léon, il décrivait le musellement du 128peuple, la mise à mort des libertés publiques et l’agonie de la démocratie, dès 1923 :
Ici, d’après les journaux, quelques vagues simulacres de vie politique, dans l’attente des élections, que le dictateur daigne annoncer son intention de faire, dans un délai assez rapproché. Mais un jour il dit oui, le lendemain il dit non. Et tout le monde, béat, attend un signe de lui. Le groupe Salandra demande place sur les listes fascistes. Le groupe Giolitti annonce son intention de faire liste à part, tout en protestant de sa sympathie pour Mussolini. Les catholiques ne savent à quel saint se vouer. Nitti est au ban de la société. Socialistes et communistes s’abstiendront, si les fascistes le leur permettent. Bref, Mussolini règne despotiquement à l’heure qu’il est41.
Encore plus à gauche, Émile Kahn, membre de la Ligue des Droits de l’homme, insistait également sur le simulacre de démocratie que maintenait le régime fasciste : « Le fascisme parodie la démocratie : apparemment il fait comme elle confiance au peuple, mais il ne laisse au peuple ni le moyen de s’informer, ni le moyen de s’exprimer42 ».
Le caractère dictatorial du régime posé, encore restait-il à identifier de quel type exact de dictature il s’agissait. Une impressionnante série de régimes dictatoriaux, autoritaires, conservateurs, réactionnaires, fascistes, fleurit dans l’Europe de l’entre-deux-guerres. À l’époque, la primauté de l’Italie en la matière amena, par abus de langage, à qualifier tous ces régimes de fascistes43. En fait, l’on opposait, de manière simpliste parfois, d’une part les régimes non communistes, de droite, au régime communiste, de gauche, ce qui amenait à des prises de positions tranchées en faveur des uns ou de l’autre. La réalité était bien plus complexe, comme la gamme des choix possibles face à ces régimes. Le très lucide Raymond Aron avait alors rejeté cette catégorisation : « l’alternative “communisme ou fascisme” n’est pas fatale. À la différence d’une fraction importante de l’intelligentsia, je ne me suis jamais laissé prendre à cette prétendue fatalité44 ». L’ensemble des Israélites français se révélaient-ils aussi fins 129dans leur analyse ? À les lire, il le semble, car selon ceux qui faisaient glisser cette question sur le terrain communautaire, définir clairement et précisément la nature du régime fasciste présentait l’enjeu de savoir s’il serait intrinsèquement antisémite ou non. À quel groupe l’Italie s’apparentait-elle ? De quelle dictature s’agissait-il alors ? « Le vent de réaction qui souffle depuis la guerre sur toute l’Europe […] a atteint jusqu’à l’Italie où il s’est concrétisé dans le fascisme », affirmaient les Archives Israélites45 ; le terme de « réaction » avait d’ailleurs été également employé par Daniel Halévy, qui répondait, lui, à des considérations bien différentes de celles d’Hippolyte Prague46. Les Israélites les plus à gauche étaient ceux qui s’employaient le plus à clamer haut et fort la nature réactionnaire du fascisme. Cela permettait de récuser le côté révolutionnaire qu’il revendiquait. Les vrais révolutionnaires selon Le Droit de Vivre, organe de la LICA, ligue progressiste, se trouvaient à gauche. Jacques Rozner, qui se faisait le porte-voix d’une telle opinion, estimait que le fascisme n’était en fait qu’un stade du capitalisme, non une doctrine politique originale, comme le pensaient les modérés :
C’est la réaction convulsive, instinctive et spontanée, d’une époque, d’une civilisation, d’un monde à son déclin. C’est un instinct de conservation qui se manifeste d’une façon violente et barbare, tout simplement parce que la constitution de ce dont il émane ne permet pas qu’il réagisse autrement. Le fascisme n’est donc ni le fruit de l’Imagination ou de la Médiation, ni l’expression d’une philosophie ; […] c’est un phénomène congénital propre à un stade de l’évolution historique47.
Le fascisme, loin de révolutionner quoi que ce fût, regroupait en fait « les capitalistes sans le capitalisme48 ». Ces lignes du Droit de Vivre semblent témoigner d’une incertitude, d’un flou caractéristiques de l’époque quant à l’acception précise des termes employés : réaction et conservatisme semblaient des notions interchangeables, qui renvoyaient toutes à une idéologie de droite, aux antipodes du progressisme qu’incarnait la LICA. Mais les deux termes, bien qu’ils se confondissent parfois dans les esprits, exprimaient deux réalités nettement différentes : le conservatisme impliquait le maintien d’une situation, d’une politique, de valeurs traditionnellement en vigueur dans un État ou une entité donnés, tandis que la réaction, elle, nécessitait une rupture avec le temps présent et prônait le retour à 130un comportement et à une culture politiques antérieures, abandonnées pendant un temps. Alfred Berl, tout en reconnaissant la difficulté de toujours clairement distinguer les deux notions, en appelait à la vigilance :
A-t-on le droit de confondre le conservatisme avec la réaction ? Maintenir en améliorant prudemment, c’est le rôle du conservatisme le plus libéral. Réagir, c’est revenir en arrière. Par ailleurs, il est imprudent de se fier aux étiquettes, et il faut se garder des formules toutes faites. Libéral, conservateur, réactionnaire, sont des vocables dont le sens est relatif et variable ; ils ne sont nullement probants quant au fond des choses49.
L’idéal aurait donc été d’adopter une attitude empirique pour scruter la nature véritable du fascisme. Mais le pouvait-on ? Des considérations internes au judaïsme, personnelles ou collectives, n’impliquaient-elles pas de s’engager sur le terrain idéologique ?
Les diverses discussions portant sur l’essence du fascisme n’avaient en effet pas simplement un but heuristique, mais servaient une idéologie et s’inscrivaient pour beaucoup sur fond de question juive. Il est intéressant de noter la manière dont l’analyse d’un problème de politique extérieure pouvait s’inviter sur le terrain religieux et par là même s’insérer dans les clivages de la judaïcité française. Car parler de réaction, de conservatisme et d’autoritarisme n’était pas égal ; certains des régimes qui s’en réclamaient pouvaient être amenés à revoir la place des Juifs dans les sociétés qu’ils régissaient, pensait-on. Cerner la nature du fascisme revenait ainsi à connaître en un sens l’avenir des Juifs italiens, débat qui raviva les luttes intérieures au judaïsme français. Très tôt les liens entre le fascisme et la question juive firent l’objet d’âpres discussions, qui éclatèrent cependant à l’étranger. En Italie, le sujet se posa mais le musellement de la presse – juive notamment – ne lui conféra qu’une faible profondeur et résonance : les communiqués officiels, jusqu’en 1938, niaient que fascisme et antisémitisme s’irriguassent mutuellement, bien au contraire50. Aussi fut-ce dans les pays européens abritant une forte communauté juive que naquirent débats et controverses. Dès 1924, Paix et Droit s’en fit l’écho, en citant l’analyse du journal hongrois Pester Lloyd, qui récusait toute parenté entre le fascisme et l’antisémitisme :
131Ni le nationalisme bien compris, ni le conservatisme au sens propre du mot n’ont rien de commun avec l’antisémitisme : bien plus, il n’y a pas de raison pour que le chauvinisme le plus réactionnaire prenne une attitude d’hostilité à l’égard des juifs. Cependant, chez les Européens à l’esprit paresseux – qui, en dépit des progrès de l’éducation politique des masses demeurent légion – l’idée s’est ancrée que fascisme et antisémitisme sont, sinon identiques, du moins proches parents, et devraient toujours marcher main dans la main51.
Cette thèse l’emporterait-elle massivement chez les Juifs de France ? Ce fut en grande partie, mais pas en majorité, le cas. Les Israélites les plus à gauche, au premier rang desquels la LICA, entendaient, surtout dans les années 1930, les premiers briser le consensus sur la question. À leurs yeux, il existait une équation simple : « fascisme = antisémitisme52 », non pas seulement du fait de la conjoncture, mais par essence. Il ne pouvait en être autrement, clamait-on : le fascisme avait besoin d’être en mouvement, en progrès constant pour se maintenir ; s’il stagnait, il mourait. Le but de la guerre, soutenait Le Droit de Vivre dès 1933, constituait la ligne de force du régime, mais avant de l’atteindre, il fallait « créer l’exutoire susceptible de donner une autre animation aux masses, qui leur est nécessaire. Là, l’antisémitisme apparaît comme étant un terrain particulièrement favorable53 ». Une instrumentalisation de la question juive était ainsi susceptible de survenir ; en cela, la LICA défendait la même position que celle de certains antifascistes italiens estimant qu’avec le fascisme, l’on ne pouvait en rien présager de l’avenir, tel Camillo Berneri qui, en 1935, écrivait de Buenos Aires que « si l’antisémitisme devenait nécessaire aux buts du fascisme italien, Mussolini, pire que Machiavel, suivrait Gobineau, Chamberlain et Woltmann et parlerait, lui aussi, de race pure54 ». Les modérés qui critiquaient cette thèse lui opposaient plusieurs attaques et arguments : Amarti, collaborateur à la revue Samedi dont les colonnes décochaient régulièrement leurs flèches contre la LICA, soutenait ainsi que le lien entre fascisme et antisémitisme pouvait apparaître comme un des ressorts de la propagande d’extrême gauche ; « Avez-vous remarqué, écrivait-il 132[…] que nos maladroits marxistes attaquent le fascisme en faisant croire au monde que tous les fascistes sont antisémites ? N’en déplaise à ces messieurs, j’aime mieux vivre à Rome qu’à Moscou55 ». L’on aurait pu arguer de la participation des Israélites aux gouvernement et institutions fascistes, mais cela relevait plus de la politique du fascisme que de sa véritable nature. Pour contrer leurs adversaires sur le même terrain, les modérés faisaient appel, autant que faire se pouvait, à la théorie même du fascisme et s’appuyaient sur les écrits parus en France de théoriciens ou de vulgarisateurs du fascisme56. Désireux de poser le débat en termes différents et de prendre un recul historique par rapport à celui-ci, Alfred Berl rappelait, en prenant l’exemple de l’histoire italienne, que « les partis d’avant-garde n’offrent pas au judaïsme des garanties plus sûres que les partis modérés », en ajoutant que « dans l’émancipation du judaïsme italien, ce sont les conservateurs libéraux qui ont la part prépondérante57 ». Il était donc possible de penser que le fascisme ne ferait que suivre la tradition amorcée par les plus conservateurs des Italiens. Mais la force de la contre-attaque ne suffisait pas à invalider les arguments de la LICA.
Il se révélait donc bien difficile de cerner les origines, et encore plus la nature du fascisme. Très rapidement, le débat sur l’essence politique du fascisme dérivait sur la question juive sous la plume de certains. Mais il se trouvait d’autant plus ardu de cerner les rapports entre fascisme et judaïsme que les événements donnaient à la fois tort et raison aux deux camps qui s’opposaient, et ce jusqu’en 1938 : ceux qui concluaient à l’absence de liens entre fascisme et antisémitisme pouvaient s’appuyer sur les nombreuses manifestations philosémites du régime de Mussolini ; les défenseurs de la thèse inverse pouvaient quant à eux invoquer les traces d’antisémitisme dont le fascisme faisait montre. Cette ambivalence italienne, qui se retrouvait parfois dans le caractère flou des arguments agités en France, est essentielle pour comprendre les réactions suscitées par 133la politique transalpine durant l’entre-deux-guerres. Les rapports entre le fascisme et la question juive constituent ainsi une question structurant l’opinion juive tout autant qu’un point d’achoppement dans l’analyse de la nature du fascisme formulée par les Juifs. Pour aller plus loin et dépasser la difficulté, il fallait répondre à une double question : comment les Italiens, peuple philosémite, avaient-ils accueilli le fascisme ? Quelle attitude les Israélites transalpins avaient-ils adoptée à l’égard du nouveau régime ? Ce questionnement apportait néanmoins autant de réponses que de divisions.
Les débats sur le consensus autour du régime
« Ceux qui ne sont pas fascistes sont mussoliniens » ?
Que signifie cette fête ? Est-ce Rome qui acclame le fascisme, ou les fascistes, conquérants de Rome, qui se glorifient eux-mêmes, entre eux ? Me voici soudain heurté à cette énigme que posent inévitablement les régimes dictatoriaux et que les dictateurs les plus sagaces sont incapables de résoudre : ils ne savent pas, ils ne sauront jamais ce qui est pensé dans ces masses qu’ils obligent au silence58.
C’est en ces termes que Daniel Halévy décrivait son incertitude relativement au sentiment des Italiens face au régime, question cruciale très discutée par les contemporains et non résolue par les historiens. D’autant que les interprétations évoluèrent : dans les années 1950, Luigi Salvatorelli et Giovanni Mira avançaient l’idée d’un consensus amorphe, atone, autour du régime59, tandis que vingt ans plus tard, Renzo De Felice évoquait, pour la période allant de 1929 à 1936, « les années du consensus60 ». Selon les options politiques, les professions, les couches sociales, les régions, l’attitude face au régime divergeait.
En règle générale, les observateurs juifs défendaient des valeurs aux antipodes de celles qui façonnaient le fascisme. Ils espéraient que le régime italien constituât une brève tranche de l’histoire transalpine, une parenthèse bientôt refermée. Tous n’avaient cependant pas la même 134perception du consensus populaire : les uns étaient amers et décelaient un solide ancrage du fascisme, les autres montraient plus d’optimisme. Revenait souvent sous leur plume le fait que le régime de Mussolini s’appuyait grandement sur la bourgeoisie, qui l’avait mené au pouvoir, et sur les classes moyennes, qu’il avait sorties de leur torpeur61 ; dans les villes, il assurait l’ascension sociale de ces dernières grâce à la fonction publique, et dans les campagnes, il gagnait les Italiens à sa cause par un discours ruraliste et de grandes réalisations. Les ouvriers, plus tard touchés de plein fouet par la crise des années 1930, paraissaient plus rétifs. Les Israélites français remarquaient ainsi que l’un des principaux succès du fascisme était d’avoir réussi à unifier l’ensemble des classes moyennes et de la bourgeoisie, jadis dispersées, au sein d’une véritable nation mue par un idéal commun. Benjamin Crémieux parlait ainsi d’une « fusion de tous les éléments constitutifs de l’Italie qui vivaient d’une vie jusque-là distincte62 ». Les nouvelles structures mises en place contribuaient d’ailleurs à cette fusion, désormais géographiquement visible : « L’Italie s’est centralisée », constatait Daniel Halévy63. Mais le développement du sentiment national avait pour corollaire, d’une part de renfermer sur eux-mêmes les Italiens devenus « un peuple qui veut désormais tout faire da sè64 », d’autre part, comme par gratitude, de renforcer l’adhésion d’une importante fraction au régime. Élie Halévy exprimait cette impression en une phrase éloquente : « Ceux qui ne sont pas fascistes, sont mussoliniens65 ». Frédéric Roche, du Droit de Vivre, évoquait cet aspect par une anecdote ; il avait parcouru toute l’Italie, en 1936, moment où le consensus autour du régime était le plus fort, et finit par trouver un Italien pour lui déclarer : « Je ne suis pas fasciste ». Le Français ne dissimulait pas sa joie :
Je faillis lui sauter au cou. Un chasseur américain, collectionneur de cornes de moutons sauvages, m’avait raconté être allé tout spécialement à New York, jusque sur les hauts-plateaux du Tibet pour trouver un mouton d’une espèce rare, orné de cornes d’une forme absolument unique. J’imagine que lorsqu’après trois mois de caravane, il vit l’animal au bout de son fusil, il ne fut pas plus heureux que je ne le fus, ce soir-là66.
135Quelle ne fut pas la déception de Roche lorsque, allant plus avant, l’ouvrier italien lui dit qu’il entendait par là qu’il n’était pas inscrit au parti fasciste, mais qu’il approuvait en tous points les réalisations de Mussolini. L’on reconnaissait cependant que le consensus marquait plus les bourgeois que les classes moins favorisées : « Tous les bourgeois sont épanouis. […] Le bas peuple fermente sans doute : mais dans quels coins67 ? ». Idée également développée par Le Droit de Vivre qui attirait l’attention sur le maintien de la vie mondaine en Italie : les populations aisées et étrangères ne paraissaient pas touchées par les restrictions ; seules les classes les moins élevées subissaient le poids des mesures de contrition mais, ajoutait-on, elles s’habituaient à leur malheur68.
Autant dire que l’atmosphère n’était pas à la contestation. Comment avait-on pu aboutir à pareille situation ? Outre la répression, par un embrigadement – et même une infantilisation du peuple –, répondait-on de manière unanime, processus voulu par le régime qui mit en place des institutions ad hoc. À partir de mai 1933 par exemple, nul ne pouvait accéder à l’administration sans être muni de la tessera, surnommée par les plus sceptiques et désabusés des Italiens « tessera del pane » ; il s’agissait de la carte du Parti national fasciste (PNF) dont l’acronyme était décliné en « Per necessità familiale ». Certains ralliaient ainsi le régime par opportunisme, mais leur silence gonflait le consensus. En adhérent massivement aux structures mises en place par l’État, pour les enfants l’Opera nazionale Ballila, ou, destiné aux adultes, l’Opera nazionale Dopolavoro, chargé des loisirs, les Italiens se familiarisaient avec les grands thèmes de propagande fasciste et lui apportaient souvent sincèrement leur soutien. En octobre 1936, Le Droit de Vivre, décrivant cette situation, titrait : « Un Italien n’est jamais majeur » ; il notait comment l’État avait réussi à s’insinuer dans les moindres recoins de la vie privée : « Un être humain forme un tout indivisible. L’homme mis en tutelle pour tout ce qui concerne la politique, l’intelligence et le travail doit l’être aussi quant aux mœurs. Ayant commencé, dans les affaires importantes, à traiter les Italiens comme des enfants qui n’atteindront jamais leur majorité, Mussolini 136devait nécessairement être amené à réglementer leur vie jusque dans le plus infime détail69 ». Et, ajoutait Frédéric Roche, Mussolini avait réussi à modifier la nature profonde de l’Italien : « de même qu’il est parvenu à faire d’un peuple libre un peuple d’esclaves, d’un peuple joyeux un peuple triste, le régime fasciste est parvenu à contraindre la nature méridionale70 », en réprimant les passions et le désir au profit de l’austérité, entre autres. Ces analyses subsumaient de manière frappante les éléments esquissant l’« homme nouveau » que voulait façonner le fascisme71. En observant l’attitude du peuple italien, les Français en apprenaient davantage sur la nature du régime. Prenant acte de cet enrégimentement total de la société italienne, Julien Benda, avec une grande lucidité, soulignait que « le “faisceau” de toutes [les] classes » réunies constituait en fait une « nation “totalitaire”72 » ; il pressentait le caractère inédit du régime fasciste.
Mais certaines plumes venaient cependant nuancer ces jugements et refusaient de croire que l’Italien s’était abandonné tout entier à un régime autoritaire : elles insistaient donc sur un seul des aspects du consensus, la nécessité professionnelle ou familiale que représentait l’adhésion au régime. Daniel Halévy s’interrogeait de cette manière : « Quant aux masses, quelle est leur attitude ? s’abandonnent-elles à l’opérateur ? C’est douteux. Elles se laissent arracher des acclamations, des cris, mais résistent à l’expropriation73 ». Certes, le régime flattait l’honneur national sur le plan extérieur mais, dans le pays, la lassitude que provoquait la monotonie de la vie quotidienne entraînerait une forme de désaffection. Dans ses mémoires, Philippe Erlanger allait plus loin : à ses yeux, le peuple n’avait fait que jouer une comédie ; jamais l’esprit du fascisme ne l’avait pénétré en profondeur :
Je revois les villes enchantées où la douceur de vivre était telle que les parades agressives des hommes en chemise noire et le lyrisme belliqueux du dictateur ne semblaient pas avoir de signification. On en souriait. Les Italiens n’avaient jamais été dupes de rien. Pouvaient-ils l’être de la mythomanie fasciste74 ?
137Erreur d’appréciation ? Jugement tronqué ? Manque de recul pour Halévy ? Déformation a posteriori pour Erlanger ? Il est difficile de trancher. Toujours était-il que, pris d’admiration pour l’Italie et les Italiens, beaucoup refusaient de croire que ceux-ci avaient pu se laisser si facilement abandonner à la dictature, à l’uniformisation. Les Italiens semblaient en constante représentation. Il arrivait que l’on poussât plus loin ce raisonnement et imputât l’absence d’adhésion sincère au régime au caractère même de l’Italien : celui-ci demeurait un esprit libre en dépit d’un comportement qui ne le laissait cependant pas apparaître. Afin d’illustrer la nature de l’Italien viscéralement hostile à la dictature, on l’opposait souvent à l’âme docile de l’Allemand, régi après 1933 par un régime de même nature que le fascisme. Emil Ludwig, lui-même originaire d’outre-Rhin et très écouté parmi les Israélites français le notait sans détour : l’Allemand préférait s’en remettre à un « Führer », tandis que l’Italien semblait plus libre de sa pensée75. Jean-Richard Bloch ne pensait pas différemment et écrivait des Allemands : « ce peuple délire, à la voix de son Führer, comme jamais les Italiens eux-mêmes (surtout aux débuts du fascisme) n’ont déliré, à la voix de leur Duce76 ». Si les Transalpins gardaient le silence, la raison provenait de ce que le régime protégeait leurs intérêts mais cela n’était aucunement définitif ; sitôt que monterait la contestation, les Italiens lui donneraient un écho grondant. André Maurois soulignait également le caractère contingent de l’attitude des Italiens ; c’est que, pensait-il, ceux-ci constataient que le régime était synonyme de paix civile et opposaient la période de tranquillité fasciste au désordre généralisé qui avait prévalu durant le biennio rosso pré-fasciste :
Il suffit d’avoir vu l’Italie de Nitti, l’anarchie dans les rues, le vol organisé, la sauvagerie des tricoteuses de Milan, ce jeune homme accroché au pont de Florence et de qui les émeutiers coupèrent les poignets. Voilà ce qu’il ne faut pas oublier quand on s’étonne de voir le peuple italien supporter les violences fascistes. Le sophisme consiste à juger les actions des temps de crise en négligeant l’état de crise77.
Et les Juifs transalpins ? Quel accueil avaient-ils réservé au fascisme ? S’étaient-ils comportés comme une minorité présentant des traits 138communs ? Avaient-il réagi sans lien avec leur appartenance religieuse, comme des Italiens tout simplement ?
Les Juifs italiens face au fascisme
En 1927, L’Univers Israélite publiait une déclaration faite à la presse par le grand-rabbin de Rome Angelo Sacerdoti, où il affirmait :
La grande majorité de nos coreligionnaires soutient avec enthousiasme l’œuvre de Mussolini pour la restauration nationale. Le nombre de Juifs qui sont membres du parti fasciste est grand. Le fascisme choisit toujours pour des postes importants des hommes, selon leurs capacités individuelles et non selon leur religion78.
Un nombre écrasant de Juifs français reprenaient ces éléments à leur compte pour donner à voir l’enthousiasme qu’avait suscité le fascisme parmi leurs coreligionnaires italiens. Les chiffres établis par Renzo De Felice permettent de saisir dans la nuance l’évolution des adhésions juives au parti de Mussolini79 :
|
Inscrits avant la Marche sur Rome |
739 |
|
Inscrits d’octobre 1922 à octobre 1928 |
1 770 |
|
Inscrits d’octobre 1928 à octobre 1933 |
4 819 |
|
Inscrits après octobre 1933 |
2 505 |
|
Inscrits à une date inconnue |
292 |
|
Total des inscrits |
10 125 |
|
Total des non inscrits |
22 161 |
C’étaient donc environ 20 à 25 % de la judaïcité italienne qui possédaient la tessera. En valeur absolue, cela ne représentait qu’un faible nombre, mais l’on comprend la force de ce chiffre lorsqu’on se souvient que seuls 6 % de l’ensemble de la population italienne étaient inscrits au parti80.
On le voit, certains n’avaient pas attendu l’installation du fascisme au pouvoir pour se rallier à lui ; nombre de Juifs comptaient parmi les fascistes de la première heure. L’on évoquait parmi les observateurs français le souvenir de Gino Bolaffi, jeune étudiant de Settignano, près de Florence, 139mort en 1920 aux côtés des fascistes – il faisait à ce titre officiellement partie du « martyrologe fasciste » –, et auquel un hommage public fut rendu en 193481, l’occasion pour L’Univers Israélite de rappeler que parmi les Juifs fascistes figuraient même des religieux : « Les dirigeants du parti florentin ont assisté à la cérémonie. La communauté israélite y était représentée par trois de ses membres – dont le hazan82 – qui portaient des chemises noires83 ». Mais ce fut après la Marche sur Rome que les Israélites rejoignirent le PNF en masse ; comme pour le reste des Italiens, il se révèle néanmoins malaisé de distinguer ceux qui le faisaient par conviction de ceux qui obéissaient à l’intérêt. Le progressiste Pierre Paraf s’interrogeait sur les motivations de ses coreligionnaires : « Les jeunes Juifs de leur côté adhérèrent aux organisations fascistes en assez grand nombre… Opportunisme, désir de nouveauté ou conviction sincère ? Nous nous excusons de poser la question et nous nous abstiendrons d’y répondre84 ». Une chose était sûre en tout cas : l’image que donnait le fascisme, en accueillant des enfants d’Israël aux plus hauts rangs, ne pouvait qu’inciter les Juifs à y adhérer, du moins à ne pas s’en défier, vision défendue par les observateurs français. La presse juive française, conservatrice et modérée, n’épargnait à ses lecteurs aucune nomination, promotion ou commémoration témoignant de la bienveillance du fascisme à l’égard des Israélites. On ne comptait plus les mentions relatives à l’accession de Juifs italiens à des fonctions prestigieuses, décisives ou honorifiques, et il serait impossible de les citer de manière exhaustive. Plusieurs noms apparaissaient régulièrement, comme celui d’Angelo Sacerdoti, grand-rabbin de Rome qui entretenait une relation étroite avec le Duce85, de Luigi Luzzatti, ancien premier ministre régulièrement consulté par les plus hauts sommets de l’État86, ou encore de Margherita Sarfatti, influente compagne de Mussolini pendant les années dix et vingt, qui joua un grand rôle culturel à la tête du journal Gerarchia jusqu’au début des années 193087. L’Univers Israélite la qualifiait sobrement 140de « collaboratrice du Premier italien, M. Mussolini » et rappelait en 1926 qu’elle avait reçu une médaille d’or en hommage à son fils tombé au champ d’honneur88. La présence de tant d’Israélites aux plus hautes instances du fascisme prouvait que judéité et adhésion au régime ne s’excluaient nullement. Loin s’en fallait. Elles étaient bien loin, les déclarations de la fin du xixe siècle dans lesquelles les Juifs italiens voyaient dans le libéralisme l’autre nom du judaïsme89. Et le fascisme ne faisait pas office de pis-aller. Bien qu’il ne représentât pas une vaste tendance, Waldemar-George allait jusqu’à soutenir que seul le fascisme permettait de concilier identité juive et intégration politique, car la structure corporatiste de la société fasciste n’obligeait nullement Israël à la fusion avec quelque autre corps : « Les Juifs collaborent à l’œuvre de l’Italie fasciste, et se sentent italiens sans cesser de se sentir Juifs90 ». Certes, le nombre d’inscrits après 1933 diminua : l’on enregistra 2 505 nouvelles adhésions au PNF après 1933, contre 4 819 depuis 1928. Mais cela était compensé par la radicalisation fasciste de certains Juifs, désireux de clamer haut et fort leur loyauté au moment où les langues antisémites commençaient à se délier. C’est ainsi qu’à Turin, Ettore Ovazza, fasciste de la première période, créa, en 1934, le journal La Nostra Bandiera, qui se voulait l’organe des anciens combattants et fascistes juifs ; il adoptait un discours radical, à la fois hostile à l’antisémitisme et au sionisme, jugé incompatible avec le nationalisme fasciste91. Plus que jamais, semblait-il, il fallait clairement montrer de quel côté inclinaient les Juifs.
Peut-être ces éléments expliquaient-ils en partie pourquoi les allusions aux Juifs antifascistes ne se signalaient guère par leur abondance parmi 141les Israélites français. Pierre Paraf remarquait simplement que « l’hostilité des nombreux Israélites, victimes du Fascisme, s’oppose au conformisme des premiers92 », ceux qui avaient adhéré au mouvement. Étonnamment, quand Le Droit de Vivre, organe de l’antifascisme, s’intéressait aux opposants à Mussolini, il évoquait bien plus de non Juifs que d’enfants d’Israël93. De fait, comme l’a montré Éric Vial, l’émigration antifasciste comptait un certain nombre de Juifs, mais leur identité n’influait guère dans leur engagement, ce qui rendait l’identification et l’estimation de leur nombre malaisée94. Ils combattaient avant tout sous la bannière politique, non religieuse, ce qui se comprenait, du fait que la question juive ne se posa véritablement qu’au milieu des années 1930 en Italie. À cela s’ajoutait l’idée, fort diffuse parmi les opposants à Mussolini, que les Juifs avaient pris fait et cause pour le fascisme auquel ils apportaient un soutien actif, si bien que les Israélites s’étant engagés tardivement dans le combat contre le régime le faisaient, selon leurs détracteurs, de manière tout sauf désintéressée95.
Les liens entre judéité et antifascisme furent abordés par L’Univers Israélite à l’occasion de la sortie de l’ouvrage de Curzio Malaparte, La Technique du Coup d’État, en 1931. Ce livre conduisait en effet à se poser une question de fond : la judéité plaçait-elle du côté de la révolution ou de celui de la réaction ? Les réponses des Israélites français oscillaient selon qu’on taxait le fascisme de révolutionnaire ou de réactionnaire. M. Lotar rappelait ainsi l’action d’Israël Zangwill, célèbre membre de l’Union of democratic Control, qui, du fait qu’il était anglais, ne craignait pas les représailles et ne dissimulait pas son opposition aux fascistes, révolutionnaires en tous points selon lui. En voyage en Italie en 1922, il refusa de montrer ses papiers d’identité à des chemises noires, parce qu’il leur déniait toute légitimité96. Une telle vision ne faisait pas l’unanimité car, pensait-on, les Juifs, plutôt conservateurs et modérés dans l’ensemble, auraient donc dû être plus nombreux à s’opposer au fascisme, ce qui était loin de se vérifier. C’est que, affirmaient les tenants d’une thèse oppo142sée, le fascisme étant un mouvement réactionnaire protégeant l’intérêt des possédants – on retrouve là une terminologie typique de l’extrême gauche – les Juifs, plus particulièrement les bourgeois parmi eux, qui se trouvaient au sommet des instances communautaires, avaient réagi selon un réflexe de classe. Maurice Rajsfus le pensait et expliquait plus tard par les mêmes arguments que « les porte-parole de la bourgeoisie juive française regardaient le fascisme mussolinien avec sympathie97 ». Le consensus d’une vaste frange de l’opinion juive italienne – et française peut-on ajouter – face à l’entreprise fasciste paraissait clair.
Comment expliquer toutefois la sous-estimation de l’antifascisme israélite par les observateurs français ? La répression que faisait régner l’OVRA (Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell’antifascismo) dans la péninsule incitait au silence, ce qui ouvrait sur un manque d’information de ce côté des Alpes. Profondément sécularisés, laïcisés et assimilés, les Israélites italiens qui combattaient Mussolini n’estimaient pas nécessaire de faire état de leur appartenance confessionnelle, parfois traduite par leur seul patronyme, pas plus que les organes de répression d’ailleurs98. Aussi la prudence était-elle de mise : quand, dans les premières années du régime, plusieurs Juifs signèrent le Manifeste des intellectuels lancé par Benedetto Croce, l’on aurait pu penser qu’ils représentaient une tendance générale parmi leurs coreligionnaires. Or, comme le remarque Marie-Anne Matard-Bonucci, « leur engagement était moins vécu comme celui d’intellectuels juifs que comme le geste de citoyens épris de liberté99 ». Il fallut attendre en France 1932 pour que la presse juive fît clairement état de l’existence des Juifs antifascistes. L’Univers Israélite ne cacha pas leur judéité : « Onze professeurs d’Universités ont préféré renoncer à leurs fonctions plutôt que de prêter serment de fidélité au régime fasciste. Parmi eux, il y a trois juifs100 ». Le journal n’allait tout de même pas jusqu’à affirmer que la judéité de ces illustres personnages était la cause de leur antifascisme ; il livrait cette information à ses lecteurs sans commentaire et estimait sans doute qu’il 143s’agissait là d’exceptions. En fait, il n’y avait pas beaucoup plus de Juifs fascistes qu’antifascistes101 – actifs ou silencieux – mais, en France, les Juifs ne voyaient que les premiers.
Mis à part les plus progressistes, les Israélites français considéraient le fascisme de manière assez neutre, une neutralité bienveillante quelquefois, qui ne tournait toutefois jamais à l’admiration. L’idée selon laquelle il s’avérait délicat de par trop critiquer un régime qui ne donnait pas de traces d’antisémitisme connaissait une heureuse fortune. À cela s’ajoutait que les Juifs italiens avaient fait bon accueil au régime des faisceaux. Autant de raisons qui incitaient la majorité à rester prudente, jusqu’en 1938. Cette neutralité d’apparence volait cependant en éclat pour tous dès qu’il s’agissait du père du fascisme, Mussolini. Là, les considérations politiques le cédaient aux réactions épidermiques.
Images contrastées de Mussolini
Quiconque voulait à l’époque reconstituer un portrait fidèle, ou du moins complet, de Mussolini n’aurait pu s’en tenir aux organes de l’opinion juive qui ne dépeignaient le Duce que sous certains traits les plus marquants et significatifs, ce qui n’offrait qu’une vision partielle du personnage. Mussolini ne les laissait pas indifférents et suscitait en eux louanges ou diatribes.
Le maître de l’Italie
Dans l’entre-deux-guerres et même après, le genre biographique portait souvent l’idée que certains hommes étaient promis à leur destin dès leur plus jeune âge, par leur filiation, leur caractère ou leur action. Mussolini s’inscrivait pleinement dans ce type de représentations, à une époque où l’exercice du portrait historique connaissait de belles heures. Qu’il les séduisît ou les repoussât, Mussolini semblait aux yeux des Israélites français concentrer toutes les caractéristiques d’un chef d’État charismatique. Dans l’ensemble, ils ne s’intéressaient pas, ou très peu, au Mussolini d’avant le fascisme.
144Objet de toutes les considérations, le côté autoritaire du chef fasciste. L’on présentait avant tout Mussolini comme un dictateur aux antipodes de l’idéal du grand homme, représentant des Lumières et de la démocratie, que célébraient les Juifs de France. Mussolini semblait pourtant dépositaire d’une autorité reconnue par le peuple ; il était « le maître absolu de l’Italie102 ». Il détenait un pouvoir mystifié par le véritable culte de la personnalité qu’avait instauré le fascisme en Italie. Progressistes et modérés ne manquaient pas de relever les grands traits de cette adoration de Mussolini ; Le Droit de Vivre intitula l’un de ses portraits du Duce : « Mussolini ha sempre ragione103 ». Cela semblait découler de la nature même du régime qui célébrait le primait du chef. Dès l’enfance, précisait Daniel Halévy, l’on inculquait aux petits Italiens la vénération de Mussolini : « Credere, obbedire, combattere : cette formule catéchistique est en usage à l’école de haute culture, de mystique fasciste, qui fonctionne à Milan. Credere, à quoi ? au Duce ? “Notre Duce a toujours raison”, cela s’enseigne aux petits Ballilas104 ». Pour qualifier le premier des Italiens, le terme de « tyran » revenait de manière récurrente. Certains l’employaient dans son acception courante et en faisaient le synonyme de « dictateur », dans le sens où la LICA parlait de « Benito le Père Fouettard105 ». D’autres, sémantiquement plus rigoureux, l’utilisaient au contraire dans son sens exact d’homme détenant un pouvoir suprême acquis par la force avec le soutien d’une partie du peuple. Les intellectuels se montraient les plus précis, comme Daniel Halévy qui levait toute ambiguïté sur la question : « Tyran. J’écris le mot sans le prendre en mauvaise part, et comme la vérité veut qu’on l’emploie. Il y a eu Denys de Syracuse, Laurent de Médicis, et il y a Mussolini106 ». Benjamin Crémieux, de la même manière, pensait que la tradition du tyran s’inscrivait dans la mythologie italienne du héros qui doit triompher du peuple et le guide, idée déjà soutenue par Dante, Pétrarque, Alfieri, Carducci ou Malaparte : « Tout héros italien prend par nécessité figure de tyran107 ».
Mais Mussolini était bien entendu plus qu’un tyran traditionnel : il appartenait à un type nouveau de dictateurs. L’on entreprit de dresser un parallèle entre Mussolini et les hommes forts de son temps, exercice 145périlleux auquel seul un faible nombre s’adonnaient. Des observateurs entrevoyaient une parenté entre les différents chefs de régimes nouveaux – totalitaires si tant est que l’Italie en fût108 et bien que le terme ne s’employât alors que très peu. On observait dès lors une analogie dans les attitudes et la manière de régir la société dans différents pays, le tout s’avérant inédit. Dans son livre Les Dirigeants de l’Europe, Emil Ludwig classait les « grands » hommes de son temps en trois catégories : Briand, Masaryck et Rathenau étaient les « serviteurs du peuple », Lloyd Gorge et Venizelos des « opportunistes » tandis que Mussolini, en compagnie de Staline, appartenait au camp des « dominateurs du peuple109 » – on s’étonne de l’absence d’Hitler. Ces derniers semblaient partager une vision commune du monde et de la société ; ils étaient de ce genre nouveau de dictateurs mégalomanes qui pour asseoir leur pouvoir à l’intérieur de leurs frontières manifestaient des appétits de conquête démesurés, ce qui n’échappait pas à Raymond Aron, qui se souvenait : « Hitler, Mussolini et Staline pensent tous trois, chacun à sa manière : politique d’abord. […] Un budget de défense qui absorbe 15% du produit national ne laisse pas de doute sur l’ordre des priorités110 ». À Mussolini était cependant attribué un caractère particulier : pour les plus modérés, il ne semblait pas tout à fait un dictateur sanguinaire, image qui marqua d’ailleurs une vaste partie de ses contemporains et de ses descendants. L’historien Didier Musiedlak note ainsi que « parmi les dictateurs du xxe siècle, Mussolini représente une forme d’anomalie. Nul ne contesterait à Hitler, Staline, Franco ou Salazar leur qualité. À l’inverse, lorsqu’on aborde Mussolini, l’image semble se brouiller111 ». Nombre d’Israélites français d’alors constituaient l’exemple parfait d’un tel phénomène.
Un facteur aide à la compréhension : si l’on distinguait à ce point Mussolini de ses pairs, c’était parce qu’il parvenait, dans ce qui apparaissait comme une véritable comédie du pouvoir, à donner plusieurs images de lui-même et par là, à handicaper le jugement.
146Mussolini ou la comédie du pouvoir
« Point de doute, nous venons d’assister à une comédie, jouée avec style, mais un style un peu trop marqué pour le public qui était là112 ». Le Duce semblait en représentation permanente. Impression confirmée par Emil Ludwig : « Je lui connais deux tons différents113 ». Mussolini semblait revêtir les traits du caméléon, qui peut changer de peau quand bon lui semble. L’image que se donnait le Duce changeait simultanément et évolua dans le temps, ce qui, dès l’époque, n’échappa à personne114. Les Israélites français percevaient nettement les diverses facettes du personnage. Avaient-ils lu la traduction française du livre intitulé Dux, écrit par la compagne juive de Mussolini, Margherita Sarfatti ? Le Duce n’y cachait pas son amour de la représentation : « La pensée que je ne m’appartiens plus, la sensation d’appartenir au contraire à tous, et d’être si aimé et si haï, un élément essentiel de la vie d’autrui, cette pensée me devient une sorte d’ivresse ou d’incantation », écrivait-il en préface115. Cela semblait la profession de foi d’un véritable comédien. André Suarès, qui exécrait le Duce, notait que celui-ci avait d’ailleurs le physique d’un comédien ; mais sous sa plume, Mussolini devenait en fait le dernier des histrions ; ses traits extérieurs semblaient empreints de « bouffonnerie116 ». Comme Suarès, de nombreux Israélites s’attardaient sur l’apparence physique de Mussolini, laquelle suscitait d’ailleurs souvent les sarcasmes. Ainsi, l’expression « relever le menton comme Mussolini117 » commençait à passer dans le langage courant et désignait l’attitude de qui voulait se donner un air autoritaire et majestueux de manière si outrancière que cela en devenait ridicule. Il était fréquent qu’en public, devant les foules italiennes, Mussolini adoptât cette posture figée ; Philippe Erlanger s’en souvenait : « Je revois le dictateur, les poings sur les hanches, le menton pointé vers le ciel, jetant à une foule hystérique ses phrases d’imperator118 ». D’autres se montraient plus incisifs car tourner le Duce en ridicule pouvait marquer les esprits et permettait 147de s’opposer à ceux qui, en France, l’admiraient et s’exclamaient : « Ah ! si nous avions un Mussolini119 ! ». Selon Le Droit de Vivre, les sectateurs français du fascisme italien et de son chef étaient des bourgeois situés à droite ou à l’extrême droite de l’échiquier politique ; il fallait leur montrer que Mussolini n’était autre qu’un « César de Carnaval », selon l’expression du socialiste Paul-Boncour120. Tenir une telle position, même à la fin des années 1930, se révélait malaisé, car quiconque critiquait le Duce se voyait taxer de bolchevisme, ressentait la LICA ; cela conférait un pouvoir supplémentaire à la dérision. Le Droit de Vivre moquait ainsi Mussolini tel que le représentaient les actualités :
Ce Duce qui s’exhibe à moitié nu sur l’écran, grotesque, le ventre en avant comme un faux Bouddha, le poing sur la hanche, l’air crâneur, la poitrine tétonnière et poilue, ce fils de la Louve et d’un charpentier de la Romagne, cet ex-socialiste révolutionnaire converti au culte de la force et qui, rentré le soir chez lui, court voir s’il a bien suivi les conseils de Machiavel et s’il a bien digéré les Réflexions sur la violence de Georges Sorel, mais c’est un grand homme. Et ne dites pas le contraire, autrement quoi vous êtes un bolchevick, un suppôt de Staline, un ennemi de l’ordre, de la paix, de la santé, des sports d’hiver, du cinéma, du théâtre et de la Comedia dell’Arte121.
La propagande fasciste faisant son œuvre, les Français pouvaient obtenir des entrevues avec Mussolini – comme ce fut le cas pour Waldemar-George, Philippe Erlanger, André Maurois et d’autres – au cours desquelles le chef fasciste faisait montre de bienveillance, ce qui invalidait aux yeux de quelques-uns les portraits acerbes tels que ceux dépeints par la LICA. Certains avaient ainsi pu entrer en contact avec celui que l’on connaissait d’ordinaire par l’intermédiaire des ondes ou du grand écran. Là, Mussolini se montrait chaleureux, policé, attentif et se donnait l’allure d’un sage lettré et rassurant : « Je le revois en son bureau du Palais de Venise après sa découverte de Corneille, s’identifiant au Vieil Horace », se rappelait Erlanger122. De même, André Maurois notait : « Je crois voir encore cette longue galerie, cette petite table, et l’homme à la forte mâchoire qui me parla de la Divine Comédie123 ». Certes, comme beaucoup d’autres observateurs, les Juifs qui s’entretenaient avec Mussolini remarquaient qu’il faisait preuve d’une bien plus grande amabilité avec 148les étrangers et qu’il se donnait une image bien différente de celle qu’il se façonnait dans son pays : « Avec les étrangers, [son] regard n’est pas le moins du monde sévère ; il en est peut-être autrement avec ses quarante-deux millions d’Italiens124 ». Le grand admirateur du Duce qu’était Waldemar-George en célébrait la figure protéiforme :
Un tribun doit être un artiste. Son image physique doit être le symbole visible de sa pensée. Il faut qu’il sache exploiter les effets, les graduer, les varier suivant les circonstances et suivant le climat de son auditoire. Mussolini tient un tout autre langage selon qu’il parle au Sénat, au Congrès du Parti, ou sur la Place de Venise. Le Duce, qui adopte avec ses visiteurs, tout particulièrement avec les intellectuels, une attitude empreinte de familiarité, paraît en public solennel et altier, revêtu du brillant uniforme de général de la milice fasciste. Il se meut comme un grand tragédien125.
Des développements fréquents étaient également consacrés aux relations que Mussolini entretenait avec les femmes, lesquelles semblaient dévoiler sa vraie nature et lever le masque du Duce.
La variété des postures adoptées par Mussolini, qui renvoyaient autant d’images différentes d’un seul et même personnage, brouillait les cartes et expliquait que le chef du fascisme jouît d’une réputation favorable auprès d’une grande partie de l’opinion européenne, tous bords confondus parfois. D’aucuns, sans souhaiter l’instauration d’un régime copié sur celui de l’Italie, appelaient de leurs vœux à en adopter certains traits qui avaient porté leurs fruits. Qu’on songe aux « fascistes » français convaincus, que l’on rencontrera plus loin, ou à Churchill lui-même qui se montrait favorablement disposé à l’égard de son homologue italien ; se joignaient à lui, entre une série d’exemples, les écrivains Kipling ou Bernard Shaw. Il n’en allait pas différemment de Ford ou de Roosevelt lui-même aux États-Unis, où Mussolini faisait figure de véritable « héros américain126 », sans parler des pays d’Europe centrale ou orientale qui avaient instauré en leur sein des régimes largement inspirés du fascisme127. Dès lors, l’attitude des Juifs français ne devait pas étonner : si ce n’était pour la LICA, avant 1938, l’heure n’était pas à la diabolisation.
149Malgré ce qu’elles se plaisaient à affirmer, les langues se déliaient et de grandes tendances se dessinaient parmi les Israélites français qui, on le voit, accordaient une place non négligeable aux questions de politique extérieure. Un premier constat se dégage : aussi bien quantitativement que qualitativement, l’opinion juive, mobilisée par sa presse et ses intellectuels, se distinguait de l’opinion française générale. Quantitativement, elle comprenait moins de tendances : on ne trouvait pratiquement pas de véritables sectateurs du fascisme dans ses rangs, tout au plus certains individus séduits par l’expérience italienne mais qui, conscients du danger qu’elle recélait, témoignaient d’une admiration prudente et lointaine, ce qui plaçait l’axe central de cette opinion plutôt vers la gauche. Qualitativement, l’opinion israélite réagissait lentement aux événements extérieurs, surtout s’ils ne concernaient pas directement la question juive. Contrairement au cas courant, les Israélites détestaient plus Mussolini que le fascisme, car, s’ils n’entendaient pas critiquer en majorité le régime italien frontalement, ils étaient nombreux à nourrir une profonde antipathie pour un homme qui semblait incarner toutes les valeurs opposées à celles que véhiculaient la République, la démocratie – et le judaïsme. Second constat, qui découle du précédent : l’opinion juive avançait à plusieurs vitesses ; à côté d’une majorité somme toute consensuelle, celle des organes communautaires qui se faisaient la « voix » d’une importante part de la judaïcité, figuraient deux pôles actifs qui allaient nettement plus loin dans l’engagement, d’une part les intellectuels, qui s’exprimaient en leur nom propre, de l’autre la LICA, qui tentait, dans les années 1930, d’alarmer le reste des Israélites quant au danger italien. Cette multipolarité de l’opinion juive ouvrirait la voie à la division, au moment des choix décisifs.
1 Voir la profession de foi d’Émile Cahen, Archives Israélites, 5 juillet 1923.
2 Pierre Milza, L’Italie fasciste devant l’opinion française, 1920-1940, Paris, Armand Colin, 1967, p. 15-39.
3 Pascal Ory, Jean-François Sirinelli, Les Intellectuels en France de l’Affaire Dreyfus à nos jours, Paris, Armand Colin, 3e édition 2002, p. 10.
4 Outre les travaux pionniers de Pierre Birnbaum (en particulier Histoire politique des Juifs de France : entre universalisme et particularisme, Paris, Presses de la FNSP, 1990, publié sous sa direction), les recherches menées par des historiens israéliens et anglo-saxons ont fait progressé les questionnements sur ce sujet : voir entre autres, pour des mises au point théoriques, Alain Greilsammer, « Le Juif et la Cité : quatre approches théoriques », Archives des Sciences sociales des religions, no 46/1, juillet 1978, p. 135-151 ; Ezra Mendelsohn, On Modern Jewish Politics, Oxford, Oxford University Press, 1993.
5 C’est pour notre part ce que nous avons tenté de montrer dans : Jérémy Guedj, « Les Juifs de France, l’Italie fasciste et la “question juive”, 1922-1939 », Archives Juives, no 43/1, 1er semestre 2010, p. 114-125.
6 D’après le titre de l’ouvrage d’Ernst Nolte, Le Fascisme dans son époque, Paris, Julliard, 1963.
7 Les occupations des grandes terres latifundiaires, dans les campagnes, se généralisèrent, rassemblant près de 500 000 braccianti, ou travailleurs agricoles, qui, de la vallée du Pô au Mezzogiorno réclamèrent l’application de la réforme agraire promise par Salandra et Orlando, en 1915 et 1917. Situation identique à celle des villes où l’agitation gagnait du terrain, galvanisée par le rejet que suscitait l’augmentation du prix des denrées alimentaires. En 1919 et 1920, durant le « biennio rosso », des milliers de conflits sociaux éclatèrent, mobilisant presque deux millions de travailleurs. Philippe Foro, L’Italie fasciste, Paris, Armand Colin, 2006, p. 14 ; ainsi que l’ouvrage classique de Giuseppe Maione, Il biennio rosso. Autonomia e spontaneità operaia nel 1919-1920, Bologne, Il Mulino, 1975.
8 Benjamin Crémieux, L’Esprit des récentes élections italiennes et les grands courants politiques et sociaux, Paris, Comité national d’études politiques et sociales, 1921, p. 8.
9 Pierre Guillen, « La revue l’Europe nouvelle et l’établissement du régime fasciste en Italie », Recherches Régionales, no 187, juillet-septembre 2007, p. 41.
10 Cf. Ralph Schor, « L’Italie de 1920 devant l’opinion française », dans Enrico Decleva, Pierre Milza (a cura di), La Francia e l’Italia negli anni venti : tra politica e cultura, Milan, Franco Angeli, 1996, p. 15. Voir aussi Pierre Milza, op. cit., p. 18 sqq.
11 Meir Michaelis, Mussolini and the Jews. German-Italian Relations and the Jewish Question in Italy (1922-1945), Oxford, The Clarendon Press, 1978, p. 24.
12 Robert O. Paxton, Le Fascisme en action, Paris, Le Seuil, 2004, p. 22.
13 Se reporter à Bruno Goyet, « La “Marche sur Rome” : version originale sous-titrée. La réception du fascisme en France dans les années 1920 », dans Michel Dobry (dir.), Le Mythe de l’allergie française au fascisme, Paris, Albin Michel, 2003, p. 69 sqq.
14 Benjamin Crémieux, préface à Curzio Malaparte, L’Italie contre l’Europe, Paris, Félix Alcan, 1927, p. ii.
15 Sur l’influence des idées de Charles Maurras en Italie, cf. Pierre Guiral, « Charles Maurras et l’idée de races latines », dans Jean-Baptiste Duroselle, Enrico Serra (a cura di), Italia, Francia e Mediterraneo, Milan, Franco Angeli, 1990, p. 178-179 ; ainsi que Pierre Milza, « Le nationalisme italien vu par l’Action française (1911-1915) », dans Enrico Decleva, Pierre Milza (a cura di), Italia e Francia. I nazionalismi a confronto, Milan, Franco Angeli, 1993, p. 56-71. Une mise au point récente montre l’influence réelle des idées de Maurras en Italie, lesquelles ont imprégné les nationalistes italiens sans servir de soubassement à une matrice politique : Didier Musiedlak, « Charles Maurras et l’Italie : histoire d’une passion contrariée », dans Olivier Dard, Michel Grunewald (dir.), Charles Maurras et l’étranger, l’étranger et Charles Maurras, Berne, Peter Lang, 2009, p. 155-167. La thèse surestimant la marque du sorélisme dans le fascisme a été vivement critiquée : l’on avance en général une confusion dans l’esprit des observateurs entre le Mussolini d’avant 1914, admirateur de Sorel, et le Mussolini fasciste. Cf. Michel Charzat, « Georges Sorel et le fascisme : éléments d’explication d’une légende tenace », Mil neuf cent, no 1, 1983, p. 37-51. En 1978, l’historien israélien Zeev Sternhell défendit une thèse controversée selon laquelle les idées de l’extrême droite française, mêlées à celles d’autres familles politiques, de gauche notamment, furent à l’origine même du fascisme, ce qui revient à voir dans la France le berceau de ce mouvement et omet le poids des idées et du contexte italiens (La Droite révolutionnaire, 1885-1915 : les origines françaises du fascisme, Paris, Le Seuil, 1978).
16 Benjamin Crémieux, Essai sur l’évolution littéraire de l’Italie de 1870 à nos jours, Paris, Kra, 1928, p. 313-314.
17 Pour une vision générale de la filiation guerre-fascisme, Paul Corner, « La mémoire de la guerre et le fascisme italien », Vingtième Siècle, no 41, janvier-mars 1994, p. 60-66.
18 Michel Ostenc, Intellectuels italiens et fascisme, 1915-1929, Paris, Payot, 1983, p. 29.
19 Daniel Halévy, Courrier d’Europe, Paris, Grasset, 1933, p. 279.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 George L. Mosse, La Révolution fasciste, Paris, Le Seuil, 2003, p. 7 sqq.
23 Benjamin Crémieux, Essai sur l’évolution littéraire de l’Italie…, op. cit., p. 231. Nous soulignons.
24 Romain H. Rainero, « Gabriele d’Annunzio : il mito e i suoi limiti », dans Romain H. Rainero, Stefano B. Galli (a cura di), L’Italia e la « Grande Vigilia ». Gabriele d’Annunzio nella politica italiana prima del fascismo, Milan, Franco Angeli, 2007, p. 35 sqq.
25 Julien Benda, La Trahison des clercs, 1927, rééd. Paris, Le Livre de Poche, 1977, p. 216.
26 Ibid., p. 217.
27 Cf. Stéphane Mourlane, « De l’ultimatum à l’annexion : l’intervention italienne en Tripolitaine à travers la presse française (septembre-novembre 1911) », dans Romain H. Rainero (a cura di), Aspetti e problemi delle relazioni tra l’Italia e la Francia, Milan, Unicopli Cuesp, 2005, p. 131 ; ainsi que Pierre Milza, op. cit., p. 15.
28 Voir Daniel J. Grange, L’Italie et la Méditerranée (1896-1911) : les fondements d’une politique étrangère, Rome, École française de Rome, 1994, p. 965-975 ; et Jean-Pierre Darnis, « Le mythe de la Méditerranée dans le discours politique italien contemporain », Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, no 110-2, 1998, p. 805-932.
29 Sur ce point, voir en particulier Stefano B. Galli, « Il sentire politico di Gabriele d’Annunzio per una “grande” Italia : patriottismo, nazionalismo, interventismo », dans Romain H. Rainero, Stefano B. Galli (a cura di), op. cit., p. 67-97.
30 André Suarès, Présences, Paris, Émile-Paul Frères, 1926, p. 163-164.
31 Sur le rôle des classes moyennes dans la naissance du fascisme, voir Emilio Gentile, Fascismo : storia e interpretazione, Rome-Bari, Laterza, 2002, p. 12 sqq.
32 Pierre Milza, Mussolini, Paris, Fayard, 1997, p. 242-250 ; Romain H. Rainero, Stefano B. Galli (a cura di), op. cit.
33 Julien Benda, op. cit., p. 196.
34 Pour reprendre la classique distinction entre le « fascisme-mouvement », avant l’accession au pouvoir, avant tout courant d’opposition, et le « fascisme-régime », système politique d’un nouveau type. Cf. Renzo De Felice, Le interpretazioni del fascismo, Rome-Bari, Laterza, 1983.
35 C’est en cela que le fascisme dérivait du sorélisme, selon les défenseurs de la thèse « inspirationniste ».
36 Alfred Berl, « Fléchissement raciste », Paix et Droit, octobre 1932.
37 Benjamin Crémieux, op. cit., p. 300. Sur la violence fasciste, cf. Éric Vial, Guerres, société et mentalités : l’Italie au premier xxe siècle, Paris, Seli Arslan, 2003.
38 Gaston Raphaël, « Le socialisme-nationaliste en Bavière », Paix et Droit, mars 1923.
39 Benjamin Crémieux, préface à Curzio Malaparte, op. cit., p. x.
40 Élie Halévy, Lettre à Alain, de Florence, 1er janvier 1924, dans Correspondance, 1891-1937, textes réunis et présentés par Henriette Guy-Loë et annotés par Monique Canto-Sperber, Vincent Duclert et Henriette Guy-Loë, Paris, Éd. de Fallois, 1996, p. 666.
41 Id., Lettre à Xavier Léon, de Florence, 22 décembre 1923, dans Correspondance, op. cit., p. 665. Antonio Salandra, successeur de Giolitti en 1914, poussa le pays à l’intervention pendant la guerre. De retour en 1916, puis en 1922, il conseilla à Victor-Emmanuel III de laisser former un gouvernement.
42 Émile Kahn, conférence datant de 1937, dans Id., Au temps de la République : propos d’un Républicain, Paris, Ligue des Droits de l’homme, 1996, p. 192.
43 Sur la véritable nature de ces régimes, voir Serge Berstein, Démocraties, régimes autoritaires et totalitarismes au xxe siècle, Paris, Hachette, 1992 ; et plus particulièrement Ralph Schor, Crises et dictatures dans l’Europe de l’entre-deux-guerres, Paris, Nathan, 1993.
44 Raymond Aron, Mémoires. Cinquante ans de réflexion politique, Paris, Julliard, 1983, p. 154.
45 Hippolyte Prague, « Une nouvelle triplice », Archives Israélites, 18 octobre 1923.
46 Daniel Halévy, op. cit., p. 294-295.
47 Jacques Rozner, « Fascisme et antisémitisme », Le Droit de Vivre, juillet-août 1933.
48 Ibid.
49 Alfred Berl, « Le devoir civique des juifs dans les États modernes », Paix et Droit, avril 1926.
50 Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo [1961], Turin, Einaudi, 1993, p. 64 sqq.
51 Pester Lloyd, 11 janvier 1924, repris dans Paix et Droit, janvier 1924.
52 Richard Millman, La Question juive entre les deux guerres. Ligues de droite et antisémitisme en France, Paris, Armand Colin, 1992, p. 202.
53 Jacques Rozner, art. cit.
54 Camillo Berneri, El delirio racista, Buenos Aires, Iman, 1935, traduit en italien sous le titre Mussolini « normalizzatore » e il delirio razzista, Pistoia, Edizioni Archivio Famiglia Berneri, 1986, p. 39. Cité par Michele Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione [2000], Turin, Einaudi, 2007, p. 87.
55 Amarti, « Judaïsme et politique », Samedi, 5 octobre 1936.
56 Parmi les écrits convoqués, ceux diffusés par le Faisceau de Georges Valois, proche des fascistes, étaient notamment utilisés : Georges Valois, Le Fascisme, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1927 ; ou encore l’ouvrage traduit, Pietro Gorgolini, La Révolution fasciste, préface de Georges Valois, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1924. Selon ces auteurs, le fascisme ne reconnaissait qu’une seule classe d’hommes : les vrais Italiens ; et ils ajoutaient que nombre de Juifs étaient de ceux-là. Sur les liens entre le Faisceau et le fascisme italien, cf. Pierre Milza, « Georges Valois et l’Italie », dans Enrico Decleva, Pierre Milza (a cura di), La Francia e l’Italia negli anni venti…, op. cit., p. 178-191.
57 Alfred Berl, « Le devoir civique des juifs dans les États modernes », art. cit.
58 Daniel Halévy, op. cit., p. 272.
59 Luigi Salvatorelli, Giovanni Mira, Storia d’Italia nel periodo fascista, Turin, Einaudi, 1964 (1956 pour l’édition originale), p. 423-428.
60 Renzo De Felice, Mussolini, il Duce. Gli anni del consenso (1929-1936), Turin, Einaudi, 1974. Cf. Philippe Foro, op. cit., p. 78-79.
61 Voir Renzo De Felice, Intervista sur fascismo, Rome-Bari, Laterza, 1997.
62 Benjamin Crémieux, Essai sur l’évolution littéraire de l’Italie…, op. cit., p. 256-257.
63 Daniel Halévy, op. cit., p. 273.
64 Benjamin Crémieux, Essai sur l’évolution littéraire de l’Italie…, op. cit., p. 303.
65 Élie Halévy, Lettre à Alain, de Florence, 1er janvier 1924, dans Correspondance, op. cit., p. 666.
66 Frédéric Roche, « Mussolini ha sempre ragione », Le Droit de Vivre, octobre 1936.
67 Élie Halévy, Lettre à Alain citée.
68 « Rome d’aujourd’hui », Le Droit de Vivre, 30 novembre 1935. Notons ici que le maintien de la vie mondaine semble être une des raisons majeures pour lesquelles la bourgeoisie n’avait pas dans l’ensemble remis en cause son soutien aux régimes dictatoriaux, qui ne lui avaient dans l’ensemble rien retiré de ses privilèges et de ses loisirs. Cela a été particulièrement mis en relief pour le nazisme, et peut s’appliquer au fascisme, voir Fabrice d’Almeida, La Vie mondaine sous le nazisme, Paris, Perrin, 2006.
69 Frédéric Roche, « Un Italien n’est jamais majeur », Le Droit de Vivre, 17 octobre 1936.
70 Ibid.
71 Cf. Marie-Anne Matard-Bonucci, Pierre Milza (dir.), L’Homme nouveau dans l’Europe fasciste, 1922-1945. Entre dictature et totalitarisme, Paris, Fayard, 2004.
72 Julien Benda, Discours à la nation européenne, Paris, Gallimard, 1933, p. 191.
73 Daniel Halévy, op. cit., p. 276.
74 Philippe Erlanger, La France sans étoile. Souvenirs de l’avant-guerre et du temps de l’occupation, Paris, Plon, 1974, p. 32-33.
75 Emil Ludwig, Les Dirigeants de l’Europe. Portraits d’après nature, Paris, Gallimard, 1936, p. 229-230.
76 Jean-Richard Bloch, Offrande à la politique. Troisièmes essais pour mieux comprendre mon temps, Paris, Rieder, 1933, p. 83.
77 André Maurois, Dialogues sur le commandement, Paris, Les Cahiers Verts, 1924, p. 139.
78 « Le fascisme italien et les juifs », L’Univers Israélite, 19 août 1927. Déclaration également publiée dans « Les Israélites et le fascisme », Archives Israélites, 1er septembre 1927.
79 Renzo De Felice, Storia degli ebrei…, op. cit., p. 75.
80 Marie-Anne Matard-Bonucci, L’Italie fasciste et la persécution des Juifs, Paris, Perrin, 2007, p. 61.
81 Sur Gino Bolaffi, cf. Luca Ventura, Ebrei con il duce. « La nostra bandiera » (1934-1938), Turin, Zamorani, 2002, p. 40.
82 Chantre religieux.
83 « Le fascisme et les Juifs », L’Univers Israélite, 6 juillet 1934.
84 Pierre Paraf, Israël 1931, Paris, Valois, 1931, p. 133.
85 Voir à titre d’exemple, « Le grand-rabbin Angelo Sacerdoti », Archives Israélites, 21 mars 1935. On trouve parfois l’orthographe Sacerdote.
86 « Luzzatti chez Mussolini », L’Univers Israélite, 28 mai 1926. Luigi Luzzatti plaida souvent la cause de ses coreligionnaires auprès du Duce.
87 Cf. Pierre Milza, Mussolini, op. cit., p. 150-152 ; et Philip V. Cannistraro, Brian R. Sullivan, Il Duce’s Other Woman : The Untold Story of Margherita Sarfatti, William Morrow & Co, 1993 ; ainsi que récemment, Françoise Liffran, Margherita Sarfatti. L’égérie du Duce, Paris, Le Seuil, 2009.
88 « Une femme juive décorée en Italie », L’Univers Israélite, 8 janvier 1926. Margherita Sarfatti avait deux fils, Amedeo Giovani et Roberto ; ce fut le second qui perdit la vie au champ d’honneur, à 17 ans, dans le corps d’élite des chasseurs alpins. Cette perte fut souvent mentionnée à l’époque.
89 Sur ce point, Marie-Anne Matard-Bonucci, « L’Italie à la fin du xixe siècle : un Éden pour des Juifs de religion italienne ? », dans Ilana Y. Zinguer, Samuel W. Bloom (dir.), L’Antisémitisme éclairé. Inclusion et exclusion depuis l’époque des Lumières jusqu’à l’Affaire Dreyfus, Leiden, Brill, 2003, p. 398.
90 Waldemar-George, L’Humanisme et l’idée de patrie, Paris, Fasquelle, 1936, p. 208. L’auteur reprenait curieusement à son compte une déclaration du grand-rabbin de Rome Angelo Sacerdoti selon lequel la démocratie conduisait à l’extinction du peuple juif, en prônant une égalité absolue gommant toute particularité. Il soutenait que le fascisme, par l’organisation de la société en collectivités, permettait au contraire de concilier judéité et intégration politique. Compte tenu de la date de publication de l’ouvrage, cette déclaration datait d’avant 1936.
91 Luca Ventura, op. cit.
92 Pierre Paraf, op. cit., p. 133.
93 Peut-être faut-il y voir le parti-pris de la LICA de ne pas constituer un mouvement spécifiquement juif. Ce constat n’en demeure pas moins frappant mais ne peut expliquer que partiellement cette situation.
94 Éric Vial, « Les antifascistes italiens en exil en France face aux lois antisémites mussoliniennes de 1938 », Cahiers de la Méditerranée, no 61, décembre 2000, p. 228.
95 Un journal antifasciste, La Giovine Italia, parla même d’une « Internationale juive » favorable au Duce. Ibid., p. 238.
96 M. Lotar, « Les Juifs et la Révolution », L’Univers Israélite, 9 octobre 1931.
97 Maurice Rajsfus, Sois juif et tais-toi ! 1930-1940. Les Français « israélites » face au nazisme, Paris, EDI, 1981, p. 37.
98 Dans les dossiers de l’Archivio centrale dello Stato, rares étaient les mentions de l’appartenance religieuse des Juifs italiens, ce qui brouillait la perception. Éric Vial, art. cit., p. 228.
99 Marie-Anne Matard-Bonucci, op. cit., p. 60. Sur les 200 signataires, 30 étaient juifs.
100 L’Univers Israélite, 8 janvier 1932. Les trois démissionnaires juifs étaient Vito Volterra, professeur de mathématiques physiques à l’Université de Rome, Giorgio Levi della Vida, également mathématicien, qui contribua à fonder l’Université hébraïque de Jérusalem, et Giorgio Errera, professeur de chimie à l’Université de Pavie.
101 Simona Colarizi, L’Opinione degli italiani sotto il régime, 1929-1943, Rome-Bari, Laterza, 2e édition 2002, p. 243.
102 Hippolyte Prague, « Mussolini pacificateur », Archives Israélites, 23 mai 1929.
103 Frédéric Roche, « “Mussolini ha sempre ragione” », art. cit.
104 Daniel Halévy, op. cit., p. 282.
105 « Benito le Père Fouettard », Le Droit de Vivre, 6 février 1937.
106 Daniel Halévy, op. cit., p. 285.
107 Benjamin Crémieux, préface à Curzio Malaparte, op. cit., p. iv.
108 Se reporter sur ce point à Renzo De Felice, Le Fascisme : un totalitarisme à l’italienne, Paris, Presses de la FNSP, 1988 ; Emilio Gentile, La Voie italienne au totalitarisme, Monaco, Éditions du Rocher, 2004.
109 Emil Ludwig, op. cit.
110 Raymond Aron, op. cit., p. 154.
111 Didier Musiedlak, Mussolini, Paris, Presses de la FNSP, 2005, p. 11. Voir aussi, du même auteur, « Mussolini : le grand dessein à l’épreuve de la réalité », Parlement(s), no 13, 2010, p. 51-62.
112 Daniel Halévy, op. cit., p. 283.
113 Emil Ludwig, op. cit., p. 222.
114 Cf. Fabrice d’Almeida, « Les métamorphoses de l’imagier mussolinien », Matériaux pour l’histoire de notre temps, no 28, juillet-septembre 1992, p. 36-39.
115 Benito Mussolini, préface à Margherita Sarfatti, Mussolini. L’Homme et le Chef, Paris, Albin Michel, 1927, p. vi.
116 André Suarès, op. cit., p. 199.
117 Maurice Sachs, Le Sabbat. Souvenirs d’une jeunesse orageuse, Paris, Corrêa, 1946, p. 292. (Récit rédigé dans les années 1930).
118 Philippe Erlanger, op. cit., p. 269.
119 « Benito, le Père Fouettard », art. cit.
120 Pierre Milza, L’Italie fasciste devant l’opinion…, op. cit., p. 47.
121 « Benito, le Père Fouettard », art. cit.
122 Philippe Erlanger, op. cit., p. 269.
123 André Maurois, Mémoires, 1865-1967, Paris, Flammarion, 1970, p. 169.
124 Emil Ludwig, op. cit., p. 232.
125 Waldemar-George, L’Humanisme et l’idée de patrie, Paris, Fasquelle, 1936, p. 44.
126 John P. Diggins, Mussolini and Fascism. The View from America, Princeton, Princeton University Press, 1972, p. 58. Cf. la récente étude de Damien Amblard, Le « Fascisme » américain et le fordisme, Paris, Berg International, 2007.
127 Pour une analyse détaillée de l’image de Mussolini en Europe et dans le monde, Pierre Milza, Mussolini, op. cit., p. 619-629 ; ainsi que Max Gallo, L’Italie de Mussolini, Paris, Perrin, 1982, p. 204.