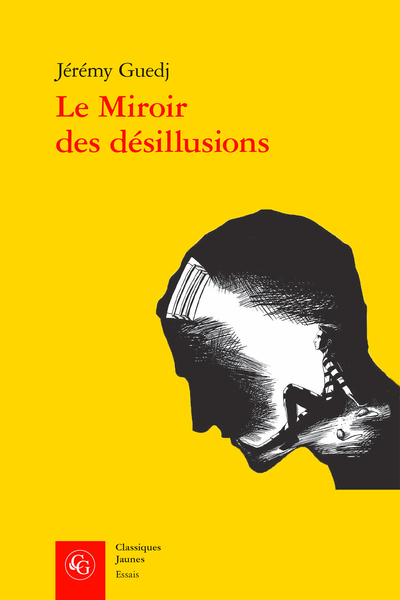
Bibliographie
- Publication type: Book chapter
- Book: Le Miroir des désillusions. Les Juifs de France et l’Italie fasciste (1922-1939)
- Pages: 357 to 376
- Collection: Classiques Jaunes (The 'Yellow' Collection), n° 763
- Series: Essais, n° 33
- CLIL theme: 3378 -- HISTOIRE -- Histoire générale et thématique
- EAN: 9782406150428
- ISBN: 978-2-406-15042-8
- ISSN: 2417-6400
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15042-8.p.0357
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 07-12-2023
- Language: French
CONCLUSION
L’intégration des Juifs avait demandé des siècles. Il n’avait fallu qu’une quinzaine d’années pour la battre en brèche. L’histoire de l’attitude des Juifs français face à l’Italie est un exemple de plus des nombreux chemins qui formaient cet amer voyage vers la désillusion. L’Italie avait constitué un miroir à la fois fidèle et déformé de la condition des Juifs qui à travers les jours et les siècles ne poursuivaient pas d’autre but qu’exister. Ceux qui étaient las de ce combat incessant pouvaient penser légitimement en scrutant l’Italie, qu’ils finiraient par trouver le repos.
Le modèle italien avait pourtant rapidement sombré de la grandeur à la misère. Mussolini avait fini par donner raison aux Cassandre. Mais le chemin de la lucidité s’avéra long et semé de perpétuels obstacles. Si bien que l’Italie apparut en un sens comme un fil rouge – un miroir – des considérations, espoirs et déconvenues des Juifs de France par rapport à leur situation et à leur identité. Car l’exemple extérieur de l’Italie était importé, intériorisé par une partie de la judaïcité française. Voilà qui conduit à s’interroger sur l’usage, l’utilisation et, partant, l’instrumentalisation, ainsi que sur la fonction et l’ancrage social des représentations. Le paradigme italien passé au prisme de l’opinion juive française rassemblait de fait toutes les fonctions jouées par les représentations, telles que les a établies l’historien Pierre Laborie : une fonction de « révélateur », relativement à la question de l’assimilation, à la nature du fascisme, à la dégradation de la condition juive, une fonction « probatoire », qui fournissait, par l’exemple, la certitude de la légitimité de son engagement (juif, antifasciste, progressiste, partisan de l’assimilation et de la réserve ou au contraire de l’action…), et venait justifier des théories ou l’adoption d’une ligne de conduite, une fonction « de légitimation » pour ceux qui défendaient l’Italie et n’en retenaient, jusqu’en 1938, que les manifestations philosémites ou antisémites pour ceux qui la couvraient de critiques. Et enfin, une fonction « d’anticipation » : anticipation, au début de la période, d’un aboutissement complet et serein de l’assimilation se traduisant par une parfaite fusion avec la nation et 350l’anéantissement des derniers sédiments de haine ; anticipation, avec le milieu des années trente, de la détérioration de la condition juive, à l’heure où l’on comprit qu’il n’existait aucun lien de cause à effet entre l’assimilation et l’absence d’antisémitisme1.
En se délestant de tout a priori, préjugé historique ou vision rétrospective, l’on peut ainsi établir que la tendance majoritaire de l’opinion juive française de l’entre-deux-guerres se montrait favorable à l’Italie, interprétation qui amène à mieux saisir les contours de l’imaginaire collectif et de l’identité des Juifs d’alors.
L’attitude des Juifs de France à l’égard de la sœur latine ne se caractérisait pourtant pas par une morne continuité interrompue en 1938. L’appréhension de la question italienne constituait en fait l’exemple parfait des troubles, allant du léger spasme au grave bouleversement, qui traversaient l’ensemble de la judaïcité française, atteinte face à l’Italie par les incertitudes, les ambiguïtés et les divisions.
Fin observateur du fait politique et des mécanismes de l’opinion, Massimo Rocca, parlementaire italien, estimait que le fascisme pouvait susciter soit l’enthousiasme le plus débordant, soit le rejet le plus net :
Il est impossible, même aux étrangers qui écrivent sur l’Italie actuelle, sur place ou de loin, de se soustraire à un parti pris qui, avant toute enquête impartiale, approuve ou condamne sans appel.
Le résultat est que dans le monde il n’y a que deux opinions nettement contradictoires, mais cristallisées, à propos du phénomène fasciste : ou mieux deux thèses où la vérité a sans doute sa part, mais qui ont le tort de prétendre d’être chacune toute la vérité, et qui, en attendant, empêchent tout observateur sérieux et sincère de se faire tout bonnement, mais personnellement une opinion2.
À coup sûr, cela ne s’appliquait pas aux Juifs de France, ou plutôt, serait-il plus juste de dire, pas à tous. C’est que l’opinion juive apparaissait double : aux plus critiques, la plupart progressistes qui ne s’embarrassaient parfois guère de nuances et n’étaient pas en proie au doute quand il était question de l’Italie, condamnable car fasciste, s’opposait la majorité de leurs coreligionnaires, admiratifs du pays de Dante, mais noyés dans un faisceau d’incertitudes.
Les plus à gauche en effet étaient acquis à une puissante idéologie antifasciste qui fit très tôt de l’Italie une ennemie ; en ce sens, ils 351correspondaient à la description livrée par Massimo Rocca. Or ce n’était pas le cas des autres qui, refusant officiellement de s’engager sur le terrain politique, s’intéressaient avant tout aux questions religieuses : mais comment analyser par exemple la politique extérieure de l’Italie à l’aune de considérations spirituelles ? Il semble que les Israélites conservateurs et modérés partissent du postulat d’une Italie philosémite pour examiner toutes les actions de la sœur latine. Si bien que l’on tentait, par des détours parfois acrobatiques, de tout rattacher à la question juive. Quand il s’agissait de l’immigration italienne en France, l’on dressait un parallèle avec l’immigration juive ; si l’on s’intéressait à l’essence du fascisme, il fallait se demander comment les Juifs italiens l’avaient accueilli ; ou encore, parmi tant d’exemples, porter son regard sur la guerre d’Éthiopie passait nécessairement par l’examen des relations entre Italiens et Juifs éthiopiens… Cette façon de voir l’Italie s’explique aussi par la nature de la documentation disponible pour la présente étude. Pour prendre le seul exemple de la presse, les lecteurs s’attendaient à y trouver les nouvelles du monde présentées à travers le prisme juif. Pour autant, s’intéresser la question italienne n’impliquait pas nécessairement d’interpréter l’actualité en fonction des intérêts d’Israël. Le poids de la judéité n’en était pas moins net, dans les sources écrites comme dans l’espace public, semble-t-il.
Les hésitations de la majorité de l’opinion juive provenaient-elles cependant tout entières de cette volonté de ne pas prendre ouvertement parti sur des questions politiques ? Il n’était pas rare que l’on imputât ses propres doutes à l’Italie elle-même, dont la politique trop ondoyante amenait perpétuellement à corriger son jugement. Alfred Berl le notait, et cela valait particulièrement pour la question juive : « L’Italien est peu porté vers les théories ; il demeure le fils de Machiavel et profondément réaliste. Quand il adopte une doctrine, c’est a posteriori, pour justifier son action ; la doctrine n’en est jamais la génératrice3 ». Les flottements de la politique transalpine ne sauraient cependant expliquer à eux seuls les doutes et équivoques des Juifs de France.
Mis bout à bout, le corpus documentaire révèle en effet d’étranges incohérences et contradictions, ainsi que des amnésies frappantes, tant diachroniques que synchroniques. Que l’opinion juive pensât différemment en 1922 et en 1935, quoi de plus classique et normal ? Il ne faudrait pas voir de l’inconséquence là où il n’y en a pas. En revanche, 352que les Israélites français ne missent jamais en relation des événements contradictoires entre eux interroge l’observateur du passé : les incidents de Tunis en 1926 ne furent pas rapprochés de ceux de Tripoli, en 1923 ; presque personne ne mit clairement en regard les attaques antisionistes de la presse italienne en 1928-1929 et la politique sioniste de Mussolini, événements pourtant concomitants. Tout se passait comme si chaque conjoncture était indépendante des autres et considérée séparément. Il fallut attendre seulement 1935 pour que l’on commençât, timidement, à connecter les divers pans de la politique italienne entre eux : le racisme italien en Éthiopie constituait l’écho de la campagne antisémite naissant en Italie ; la politique transalpine en Afrique du Nord était mise en relation avec l’adoption d’une législation antisémite en Italie. Mais, là encore, comment comprendre qu’à partir de 1937, a fortiori de 1938, il ne se trouva pas une voix pour rappeler les traces, même légères, d’antisémitisme italien par le passé, alors même que la presse juive s’en était chaque fois préoccupée ? De telles palinodies, plus qu’à une conclusion, doivent en réalité mener à de nouvelles interrogations. Et si les silences et les contradictions participaient d’une ambiguïté, dans laquelle une fraction des Israélites français se complaisait ?
Il pouvait parfois apparaître délicat de pointer des éléments qui contredisaient ses propres certitudes, sa propre idéologie. Dénoncer les actes antisémites italiens aurait infligé un camouflet à l’idée que l’assimilation induisait le philosémitisme. Attirer l’attention sur les dérives du fascisme italien aurait pu laisser entrevoir aux plus pessimistes un éventuel retournement contre Israël, souvent cible privilégiée en cas de crise. Plus que des sympathies cachées à l’égard du modèle fasciste, qui pouvaient toutefois être réelles chez les Israélites les plus à droite, l’ambiguïté traduisait la prudence : en cas de geste philosémite de la part du Duce, il était possible de louer le modèle d’intégration italien sans que l’on sût si cela induisait ou non un éloge du fascisme ; en cas de dérive, nul ne pouvait accuser les Israélites français d’être les soutiens actifs du fascisme italien.
L’ambiguïté apparaissait d’ailleurs plus profonde et révélait la différence entre le discours des Juifs partisans intégraux de l’assimilation et leur action. La judéité parlait au moins autant que la francité. Malgré le slogan « Français d’abord », le paradoxe était grand. Tandis que les valeurs traditionnelles de la République (la liberté, la démocratie…) étaient bafouées en Italie, les instances et organes du judaïsme officiel préféraient se concentrer sur la qualité de la condition juive outre-monts. 353Que de nombreux coreligionnaires transalpins acceptassent cette mise à mort des libertés et participassent parfois aux plus hautes instances du fascisme n’était pas considéré comme regrettable mais au contraire, en filigrane, comme notable car participer à l’œuvre fasciste traduisait leur profonde assimilation. Une sorte d’aveuglement, provoqué par la peur et des espoirs toujours déçus, saisissait une partie de l’opinion juive : les considérations liées à l’identité religieuse pesaient inexorablement, malgré ce que les Juifs disaient et pensaient sans doute sincèrement.
Paradoxalement, les Juifs les plus à gauche de l’échiquier politique, ceux qui, souvent, revendiquaient sans la moindre gêne la primauté de l’appartenance juive et réclamaient une « politique juive » érigée comme moteur de toute action contre le fascisme, étaient ceux qui semblaient le moins réagir en fonction de leur judéité ; l’exemple de la LICA étant le plus éclatant. La solidarité politique semblait en fait, mais les exceptions restent nombreuses, décider de leur comportement. Bien qu’ils dissent lutter contre le fascisme car la défense de la liberté entraînerait le salut d’Israël, ils semblaient plus agir en hommes de gauche qu’« en Juifs », comme disait Edgar Morin, même si dans leur esprit les valeurs du judaïsme et celles du progressisme se confondaient. À ce titre, l’opinion des intellectuels juifs apparaissait éloquente. Comment comprendre sinon qu’au moment de la législation antisémite italienne, plusieurs Juifs, de la LICA notamment, critiquèrent leurs coreligionnaires transalpins participant au fascisme et considérèrent parfois avec ironie leur nouvelle condition ? La solidarité juive paraissait toute relative : le frère était avant tout le progressiste.
Ces deux visions, ces deux modes de relation à l’Italie non clairement perçus mais fermement opposés, expliquaient que la question transalpine introduisît d’acerbes et supplémentaires divisions au sein de la judaïcité française.
Une remarque préalable s’impose : tout n’était pas que division quand il s’agissait de l’Italie. Il faut distinguer quatre cas de figure : quand la question juive était au cœur des débats, les divisions étaient les plus importantes (par exemple, lorsque l’on évoquait le rapport entre fascisme et antisémitisme) ; si l’on parlait d’un événement qui pouvait, indirectement mais pas nécessairement, avoir des répercussions sur les Juifs, l’on parvenait à une opinion quasi-consensuelle, avec des degrés différents toutefois (c’était le cas au moment de la création d’une réelle ou mythique « Internationale fasciste ») ; quand la question juive n’intervenait pas ou quasiment pas, le consensus était souvent atteint 354(relativement à la politique étrangère italienne dans les années 1920 ou à la guerre d’Éthiopie, entre autres) ; enfin, dernier cas de figure, il arrivait quelquefois que toute l’opinion juive ne se mobilisât pas sur certains sujets, comme au moment de la réorganisation du judaïsme italien, après 1929. La mise en sourdine d’une partie de l’opinion juive donnait l’impression d’un consensus, alors qu’en fait, seule une tendance prenait la parole.
De cette variété de cas, il ressort toutefois que les luttes intestines et les divisions l’emportaient nettement. La question d’Italie était parfois instrumentalisée : tout était bon pour alimenter les polémiques, fratricides. Les clivages paraissaient profonds. Sur un sujet n’impliquant pas de calculs liés aux intérêts intérieurs, l’opinion juive se libérait. Les disputes qui la torturaient traduisaient en fait deux visions du monde, mais surtout deux visions de soi : qu’est-ce qu’un Juif pouvait faire pour agir en France et dans le monde ? Ainsi se résumait l’interrogation qui se posait à l’occasion des affaires d’Italie et à laquelle chacun apportait une réponse différente, par la parole, l’action ou le silence.
Ces discordes face à l’Italie confèrent un exemple supplémentaire de l’impréparation du judaïsme français à la guerre. Un groupe humain craignant pour sa sécurité, ne sachant pas lui-même ce qu’il était, pouvait-il affronter des ennemis puissants et organisés ? S’attendait-il à ce que la France, dans laquelle il plaçait tous ses espoirs, le rejetât plus tard de son sein ? Contre toute attente, l’Italie, ce pays qui avait divisé tant de Juifs, assurera, dans sa zone d’occupation en France, le salut de beaucoup d’entre eux, contre les lois françaises, au cœur de la tourmente.
Par ce dernier élément, on comprend pourquoi l’étude des rapports entre les Juifs français et l’Italie, les travaux se focalisant uniquement sur la période de la guerre, demeura longtemps confisquée par l’idéologie. Les Juifs français sauvés par les Italiens lors de la guerre eurent tendance à dénier à la sœur latine tout véritable antisémitisme. Ceux qui voyaient la situation de loin furent amenés, par le jeu des comparaisons, à minimiser l’antisémitisme fasciste par contraste avec son équivalent nazi. En Italie même, le mythe du « bon Italien » domina longtemps le débat public4. Partout l’on a absous l’ensemble du peuple italien, sans grande distinction, de tout antisémitisme. En France, en 1962, un intellectuel pouvait écrire : « De tous les pays d’Europe, l’Italie est 355celui où l’antisémitisme n’a jamais réussi à s’implanter, à empoisonner l’opinion publique5 ».
Depuis plusieurs décennies, des historiens révisent les termes du débat et disculpent beaucoup moins qu’auparavant les Italiens de tout soupçon, tout en abandonnant les clichés relatifs aux causes de l’antisémitisme d’État. Il ne saurait s’agir ici de prendre parti, mais, à l’appui des conclusions de la présente étude, l’on peut faire valoir que l’image du philosémitisme italien émergea dès les débuts du fascisme dont on notait qu’il n’avait pas mis fin à la tradition libérale italienne sur ce plan. Même en 1938, les Juifs ne croyaient pas que l’antisémitisme pût trouver ses racines en Italie. Il ne s’agissait de rien d’autre que d’un « article d’importation » remarquait-on, pour l’une des rares fois, à l’unanimité. Peu importe si les Juifs avaient raison ou tort ; comme dit Jean-Noël Jeanneney, « une idée fausse est un fait vrai6 ». L’on peut donc modestement espérer que l’histoire des idées, des représentations et de leur traduction ou ancrage sociaux apporte quelque nouvel élément à ce débat. L’exemple des Juifs montre comment des interprétations tenaces, sautant du débat public au domaine historique, se forgent et il serait regrettable d’évacuer l’histoire des représentations du débat sur l’antisémitisme italien. Si les Israélites français se trompaient, cela signifie que l’opinion publique se nourrissait d’illusions et que l’histoire présente une réalité que ne percevaient pas nécessairement les acteurs de l’époque. S’ils avaient raison, il convient alors de souligner que l’opinion juive de l’entre-deux-guerres, malgré toutes les difficultés qui la rongeaient, constitue un référent incontournable pour les études historiques sur cette question.
L’on ne peut que souhaiter que des études à venir s’intéressent au pendant du présent sujet, la vision que les Juifs italiens avaient de la France et de leurs coreligionnaires français, ou mènent une enquête systématique sur les traces mémorielles de l’Italie fasciste parmi les Juifs français, en apportant ainsi une pierre à la connaissance du « zakhor », la mémoire, si importante dans la tradition juive.
À travers la question épineuse abordée dans cet ouvrage, il ne s’est jamais agi de distribuer de bons ou mauvais points aux Juifs de l’époque. Mais de comprendre. Comprendre les ressorts de leur imaginaire et de leur action. Louant l’assimilation et réclamant le droit de parler comme des Français sans adjectif, ils s’exprimaient souvent comme juifs, pris 356entre le collectif et le groupe, enserrés entre un désir d’universalité et les contingences du particularisme. La contradiction n’est aujourd’hui encore pas dépassée, elle est le fait de toute minorité. Jamais cependant, en dépit des immenses difficultés et peines qu’ils éprouvèrent, les Juifs de l’entre-deux-guerres ne furent tentés par les prémices d’un quelconque communautarisme.
1 Pierre Laborie, Les Français des années troubles. De la guerre d’Espagne à la Libération, Paris, Desclée de Brouwer, 2001, p. 102-107.
2 Massimo Rocca, Le Fascisme et l’antifascisme en Italie, Paris, Félix Alcan, 1930, p. ii.
3 Alfred Berl, Paix et Droit, octobre 1938.
4 Cf. Paola Bertilotti, Mémoires et représentations des persécutions antisémites en Italie sous le fascisme et pendant l’occupation allemande dans la presse communautaire juive entre 1944 et 1961, Mémoire de DEA d’histoire sous la direction de Marc Lazar, IEP Paris, 2003, p. 11.
5 K. Jelensky, « Le fascisme italien et les Juifs », Évidences, no 92, mars-avril 1962, p. 36.
6 Jean-Noël Jeanneney (dir.), Une Idée fausse est un fait vrai, Paris, Odile Jacob, 2000.