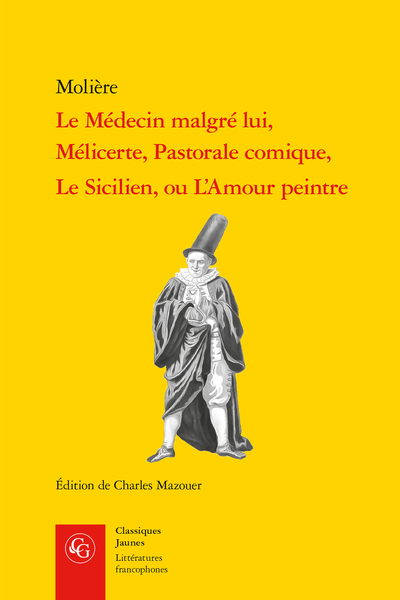
Introduction
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Le Médecin malgré lui, Mélicerte, Pastorale comique, Le Sicilien, ou L'Amour peintre
- Pages : 127 à 132
- Collection : Classiques Jaunes, n° 734
- Série : Littératures francophones
- Thème CLIL : 3436 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques
- EAN : 9782406124528
- ISBN : 978-2-406-12452-8
- ISSN : 2417-6400
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12452-8.p.0127
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 12/10/2022
- Langue : Français
INTRODUCTION
Pendant l’été et l’automne 1666, Molière et sa troupe exploitèrent le succès du Misanthrope (créé le 4 juin) et du Médecin malgré lui (créé le 6 août). Mais il leur fallut quitter leur théâtre parisien au tout début de décembre, pour le service de Sa Majesté : « Le mercredi 1o décembre nous sommes partis pour Saint-Germain-en-Laye par ordre du roi », note La Grange dans son Registre. De fait, dès le lendemain 2 décembre commençaient les représentations d’un grand ballet, Le Ballet des Muses.
Le dessein
Il s’agit encore d’une de ces grandes fêtes royales voulues par le roi, commandées par lui aux artistes, et qui avaient pour centre la personne du monarque glorifié. On y dansa – le roi et les grands du royaume se mêlant aux danseurs professionnels, aux musiciens et aux chanteurs – un ballet de cour qui fut redonné plus de dix fois entre le 2 décembre 1666 et le 19 février 1667, soit entre l’Avent et le Carême. La conception du Ballet des Muses est attribuée à Benserade, auteur également des vers d’application, truffés de jeux d’allusions à la personne des danseurs chargés des 128différents rôles. La musique était évidemment due à Lully. Voici l’argument du ballet, sur le thème des Muses :
Les Muses, charmées de la glorieuse réputation de notre monarque, et du soin que Sa Majesté prend de faire fleurir les arts dans l’étendue de son empire, quittent le Parnasse pour venir à la cour.
Mnémosyne elle-même, la Mémoire, la mère des Muses, qui ne trouve rien d’égal « à cet auguste prince » dans l’Antiquité, se déplace pour voir ce monarque ! Et la mère et les filles vont chanter à l’envi « le plus sage et le plus grand des princes », qui fait assembler en ses provinces « la gloire, les vertus, l’abondance et les arts ». Mnémosyne :
Vivant sous sa conduite,
Muses, dans vos concerts,
Chantez ce qu’il a fait, chantez ce qu’il médite,
Et portez-en le bruit au bout de l’univers.
Dans ce récit charmant faites sans cesse entendre
À l’empire français ce qu’il doit espérer,
Au monde entier ce qu’il doit admirer
Aux rois ce qu’ils doivent apprendre.
Et les Muses de reprendre en chœur la louange royale :
Rien n’est si doux que de vivre
À la cour de LOUIS, le modèle des rois1.
129La structure
Le dessein du ballet entraîna sa structure : chaque entrée doit honorer une des Muses. Tour à tour, les entrées sont dédiées à Uranie, à Melpomène, à Thalie, à Euterpe, à Clio, à Calliope – et son fils Orphée a droit à la septième entrée –, à Érato, à Polymnie et à Terpsichore ; à ces dix entrées s’en ajoutent trois, du moins dans la version initiale du ballet, consacrées à la dispute entre les neuf Muses et les neuf Piérides, les filles de Piérus qui voulaient rivaliser avec les Muses ; la querelle est finalement tranchée par Jupiter, qui punit les obstinées et insolentes Piérides en les changeant en oiseaux.
Souvent repris, le ballet connut changements et ajouts, qui concernent beaucoup la participation de Molière au Ballet des Muses, comme nous allons le voir. Ces changements touchèrent la troisième entrée, consacrée à Thalie, et la sixième entrée, consacrée à Calliope, où l’on vit en premier lieu des poètes dansants puis, plus tard, – « embellissement des mieux concertés » dit La Gazette – une comédie de Quinault, Les Poètes, enchâssant une Mascarade espagnole ; enfin, le 14 février 1667, une quatorzième et dernière entrée est ajoutée, dont Molière fournit l’essentiel avec sa comédie-ballet du Sicilien, enchâssant elle-même un divertissement turc (scène 6) et se concluant par une mascarade de Maures.
130Place du théâtre dans les entrées
Il est notable que les entrées de ce grand ballet plusieurs fois dansé et évolutif pouvaient être constituées de spectacles de théâtre, donnés par les différentes troupes parisiennes réquisitionnées pour l’occasion. Il en fut ainsi quatre fois, pour les troisième, sixième, neuvième et quatorzième entrées ; et la troupe de Molière se tailla la part du lion.
La troisième entrée, dédié à Thalie, la Muse de la comédie, appelait une pièce comique, qui fut commandée à Molière – « celui de tous nos poètes qui, dans ce genre d’écrire, peut le plus justement se comparer aux anciens », dit le livret – et représentée par sa troupe. Mais quelle pièce ? Si l’on en croit le Registre de La Grange, le 2 décembre 1666 on donna Mélicerte. Voici le texte : ce jour-là, « on commença le Ballet des Muses où la troupe était employée dans une pastorale intitulée Mélicerte puis celle de Coridon ». Coridon est le nom d’un jeune berger (joué par La Grange lui-même) parmi les acteurs de ce que nous nommons La Pastorale comique et que La Grange nomme simplement Coridon. Sans regarder le manuscrit de trop près, la critique suit traditionnellement l’indication de La Grange et admet que Mélicerte fut remplacée plus tard, le 5 janvier 1667, par la Pastorale comique. Soupçonneux, les éditeurs de la nouvelle édition de La Pléiade, scrutant attentivement le manuscrit de La Grange, y remarquèrent que le compagnon de Molière avait d’abord écrit « […] la troupe était employée dans une pastorale intitulée Coridon », puis qu’il s’était repris et avait inséré les quelques mots « Mélicerte puis celle de » ; ce qui, pour finir, donne effectivement « […] la troupe était employée dans une pastorale intitulée Mélicerte131puis celle de Coridon ». Alors ? Faut-il mettre en doute la représentation, lors de la troisième entrée, de Mélicerte, dont l’origine et la représentation seraient différentes, et imaginer qu’une autre pièce de Molière, dont la trace serait perdue, a d’abord été représentée dans cette troisième entrée, avant d’être remplacée par la Pastorale comique ? De fait, d’après ce qui nous reste de Mélicerte, seulement deux actes sur cinq attendus, cette « comédie pastorale héroïque » semble assez mal ajustable à une entrée de ballet. Mais aucun élément ne permet, actuellement, d’avancer dans la résolution de cette difficulté2.
L’on retrouva des comédiens, cette fois ceux de l’Hôtel de Bourgogne, à la sixième entrée que nous avons évoquée. Dans sa forme embellie, celle-ci vit la représentation de la petite comédie des Poètes, très probablement de Quinault, dont les sept scènes, simplement résumées, et seulement à partir de la quatrième édition du livret, introduisent « des poètes de différents caractères », avec la Mascarade espagnole.
Quant à la neuvième entrée, dédiée à Polymnie, Muse de l’éloquence et de la dialectique, elle faisait paraître des philosophes grecs et des orateurs latins « représentés en ridicule » ; mais le livret ne donne ni résumé ni même un canevas. On y voyait à nouveau des comédiens de l’Hôtel de Bourgogne (Montfleury, Poisson et Brécourt) et des comédiens de la troupe italienne (Arlequin, Scaramouche et Valerio), auxquels on avait « laissé la liberté de composer leurs rôles ».
Enfin, Molière une dernière fois contribua, avec son Sicilien, à la quatorzième et dernière entrée, ajoutée sous prétexte de faire voir des Turcs et des Maures, lors des ultimes représentations de ce grand Ballet des Muses.
132La troupe de Molière quitta aussitôt Saint-Germain, non sans avoir reçu, pour son déplacement et au titre de sa pension annuelle, la somme de 12 000 livres. Et elle reprit bien vite ses représentations au Palais-Royal, à partir du 25 février 1667, après un déplacement de trois mois.
Dans quel ordre publier les trois pièces de Molière ? Suivant, sans grande conviction, le témoignage de La Grange, nous gardons sa chronologie et donnons d’abord les deux actes restant de Mélicerte, qui n’ont été publiés que de manière posthume, en 1682, par l’édition complète de La Grange et Vivot. Nous donnons ensuite La Pastorale comique, qui n’est connue que par le résumé que fournit le livret de 1666, Molière n’ayant pas jugé digne de l’impression ce petit divertissement comique ; nous en profiterons pour transcrire, en sa troisième édition, l’intégralité de ce livret du Ballet des Muses, où prit place la pièce de Molière. Le Sicilien, plus tardif, sera donné enfin, et dans l’édition que Molière lui-même en fit imprimer. Le lecteur aura ainsi une idée assez juste de ces pièces, de leur cadre et de leur succession.