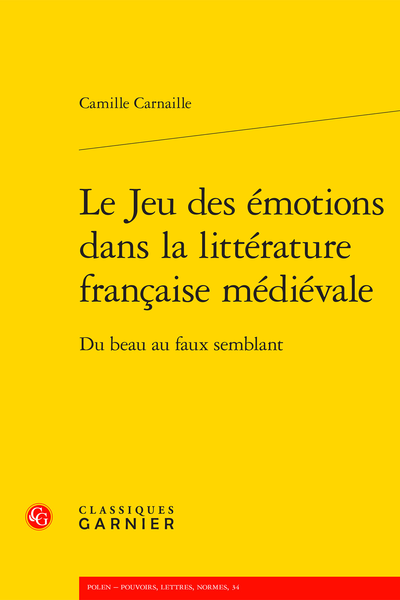
En guise de préambule De la ruse au jeu émotionnel, du jeu émotionnel à la ruse ?
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Le Jeu des émotions dans la littérature française médiévale. Du beau au faux semblant
- Pages : 61 à 98
- Collection : POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n° 34
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406151616
- ISBN : 978-2-406-15161-6
- ISSN : 2492-0150
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15161-6.p.0061
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/11/2023
- Langue : Français
En guise de préambule
De la ruse au jeu émotionnel,
du jeu émotionnel à la ruse ?
Approcher le jeu émotionnel par la ruse
Au moment d’entamer l’investigation que nous proposons de mener autour du jeu des émotions, nous voudrions avant tout repenser la question surannée de la sincérité des émotions qui surgit aussitôt dans les réflexions engendrées par cette problématique de recherche. C’est pourquoi ce préambule d’analyse au jeu des émotions a pour objectif d’appréhender des œuvres associées à la ruse : le Roman de Renart, les fabliaux et les romans de Tristan. Ces œuvres importantes de la littérature médiévale française ont la particularité de cultiver les épisodes de tromperie, au nom de motivations diverses, qu’elles relèvent de la malignité presque gratuite de Renart, des intentions mesquines et cocasses des personnages de fabliaux ou du souci de préserver ou, au contraire, de percer le secret d’un amour adultère dans le cas de Tristan et Yseut. Il nous paraissait intéressant d’en interroger les composantes plus spécifiques liées aux émotions mobilisées au gré de ces ruses et subterfuges. Ce choix s’est vite imposé dans le cadre de nos réflexions préliminaires qui visaient à nuancer la dichotomie entre vrai et faux qui pèse sur la sphère affective. A fortiori quand elle se met en scène dans la trame narrative, celle-ci nous paraissait par trop stricte. Il nous semblait important de tenter de la repenser d’emblée, par le biais d’un corpus des plus pertinents pour le faire. Ces œuvres mettent en lumière les frontières parfois ténues de la ruse, mais surtout les contextes dans lesquels elle peut s’inscrire avec plus ou moins de légitimité. Surtout, ce corpus nous permettait une entrée en matière idéale pour approcher les logiques propres aux jeux émotionnels, bien loin finalement de cet 62esprit de ruse intégré dans ces quelques œuvres. Nous avons rapidement pu constater que la ruse personnifiée avec éclat par Renart par exemple se déclinait peu sur le volet émotionnel. Les quelques épisodes qui se prêtent à de véritables jeux des émotions auront ainsi surtout permis d’identifier toute une série de critères d’intérêt pour la suite de nos analyses et de mieux en cerner les lignes directrices.
Ce premier chapitre a également été l’occasion de tenter d’établir un axe méthodologique à l’établissement et à l’étude de notre corpus d’analyse. Nous avons décidé d’y éprouver notre souhait d’une approche purement lexicale des jeux émotionnels, qui nous semblait la plus adéquate pour éviter les écueils propres à l’étude d’une entité psychologique forcément inatteignable, si ce n’est dans le cadre de constructions discursives dans lequel elle prend forme. Nous nous conformons ainsi aux appels à la prudence des historiens Damien Boquet et Piroska Nagy : « Partir d’une définition discrète, fermée de l’émotion, faire aveuglément confiance aux catégories scientifiques de notre temps, elles-mêmes multiples d’ailleurs, serait non seulement une pure illusion pratique mais la marque d’un scientisme ruineux projeté sur une réalité humaine malléable1 ». Cette mise en garde nous paraît légitimer la proximité avec les termes médiévaux sur lesquels nous souhaitons resserrer l’angle. Bien plus qu’une certaine distance à l’égard des théories contemporaines – dont nous avons déjà exprimé notre désir de nous distinguer en introduction –, nous voudrions revendiquer sur cette base une approche lexicale de l’objet émotionnel médiéval. Nombreux sont les exemples en la matière : les spécialistes de la littérature Alexandra Vélissariou et Susan Stakel insistent sur la construction lexicale pour bâtir leurs analyses, que toutes deux débutent par une ample description du vocabulaire du jeu2 et de la ruse3 dans leurs cas. Dans cette même lignée, d’autres historiens ont pu souligner l’intérêt de s’appuyer sur les listes lexicales de l’émotion médiévale4, mais aussi sur les moteurs de 63recherches, tel que le logiciel TROPES5, ou encore le corpus Garnier auquel nous avons choisi de nous référer pour ce préambule d’analyse. L’importance du vocabulaire et la difficulté de son appréhension semblent justifier ce recours à des plateformes électroniques comme premier procédé d’approche. Ces outils d’une richesse indéniable ne sauraient cependant se départir d’une lecture plus approfondie des œuvres mises à l’étude, et c’est sous cette double forme que nous avons décidé d’établir notre méthode de recherche. L’analyse du corpus de la ruse en passera donc par un relevé du vocabulaire qui lui est propre, pour en croiser l’incidence avec celle des jeux émotionnels en particulier. Sans prétendre pour autant à l’exhaustivité bien sûr, nous avons établi une liste de termes révélateurs de la dynamique rusée de ce corpus. Nous avons pu profiter des lumières offertes par Alexandra Vélissariou pour étoffer cette liste6, mais avons surtout veillé à recouper les termes identifiés avec d’autres découverts au gré de la première phase d’exploration de la base de données de Garnier et des œuvres elles-mêmes. Sur la base des 236 termes interrogés, nous avons mis en lumière quelques 1433 occurrences dans le corpus qui nous occupe. Seules 39 d’entre elles s’avéraient pertinentes à notre analyse des jeux émotionnels inscrits dans cette dynamique de ruse. Ce seul constat justifie l’intérêt de cette méthode d’analyse, qui visait à évaluer la collusion entre l’univers de la ruse et celui des jeux émotionnels. Il apparaît ainsi d’emblée que l’un et l’autre ne vont pas autant de pair que nous aurions pu l’imaginer. Cette approche lexicale aura également eu l’intérêt de mettre en lumière une polarité importante dans les jeux émotionnels entre ceux qui relèvent de la dissimulation et ceux qui visent la simulation d’émotions. Le contraste entre ces deux dynamiques de jeux s’illustre déjà dans le vocabulaire lui-même. On peut le percevoir dans les expressions de « celer », « couvrir », « privement », qui tendent à exprimer un processus de voilement des émotions, au contraire de celles de « faire » l’émotion ou de « jouer le personnage », que l’on peut davantage rattacher à une 64dynamique de simulation. Mais il pourrait se résumer dans la seule distinction entre les formules de « ne pas montrer semblant » et de « faire semblant », fréquentes dans les textes. Elle témoigne des nuances qui se présentent entre ces deux logiques de jeux émotionnels. La simulation veut exposer, au contraire de la dissimulation qui cache, voire recouvre, pour mieux y arriver, une émotion par une autre, simulée alors. Si ces deux mouvements peuvent donc parfois s’entremêler, ils ne relèvent pas moins de deux dynamiques bien distinctes et fonctionnent de manière fort différente selon les contextes dans lesquels ils s’inscrivent. Telle pourrait être la conclusion la plus porteuse de ce préambule d’analyse. Mais nous aurons également eu l’occasion, au fil d’une lecture plus minutieuse, d’identifier plusieurs critères d’intérêt pour notre analyse des jeux émotionnels. Bien loin du détail narratif, l’émotion fait sens, même dans le cadre de ruses plus développées telles qu’y recourent Renart, les femmes trompeuses des fabliaux ou Tristan et Yseut. Pour plus de clarté dans la lecture que nous souhaitons en proposer, nous traiterons ces trois œuvres de manière distincte. Cela nous permettra en outre de mieux les faire résonner ensuite et de dégager les conclusions qui peuvent s’imposer quant à l’investissement émotionnel requis dans les ruses qui y sont mises en scène.
De la guile de Renart aux fausses larmes d’Yseut :
un spectre de ruses
ou un spectre de jeux émotionnels ?
Le Roman de Renart offre une entrée en matière éloquente dans l’univers de la ruse. Renart fonctionne d’ailleurs souvent comme un véritable modèle de la ruse qu’il élève en art selon la propre formule du texte7. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce passage révélateur de l’importance accordée au vice d’hypocrisie parmi tous les autres incarnés aussi par Renart, comme la gourmandise, l’envie, la luxure. Il témoigne en effet de cette part émotionnelle de la ruse de Renart 65que nous aimerions envisager. Elle s’intègre en ceci dans une mise en lumière de la fausse dévotion, surtout portée par la veine anticléricale. L’importance prise par cette réflexion au sein du Roman de Renart nous mènera à l’explorer de manière plus spécifique aussi dans l’analyse que nous dédierons à la sphère religieuse des émotionologies médiévales. Mais il nous semblait déjà intéressant de révéler la teneur émotionnelle de la ruse bien connue de Renart. Si Renart est un symbole de la guile, il ne décline pas pour autant sa propension trompeuse sur ses émotions. Le traitement réservé aux émotions dans le Roman de Renart révèle un contraste saisissant avec la dynamique rusée posée pourtant au cœur de chacune des branches du récit. Prédominante, la ruse ne semble pas ou peu s’appuyer sur la sphère affective qui reste marquée par sa grande sincérité. On retrouve à de nombreuses reprises la formule « n’i a mestier celee » qui vient souligner l’inutilité de dissimuler les émotions éprouvées face à tel ou tel rebondissement des aventures de Renart8. Au contraire, les émotions se veulent expressives, dans une optique qui laisse peu de place au leurre. Renart surtout ne fait preuve d’aucune contenue de ses émotions qu’il manifeste dans toute leur intensité. Il est question de rire dès que pointe l’idée de joie, de larmes ou de tremblements à la moindre mention de tristesse ou de peur. La logique émotionnelle du Roman de Renart se construit ainsi sous la forme d’un hiatus posé entre cette expressivité émotionnelle, directement associée à l’honnêteté de Renart en la matière, et sa nature fondamentalement trompeuse par ailleurs. Mais un tel tableau des émotions témoigne également d’une tendance bien marquée par ailleurs dans la littérature médiévale française. La mise en scène des émotions par leurs manifestations physiques répond à une norme commune qui favorise cette représentation physiologique plutôt que celle de leur réalité psychologique. Mais elle participe aussi d’une mise en exergue de l’intensité émotionnelle, qui rend d’autant plus intéressante la capacité de Renart à ruser en dépit de sa peine, de son dénuement ou de sa colère exprimés avec emphase. On pourrait presque en conclure que la ruse n’inclut pas à proprement parler les émotions, mais s’y appuie 66pour les dépasser. La sincérité émotionnelle de Renart n’en servirait que mieux ses astuces trompeuses.
Cette forme de paradoxe qui émerge du Roman de Renart comporte bien sûr quelques exceptions. Elles jouent de cette fonction dont Renart peut aussi investir ses émotions dans ses démarches rusées. L’exemple le plus éclatant se lit dans l’épisode de son passage au couvent de frère Bernard. Renart parvient à s’y faire passer pour un moine, simule tous les signes de dévotion et confond par-là l’ensemble des frères :
Bien retient ce c’on li ensaingne,
Ne fait sanblant que il s’en faingne,
le singne fait dou moniage.
Mout le tindrent li frere a sage ;
chiers est tenuz et bien amez
et frere Renart est clamez.
Et il fait mout le papelart
tant que s’en puisse issir par art9.
Cette description de l’ordination de Renart met en présence tous les éléments primordiaux du champ lexical de la tromperie. Outre l’expression de papelart, nous retrouvons les allusions au sanblant, au singne et à la feintise dans une construction révélatrice de l’ambiguïté de la mise en scène de Renart. L’accent est ainsi porté sur la parfaite maîtrise de soi de Renart, qui dissimule qu’il simule, dans un jeu complet des apparences. La rime papelart-art participe de cette valorisation de la manipulation que Renart érige effectivement en véritable art au gré de ses aventures. Elle atteste aussi son orientation religieuse et joue ainsi de l’ambiguïté dans ce rapprochement avec le vice de papelardie. Son succès surtout est souligné, dans un rapport de cause à effet bien mis en lumière. Le signe offert aux Frères suffit à les convaincre de la sagesse de Renart et plus encore à l’intégrer parmi eux. Renart n’est pas seulement apprécié pour sa manifestation de dévotion, il est clamé Frère. La portée publique de son geste est donc bien prise en charge dans la narration, dans une belle démonstration de l’étendue du pouvoir et donc des dangers des rituels émotionnels. L’efficacité du signe dévotionnel ne pourrait être plus éclatante. Mais tout aussi explicite 67est donc la duperie qu’il constitue. La prétendue dévotion du goupil ne s’inscrit que dans une optique très intéressée de sa part : se faire moine pour échapper à la potence. Surtout, la présentation de ce signe se trouve, de manière notable, comme encadrée par les références à son hypocrisie, révélée sans doute possible par le verbe feindre et par la formule faire le papelart. Cette dernière témoigne bien de la dimension critique que peut inclure la ruse émotionnelle de Renart. La papelardie constitue à n’en pas douter le degré le plus intolérable de la simulation émotionnelle que nous souhaitons définir au travers de cette étude, nous le verrons10. La précision donnée de la feintise de Renart fonctionne ainsi comme un argument critique immanquable dans ce tableau de la ruse émotionnelle du goupil. Davantage que de tromper son monde, Renart trompe en outre des moines. Surtout, il rompt pour ce faire le rapport de concordance entre intériorité et extériorité, tant discuté et exigé à l’époque médiévale, nous le verrons tout au long de nos analyses, et, ce, au sujet le plus intime, mais aussi le plus exigeant peut-être, celui de sa dévotion. La ruse de Renart révèle ce faisant toute la portée potentielle des jeux émotionnels qui peuvent s’intégrer dans diverses machinations au fil de ses aventures.
Les jeux émotionnels ne viennent cependant pas seulement supporter les stratégies honteuses de Renart. Bien au contraire, ils peuvent aussi être prêtés à ses victimes, telles que Brunmatin qui, dans la dixième branche du roman, s’efforce de simuler l’amour à son égard :
Brunmatin, qui tot an tranblant
li faisoit d’amor .I. sanblant,
ne li osoit riens refuser,
que mout redoute l’ancuser11
On est bien loin de la ruse gratuite de Renart, du moins seulement animée de son souhait de tromper et de bénéficier ainsi des avantages propres aux Frères qu’il imite si vilement. Si Brunmatin choisit lui aussi de feindre ses émotions, c’est par peur de Renart. Le champ sémantique 68de la peur irrigue ce court passage et se marque en particulier dans les tremblements qui viennent la manifester en dépit des efforts de Brunmatin pour la maîtriser. Ils traduisent bien toute sa difficulté à camoufler sa peur qui, de manière intéressante, est à la fois l’objet et le moteur de la dissimulation que Brunmatin cherche à mettre sur pied. C’est elle qui inspire cette apparence d’amour qu’il tente d’afficher. L’une et l’autre de ces émotions sont ainsi rapprochées dans la rime qui vient souligner leur contraste. Aux tremblements de Brunmatin succède en effet son apparence d’amour. On observe ainsi l’un de ces doubles jeux typiques des efforts de dissimulation, renforcés par une simulation de l’émotion inverse. Mais davantage que l’efficacité du jeu mobilisé, il permet de révéler sa difficulté. Le sanblant d’amour que Brunmatin veille à afficher va, de manière sans doute incompatible, de pair avec les tremblements qu’il ne peut réfréner, dans une attitude émotionnelle des plus ambigües. La différence est criante avec la propre manipulation émotionnelle de Renart. L’accent y était mis sur la maîtrise totale de son apparence, au contraire de Brunmatin qui ne parvient à contenir cet indice extrême de sa crainte. Si ces deux passages se rapprochent par la même démarche de simulation, on note surtout toutes les différences qui les séparent. Les jeux émotionnels de Renart et de Brunmatin s’opposent ainsi en terme d’efficacité, mais surtout en terme d’émotions mobilisées. Tous deux veillent à manifester des émotions que l’on pourrait qualifier de positives, la dévotion ou l’amour. La logique du jeu mis sur pied diffère néanmoins grandement. Là où Brunmatin tente de mimer l’amour par peur et justement pour mieux camoufler sa peur, Renart feint la dévotion sans aucun investissement émotionnel avéré. Tout le jeu de décalage entre la peur ressentie et camouflée de manière si maladroite chez Brunmatin ne laisse place qu’à l’absence d’émotions ressenties par Renart. Si sa simulation en paraît plus efficace, elle souligne aussi combien cette dévotion qu’il affiche n’est fondée sur aucune réalité. Cela laisse surtout transparaître la nuance d’intentions qui animent ces deux jeux. Ils touchent ainsi à la question de l’intention – si chère aux théologiens médiévaux – qui incite au jeu émotionnel. L’objectif poursuivi par Brunmatin en se composant cette mine bienveillante n’est en effet pas tant de tromper Renart que d’éviter de se faire dénoncé par Renart en lui déplaisant. Cette volonté ne peut que contraster face à la volonté générale de ruse de Renart tout au long 69du roman. Cette nuance semble en induire une autre, dans la mise en scène même de la simulation, bien plus assurée dans le cas de Renart, expert des ruses éhontées. Cette opposition remarquable quant aux méthodes et aux objectifs poursuivis dans la mise en place de la ruse relève de la portée publique et morale des attitudes émotionnelles. La simulation de Brunmatin s’intègre dans ce souci obsessionnel des apparences et de l’honneur dans la société médiévale, au contraire de celle de Renart inspirée par son seul sens de survie. Renart fait d’ailleurs plus globalement preuve d’un grand désintérêt face aux lois courtoises. Ce désintérêt, bien au-delà de son indifférence marquée à plusieurs reprises face à la cour du roi Lion ou aux conventions de bienséance, impliquerait un désinvestissement total du poids qu’exercent les codes sociaux sur l’attitude émotionnelle, dont nous pourrons citer tant d’exemples. Cela ne légitimerait pas seulement cette forme de gratuité des simulations d’émotion présentées par Renart, mais pourrait même expliquer la sincérité émotionnelle qui le caractérise si souvent. Cette spontanéité presque bonhomme nous paraît en effet tenir à son indifférence à l’égard des normes comportementales, Renart ne démontrant à aucun moment le besoin de se conformer aux valeurs attendues. L’absence de contrôle et de dissimulation qui sous-tend cette sincérité pourrait ainsi relever du désintérêt social dont Renart fait preuve tout au long du roman. Ces précisions induisent un constat plus général quant à l’emploi et à la manipulation des émotions dans une perspective sociale. Il semblerait logique que ce désintérêt face aux normes traduise une position sociale hors du champ d’influence de ces codes, mais surtout favorise, dans le cadre des émotions elles-mêmes, une plus grande propension à la simulation qu’à la dissimulation, qui paraît davantage rattachée au phénomène de contrôle que requièrent ces normes sociales. Brunmatin ne simule l’amour que pour mieux dissimuler sa peur, son intention relevant plutôt de la nécessité de garder sa peur cachée par peur de représailles ou d’atteinte à son honneur, que de la ruse. Il s’agit là d’un paramètre de grand intérêt, que nous ne manquerons pas d’intégrer dans nos analyses d’œuvres à composante bien plus courtoise, à commencer par les romans de Tristan. Le Roman de Renart livre un tableau particulier des émotions, très sincères de manière paradoxale dans ce roman de la ruse par excellence, et propose ainsi quelques premières pistes de réflexion quant aux dimensions utilitaires, sociales et intentionnelles qui 70entourent le phénomène émotionnel. Surtout, ces deux seuls exemples, parmi tous ceux que nous pourrons citer dans la suite de nos analyses, témoignent déjà de toute la diversité des situations dans lesquelles les jeux des émotions peuvent s’inscrire.
Ces premiers constats trouvent écho dans les fabliaux, eux aussi baignés de cet esprit de ruse incarné par Renart. Inutile de rappeler combien la ruse s’avère essentielle dans la trame des fabliaux12. Mais surtout, eux aussi mettent en scène des personnages peu concernés par les normes de bienséance que l’on peut observer dans les romans courtois. Ils présentent dans ce sens peut-être la même inclinaison à la simulation plutôt qu’à la dissimulation discrète. On pourrait y lire cette fois une tendance sociologique. L’appartenance sociale des protagonistes des fabliaux pourrait en effet conditionner leur rapport à la ruse. Bien loin des rois et chevaliers héros des romans arthuriens, les héros des fabliaux se rattachent à des classes sociales moins élevées, celle des marchands, des artisans et des paysans13. Cet écart social, mis en exergue dans une portée humoristique, se déclinerait ainsi également sur le pan émotionnel. Au-delà de la propension aux bas instincts et aux instincts rusés, il pourrait conditionner l’attitude émotionnelle de ces personnages. Souvent, il s’agit de personnages jeunes, d’autant moins disposés à contrôler leurs émotions14. Comme le résume Brînduşa Grigoriu au sujet de La pucele qui vouloit voler : « aucune instance sociale ne vient la censurer15 ». Son constat pourrait en réalité s’appliquer à une grande majorité des héros de fabliaux, libérés des normes sociales par leur position, leur âge ou leur sexe. Nous retrouvons ainsi la même sincérité 71étonnante autour des émotions que chez Renart. Cela transparaît dans les épisodes de manifestation si souvent extrême des émotions mises en scène, mais aussi dans la faible proportion d’épisodes de dissimulation émotionnelle. Surtout, on perçoit l’influence du bas-ventre dans la plupart des jeux émotionnels identifiés, qui relèvent, comme chez Renart, d’instincts primaires tels que la faim ou surtout le désir sexuel bien sûr.
Dans ce contexte de ruse généralisée, il est intéressant de relever une dénonciation de la fausseté, justement fondée sur les apparences émotionnelles. Rutebeuf critique en effet les attitudes hypocrites des envieux dans le prologue du Testament de l’Asne :
Des mesdizans i aura sis
Et d’envieux i aura nuef ;
Par derrier nel prisent .i. oef
Et par devant li font teil feste
Chacuns l’encline de la teste16.
Comme dans le cas de Brunmatin, le jeu émotionnel se voit redoublé : les mesdizans dissimulent leur mépris et simulent la bienveillance pour mieux tromper. La condamnation de telles pratiques émotionnelles transparaît sans doute des qualificatifs de médisants et d’envieux, deux péchés tant connotés dans l’idéologie médiévale. Les mauvaises intentions que recèlent ces manipulations de leurs émotions sont ainsi explicites en touchant au vice de l’envie et surtout au véritable fléau social de la médisance dans la culture de l’honneur qui empreint la société médiévale17. Le jeu se construit sur l’opposition entre derrier et devant qui permet souvent de rythmer les occurrences de manipulations émotionnelles. Le caractère formulaire vient renforcer la portée dépréciative d’une telle feste qui ne cache en réalité que le peu d’estime porté, comparé à un oef. Rutebeuf donne plus de poids encore à cette condamnation en lui conférant une portée générale. Il l’élève au-dessus de toute considération de classe sociale que l’on pourrait 72rattacher aux fabliaux, la médisance et l’envie étant d’ailleurs plus souvent décriés chez les flatteurs de cour que chez les paysans. Mais, même dans cette perspective critique, l’exemple prend une portée sociale. On perçoit d’emblée toute l’importance conférée à l’émotion et à sa manipulation sur la scène publique, qu’elle soit nécessaire ou, au contraire, condamnée. Ce passage permet aussi de confirmer la place du critère essentiel dans l’évaluation des jeux émotionnels qu’est l’intention. Mais il nuance aussi la perception des dynamiques de jeux, surtout quand la dissimulation se mêle à la simulation. De tels doubles jeux restent assez rares dans le reste des fabliaux, qui cantonnent les manipulations émotionnelles à un mode plus réduit et peut-être plus simple. Ils s’avèrent en ceci aussi conformes à la simplicité affichée chez les personnages de fabliaux, dans leur expression émotionnelle comme dans leur manipulation.
La part critique de la ruse mise en scène dans les fabliaux touche de manière bien plus spécifique les femmes que les médisants décriés par Rutebeuf. Selon l’esprit ludique, mais aussi misogyne qui caractérise ce corpus, les femmes sont par définition fausses et disposées à tromper leur mari avant tout18. Le fabliau La dame qui demandoit aveine pour Morel sa provende avoir offre un exemple éclatant de cette idéologie anti-féminine. Comme pour mieux la dénoncer, il cherche même à identifier les causes qui poussent la dame à la ruse :
Mais savez por qu’ele le fist ?
Pour mieus enlachier son mari
Et faire son voloir de li
Car fame, selonc sa nature,
La riens que mieus ara en cure
Et tout ce que mieus li plaira,
Dou contraire samblant fera19.
73Ces vers mettent bien en lumière l’ensemble des stéréotypes qui entourent la figure de la femme au sein des fabliaux. Le narrateur souligne aussi bien les intentions trompeuses, d’enlachier, le comportement faux selonc nature, que le désir qui anime la femme, de toujours chercher à faire ce que mieus li plaira. L’attitude fausse présentée comme typiquement féminine au fil de divers fabliaux semble en effet s’inscrire directement dans une optique toute subjective de désir. La femme, dépeinte comme bien davantage mue par ses émotions – liées aux plus primaires penchants de la faim et du désir dans les fabliaux –, est logiquement disposée à la tromperie par la conduite inconsidérée que celles-ci induisent. Tour à tour fausse par faim ou par désir sexuel, la femme se joue, souvent aux dépens de son mari, de l’apparence qu’elle renvoie dans une volonté de tromperie bien appuyée dans les fabliaux. La volonté explicative de ce passage souligne toute la malignité prêtée ainsi aux femmes et leur inscription dans cette dynamique du bas-ventre propre à ce corpus. Mais ce qui est donc présenté relever de la nature des femmes, davantage que leur nature trompeuse, c’est leur propension à jouer de leurs apparences. En se définissant comme forcément contraire à leur désir véritable, le samblant se veut lié à la sphère émotionnelle ainsi manipulée par les femmes pour asseoir leur domination sur leur époux. Mais il est surtout intéressant de noter que nulle émotion ne se voie en réalité convoquée dans ce passage, comme pour mieux souligner leur absence en contraste avec celles que les femmes affichent sur leur samblant pour parvenir à leurs fins. La seule apparence d’émotions constitue en effet une catégorie importante des jeux que nous aurons à cœur d’analyser, dans une logique d’ailleurs rendue d’autant plus intéressante par leur absence avérée.
Mais le jeu se veut parfois bien plus investi dans la sphère émotionnelle qu’il ne l’est ici dans cette séquence de dénonciation de la ruse féminine. Selon cette tendance misogyne bien attestée, l’émotion la plus souvent mobilisée par ces femmes astucieuses est la tristesse. En accord avec un autre stéréotype de la nature féminine, les femmes sont fort sujettes à cette émotion significative de leur condition sensible. Jouant de ce préjugé, les héroïnes des fabliaux intègrent à leur ruse des fausses larmes. Le fabliau Les Tresces joue de leur portée trompeuse. Tour à tour conseillées et simulées, les larmes sont au cœur des stratagèmes de l’épouse rusée. La manipulation y est explicite, selon une habitude assez commune d’insistance sur la ruse dans tous ces récits. La narration 74précise : « Fait cele qui par guile pleure20 ». Conformément à l’esprit des fabliaux, la ruse est assumée. Mais plus encore, elle vient ici déterminer les larmes qui, plutôt que d’être conditionnées par la tristesse qui les suscite, répondent à cette origine trompeuse. Le détournement des larmes, indice le plus formel peut-être et dès lors le plus manipulé de la tristesse, se marque ainsi dans la construction même de ce passage. La référence à la guile témoigne de la visée rusée sans aucun détour. Elle est significative du processus et de l’intention de ruse qui motive ces larmes21. Le fabliau De Jouglet joue d’ailleurs de la même formule révélatrice de la nature feinte des larmes :
Cele qui mout savoit de guile
Li dist, aussi comme en plorant22
Davantage que de pleurer par guile, le dame est dite cette fois toute à fait experte en la matière. Forte de ce savoir, elle mime les larmes, pas moins trompeuses que celles de la dame des Tresces. L’expression comme en vient marquer de manière intéressante la nuance, avec une ironie propre aux tonalités humoristiques des fabliaux. On constate la fréquence du recours aux manifestations physiques des émotions ainsi manipulées, tout comme dans le Roman de Renart. Les larmes remplissent parfaitement leur rôle d’outils d’illusion de l’émotion, en jouant de cette association si souvent détournée entre l’émotion et ses symptômes physiologiques. Le fabliau Des .III. dames qui trouverent l’anel élève ce stratagème à un niveau encore supérieur. L’une de ses trois protagonistes ne se contente plus d’apparaître en larmes, mais même de feindre défaillir sous l’intensité de sa peine :
A la terre chéi pasmée ;
Par faint sanblant s’est demorée
Une grande piece a la terre ;
Samblant fet que li cuer li serre23.
75La simulation s’expose encore une fois dans toute son ampleur, soulignée par le lexique éloquent employé pour insister sur la part feinte de cet évanouissement. Par trois fois, le malaise ainsi mis en scène est répété, avec une répétition en outre de la terre jusqu’à laquelle cette tristesse intense fait chuter la dame. L’insistance est bien sûr révélatrice d’une forme de surjeu et donc de condamnation. Autre répétition notable, le sanblant apparaît à deux reprises. Ce terme cristallise un point central de notre approche des émotions en même temps qu’il la problématise dans toute son ampleur de par l’ambiguïté qu’il véhicule24. Il apparaît bien souvent pour marquer le jeu qui s’opère entre l’émotion elle-même et l’apparence qui en est finalement livrée, cachée ou simulée. S’il peut rester ambigu quant à la nature trompeuse de l’apparence en question, le sanblant relève sans aucun doute possible de la ruse ici. Sa répétition viendrait d’ailleurs plutôt indiquer la manipulation, tout en soulignant tout l’intérêt porté à la visibilité de ce jeu orienté vers un public que la dame cherche à tromper. Il s’agit là d’un autre paramètre essentiel de ces jeux émotionnels construits en regard de l’auditoire auquel ils se destinent. La qualification du sanblant comme faint ou son inscription dans la formule, aujourd’hui tout à fait univoque, faire semblant confirment sa portée trompeuse. Pareille emphase sur la ruse sert bien sûr à tourner en ridicule la naïveté du mari trompé qui ne perçoit pas que sa femme se joue de lui et surtout de cette tristesse prétendue de le voir la quitter pour entrer dans les ordres, quand elle a en réalité tout orchestré pour y parvenir et gagner contre ses amies l’anneau fait trophée de leur aptitude à la ruse. De manière significative quant au jeu de décalage opéré, le semblant vise à mimer un état du cuer. La nuance entre extérieur et intérieur se veut ainsi très subtile. Le renversement est notable, condensé sur un seul vers. Il se marque aussi dans la construction de l’émotion, entre celle faite par la dame et celle dont elle mime être l’objet quand le cœur lui serre. Il ne subsiste en réalité que celle qu’elle affiche, qu’elle prend en charge au contraire de celle qui devrait l’étreindre. La part proactive de la ruse émotionnelle ne saurait être plus explicite, tout comme l’absence d’émotions qui la sous-tend. On retrouve ainsi la dynamique frauduleuse des émotions de Renart, uniquement simulées, au contraire de Brunmatin 76qui n’en feint que pour mieux camoufler celles qu’il éprouve si amèrement. Tout comme dans le Roman de Renart, les jeux émotionnels relèvent avant tout de la simulation pour s’intégrer dans les stratégies rusées mises sur pied avant tout par les protagonistes féminins des fabliaux.
La polarité entre simulation et dissimulation qui se dessine ainsi gagne en importance au travers des quelques exemples de dissimulation que le corpus des fabliaux présente néanmoins également. Deux occurrences de dissimulation se lisent dans le fabliau des Braies au cordelier. Dans l’esprit ludique inscrit, au cœur des fabliaux, autour de la littérature courtoise, c’est l’amour qui fait l’objet de ce processus de camouflage. Il s’agit là d’une injonction des plus communes dans la poésie amoureuse courtoise, obsédée par la loi du secret posée au centre de son émotionologie25. Le fabliau se fait le relai de cette emphase mise sur la discrétion de l’amour, ainsi instillée jusqu’à cette part nettement moins courtoise pourtant de la littérature médiévale : « Qui aime, il doit s’amor celer26 ». Cette recommandation à caractère proverbial joue de la tradition en la matière. Elle vient mettre en valeur le bienfondé de la dissimulation amoureuse sous la forme d’une sorte de vérité générale. La volonté même d’aimer, et nous savons toute l’importance de la volonté, réside dans les efforts à démontrer pour garder l’amour celé. Avant même cette sentence éloquente, le fabliau s’arrêtait dans son introduction sur cet impératif de la dynamique amoureuse :
A feme, qui tel mestier fait
Et qui veut amer par amors,
Couvient savoir guenches et tors,
Et enging por soi garantir ;
Bien covient que saiche mentir,
Tele eure est, por couvrir sa honte27.
La dynamique amoureuse en question se voit néanmoins détournée ici au profit de cet esprit de ruse propre aux fabliaux. L’insistance sur le sujet est immanquable, au gré des références aux guenches, aux tors, à l’enging et 77même aux mensonges dont l’amour se teinte ainsi. Le détournement est assuré par la précision donnée du public visé par ces recommandations, qui touchent à ceux qui souhaitent amer par amors. La redondance révèle autant la concentration sur ce public que le jeu opéré à ce niveau. Elle joue elle aussi de la volonté marquée ainsi, tout comme dans le passage précédent qui insistait sur le désir d’aimer. Plus encore, on retrouve l’idée de la convenance ainsi que celle de la garantie et de la couverture, propres aux feeling rules des amants qui touchent en effet à l’honneur essentiel de la dame. L’entremêlement des normes amoureuses et de la ruse se veut complet dans ce passage. Il n’est cependant question que de dissimulation, de couvrir la honte, sans référence explicite aux simulations que peuvent impliquer les guenches et tors en question. Le fabliau se veut ainsi conforme à la tradition de la fin’amor qui pose comme enjeu central de son émotionologie la discrétion amoureuse. Elle relève bien de la honte à éviter à tout prix, mais on perçoit bien sûr ainsi comment pareille mise sous silence peut aussi se prêter aux enging des femmes. Qu’ils touchent à la dissimulation ou à la simulation, les jeux émotionnels s’intègrent ainsi dans les démarches trompeuses prêtées aux héros, et surtout aux héroïnes, des fabliaux. Il s’agit là d’une différence majeure avec le Roman de Renart où l’émotion restait presque exclue du champ de la ruse. On reste néanmoins dans une dynamique proche de celle de l’art de Renart. Les manipulations des émotions se prêtent aux vils desseins de personnages animés d’un désir de tromper des plus mal intentionnés. Même la discrétion amoureuse vise bien davantage qu’un souci de garantie au gré des guenches qui l’assurent. Une telle mise en lumière des intentions trompeuses doit bien sûr se lire en regard du contexte de rédaction des fabliaux, contes à rire centrés sur des personnages définis par leur non-courtoisie. Leur détachement des règles sociales se veut explicite chez ces hommes, et surtout ces femmes, du bas-peuple. Leur ignorance des normes courtoises est ainsi revendiquée aussi bien par leur classe sociale que par leur genre et leur jeune âge. La propension à la ruse paraît se justifier du même mouvement, bien loin de l’esprit instillé dans les romans de Tristan.
Insaf Machta, qui s’est consacrée à l’analyse de la « poétique de la ruse » dans les récits tristaniens, souligne le peu de mise en valeur de la ruse en dépit de la récurrence des stratagèmes de feintise28. Les romans 78de Tristan n’accordent pas la même place à ces objectifs de tromperie et se vident de la dimension purement ludique qui les entoure dans les fabliaux ou le Roman de Renart29. Ils se caractérisent plutôt par un certain sérieux de ton, qui vient également connoter le traitement émotionnel. Mais tout comme dans les fabliaux et le Roman de Renart, la saga tristanienne est marquée par un contraste entre la tendance rusée de ses aventures et la place réservée aux instances affectives. De manière paradoxale, elle se voit animée d’une grande sincérité émotionnelle. En-dehors de la thématique générale de l’amour caché, la souffrance des amants, au moment de leurs séparations par exemple, se livre dans toute son intensité, et ainsi avec une véracité indéniable. L’univers amoureux semble lui-même habité par cette tension entre la force et donc l’irrépressibilité des émotions qu’elle implique et l’injonction à la discrétion qui pèse sur elles. Il s’agit là d’une intuition que nous aurons à cœur de vérifier à l’issue de cette analyse préliminaire, en particulier au gré du chapitre que nous dédierons à la sphère amoureuse des normes émotionnelles. Dans la multitude de ruses mises sur pied par les amants et leurs opposants pour préserver ou dévoiler leur amour, il arrive bien sûr que les émotions soient mobilisées. Mais s’il y est souvent question de simulations – et l’on perçoit ainsi toute l’importance accordée aux apparences, pas seulement émotionnelles –, c’est plutôt hors de la sphère affective qu’elles se situent. Pensons à la simulation de sommeil de Tristan30 ou à celle, célèbre, de Tristan qui feint d’être atteint par la lèpre dans le roman de Béroul31. L’importance de l’investissement affectif dans ce triangle amoureux conduit tout de même à l’une ou l’autre situation lors de laquelle les personnages, et pas seulement les amants comme nous pourrions nous y attendre, font preuve de simulation ou de dissimulation de leurs émotions réelles. De manière logique, c’est du côté de l’amour, de la peur et surtout de la tristesse que se concentrent la plupart des occurrences de jeux des émotions dans ces romans tristaniens centrés sur les péripéties d’un couple d’amants adultères dépeints comme des victimes de leur amour. Les manipulations émotionnelles paraissent en effet d’emblée justifiées dans ces romans qui cultivent autant l’art du secret que celui de l’amour, essentiel dans ces œuvres 79qui offrent de véritables modèles de l’idéologie de la fin’amor32. L’amour s’y érige comme le paradigme des émotions accablantes, caractérisé par sa force de possession et par son inévitabilité33 et confronté, avec toutes les difficultés que cela engendre, au rapport de sociabilité étroit dans lequel le couple de Tristan et Yseut s’inscrit34. Brînduşa Grigoriu souligne dans ce cadre l’importance des démarches de figuration, de face-work selon la notion d’Erving Goffman, comme moyen légitime de défense35. L’intrigue entière paraît fondée sur l’exploration du motif du secret révélé, posé au cœur d’une opposition entre loi et amour par le prisme de l’enjeu du flagrant délit36. Se pose donc la question du caractère réalisable du secret amoureux, que les amants s’ingénient à préserver en dépit de la complexité de composer avec la violence de leur affection. Tristan et Yseut permettent ainsi de repenser le paradoxe de l’émotion partagée entre authenticité et dissimulation. Nous avons pu noter l’intensité de l’amour qu’il se portent, son caractère le plus souvent irrépressible. Rares sont donc en proportion les occurrences de manipulation émotionnelle dans les romans tristaniens, surtout au vu de la dimension de ruse incontournable qui les empreint à tout autre niveau. Le secret de leur amour dicte néanmoins un besoin crucial d’en taire les apparences, et surtout celle de cet amour coupable. Cependant, les exemples de manipulation de la tristesse chez les amants ne relèvent pas de la dissimulation, mais plutôt de la feintise. Poussés par le désir de préserver leur amour, Tristan et Yseut semblent eux-mêmes faire ainsi gagner du terrain aux procédés de ruse émotionnelle. En effet, davantage qu’à une simple dissimulation de leur affection, c’est le plus souvent à de véritables mises en scène d’émotions qu’ils se prêtent pour protéger leur relation, selon un stratagème essentiel dans l’éthique amoureuse37, de tromper pour éviter de l’être par leurs ennemis. Le roman de Béroul, 80animé par cet esprit de ruse que peut impliquer le récit d’un amour adultère, témoigne de la feintise émotionnelle requise dans ce contexte. Dès les tout premiers vers conservés du roman, Yseut est mise en scène simulant la tristesse : « Or fait senblant con s’ele plore38 ». Nous pouvons noter l’implication physique qui caractérise d’emblée ce jeu émotionnel. C’est par ses symptômes corporels que s’exprime la tristesse jouée par Yseut. Cette manifestation de la tristesse par les larmes renforce évidemment l’ampleur de l’émotion et plus encore de la feintise dont fait preuve Yseut. Nul besoin d’expliciter la forte valeur que confèrent les larmes à ce processus : elles apparaissent comme le témoin sincère de la douleur et contribuent donc efficacement aux enjeux de la simulation. Il s’agit là d’un paradigme commun au sein des jeux des émotions qui recourent volontiers au corps, souvent considéré intrinsèquement authentique et honnête dans la pensée médiévale, pour mieux convaincre des émotions mises en scène. Tous les cas de feintise ne poussent pas aussi loin la démarche, mais il est intéressant de constater que de nombreuses occurrences incluent ainsi le corps, le visage du moins. C’est à nouveau le cas lorsque Tristan, dans un épisode fameux, se déguise en lépreux et affecte la douleur en portant la reine sur son dos :
L’un pié sorlieve et l’autre clot :
Sovent fait senblant de choier,
Grant chiere fait de soi doloir39.
Tout le corps est ici engagé dans la ruse de Tristan, puisqu’il mime aussi bien la chute qu’il ne tord son visage d’une douleur tout apparente. L’exagération marque l’ensemble des symptômes que Tristan choisit de manifester, comme pour mieux consolider son jeu émotionnel. La feintise est rendue explicite par le lexique qui sert à le décrire : on retrouve le verbe faire, qui témoigne de la dimension proactive de cette manifestation d’émotions dans la formule faire semblant, mais aussi dans celle faire chiere, l’une et l’autre renforcées par l’adverbe de fréquence sovent et par l’adjectif de grandeur. La rime entre choier et doloir atteste l’importance accordée, au cœur de tous ces stratagèmes, à la sphère corporelle comme témoin incontestable de l’implication émotionnelle. Ce passage nous renseigne en outre sur la fonction importante que peuvent revêtir les simulations 81d’émotions dans la trame du roman. Cette scène quasi théâtrale s’insère en effet dans le cadre de la ruse plus générale, et bien plus essentielle à l’histoire des amants, d’Yseut, qui recourt à ce stratagème de se faire porter par Tristan, rendu méconnaissable par son apparence de lépreux, pour pouvoir honnêtement jurer n’avoir eu entre ses cuisses d’autres hommes que le roi et cet homme qui l’a portée juste auparavant. La visée utilitaire de cette feintise émotionnelle apparaît très clairement ici, puisqu’elle permet à la reine, à l’heure de ce quasi-procès qui lui est intenté, de se voir lavée de tout soupçon quant à son présumé adultère, mais aussi ainsi de le poursuivre. Nous rejoignons en ceci les analyses proposées par Insaf Machta de l’univers tristanien : « La ruse, qui est souvent au service de cette quête [de la proximité physique], se présente comme le moyen, souvent incontournable, de l’actualisation du désir40 ». Uniquement animés par ce désir, Tristan et Yseut ne semblent recourir à ces manipulations émotionnelles qu’à la seule fin d’en assurer la réalisation dans cette proximité physique tant recherchée, évidente dans un contexte amoureux et plus encore quand elle se voit problématisée dans ce cadre d’amour adultère. L’intention trompeuse y est néanmoins soulignée, loin de la complaisance affichée à l’égard des amants dans le Lancelot Graal par exemple, nous le verrons. À cet égard, il est significatif que les émotions mobilisées ne relèvent jamais de ce sens de la bienséance recommandé par la société courtoise. Au contraire, Tristan et Yseut préfèrent simuler la tristesse, la douleur, et même la colère, comme pour mieux démontrer leur souhait de duper pour camoufler leur amour. Le dernier passage que nous aimerions citer du roman de Béroul atteste ce renversement. Tristan y est invité par Brangien à simuler la colère à son égard pour faire face aux soupçons du roi et de son entourage :
Fai grant senblant de toi proier,
N’i venir mie de legier.
Se li rois fait de moi proiere,
Fai par senblant mauvese chiere41.
Le bel semblant, au cœur de la plupart des recommandations qui touchent à la sphère émotionnelle, se trouve ici inversé dans la mauvese chiere que Tristan doit laisser apparaître, dans une perspective fausse assumée par 82la formule faire par semblant qui l’introduit. La rime qui est présentée entre la prière du roi et la mauvaise chiere de Tristan rend explicite le lien qui se forge dans la nécessité de paraître plus hostile à Brangien qu’il ne l’est en réalité. L’introduction du jeu émotionnel au sein des conseils prodigués par l’adjuvante des amants qu’est Brangien est intéressante. Elle fait état de la place qui peut être accordée aux manipulations d’émotions dans les stratagèmes déployés par les amants, de leur importance pour parvenir à leurs fins. Elle joue en tout cas d’une tradition portée par les arts d’aimer, faits de conseils et incitations de ce type, tout en la renversant. On pourrait y lire une inversion remarquable des rôles sociaux de sexe, la femme se faisant la conseillère de l’amant, au contraire des logiques attestées dans la plupart des exemples que nous pourrons en citer, mais surtout reconsidérer à cette aune42.
La Folie Tristan d’Oxford présente également un cas de figure intéressant, qui atteste l’inscription des manipulations émotionnelles dans une perspective plus vaste visant la survie et l’accomplissement de l’amour. Ainsi, Tristan choisit de dissimuler son angoisse pour assurer le succès de son projet de rejoindre l’Angleterre et Yseut :
Vers tute gent se cele e doute.
Ne volt vers nul descovrir le dute.
Il s’en celet, s’en est la fin,
vers sun cumpaingnum Kaherdin,
kar ço cremeit, si li cuntast,
de sun purpens k’il l’en ostast,
kar ço pensout e ço voleit
aler en Engleterre droit43
On nous présente donc Tristan se celer, à deux reprises sur quelques vers seulement, de sa douleur de vivre sans Yseut, mais aussi de son purpens, de sa résolution – bien mise en exergue par le doublet pensout et voleit – de mettre fin à ses souffrances en retrouvant Yseut. La dissimulation 83centrée sur Kaherdin, son ami et confident, témoigne de la distinction qui s’opère avec les occurrences qui visent la simple discrétion. Ici, un objectif plus global est prêté à Tristan, le texte lui-même le souligne : s’en est la fin. Et c’est celui-ci davantage que le secret de son amour qui se veut assuré par sa dissimulation. Ainsi, on peut nuancer une approche de la simulation comme relevant de manière explicite de la ruse par contraste avec la dissimulation, inscrite dans un souci de bienséance ou de secret seulement. Et tout autant que la dissimulation peut dépasser les enjeux de convenance pure ou de secret en soi, la simulation peut s’inscrire dans une volonté plus basique disons de discrétion amoureuse, comme on pouvait l’observer dans le roman de Béroul.
La ruse s’insère donc avec subtilité parmi les enjeux cruciaux de l’éthique de la fin’amor que sont le secret et la bienséance, nous voudrions le démontrer dans la suite de nos analyses. Elle semble profiter de la justification, offerte par les traités d’amour que nous aurons à cœur d’analyser, du recours à la dissimulation. Elle se légitime même comme un moyen de défense tout aussi acceptable pour préserver l’amour. Des nuances s’esquissent cependant, entre les démarches de dissimulation ou de simulation, selon les émotions impliquées surtout – l’atmosphère trompeuse imprégnant davantage les fausses colères que les fausses joies –, les personnages qui se prêtent à ces manipulations – dame, amant, ou opposant des amants. Le roman de Béroul s’avère ainsi un excellent point de départ pour explorer et affiner la dichotomie entre simulation et dissimulation et la tension entre la sincérité et le jeu des émotions qu’il met bien plus en scène que les autres œuvres du corpus tristanien. On le voit ainsi, quand elle se trouve intégrée au récit, la ruse émotionnelle porte celle, plus générale, qui en anime la trame même. Elle n’est donc jamais gratuite et, au contraire des enjeux parfois triviaux des personnages de fabliaux ou de Renart, conditionne la survie de leur amour, si ce n’est la leur même. Tout comme dans tous les exemples de simulation que nous avons pu citer jusqu’ici, le jeu se fonde sur les indices corporels affichés, avec un excès révélateur de la ruse le plus souvent. Il pourrait également s’agir d’un signe de la dépréciation portée sur de telles démarches trompeuses, quel que soit l’esprit de légitimation général des ruses animées par la loi du secret amoureux. Les connotations dont s’entourent tous ces exemples quant aux objectifs exacts poursuivis par les amants constitueront un objet 84d’étude fort intéressant pour mieux saisir les logiques à l’œuvre dans l’émotionologie amoureuse. Elles paraissent d’ailleurs directement toucher à la tension que nous pouvons percevoir entre cet esprit de ruse omniprésent dans le roman de Béroul en particulier et la faible proportion de ruses émotionnelles à proprement parler.
Si les stratégies trompeuses s’y avèrent tout aussi essentielles aux aventures des amants que dans le roman de Béroul, le roman de Thomas joue autrement des émotions qui y sont intégrées. L’amour adultère qui lie Tristan et Yseut les pousse ici davantage à cacher leurs émotions qu’à en feindre d’autres pour parvenir à leurs fins. C’est particulièrement le cas de Tristan une fois marié à Yseut aux Blanches Mains dans le roman de Thomas. Alors exilé loin de la cour de son oncle, le roi Marc, et de la belle Yseut la Blonde qui continue de faire battre son cœur en dépit de son union factice, Tristan éprouve la plus grande des difficultés à dissimuler la souffrance de cette séparation et plus généralement ses sentiments à sa nouvelle épouse :
En paine est e en turment,
en grant pensé, en grant anguisse ;
ne set cume astenir se poisse
ne coment vers sa femme deive,
par quel engin covrir se deive44.
On perçoit bien l’angoisse de Tristan, étreint par le souvenir d’Yseut, et le dilemme qui se pose alors à lui, entre la promesse faite à l’amante, de ne jamais se voir préférée, et celle, bien évidente, à l’épouse, celle de l’amour et celle du mariage. L’insistance mise sur la grande souffrance ressentie, répétée à quatre reprises sur deux vers seulement, exacerbe l’embarras perceptible de Tristan pour dissimuler ses tourments. Cette dissimulation est néanmoins présentée comme impérative à mettre en œuvre par la répétition du verbe devoir, ainsi que par la mention de l’abstention, qui soulignent l’importance de cette obligation fondamentale du secret. Mais le terme engin met aussi en lumière la dimension manipulatrice indubitable de cette dissimulation. Il joue de l’ambiguïté de cette discrétion trompeuse dans cet entremêlement de relations, amoureuse et conjugale, et du respect que Tristan doit à la fois à son amante et à son 85épouse. Le texte revient un peu plus loin sur cette nécessité de dissimulation, aussi malaisée soit-elle, et alors hors de toute considération de ruse, pour dépeindre les efforts, toujours confus, de Tristan pour y parvenir :
Por iço fist il ceste image
Que dire li volt son corage,
Son bon penser e sa fole errur,
Sa paigne, sa joie d’amor,
Car ne sot vers cui descovrir
Ne son voler ne son desir.
Tristran d’amor si se contient45
Le narrateur nous relate le recours de Tristan à une statue auprès de laquelle il peut laisser libre cours à sa peine et à ses doutes, à défaut de confident à qui il pourrait honnêtement ouvrir son cœur. La rime entre image et corage rend compte de l’importance accordée à cet artifice rendu indispensable par l’intensité des émotions que Tristan doit camoufler. On note l’entremêlement des émotions éprouvées et dès lors dissimulées à tout son entourage par Tristan : amour, regret, peine, joie, désir. L’acte créateur qui est à l’origine de la statue et donc de la confidence est bien explicité en début de citation. Il met en exergue le désir de dissimulation et sa difficulté persistante, en démontrant les efforts fournis par Tristan et les réalisations qui lui ont été nécessaires pour parvenir à garder cachées ses émotions, à les contenir. Mais il offre ainsi une forme de consolation dans l’art à la désolation de Tristan face à la séparation et aux enjeux complexes de la discrétion à laquelle il doit veiller46. Par le terme qui clôt le passage, on en revient à l’influence courtoise qui pèse sur le souci de Tristan de contrôler ses émotions, du moins le semblant qu’il en offre, bien loin des seules considérations de ruse. On perçoit ainsi toute l’importance que peuvent revêtir les manipulations émotionnelles, le dénouement du roman se basant essentiellement sur le silence de ses émotions de la part de Tristan.
À ces jeux de dissimulation de Tristan, le narrateur fait répondre ceux mis sur pied par Yseut aux Blanches Mains. Ils se caractérisent 86par toute l’intensité de son amour vain pour Tristan et de sa colère de se voir ainsi trompée. Ces émotions fortes ne l’empêchent de les manipuler pour tromper à son tour Tristan, et le mener d’ailleurs à sa fin tragique. La portée narratologique du jeu des émotions se veut éclatante, puisqu’il détermine l’issue même du récit. Ainsi, si Tristan dissimule sa peine d’être privé d’Yseut la Blonde, Yseut aux Blanches Mains cache la sienne de se sentir délaissée par son époux :
Bien puis dire, si l’en pesast,
ja en son tens ne le celast,
come ele l’a, a ses amis47.
Le lien tissé entre l’émotion et son secret est ici mis en exergue directement à la rime. Davantage que l’intensité de l’émotion, c’est cette fois celle de sa dissimulation qui est soulignée, qui s’avère n’avoir son pareil en son tens. Comme souvent, le public visé par les efforts d’Yseut est précisé, avec tout l’intérêt ici qu’il s’agit de son ami lui-même, là où le secret amoureux concerne plutôt la sphère extérieure au couple. La rupture avec l’optique de discrétion amoureuse habituelle paraît ainsi consommée par cet indice de désunion entre Yseut et Tristan. Au-delà du témoignage qu’il offre de la piètre qualité de ce mariage, il révèle la dynamique émotionnelle tout autre qui l’empreint, dans lequel le secret s’immisce entre les époux plutôt qu’autour d’eux. C’est ainsi que leur histoire se dégrade, non pas par le dévoilement du secret, mais par celui qui ronge d’abord leur propre relation. Bien sûr, ce secret finit par se rompre, mais c’est par un autre, d’autant plus fatal, que le récit se solde. Yseut aux Blanches Mains finit en effet par découvrir la cause de la distance de son époux à son égard, l’amour qu’il porte à Yseut la Blonde. Ce dévoilement induit alors une autre dissimulation, celle de la colère sourde qui anime dès lors l’épouse abusée :
Ysolt est en la chambre entree,
vers Tristan ad s’ire celee,
sert le e mult li fait bel semblant
cum amie deit vers amant.
Mult ducement a li parole
e sovent le baise e acole,
87e mustre lui mult grant amur
e pense mal en cele irrur
par quel manere vengee ert,
e sovent demande e enquert
kant Kaherdin deit revenir
od le mire qu’il deit guarir.
De bon curage pas nel plaint,
la felunie el cuer li maint
qu’ele pense faire, s’ele puet,
car ire a iço la comuet48.
Ainsi, davantage que celle des amants, c’est la propre ruse d’Yseut aux Blanches Mains qui se révèle la plus représentative des enjeux parfois essentiels de la simulation et la dissimulation d’émotions. Elle donne lieu à une double forme de jeu, à une manipulation totale des émotions, passant aussi bien par une dissimulation de son ire que par une simulation, longuement démontrée, de bienveillance, de mult grant amur même. Cette intensité de l’amour ainsi manifesté exacerbe bien sûr la teneur de la feintise, mais aussi le fossé qui s’installe entre l’apparence et les sentiments réels d’Yseut. Le narrateur prend d’ailleurs bien soin de préciser ensuite le désir de vengeance qui étreint Yseut et combien son cœur, bien autrement que d’amour, est empli de felunie. La répétition de la colère qui la comuet témoigne de l’intensité de son dépit. Il l’émeut, la soulève même49. Tout ceci contribue à mettre en exergue les émotions véritablement ressenties par Yseut, cette ire qui conduira alors tous ses actes. Cette colère et son camouflage se révèleront en effet capitaux pour la suite du récit : Tristan ignorant tout des nouvelles dont fut informée son épouse et de l’hostilité que celles-ci suscitèrent en elle, il ne se méfiera en rien de son comportement et de ses mensonges, particulièrement celui, crucial, proféré quant à la couleur de la voile du bateau amenant Yseut la Blonde. Plus encore, c’est sa simulation de bienveillance qui induira Tristan en erreur en endormant sa vigilance. Le narrateur insiste ainsi sur sa dimension véritablement rusée, notamment par l’opposition créée entre l’image d’amour qu’Yseut renvoie et la félonie qui lui emplit en réalité le cœur. Tout se construit donc comme si l’intrigue même du roman reposait sur ces manipulations 88du semblant amoureux, difficilement dissimulé par Tristan, faussement affiché par Yseut. Surtout, aux efforts vains de Tristan pour garder secret son amour pour Yseut la Blonde se superposent ceux, bien plus efficaces, de son épouse qui parvient ainsi à le duper et, in fine, à le conduire à la mort. Les enjeux de la dissimulation émotionnelle ne pourraient être plus grands. Elle n’est pas seulement garante de la préservation de l’amour, mais même de la survie des amants. De manière intéressante, la maîtrise des émotions, qui s’avère cruciale dans cet épisode, réside donc du côté de l’épouse plutôt que du couple, les amants se révélant inaptes à camoufler leur amour. Le renversement de l’un à l’autre de ces jeux émotionnels est notable, significatif des dynamiques diverses qui peuvent les entourer et surtout du rôle qu’ils jouent dans la trame narrative. L’exemple d’Yseut aux Blanches Mains s’écarte à la fois des enjeux de discrétion amoureuse, mais aussi de bienséance courtoise, elle relève d’une vraie dynamique de ruse, voire de vengeance inscrite dans ce processus de manipulation émotionnelle. Cet épisode met en exergue la question centrale de l’intention poursuivie, plus encore si l’on compare ce double jeu auquel recourt Yseut pour lutter contre sa colère avec celui observé chez Brunmatin, qui ne se soucie que de se prémunir de Renart. Le parallèle entre ces deux épisodes révèle toute la symbolique d’un tel processus. Dans l’un comme dans l’autre cas, on peut y voir une preuve de la puissance des émotions à camoufler, qui nécessitent de les recouvrir par une autre pour mieux y parvenir. La simulation paraît comme justifiée par ce biais, quelles que soient les intentions qu’elle sert. Bien sûr, la fausse apparence d’amour de Brunmatin et d’Yseut aux Blanches Mains ne peuvent se lire à la même aune. La nuance semble tenir aux émotions qui se voient ainsi dissimulées, la peur dans le cas de Brunmatin, la colère et même la haine dans le cas d’Yseut. Elles paraissent toutes suffisamment malséantes pour expliquer leur souci de discrétion, mais elles ne connotent pas de la même manière le jeu opéré, selon l’intention qu’elles impliquent. Le contraste se veut plus explicite encore avec le cas du roi Marc dans le roman en prose.
Pareilles double mise en scène et logique évaluative se retrouvent en effet dans les romans en prose. De manière d’autant plus intéressante, il n’y est plus question des jeux émotionnels des amants, ou en tout cas de ceux qui aiment – comme c’est encore le cas d’Yseut aux Blanches Mains –, mais du roi Marc surtout. Au contraire de cette autre épouse 89trompée, Marc agit en regard de tout autres instances de régulation. En tant que souverain de sa cour, Marc se doit d’y faire figure d’exemple et de maîtriser ses émotions sur la scène publique au centre de laquelle il trône. Pas moins touché qu’Yseut aux Blanches Mains, il recourt lui aussi à la simulation d’émotions pour mieux cacher les siennes. À de nombreuses reprises, il est dépeint éprouver une émotion de haine ou de colère, qu’il réprime et camoufle derrière une apparence bienveillante, de joie, voire d’amour. L’insistance mise sur cette mine convenante par la proximité des formules convoquées vient souligner l’importance conférée à cet enjeu de contrôle de soi et de sociabilité avenante. Décrit tour à tour « corresiés50 », « dolenz51 » ou éprouvant « mortel haine52 », Marc « mes grant semblant li fist d’amor53 » ou « neporquant si il fait semblant de joie54 ». Le renversement est mis en exergue par la conjonction adversative qui marque la transition vers ce semblant d’amour ou de joie qu’il s’efforce de faire. On perçoit tout l’intérêt de la formule faire semblant de, qui met si bien en lumière le jeu émotionnel, dans sa portée apparente tout à fait centrale. Ce semblant ne relève cependant ici en rien de la ruse. La précision donnée dans le dernier passage cité vient témoigner de la dynamique tout autre dans laquelle il s’inscrit. Le narrateur justifie en effet la démarche de Marc : « por ce que nus de leanz ne s’en aperceüst55 ». Il éclaire ainsi la particularité de ce jeu émotionnel qui ne vise pas la tromperie, mais la discrétion et la bienséance. Nous devrons également dédier une part substantielle de nos réflexions à ce paramètre fondamental des émotionologies médiévales, en particulier de celle mise en scène dans les romans courtois. Animée d’un souci de convenance directement lié à celui de l’honneur, la société médiévale se conçoit dans un rapport obsédant de performativité de la sociabilité courtoise. Les émotions bercent elles aussi dans cette conscience élevée du jeu public et du poids exercé par la sphère sociale. Ceci expliquerait le caractère policé toujours démontré, de manière exemplaire, par le 90roi Marc, dans l’expression de ses émotions, dirigées par un sens accru de la politesse et de l’affabilité. Marc ne consent pas à manifester ses émotions, les dissimule, voire même en simule d’autres pour mieux les recouvrir, dans le seul objectif de ne pas quitter sa posture royale et ce qu’elle implique. Céder à la colère, faire montre de tristesse en pleine cour ne saurait correspondre aux normes courtoises auxquelles le roi, plus que quiconque, doit se conformer, telle est en tout cas une intuition que nous chercherons à confirmer56. Cette démarche pourrait en quelque sorte se voir opposée à celle de la communauté émotionnelle des amants, que l’amour détourne, selon un schéma assez courant dans la littérature médiévale, de la raison sociale, dictée par les lois courtoises suivies par le roi Marc – symbole tout désigné de ces préceptes. Le détachement de ces normes rapprocherait ainsi les amants de Renart, totalement désintéressé de ces questions sociales, ou des personnages de fabliaux, situés en dehors de la sphère courtoise. La propension à la dissimulation dans les romans tristaniens peut se comprendre dans ce contexte, davantage que dans la seule dynamique dictée par la loi du secret amoureux. On observe ainsi plusieurs logiques des feeling rules mises en scène, liées à la ruse, au secret amoureux ou au contrôle bienséant, que nous aimerions analyser plus en détails pour mieux en cerner toutes les nuances. Elles éclairent en tout cas déjà notre appréhension du traitement réservé aux émotions dans la saga tristanienne. Son rattachement au corpus de la ruse ne paraît, pas plus que celui du Roman de Renart ou des fabliaux, si ce n’est moins encore, instillé dans la sphère affective de ses personnages. Leurs émotions se caractérisent par une tendance à l’honnêteté ou du moins à la conformité bien davantage qu’à la manipulation éhontée. La dimension de ruse motivée par le caractère adultère de l’amour que se portent Tristan et Yseut apparaît néanmoins dans leur propre comportement émotionnel, eux qui simulent presque plus qu’ils ne dissimulent, dans une volonté de tromperie bien plus assumée que celle des autres personnages de ces récits. Aucune mention en effet de simulation d’émotions de la part des losengiers ou de tous les nombreux opposants des amants, pourtant eux aussi prodigues en ruses et fourberies pour 91les piéger. Et s’il arrive à Marc de simuler ses émotions, nous avons vu que ses artifices se révélaient habités de plus nobles intentions : s’en tenir à son statut de roi. Quant à Yseut aux Blanches Mains, nous avons vu qu’elle aussi obéit aux règles difficiles de l’amour, d’autant plus quand il se voit ainsi contrarié. La faible proportion de simulations et leur cantonnement aux amants – distraits, comme on l’a vu, des règles sociales et courtoises – tendraient à traduire le caractère assez réduit de la dimension de ruse à proprement parler, la feintise étant davantage dictée par la pression sociale que par une réelle volonté de tromperie.
Avant de conclure cette analyse, nous voudrions tenter d’effectuer un rapprochement des résultats obtenus à la lecture de chacune de ces œuvres, pour offrir une perspective plus globalisante des phénomènes émotionnels. Le premier constat que nous pouvons en tirer tient à la sincérité paradoxale des émotions en dépit du thème général de la ruse. Il semblerait ainsi que cette étiquette de ruse accolée aux romans de Tristan, mais peut-être plus encore aux fabliaux et surtout au Roman de Renart, ne saurait s’appliquer à la dimension émotionnelle. Si la ruse y est prédominante, motivant chaque péripétie du récit, elle n’implique pas les émotions, ou très rarement seulement. La ruse transparaît malgré tout de la logique induite dans les quelques manipulations émotionnelles que nous avons pu détecter. C’est ainsi que nous aurions tendance à interpréter la propension à la simulation plutôt qu’à la dissimulation, surtout chez les personnages les plus trompeurs comme Renart, les dames rusées des fabliaux ou Tristan et Yseut. Face à eux, et le plus souvent dans la volonté explicite de répondre à leur propre tromperie, les manipulations de leurs victimes s’intègrent dans une logique presque défensive. Elles s’inscrivent en tout cas dans une autre optique en ne relevant pas de la simulation pure, mais d’un mélange de simulation mise au service de l’efficacité de la dissimulation. L’exemple du roi Marc met en lumière la volonté tout sauf rusée qui anime de telles manipulations émotionnelles. La nature du jeu émotionnel relève ainsi surtout du critère intentionnel, qui paraît tout aussi essentiel pour juger l’émotion que sa manipulation. Ses modalités exactes, de la dissimulation à la simulation, comportent aussi un grand intérêt dans la réflexion qu’elles induisent autour des apparences, érigées comme les instances fondamentales du jeu autour des émotions dans la société médiévale dite du spectacle57. Les jeux 92émotionnels touchent donc à la polarité entre cacher et montrer ainsi complexifiée, plus encore dans son rapport à la polarité entre vrai et faux et dans ses implications sur la sphère affective elle-même. Ces deux démarches présentent un contraste fort intéressant en ce qui concerne l’émotion préexistante au jeu. Simuler n’en implique pas forcément une, au contraire de la dissimulation. Cela éclaire bien sûr de manière tout à fait différente le jeu opéré, au-delà du critère intentionnel. La nature des émotions manipulées paraît elle aussi jouer un rôle important dans ce processus. On pourrait ainsi tenter d’établir une typologie des émotions mobilisées. En-dehors des émotions tout simplement absentes dans les jeux de simulation, on peut noter que les occurrences de dissimulation touchent avant tout aux émotions considérées comme malséantes, tandis que celles de simulation visent à afficher des émotions positives comme la joie ou l’amour. Quand la simulation se concentre au contraire sur des émotions que l’on peut considérer comme négatives telles que la tristesse ou la colère, la dynamique trompeuse paraît bien plus évidente, comme c’est le cas de la dame des Tresces dont les fausses larmes révèlent les intentions rusées. La dissimulation d’émotions jugées peu séantes témoigne d’un souci important de préservation des apparences ainsi posées au cœur des jeux émotionnels. Les exemples de Brunmatin ou de Marc l’illustrent bien. Des émotions aussi pures que celle de la dévotion, mimée par Renart, ou l’amour, affiché par Yseut aux Blanches Mains, ne semblent cependant s’inscrire dans le jeu émotionnel que dans une optique trompeuse. L’amour feint des femmes des fabliaux ou celui de Brunmatin et de Marc semblent diverger quant aux intentions qui animent le jeu mis sur pied, dans une nouvelle démonstration de l’importance conférée à ce paramètre. Bien qu’il soit d’emblée relativisé par les occurrences de double jeu, un constat pourrait s’imposer pour différencier la dissimulation à essence bienséante et la simulation purement rusée. Le simple fait que ce corpus de la ruse ne présente que peu d’exemples de dissimulation semble d’ailleurs le confirmer. Les efforts démontrés pour cacher les émotions, toujours jugées négatives dans les cas de dissimulation-simulation analysés ici, témoignent de la prégnance des règles de sociabilité courtoise incarnées par le roi Marc. La situation même des personnages face à la scène publique et l’importance qu’ils y accordent paraissent influer de manière considérable les jeux émotionnels auxquels ils recourent. Bien plus soucieux des convenances que 93Renart, Brunmatin choisit de camoufler sa peur. On trouve le même contraste entre Marc et les amants, obsédés par le seul secret de leur amour plutôt que par la bienséance requise dans l’espace social. Les personnages des fabliaux, volontairement exclus de la sphère courtoise, s’inscrivent dans la même dynamique d’indifférence à l’égard de ses normes. C’est donc au cœur des situations et motivations spécifiques à chaque personnage qui choisit de se jouer de ses émotions que semble résider toute la nuance entre les divers types de manipulations qui peuvent les entourer. Mais on voit également déjà ici se dessiner tout un réseau d’influences essentielles pesant sur l’instance affective, des règles courtoises à celles qui touchent à la relation amoureuse ou même aux codes qui entourent la pratique dévotionnelle manipulée par Renart. Ces normes particulières apparaissent essentielles pour comprendre la logique propre au traitement émotionnel, qu’elles conditionnent bien plus que l’esprit de ruse de ces œuvres.
Ambiguïtés des jeux émotionnels
Cette première analyse, aussi brève s’avère-t-elle, offre déjà toute une série de pistes de réflexion prometteuses. Notre volonté d’interroger ce corpus d’œuvres liées à la ruse répondait à diverses exigences posées par la problématique du jeu des émotions que nous avons choisi de placer au cœur de notre étude de l’instance affective. Elle suscite en effet d’emblée de nombreuses questions liées à la nature du jeu ou à sa perception et aux conditions de sa mise en scène dans les textes littéraires par lesquels nous souhaitons nous y confronter. Ces quelques œuvres nous permettaient de traiter la première d’entre elles, liée aux contextes d’apparition de tels jeux émotionnels et aux logiques qui les imprègnent. Elles donnaient également l’opportunité de déconstruire d’emblée l’association entre jeu des émotions et fausseté qu’il convenait de repenser pour aborder au mieux nos analyses.
La portée méthodologique de ce chapitre préliminaire pousse tout d’abord à considérer les résultats des objectifs posés en la matière. La concentration proposée sur le vocabulaire de la ruse visait à éprouver 94l’utilité d’une telle approche purement lexicale. Elle s’est avérée très efficace pour conduire cette remise en question du lien opéré entre ruse et manipulations émotionnelles. La proportion des occurrences identifiées qui touchent à la sphère émotionnelle attestait de manière évidente l’efficacité d’une telle méthode. Mais elle présentait aussi très vite ses limites. Il faut en effet constater la grande subtilité du vocabulaire, de la ruse et plus encore, à n’en pas douter, de l’émotion. Caractérisé par sa grande richesse, il est difficile à appréhender par un simple relevé électronique. Une lecture plus minutieuse en contexte se révélait aussitôt nécessaire pour mieux percevoir la logique de la ruse en question et surtout de son implication émotionnelle. Le lexique émotionnel paraît plus complexe encore. Dans notre souci de ne pas restreindre l’analyse à l’une ou l’autre émotion, nous sommes confrontée à toute la difficulté de cerner un champ du réel marqué par son ampleur comme par sa nature vague et abstraite. Les termes employés pour qualifier une même émotion peuvent être légion, rendant l’exercice de repérage contre-productif. Surtout, ils peuvent revêtir des nuances qu’il serait compliqué de cerner par cette seule voie. Plus encore, nous avons déjà pu constater que, quelle que soit notre ambition de nous concentrer sur l’émotion avérée, l’émotion, et plus encore dans ses jeux, est parfois tout simplement absente, du moins dans le vocabulaire qui la dépeint. L’exemple que nous avons cité du Testament de l’Asne de Rutebeuf en témoigne : on ne lit aucun terme émotionnel explicite, mais ce n’est pas pour autant qu’elle ne transparaît pas de l’attitude physique des médisants qui enclinent ainsi de la tête pour marquer une bienveillance toute feinte. On touche ainsi à l’importance qu’il faut aussi accorder au vocabulaire, tout aussi large et flou, du jeu lui-même et des symptômes corporels par lesquels les émotions s’expriment le plus souvent.
La place réservée aux indices physiologiques des émotions se confirme, voire croît encore quand il s’agit de percevoir les manipulations dont elles peuvent être l’objet. Si on lit le plus souvent l’émotion par le biais de son processus d’extériorisation que par celui de la nomination de sa réalité psychologique, c’est plus encore le cas des jeux à son endroit, indiqués dans le fossé qu’ils creusent entre le cœur et le corps, plutôt qu’entre le cœur et la bouche d’ailleurs. Le lien tissé avec la problématique du mensonge méritera d’ailleurs que nous nous y arrêtions. C’est néanmoins à la sphère corporelle et aux apparences qu’elle livre 95de l’instance affective que nous nous consacrerons avant tout dans cette étude des jeux émotionnels qui semblent se fonder sur la rupture du rapport entre intérieur et extérieur qu’ils impliquent. Émerge ainsi la question centrale du semblant, révélée d’ailleurs par l’étude lexicale que nous avons pu mener. Elle se trouve au cœur de bon nombre des formules employées pour mettre en scène les jeux des émotions et permet, par son sémantisme même, de véhiculer toute l’ambivalence de ce lien attendu, mais détourné, entre intérieur et extérieur. Elle coordonne en outre cette double dynamique de jeux que nous avons identifiée, entre la dissimulation qui vise à ne pas montrer semblant et la simulation qui cherche à faire semblant. On perçoit ainsi malgré tout l’intérêt de cette introduction aux jeux des émotions par le prisme du lexique qui a permis de mettre à jour plusieurs formules récurrentes dans leur mise en scène. Les lectures auxquelles nous voudrions dès à présent nous prêter de manière plus contextuelle, sans pour autant perdre de vue ce prisme lexical fondamental, bénéficieront à n’en pas douter de cette première expérience ainsi acquise du vocabulaire des manipulations émotionnelles.
La dynamique comparative sur laquelle nous avons terminé notre analyse comportait également de nombreux enseignements à tirer de cette exploration des œuvres associées à un esprit de ruse. Le premier d’entre eux touche à ces deux mouvements de manipulation de la sphère affective que sont la dissimulation et la simulation. Dans chacun des trois corpus envisagés, on constate une association de la ruse avec la simulation, au contraire de la dissimulation qui se veut plutôt animée par un souci de conformité à l’inverse des logiques trompeuses. Le constat vaut également, tout en se complexifiant bien sûr, pour les occurrences de dissimulation assurée par la simulation que nous avons pu observer. Dans notre souci de déceler des paramètres stables à l’analyse des jeux émotionnels au travers de ce corpus, nous devons cependant souligner l’importance de nuancer cette distinction en regard, davantage que de la dynamique de jeu, de l’intention qui la sous-tend. Il s’agit là d’un critère essentiel à l’évaluation de l’émotion elle-même dans l’idéologie médiévale, mais il paraît tout aussi incontournable pour celle des manipulations à son encontre. Celle-ci se révèle dans de nombreux détails qui peuvent venir préciser le jeu opéré, sous la forme de propositions finales fort explicites – comme celle qui venait compléter la présentation du roi Marc feignant la joie – ou des qualificatifs employés 96pour déterminer les acteurs ou les conditions du jeu – tel que le faisait Rutebeuf en qualifiant ses personnages de médisants. On en revient ainsi à l’importance conférée au vocabulaire, pas tant de l’émotion elle-même que de la formulation du jeu, mais surtout à son appréhension en contexte, indispensable à sa perception correcte dans toutes les nuances qu’il véhicule. Les facteurs des jeux mis sur pied, au-delà de la logique dans laquelle ils s’inscrivent, méritent également l’attention. Ils révèlent un rapport de causalité souvent mis en exergue, en relation avec des émotions elles-mêmes devenues moteurs, et plus seulement objets, de la manipulation. Les émotions qui sous-tendent les jeux en question s’avèrent elles aussi fort intéressantes à considérer. Elles témoignent de dynamiques diverses quant aux enjeux de discrétion ou d’expression forcée liées à leur nature et à leur perception bienséante ou malséante. Elles portent ainsi la nuance entre deux mêmes phénomènes de dissimulation redoublée de simulation émotionnelle, qui tiennent à assurer les apparences convenantes de la joie ou, au contraire, à mimer la bienveillance seulement pour camoufler l’envie par exemple. La prise en compte des codes comportementaux qui dictent de telles manipulations variées s’impose pour étudier les logiques propres à la sphère affective. Ils permettront sûrement d’éclairer toute une série de nuances, liées au registre émotionnel impliqué, mais aussi à la position, au genre ou à l’âge des personnages qui sont dépeints jouer de leurs émotions. Les différences perceptibles entre les jeux opérés par Marc ou par Tristan et Yseut attestent la diversité de lignes directrices qui inspirent leur prise en charge émotionnelle. On a pu deviner l’influence de la sphère courtoise ou plutôt des conditions de la fin’amor sur les uns et les autres de ces personnages. Il conviendrait bien sûr d’étayer ces impressions par une analyse plus minutieuse des règles en la matière. Des critères sociaux, mais aussi de genre sont également apparus, en particulier dans le corpus des fabliaux. Suivant l’appel qu’il semble ainsi adresser, nous aimerions nous dédier aux spécificités des manipulations émotionnelles de la gent féminine ou masculine. La prégnance du stéréotype de la femme emportée par ses passions, sur laquelle joue le fabliau, contribue à l’intérêt d’envisager la distinction potentielle entre hommes et femmes face à leurs émotions. Ce stéréotype dépasse d’ailleurs la seule identité féminine dans la perception longtemps caricaturale d’un Moyen Âge marqué par son manque de contrôle dans la 97gestion émotionnelle58. Cela ne fait bien sûr que renforcer l’intérêt de repenser ce cliché abusif de la gent féminine comme de l’homme médiéval, bien plus habité-e de ce souci de maîtrise de soi que ce qu’une part de la critique, ou les auteurs de fabliaux, ont eu tendance à le représenter. Le tableau dressé dans les fabliaux offre d’ailleurs plusieurs arguments dans cette direction. Si l’on souligne leur grande sensibilité, les héroïnes de fabliaux sont aussi mises en scène capables de manipuler leurs émotions, dans une bien plus grande proportion que la gent masculine. La collusion entre leur nature passionnée, dans tout le sens subi du terme, et leur tendance rusée suscite une tension intéressante, révélatrice de la nature clichée de ce tableau. Mais elle pousse également à interroger les dynamiques particulières qui entourent le portrait livré des émotions selon qu’elles relèvent de personnages féminins ou masculins. Elles peuvent en outre toucher à celles dictées par l’instance de régulation en question, de ruse ou de discrétion amoureuse notamment. Les règles semblent en effet varier selon le genre du public visé, dans chacune de ces feeling rules particulières. La loi amoureuse paraît fort porteuse à ce niveau, ne serait-ce que pour l’importance de son influence dans la littérature médiévale française, animée de cet esprit de fin’amor dont les trouvères viennent l’irriguer. L’écho qu’y présente même le fabliau Des Braies du cordelier témoigne de la prégnance de ce code émotionnel particulier. Il s’avère d’autant plus intéressant qu’il semble traversé d’une ambivalence de recommandations autour de l’émotion, impérativement sincère et discrète tout à la fois. En réalité, il semble répondre en ceci à un paradoxe inhérent à la sphère émotionnelle, à la maîtrise aussi absolue que sa nature inaccessible. Obsédé par le rapport de transparence supposée entre intérieur et extérieur, l’homme médiéval est autant convaincu de la nécessité de contrôler les apparences offertes de son intériorité que de l’impossibilité de s’y fier. Il craint aussi bien que le lien soit rompu qu’il soit trop évident. Pareille dynamique pousse bien sûr à dépasser la seule association des jeux émotionnels à la ruse. Il paraît indubitable qu’ils relèvent de bien d’autres logiques, la seule proportion de jeux intégrés dans ce corpus associé à la ruse le démontrait déjà. Mais surtout, on perçoit dans toutes ces nuances ainsi mises en 98lumières la complexité des instances qui régissent les manipulations émotionnelles. Elles se comprennent bien sûr avant tout en raison du contexte discursif dans lequel elles s’insèrent, cette analyse centrée sur un corpus aussi particulier que celui de la ruse en constitue un parfait exemple. La proximité qui se dessine entre les différentes émotionologies à l’œuvre dans la littérature médiévale et les genres littéraires qui les mettent en scène nous paraît justifier l’analyse que nous voudrions consacrer aux règles de la sociabilité courtoise, à celles de la communauté émotionnelle des amant-e-s et de celle des religieux-ses. Les exemples de Marc mimant la joie à sa cour, de l’héroïne du fabliau des Tresces feignant les larmes pour mieux préserver le secret de sa relation adultère ou de Renart manipulant les signes de la dévotion traduisent la diversité et la richesse de ces feeling rules que ces quelques œuvres révèlent déjà et invitent à interroger plus avant. En regard de l’importance conférée dans chacune de ces situations à la sphère corporelle qui porte le jeu mené sur les émotions, c’est aux théories liées à la garde de soi et de ses apparences que nous voudrions nous consacrer pour débuter cette exploration des logiques propres aux jeux émotionnels. Cela nous permettra du même mouvement de mieux concevoir l’importance des critères intentionnels, mais aussi émotionnels eux-mêmes, en revenant aux théories de considération de l’affect au Moyen Âge qui codifient l’apparence qui peut ou doit en être offerte.
1 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge. Une histoire des émotions dans l’Occident médiéval, Paris, Seuil, 2015, p. 16.
2 A. Vélissariou, Aspects dramatiques et écriture de l’oralité dans Les Cent Nouvelles Nouvelles, Paris, Champion, 2012.
3 S. Stakel, False Roses. Structures of Duality and Deceit in Jean de Meun’s Roman de la rose, Stanford, Anma Libri, 1991, en particulier p. 3-15.
4 C’est surtout le cas de Barbara H. Rosenwein, parmi d’autres chercheurs déjà mentionnés en introduction : B. H. Rosenwein, « Les mots de l’émotion », dans Les émotions au Moyen Âge et aujourd’hui : questions de sources et de méthodes. Pour une anthropologie historique des émotions au Moyen Âge, Aix-en-Provence, Université d’Aix-en-Provence, 2006, p. 10-12.
5 R. Bannour et A. Piolat, « Émotion et affects. Contribution de la psychologie cognitive », dans Le Sujet des émotions au Moyen Âge, dir. D. Boquet et P. Nagy, Paris, Beauchesne, 2008, p. 53-84, ici p. 82.
6 A. Vélissariou, op. cit.
7 Voir par exemple Le Roman de Renart, éd. J. Dufournet et al., Paris, Champion, 2013, t. 1, branche VIII, v. 1 415-1 422, p. 642.
8 Cette expression se retrouve de manière très intéressante dans l’édition de Méon : Le roman du Renartpublié d’après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi des xiiie, xive et xve siècles, éd. D. M. Méon, Paris, Treuttel et Wurtz, 1951, 4 t. ; ici branche III, v. 4 218-4219 : « “Pintain, n’i a mestier celee : / mout sui dolenz et esmarriz ;” ».
9 Il s’agit bien sûr du passage évoqué en introduction, pour rappel : Le Roman de Renart, op. cit., t. 1, branche VIII, v. 1 415-1 422, p. 642, mentionné p. 64.
10 Nous nous y attarderons surtout dans notre analyse plus spécifique des jeux émotionnels religieux, à la lueur du spectre de Faux Semblant dans cette tradition, mais aussi des recommandations explicites en la matière de Thomas d’Aquin notamment.
11 Le Roman de Renart., éd. J. Dufournet et A. Méline, Paris, Flammarion, 1985, t. 1, branche X, v. 2 191-2 194, p. 812.
12 Comme le font par exemple Rosanna Brusegan ou Corinne Denoyelle : R. Brusegan, « Regards sur le fabliau, masque de vérité et de fiction », dans Masques et déguisements dans la littérature médiévale, dir. M.-L. Ollier, Paris/Montréal, Vrin / Presses Universitaires de Montréal, 1988, p. 97-109, ici p. 97 et C. Denoyelle, « Le discours de la ruse dans les fabliaux. Approche pragmatique et argumentative », Poétique, no 115, 1998, p. 327-350, ici p. 327-328.
13 M.-T. Lorcin, « Jeux de main, jeux de vilains. Le geste et la parole dans les fabliaux », dans Le Geste et les gestes au Moyen âge, Aix-en-Provence, CUERMA, 1998, p. 369-382, ici p. 371.
14 Selon un facteur d’influence important, que nous pourrons mettre en lumière dans la suite de nos analyses dédiées à ces normes courtoises que nous voyons déjà s’esquisser dans ce corpus de la ruse.
15 B. Grigoriu, Actes d’émotion, pactes d’initiation : le spectre des fabliaux, Craiova, Editura universitaria, 2015, p. 48-49.
16 Rutebeuf, Le Testament de l’Asne, v. 10-14, dans Recueil général et complet des fabliaux des xiiie et xive siècles, éd. A. de Montaiglon et G. Raynaud, Paris, Librairie des Bibliophiles, 1872, t. 3, p. 215. Bien qu’ancienne, nous avons préféré cette édition à d’autres plus récentes, par souci d’harmonie des références à l’ensemble des fabliaux cités dans notre analyse.
17 Damien Boquet et Piroska Nagy ont beaucoup insisté sur cette composante essentielle de l’émotionologie médiévale : D. Boquet et P. Nagy, op. cit., p. 11 ou p. 48 par exemple.
18 Cette dynamique importante des fabliaux a notamment été mise en exergue par Roberta L. Krueger ou Lisa Renée Perfetti : R. L. Krueger, « Towards Feminism : Christine de Pizan, Female Advocacy, and Women’s Textual Communities in the Late Middle Ages and Beyond », dans The Oxford Handbook of Women and Gender in medieval Europe, dir. J. M. Bennett et R. Mazo Karras, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 590-606, ici p. 591 et L. R. Perfetti, The Representations of Women in Laughter in Medieval Comic Literature, Michigan, Ann Arbor, 2003, p. 2.
19 La dame qui demandoit aveine pour Morel sa provende avoir, v. 81-87, dans Recueil général et complet des fabliaux des xiiie et xive siècles, op. cit., t. 1, p. 322.
20 Les Tresces, v. 321, dans Recueil général et complet des fabliaux des xiiie et xive siècles, op. cit., t. 4, p. 77.
21 Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 28 juin 2016.
22 Colin Malet, De Jouglet, v. 178-179, dans Recueil général et complet des fabliaux des xiiie et xive siècles, op. cit., t. 4, p. 118.
23 Des .III. dames qui trouverent l ’ anel, v. 52-55, dans Recueil général et complet des fabliaux des xiiie et xive siècles, op. cit., t. 1, p. 171.
24 Nous aurons l’occasion de nous y arrêter plus en détails en introduction du chapitre, que nous aimerions poser au cœur de nos analyses au vu de son intérêt dans la dynamique de jeu autour des émotions, consacré à Faux Semblant. Voir p. 225-233.
25 Au vu de l’intérêt, déjà manifeste dans ce corpus, des normes émotionnelles des amants, nous veillerons à y revenir, au fil de notre exploration des émotionologies médiévales, en particulier de celles spécifiques à la communauté émotionnelle des amant-e-s.
26 Des Braies au Cordelier, v. 206 dans Recueil général et complet des fabliaux des xiiie et xive siècles, op. cit., t. 3, p. 282.
27 Ibid., v. 10-15, p. 275.
28 I. Machta, Poétique de la ruse dans les récits tristaniens français du xiie siècle, Paris, Champion, 2010, p. 11.
29 Ibid., p. 12.
30 Béroul, Le Roman de Tristan, éd. E. Muret, Paris, Firmin Didot, 1903, v. 760.
31 Ibid., v. 3 900-3 950.
32 S. Ríkharðsdóttir, Emotion in Old Norse Literature, op. cit., p. 44-45.
33 J. Eming, Emotionen im « Tristan », op. cit., p. 62-63.
34 B. Grigoriu, Amor sans desonor, op. cit., p. 26.
35 Ibid., p. 77.
36 N. Koble, « “Car amors ne se puet celer” : Les tentatives de flagrant délit dans les romans français de Tristan », dans Des Tristan en vers au Tristan en prose. Hommage à Emmanuèle Baumgartner, dir. L. Harf-Lancner, L. Mathey-Maille, B. Milland-Bove et M. Szkilnik, Paris, Champion, 2013, p. 325-344.
37 Nous aurons l’occasion de revenir à l’importance de cette recommandation qui se fait presque refrain dans le Roman de la Rose. Voir nos analyses de la page 310 qui se consacrent à sa première occurrence.
38 Béroul, op. cit., v. 8.
39 Ibid., v. 3 490-3 492.
40 I. Machta, op. cit., p. 149.
41 Béroul, op. cit., v. 517-520.
42 Voir, par exemple, les épisodes qui dépeignent Hélène de Benoïc dissimuler sa tristesse selon la recommandation d’un moine ou Guenièvre réfréner ses émotions à l’invitation de Galehaut : Lancelot du Lac, éd. E. Kennedy et trad. F. Mosès, Paris, Le Livre de Poche, 1991 (2e édition), chap. 10, f. 17d, p. 166, analysé dans notre chapitre sur la garde, p. 132, et Lancelot du Lac II, éd. E. Kennedy et trad. M.-L. Chênerie, Paris, Le Livre de Poche, 1993, chap. 70, f. 181a, p. 642-644, cité p. 155.
43 La Folie Tristan d ’ Oxford, éd. F. Lecoy, trad. E. Baumgartner et I. Short, Paris, Champion, 2003, v. 25-32.
44 Thomas, Le Roman de Tristan, éd. F. Lecoy, trad. E. Baumgartner et I. Short, Paris, Champion, 2003, v. 820-824.
45 Ibid., v. 1 139-1 145.
46 Le détail paraît insignifiant, mais il s’agit d’une nuance de taille avec le Lancelot en Prose qui se contente de renvoyer ses personnages au tragique de leur solitude émotionnelle, comme nous pourrons l’observer au gré de notre analyse du cycle du Lancelot en Prose dans le chapitre prochain.
47 Thomas, op. cit., v. 1 286-1 288.
48 Ibid., v. 2 773-2 788.
49 Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 6 juin 2020.
50 La grant ystoire de Monsignor Tristan Li Bret, the First Part of the Prose Romance of Tristan, from Ashb. ms. 19, 1, 3 in the National Library of Scotland, éd. F. C. Johnson, Édimbourg, Oliver & Boyd, 1942, 35, p. 47.
51 Le Roman de Tristan en Prose, éd. R. Curtis, t. 2, Leiden, Brill, 1976, 483, 10, p. 91.
52 Ibid., 533, 20, p. 135.
53 Ibid., 533, 21, p. 135.
54 Ibid., 483, 11, p. 91.
55 Ibid., 483, 11-12, p. 91.
56 Cela fera surtout l’objet de nos réflexions du prochain chapitre consacré à la garde. Les analyses de Laurent Smagghe consacrées justement aux émotions du prince pourraient bien sûr déjà être citées ici pour asseoir ce constat : L. Smagghe, Les Émotions du prince. Émotion et discours politique dans l’espace bourguignon, Paris, Classiques Garnier, 2012.
57 D. Boquet et P. Nagy, op. cit., p. 153.
58 C’était le point de vue de Norbert Elias en particulier, que nous avons eu l’occasion de citer en introduction. Voir p. 11.