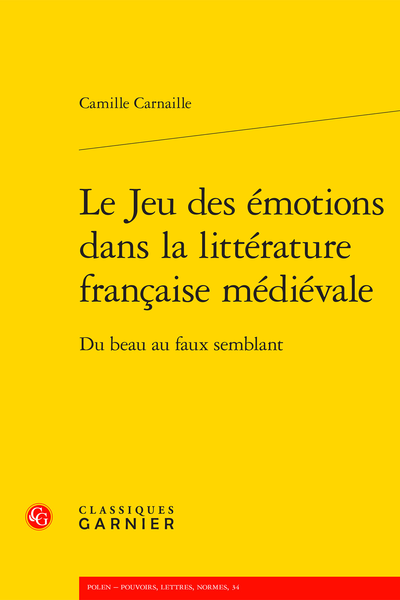
De la garde à la manipulation des émotions Normes émotionnelles et premières dérives
- Publication type: Book chapter
- Book: Le Jeu des émotions dans la littérature française médiévale. Du beau au faux semblant
- Pages: 99 to 221
- Collection: POLEN - Power, Literature, Norms, n° 34
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406151616
- ISBN: 978-2-406-15161-6
- ISSN: 2492-0150
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15161-6.p.0099
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 11-08-2023
- Language: French
De la garde à la manipulation
des émotions
Normes émotionnelles et premières dérives
À la recherche
des émotionologies médiévales
Introduction
À la source du jeu des émotions que nous souhaitons mettre en lumière s’inscrit un principe primordial dans le système de valeurs médiéval : celui de la garde. Il convenait, à l’aube de notre appréhension des manifestations et manipulations d’émotions, de circonscrire les tenants et aboutissants de cette recommandation obsessionnelle au sein de bon nombre de traités de comportement avant d’en envisager les influences dans la production littéraire médiévale. Nous voudrions dès lors tenter d’approcher ce cadre normatif, ses spécificités, ses sources et ses nuances, mais avant tout son importance et son étendue.
L’importance donnée au contrôle des émotions s’explique, comme le soulignent Damien Boquet et Piroska Nagy, dans le cadre de la compréhension médiévale des émotions, placées au cœur du lien social et symbolique1. La société médiévale accorde une place essentielle à la sphère émotionnelle et, loin de se laisser diriger par elle, propose toute une série de lignes directrices pour l’endiguer. Les auteurs de Sensible Moyen Âge l’ont démontré : « Ils [les médiévaux] font au contraire un usage raisonné et calculé des émotions et de la violence, selon des modalités socialement acquises, voire requises2 ». Parmi bien d’autres historiens, 100Martin Aurell défend dans ce sens la préexistence du phénomène de la civilisation des mœurs, développé par Norbert Elias, au cœur du Moyen Âge3. Les émotions répondent à un code culturel dicté par la raison et les lois sociales en la matière. Toute la logique du jeu que nous souhaitons approcher réside justement dans ces règles et dans l’influence qu’elles exercent sur la pratique émotionnelle. Jan Dumolyn et Élodie Lecuppre-Desjardin le soulignent dans leur analyse de la place prise par les émotions dans les dynamiques politiques et sociales : « À chaque émotion correspond un code ou un modèle de conduite tour à tour respecté ou trahi4 ». Cet univers normatif imprègne tant et si bien la société médiévale qu’apparaît pour le qualifier la notion de « grammaire émotionnelle5 », pertinente pour notre analyse de cette tendance codificatrice et du lot d’exceptions, de nuances ou d’infractions qu’elle véhicule.
Les normes qui pèsent sur l’émotion, les « feeling rules », telles que les nomme Arlie Russel Hochschild6, visent avant tout la contenance, nous pourrons l’observer au travers de divers traités emblématiques de la réflexion médiévale à cet endroit. Induites par la vocation éminemment publique de l’émotion7, ces règles se construisent en regard de la dialectique entre dedans et dehors qui berce la société médiévale. Il faut en effet noter le poids exercé par l’idéal, d’inspiration aristotélicienne, d’harmonie entre intérieur et extérieur, l’apparence étant alors supposée refléter les qualités, ou les défauts, intérieurs. Cet absolu de concordance d’héritage antique se conforte dans la conception chrétienne 101de l’union de l’âme et du corps8. Il se voit cependant bien vite accompagné d’une réflexion sur le véritable degré de transparence entre ces deux entités9. On prend conscience du fossé qui peut se creuser entre ces deux pôles de l’homointerior et de l’homoexterior, surtout en regard de l’intérêt témoigné à l’extérieur seul, dans l’univers laïc avant tout10, mais pas seulement. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette tension ainsi mise en lumière, sur la réflexion qu’elle induit autour de la manifestation émotionnelle et sur ses implications évidentes dans le jeu des émotions que nous cherchons à appréhender. Mais avant de considérer ses écarts, nous voudrions exacerber l’importance de cet idéal d’harmonie et l’influence qu’il exerce sur les émotions. Jeff Rider rappelle la place logique des émotions dans cette réflexion comme lieu de rencontre entre intérieur et extérieur, mais aussi entre les sphères intime et publique : « Emotions are precisely where inner and outer life meet and open out one another11 ». Dans ce cadre, c’est avant tout l’exhortation à la discrétion qui irrigue la société médiévale. Martin Aurell en souligne l’importance et la vertu : « Dans l’esprit des clercs de l’époque, mais aussi des moines, la discrétion n’est pas nécessairement synonyme de cachotterie ou de mensonge. Elle apparaît souvent comme une marque de respect, relevant de la tempérance12 ». Se conjuguent ici les maîtres-mots de la codification des émotions, animée d’un souci de tempérance qui vise ainsi leur discrétion et leur modération. Se construit sur cette base tout le système émotionnel que l’on peut résumer en ces termes : « Ce dont il est question ici, sous différentes colorations (chrétiennes ou non), c’est d’un contrôle, d’une maîtrise d’un mouvement13 ». Cette recommandation d’un usage contrôlé, voire raisonné, des émotions est 102portée par des autorités très variables. Nous nous concentrerons avant tout sur les témoins de cette emphase mise sur la maîtrise émotionnelle, avec un effet de source qu’il convient de reconnaître en amont de notre exposé. L’époque médiévale a également porté des appels très forts en faveur de l’expression émotionnelle et, si nous accorderons un intérêt tout particulier à la tension que peuvent présenter les textes entre ces deux recommandations, notre propos n’en restera pas moins orienté pour considérer le jeu des émotions qui nous paraît fondé sur les feeling rules. Dans toute la diversité (temporelle, générique et, dans une moindre mesure, linguistique14) dans laquelle nous souhaitons les envisager, ces ouvrages témoignent de différents intérêts qui illustrent tous l’importance accordée à la garde des émotions. Ce qui transparaît donc avant tout de cet enchevêtrement de normes pesant sur l’instance affective, c’est leur omniprésence dans l’idéologie médiévale.
Pour en décoder ensuite toutes les nuances, ou les dérives, qui font justement le jeu des émotions, nous voudrions nous consacrer à cette grammaire, ou à ce bon usage, des émotions. La codification de l’émotion s’avère d’autant plus importante qu’elle permet de libérer l’instance affective de sa considération vicieuse et de son impératif d’éradication pure et simple longtemps en vigueur. Plus encore, elle fonde la possibilité de sa réhabilitation. Les réflexions que Thomas d’Aquin mène autour des émotions offrent un exemple représentatif, de par la portée de la Somme Théologique, de ce mouvement de défense. Dans « le schéma thomiste, la vertu réside dans le bon usage des émotions15 ». Richard de Saint-Victor témoigne aussi de cette valorisation de l’émotion ainsi érigée au rang de vertu, pour peu qu’elle se voie contrôlée : « Siquidem, nichil aliud est virtus quam animi affectus ordinatus et moderatus : ordinatus, quando ad illud est ad quod esse debet, moderatus quando tantus est quantus esse 103debet16 ». La condition posée par le moine victorin se fait double, comme pour mieux souligner l’importance de l’ordre et de la modération de l’émotion. Il est ainsi à la fois question de l’objet et de l’intensité de l’émotion, laissant deviner une véritable typologie des émotions vertueuses, sur la base de leur contrôle. Son enjeu essentiel réside donc du côté de la maîtrise, conçue comme un processus de modération et non de minoration de l’émotion.
Ces spécifications ne peuvent que pousser à la réflexion quant à la terminologie qui recouvre le précepte de contrôle. C’est en effet sous des étiquettes diverses que se formule la codification des émotions, de la garde à la tempérance mise en lumière par Martin Aurell. La variété terminologique employée pour qualifier cet ensemble de normes permet de révéler d’emblée les nuances dont s’entoure ce phénomène de contrôle émotionnel. Un examen plus approfondi du vocabulaire qui gravite autour de ce phénomène nous semble dès lors constituer une première étape obligée pour construire la réflexion que nous aimerions dédier aux définitions et aux modalités de la garde des émotions. Nous nous consacrerons ensuite à sa théorisation au fil du Moyen Âge pour approcher les logiques qui animent la mise en place de l’émotionologie médiévale. Cela nous permettra d’envisager au mieux les conditions particulières dans lesquelles s’inscrivent les émotions mises en scène dans la littérature narrative qui nous intéressera au premier plan. Elle se fait le plus souvent l’écho de ces feeling rules, mais en joue aussi et démontre ainsi tout l’intérêt d’interroger les émotions sous le prisme des normes qui pèsent à leur encontre et des jeux qu’elles suscitent. On le verra, les contraintes de l’expression émotionnelle paraissent fonder le jeu qui peut l’entourer. L’importance accordée à son contrôle jette en effet la lumière sur la possibilité de la manipuler à d’autres fins. On touche ainsi à la dialectique centrale du jeu des émotions, entre contrôle et ruse, mais surtout à la richesse de son étude.
104Terminologie et sémantisme du principe
de contrôle émotionnel
Tout comme l’étiquette émotion, l’emploi du terme contrôle constitue stricto sensu un anachronisme17. Mais il peut se justifier pour offrir une formulation explicite et productive du processus de régulation émotionnelle qui marque l’époque médiévale.
Bien qu’il soit utile pour désigner, dans notre conception moderne, le phénomène que nous désirons approcher ici, nous avons préféré à ce terme de contrôle celui de garde, tiré d’un chapitre que Brunet Latin consacre à ce motif dans le Livre du Trésor. Sa définition rend compte de l’importance de cette vertu qui vise de « garder soi des vices contraires » en « sieuv[ant] le mi en toutes choses18 », telle que nous avons pu la retrouver sous la plume des grands théologiens Thomas d’Aquin ou Richard de Saint-Victor. Son intégration dans le manuel de comportement à portée générale de Brunet Latin atteste l’importance conférée à cette réhabilitation et au principe de contrôle qui la sous-tend. Brunet Latin se fait aussi l’écho du succès rencontré alors par les théories aristotéliciennes, surtout par celle du juste milieu qui traverse de nombreux courants de la philosophie du xiiie siècle et participe de la réhabilitation de l’émotion au nom de ce principe. Surtout, il la concentre sur le « cuer », selon l’exhortation de Salomon19. Au carrefour de recommandations antiques et bibliques, la garde des émotions se fait fondamentale. Brunet Latin insiste d’ailleurs sur l’enjeu qu’elle constitue pour des émotions problématiques comme l’avarice ou la peur. Il poursuit dans cette optique son appel à se garder en « bon sens » pour insister sur l’importance de « contraindre [le] courrous20 ». La colère constitue un objet central de la codification autour des 105émotions, propice qu’elle est aux excès. L’éloge du contrôle ne saurait en effet se concevoir en dehors de la critique insistante de l’excès émotionnel, nous pourrons le confirmer tant au niveau sémantique qu’à celui de la mise en scène littéraire de ces préceptes.
La consultation des dictionnaires de référence rejoint ces premiers constats, mais permet surtout de porter un regard plus global et précis sur cette notion et celles qui gravitent autour d’elle. Nous voudrions rapidement revenir sur les éléments les plus saillants de chacune de leurs définitions pour mieux circonscrire la dynamique générale de la codification émotionnelle.
Le terme de garde s’inscrit, dès son apparition, notable, dans la Vie de saint Alexis, dans une dynamique de surveillance, avant d’impliquer la dimension concrète que nous lui connaissons toujours21. Il se comprend dans un sens protecteur face à un sujet de crainte22 qui se veut tout intérieur23, de manière très pertinente pour saisir son association à la codification émotionnelle qui prend le plus souvent la forme d’une invitation à l’introspection au gré des divers traités qui se consacrent à cette question.
Conçue dès l’époque médiévale dans ses deux sens littéral et figuré24, la mesure est souvent recommandée avec insistance, comme par Brunet Latin qui la définit d’emblée comme une vertu, de manière plus significative et laudative encore que dans le cas de la garde : « Mesure est une vertu que touz nos aornemenz, nos movemenz et touz nos afaire fait estre sens defaute et sans outraige25 ». Elle se conçoit dans une perspective de 106lutte contre les excès26, notamment par la fréquence de la formule sanz mesure dans le corpus de la chanson de geste27, et de norme28, qui nous rappelle bien sûr le processus important de standardisation qui entoure cette exigence de contrôle. La notion cumule les valeurs des mots latins modus et metior29, tous deux révélateurs des enjeux de convenance et d’évaluation que les feeling rules induisent30.
Le terme de modération, ou plus tôt de moderance31, véhicule, de par son étymologie, les idées de mesure et de sagesse32. Il prend aussi dès son apparition en français un sens de diminution qui s’inscrit dans l’optique de retenue qui anime la codification émotionnelle. Il s’attache très tôt au comportement et même à la vertu dans l’opposition aux excès33 et s’inscrit ainsi à merveille dans la réflexion menée sur le bon usage des émotions. Fonctionnant comme son quasi-synonyme au Moyen Âge, la modestie se conçoit, en regard de sa racine latine, comme une vertu associée à la bienséance et à la sagesse34, des moteurs importants dans le processus de codification émotionnelle.
Pensée par les auteurs antiques, et chrétiens à leur suite, comme un synonyme ou une sous-catégorie de la moderatio35, la temperentia occupe un large spectre du champ de réflexion autour de la mesure des émotions. D’origine latine elle aussi révélatrice36, la tempérance, ou la temperation107auparavant37, vient spécifier une forme de modération liée aux plaisirs des sens38. Elle sous-tend donc une orientation importante du principe de contrôle centré sur le corps et, par voie de conséquence, compte tenu de la représentation physiologique omniprésente des émotions, sur les émotions elles-mêmes. La notion renvoie aussi, dès son apparition en français, à un processus, concret puis figuré, d’adoucissement, porteur pour interroger ses objectifs moraux et bienséants. Davantage que la notion, ou du moins le terme exact, de temperance, c’est celui d’attemprance qui irrigue les manuels de comportement et les œuvres narratives du Moyen Âge. Il se comprend dans la même logique d’adoucissement, voire d’ajustement39. Il se concentre surtout sur le tempérament, en renvoyant au système humoral, conçu ainsi dans sa normalité ou dans son équilibre, d’ailleurs précisé en lien avec le caractère et les sentiments qu’il implique40.
Un autre terme du champ sémantique de la retenue mériterait encore que l’on s’y intéresse, celui, déjà plusieurs fois évoqué, de contenance. Il renvoie à la dimension comportementale41 qui peut venir traduire les émotions. De manière intéressante, elle se comprend d’emblée en rapport avec les limites qu’elle doit impliquer42, voire avec le risque que peut comporter tout débordement43, et se concentre de manière explicite sur l’humeur qu’elle vient traduire44. Cette spécification témoigne de la tendance révélatrice du comportement quant à la personnalité, à l’humeur et, avec elle, aux émotions. On rejoint ainsi le champ, extrêmement fertile, de l’apparence expressive, voire trahissant l’émotion, que cela soit par le visage, les gestes ou le comportement plus largement. Surtout, on comprend l’importance accordée au lien entre intérieur et extérieur et au comportement conçu comme révélateur de l’instance affective. Cela nous semble justifier l’intérêt que nous porterons aux manuels de comportement et autres règles de conduite, 108qui transmettent une réflexion importante sur la contenance et sur sa dimension émotionnelle incontournable.
On le voit, le champ sémantique du contrôle, pourtant sûrement loin d’avoir été traité avec exhaustivité dans cette rapide introduction, est vaste. Plus encore, il atteste la richesse et l’ampleur de sa prescription dans la pensée médiévale. Les quelques exemples cités témoignent de son importance, mais il convient d’appréhender également l’ensemble de l’univers normatif qui véhicule cette recommandation de mesure, dans une diversité de conseils, d’objectifs, d’applications. Un rapide panorama historique du concept et du principe de contrôle nous permettrait de mieux cerner les conditions et les variables du développement de l’idéal de mesure émotionnelle.
Panorama historique de la garde
Si la recommandation de garde s’avère omniprésente, sa définition et ses modalités varient au cours du temps. Loin de vouloir dresser un tableau in extenso de l’évolution des prescriptions en la matière, nous nous en tiendrons aux auteurs et penseurs les plus emblématiques, en nous concentrant en particulier sur ceux qui exercèrent l’influence la plus forte à l’époque médiévale.
Les philosophes antiques incitaient déjà à la mesure de soi et des émotions, dans une perspective essentiellement éthique alors45. Aristote joue un rôle clé dans l’élaboration du concept de contrôle, auquel il insuffle la dimension vertueuse qui servira de ligne directrice à la pensée de la plupart des théoriciens médiévaux. Il développe une philosophie pratique des émotions, qui préconise leur maîtrise, comprise comme leur juste proportion, et donc leur manipulation46. Dans l’Antiquité latine, Cicéron accorde pour sa part une grande importance à la mesure des émotions pour permettre l’adaptation d’un idéal de bien absolu aux conditions de la vie sociale. La mesure cicéronienne se conçoit dès lors comme une préoccupation de convenance à prôner pour assurer le maintien de rigueur au cœur du monde. Il insiste en outre sur la peur de l’excès pour développer sa réflexion, qui imprégnera à sa suite la pensée médiévale47. 109Cicéron est surtout à la source de la conception proprement morale de cette recommandation et contribue dans ce sens à instaurer la règle du juste milieu comme idéal de contrôle de soi, reprise par Sénèque et les philosophes de l’école de Zénon. L’influence stoïcienne se fait aussi sentir dans la compréhension médiévale du concept de garde comme une vertu d’ordre48. Les traités de savoir-vivre médiévaux qui véhiculent l’exigence de contrôle doivent beaucoup aux théories et réflexions de ces deux philosophes49. Quintilien exerce lui aussi une influence notable. Il défend en particulier l’utilité des affects et promeut dans ce sens une stratégie socio-éthique visant le contrôle de soi et, ainsi, des autres50. Tel est le cœur de la notion de gouvernement développée dans la philosophie médiévale, fondée sur celui de soi avant d’envisager celui des autres. On perçoit la source d’inspiration que représentent les réflexions stoïciennes. Elles bercent les penseurs de la fin de l’Antiquité, comme Macrobe, pour atteindre les philosophes médiévaux, à commencer par les Pères de l’Église51.
Ils jouent en effet un rôle primordial dans la construction des normes émotionnelles, nous l’avons vu en introduction52. C’est surtout chez eux que se développe le motif de la moderatio dont nous avons pu appréhender l’importance. Mais les premiers temps chrétiens sont avant tout ceux d’une évolution et d’une alternance entre les idéaux d’éradication et de modération53. Ils se font l’écho de l’opposition des courants philosophiques antiques, mais en restent encore à une déconsidération tenace de l’émotion. Surtout, le lien qui s’instille au cœur de toute la réflexion médiévale autour des émotions entre affect et vice s’instaure alors chez les Pères du Désert54. C’est sur cette base que se fonde le souci d’éradication ou, au 110moins, de contrôle exacerbé de l’émotion. Lactance se consacre à cette représentation de l’émotion et définit dans cette perspective l’émotion mal orientée comme un vice55. Il s’agit là bien sûr d’une idée fondamentale dans la valorisation du principe de contrôle. Cette perception vicieuse de l’émotion se conçoit en lien avec la théorie de la Chute qui s’élabore à la même époque, non sans accorder un rôle important à la notion de mesure : la malédiction de l’homme ne résiderait en effet pas tant dans l’émotion en soi que dans l’incapacité à la contrôler56. Saint Augustin renforce cette réflexion. Surtout, il déplace le débat de la seule question de la licité des émotions à celle des conditions et raisons de son utilisation57. Il met l’accent sur la volonté à exercer dans ce cadre58, selon un critère devenu essentiel au système émotionnel à sa suite. Cassien poursuit cet effort de domestication affective par une valorisation de la tranquillité de l’âme posée en objectif de l’ascèse59, qui correspondrait à l’écrasement de tous les appétits sensibles60. En parallèle de cette réflexion très ferme conduite autour de l’instance affective, Cassien est également à l’origine de l’élévation de la tempérance au rang des quatre vertus cardinales et promeut la mesure comprise comme le respect de l’ordre instauré par Dieu61. Grégoire le Grand jette un pont entre les théories de saint Augustin et de Cassien, dont il effectue une véritable synthèse. Il prône à son tour la maîtrise ascétique, mais recommande davantage la correcte orientation de l’émotion que son éradication62. Le Haut Moyen Âge est ainsi marqué par un appel constant à la mesure des émotions, particulièrement dans le monde monastique, selon une tendance bien ancrée qui ne se verra nuancée qu’avec le tournant qu’incarne le xie siècle sous l’effet du christocentrisme et de la reconsidération des émotions, surtout de l’amour, qui se développe alors63. Le xiie siècle constitue dans ce sens un temps fort pour le développement de la morale 111des émotions. C’est en effet à la fois l’époque d’une forme de remise en cause de la considération des émotions peccamineuses et celle d’une naturalisation accrue des émotions. Cela ne remet pas pour autant en question la dimension morale ni la responsabilité individuelle qui les entourent64. Au contraire, cela semble conduire à une hausse générale de l’effort de codification émotionnelle, mais aussi de sa complexité. La place accordée aux émotions en dehors des appels à leur éradication nécessite un effort de contrôle pour la légitimer. L’Église et l’idéologie chrétienne jouent un rôle important dans cette réglementation des émotions65. En témoignent plusieurs ouvrages essentiels comme les Institutiones de Cassien, la Règle du Maître et la règle de Benoît de Nursie66. Au nombre des traités les plus considérables, nous pourrions évoquer aussi le Disciplina Clericalis de Pierre Alphonse qui se consacre aux sept atempranches, qu’il applique aux divers vices de l’outrageux, du mangeur, du buveur, du luxurieux, du jureur, du menteur, de l’avare, et finalement de la mauvaise coutume67 ; ou encore le Facets qui atteste la valorisation de l’attitude courtoise conçue pour réfréner les désirs spontanés et inciter à la discrétion, dans une association révélatrice des enjeux chrétiens et sociétaux68. Les prescriptions d’ordre monastique s’avèrent en général plus pratiques, animées par l’idéal d’union mystique qui irrigue la considération potentiellement vertueuse de l’affect. Elles se concentrent ainsi sur des gestes quotidiens69, qui portent la valorisation de l’émotion comme un levier du rapprochement de Dieu. Cette reconsidération de l’émotion vertueuse qui transparaît dès le xiie siècle intègre pour condition fondamentale un besoin de discrétion70, comme l’illustre le Facets. Les Cisterciens participent à cette réhabilitation de l’instance affective, non plus sujette à l’amputation, mais à la correcte orientation. Soumise au 112principe d’ordination qui imprègne la réflexion monastique, l’émotion se fait outil de vertu71. Cette exigence de contrôle s’impose alors avec d’autant plus de vigueur, à force de discipline72. Le célèbre théologien Thomas d’Aquin témoigne de cette philosophie pratique élaborée autour des émotions. Il vante l’utilité des passions dans le cheminement vers Dieu, à la condition qu’elles se soumettent à la raison et se plient à cette norme de mesure73. L’éducation émotionnelle des fidèles s’érige au fil du Moyen Âge en véritable enjeu pour les moines, que Carla Casagrande résume sous la formule de « pastorale des émotions74 ». La nouvelle prédication qui s’élabore au xiiie siècle assigne ainsi un rôle pédagogique aux émotions75. Les discours pastoraux et les traités qui se consacrent à leur mise en forme offrent à leur tour un moyen d’expression et de propagation de cette codification émotionnelle. C’est ainsi que se développe la vertu de temperentia, dès lors essentielle dans la philosophie médiévale. Elle fait partie des vertus cardinales, d’origine antique, reprises par les Pères de l’Église et vantées en particulier dès l’époque carolingienne, en parallèle des vertus théologales que sont la foi, l’espérance et la charité. Elle gagne ensuite en importance au fil du xiiie siècle, notamment sous la plume de Thomas d’Aquin76. Elle irrigue dès lors la littérature morale et fait l’objet de nombreux efforts de codification. Pierre le Chantre, par exemple, mène une ample réflexion autour de cette vertu et de ses subdivisions, visant toutes la mesure des mouvements de l’âme et du corps77. La vertu de tempérance se rapproche alors de celle de prudence78 et ainsi d’enjeux essentiels dans l’économie des relations humaines. Christine de Pizan démontre, au xve siècle encore, la proximité de ces deux vertus et l’importance conférée dans ce cadre à l’attemprance :
La vertu d’attrempance voirement peut estre dicte sa serour et semblable a prudence ; car attrempance est demonstrance de prudence, et de prudence 113s’ensuit attrempance. Pour ce dit qu’il la tiengne pour s’amie, ce que semblablement doit faire tout bon chevalier desirant le loyer deu aux bons. Sicomme dit le philosophe appellé Democritus : « Attrempance amodere les vices et parfait les vertus79. »
Calquée sur une autorité antique, cette définition tirée de l’Epistre Othea met en exergue la considération utilitaire, voire salutaire, du concept de contrôle comme outil de perfection de la vertu. Davantage qu’un outil vertueux, l’attrempance est même présentée comme une vertu, selon cette valorisation croissante effectuée au contact de la prudence. Sur cette base, l’attrempance ne peut qu’être une amie, plus encore pour tout bon chevalier qui se respecte. On découvre ainsi déjà une orientation sociale de la vertu de tempérance, selon une tendance marquée à l’élégance des mœurs que nous aurons l’occasion d’investiguer. La mention de la modération des vices est elle aussi intéressante dans ce sens et semble rejoindre le traitement général des émotions dans la pensée médiévale qui, sous bon contrôle, peuvent servir de vecteur vertueux et d’arme contre les vices. On perçoit ainsi le lien qui s’instaure entre idéal monastique et idéal politique, l’un comme l’autre se fondant sur un impératif de retenue absolue. Peter von Moos souligne la conjonction des intérêts religieux et courtois : « Les deux enseignements, celui de l’ascèse monastique et celui de la prudence mondaine, tout différents qu’ils sont, ont en commun l’idéal de l’homme entièrement contrôlé80 ». L’entremêlement de ces doctrines se révélera très intéressant dans la perspective qui est la nôtre. Nous avons en effet pour ambition, dictée par cet entremêlement de fait, de croiser les regards portés sur la manifestation des émotions, et surtout son contrôle, en prêtant attention aux objectifs poursuivis. De ces deux univers de recommandation émergent différentes modalités de contrôle.
La littérature politique constitue elle aussi un important laboratoire à l’élaboration et à la diffusion de ces règles comportementales. Les manuels de comportement se construisent à la croisée de lignes d’influence diverses, de la littérature morale antique abordée à l’instant, avec les autorités immanquables de Cicéron, Sénèque ou des Disticha Catonis. Mais ils témoignent également des idéaux portés par les théologiens, dans une 114valorisation absolue de la vertu de tempérance. Dans une perspective non plus seulement monastique, les traités de gouvernement, d’emblée nommés miroirs dès leur apparition au xiie siècle, jouent un rôle conséquent dans la mise en place d’un objectif d’exemplarité81. Gilles de Rome, auteur du plus célèbre de ces miroirs aux princes, incarne parfaitement ce mouvement, dans l’organisation même de son ouvrage. Divisé en trois sections, son traité débute par un parcours éthique consacré à la conduite de soi présentée comme indispensable à la conduite des autres et plus encore à celle de l’État82. Ces manuels de gouvernement offrent un exemple éclatant de la défense et même de l’utilisation possible des émotions une fois soumises au principe de mesure. Cette dynamique particulière de la garde des émotions connaît d’ailleurs peut-être plus de succès encore dans la sphère courtoise animée de cet idéal de décence. Avec des variables dues aux périodes qu’ils traversent, les traités de savoir-vivre connaissent un succès constant tout au long du Moyen Âge. Ils témoignent, sous les formes diverses de l’allégorie propre au xiiie siècle ou d’une attention accrue aux contraintes de la vie de cour au xve siècle83, de la prégnance de l’idéal d’attemprance. De manière intéressante, celui-ci se concentre sur la maîtrise des émotions. Le miroir de Gilles de Rome participe de cette orientation, comme l’atteste sa traduction française donnée par Henri de Gauchy :
Et por cen que ces .iiii. vertuz [sagesse, attemprance, force de courage et justice] sont principaument es puissances de l’ame, eles sont plus dignes et plus principaux des autres. La seconde reson si est, que toute vertu est tiele qu’ele adresce les raisons humaines, ou ele fet les euvres humaines droitureres, ou ele atempre les movemenz de courage, por cen que li hons par les movemenz de courage desatempré ne se departe de cen que reson enseingne. Donc comment sagesce principauement adresce les resons humaines, et justice face principaument les euvres humaines droitureres, atemprance principauement atempre les movemenz du courage, por cen que li hons ne se mueve a fere chose contre reson84.
115Aux côtés de la sagesse, de la force de courage et de la justice, l’attemprance vient incarner une force vertueuse qui applique le jugement indispensable de la raison aux movemenz de couragedesatempré auxquels elle est dédiée. La seule qualification des émotions par cet attribut condense toute la tension qui les entoure et l’impératif qui s’impose de contrôler cette instance qui reste largement incontrôlable. Telle est d’ailleurs la voie d’entrée à la réflexion dédiée aux movemenz du courage : « Ceste .x. capitre enseigne, que des movemenz de courage acuns font a loër et aucuns a blasmer, et enseingne comment les rois et les princes se doivent avenaument contenir es movemenz devant diz85 ». Il est ainsi aussitôt question d’émotions quand il est question d’attemprance et de contenance quand il est question d’émotions. Le lien tissé entre l’idéal de tempérance et les émotions se fonde, dans la sphère publique induite par les miroirs aux princes, sur la bienséance. L’adverbe avenaument témoigne de l’orientation de la contenance dans un objectif de convenance86. Il s’agit d’une évidence dans les miroirs aux princes qui visent le bon gouvernement de figures hantées par l’espace public. Il ne faut en effet pas perdre de vue le contexte dans lequel s’inscrit cette recommandation, étant donné le lien qu’il induit entre contenance, mêlée de convenance, et capacité de gouvernement. Ce réseau de prescriptions imposées aux souverains est plus explicite encore dans l’introduction donnée à la section consacrée aux movemenz de corage :
Puis que en cest primier livre nos entendons a enseingnier comment li hons se doit gouvernier, et il ne se siet gouvernier se il ne siet queux movemenz il doit ensivre et quiex il doit lessier, nos enseignerons comment les movemenz de courage sont ordenez et les queux sont plus principaus des autres, quer par cen nos poon mieuz savoir les queux nos devon ensivre et les quex nos devons fuir87.
Selon une conception traditionnelle du regimen à l’époque médiévale, le gouvernement est pensé comme celui de l’âme avant sa politisation sur un axe moral, qui préconise un rapport fort entre la conduite de soi et celle de l’État et qui induit dès lors une codification comportementale importante pour les princes. Il n’est ici question que du gouvernement de l’homme, sans aucune allusion encore à celle induite par le souverain 116sur son peuple. La base même du gouvernement semble ainsi liée à celle des movemenzde courage qu’il faut suivre ou non. Nous pourrons observer la prégnance de cette logique de gouvernement et des codes émotionnels qui le sous-tendent et qui pèsent en particulier sur la figure du prince. La littérature narrative s’en fait l’écho au travers d’œuvres aussi essentielles que les romans arthuriens ou tristaniens. Ils offrent une vitrine exemplaire de cette émotionologie propre aux souverains, qui détermine chacune de leurs réactions émotionnelles, quelles que soient les difficultés auxquelles ils font face pour ce faire. Mais l’éloge de l’attemprance dépasse la seule condition des souverains. La portée généralisante du miroir de Gilles de Rome l’atteste déjà, mais c’est plus clair encore dans le traité de Brunet Latin. Le Livre du Trésor, que nous avons déjà pu citer pour sa définition de la garde, occupe évidemment une place centrale dans ce tableau des ouvrages de codification émotionnelle. Il s’appuie pour ce faire sur la morale façonnée par Guillaume de Conches dans ses Moralia Dogma Philosophorum88. Comme bien d’autres manuels de comportement, il se construit sous la forme d’un mélange de principes moraux et de conseils pratiques89, qui vise une éducation achevée90. Il fonde un idéal d’elegentiamorum pensé comme une discipline à acquérir et comme un apprentissage en soi91. La portée éducative de l’idéal de garde connaît d’ailleurs un retentissement important dans la littérature narrative qui se plaît à dépeindre le parcours initiatique de héros en devenir, nous le verrons. Or, l’effort de disciplinarisation ainsi prescrit s’élabore avant tout sous la forme d’une éducation du cœur92. Néanmoins, animés par les soucis posés par la visibilité de l’émotion, les guides de comportement visent avant tout sa bonne contenance extérieure93. Brunet Latin insiste dans ce sens sur la dimension corporelle de l’attemprance qu’il définit comme « la tres noble vertus qui refraint les charnels delis94 ». Selon un effort définitoire similaire à celui fourni 117pour la garde, cette présentation de l’attemprance se veut significative de l’ensemble de ses dynamiques. Brunet Latin y défend la valorisation du principe de tempérance, qualifiée avec éloquence de « seingnorie » puis de tres noble vertus95. Il témoigne ainsi de l’importance qu’il prend dans la sphère religieuse comme mondaine. Il jumelle encore les notions de « mensure », typiquement chevaleresque, et d’« atemprement » pour mieux en préciser la jonction sémantique, et ainsi en combiner l’éloge96. Dans cet ancrage corporel qu’il assigne à l’idéal d’attemprance, il souligne aussi la question de la volonté, posée au cœur de la réflexion menée autour des émotions97. Contrôles des émotions et du corps se conjuguent ainsi dans les traités de savoir-vivre. Les enjeux de régulation qui entourent l’instance affective ont en effet tendance à se concentrer sur les gestes qui la manifestent. Jean-Claude Schmitt rappelle dans ce sens que les gestes et attitudes se définissent comme des acquis sociaux, comme le fruit d’un apprentissage et de mimétismes, qu’ils soient formels ou inconscients98. Le mouvement de codification de l’instance affective s’accompagne donc d’une réflexion similaire portée sur le corps. Lui aussi fait l’objet d’une considération nouvelle, à la même condition qu’il soit soumis à une surveillance accrue. C’est ainsi que s’épanouit ce que Jean-Claude Schmitt nomme la morale du geste99.
Le système normatif développé autour des émotions pèse ainsi avant tout sur le corps, conçu comme la vitrine des émotions. Il nous paraît dès lors indispensable, pour approcher les règles qui pèsent sur l’instance affective, d’en saisir les dynamiques corporelles. Le corps joue en effet un rôle considérable dans l’approche de l’objet émotionnel. Laurent Smagghe l’affirme avec éloquence : « force nous est d’admettre qu’il n’y a d’émotion que dans la preuve de l’émotion100 ». Damien Boquet et Piroska Nagy semblent s’associer à cette défense du caractère inaccessible de l’émotion hors de son extériorisation, qu’elle soit vocale, gestuelle ou corporelle, mais aussi de la pertinence d’interroger cette émotion qu’elle 118soit dite ou montrée101. L’importance accordée à la dimension corporelle des émotions s’inscrit par ailleurs au cœur même des choix stylistiques posés par les auteurs médiévaux qui nous en offrent ainsi la trace. Il a été noté que les descriptions de l’intériorité au sein de la littérature du Moyen Âge s’avéraient très rares ou relativement stéréotypées, les émotions étant davantage présentées par le biais de leurs manifestations physiques ou des actes symboliques qui les incarnent102. L’attention accordée à la dimension corporelle des émotions se révèle donc essentielle parce qu’elle conditionne le plus souvent les descriptions données des émotions au sein de la littérature médiévale, mais aussi et peut-être surtout la réception et la compréhension de celles-ci. Les théoriciens des émotions accordent une grande importance à l’aspect physiologique de l’entité émotionnelle, comme l’atteste par exemple Thomas d’Aquin. Il définit les passions, auxquelles il consacre toute une série de questions de sa Somme Théologique, comme des mouvements du corps : « Respondeo dicendum quod, sicut jam dictum est, passio proprie invenitur ubi est transmutatio corporalis103 ». Thomas d’Aquin met ainsi en lumière l’association entre dimension corporelle et manifestation émotionnelle. La notion de mouvement, de transmutatio, est évidemment très pertinente et semble d’emblée faire écho à celle de l’émotion en soi. La limite entre émotion et corps se veut ainsi des plus ténues pour souligner l’importance de l’emprise physiologique des émotions et plus encore de leur expression. Le corps prend une place considérable dans le système de représentation médiévale de l’émotion. Il est à la fois la voie d’accès obligée à cet objet historique autrement insaisissable, le moyen de construction privilégié de l’entité affective dans la littérature du Moyen Âge et surtout une composante essentielle de la compréhension médiévale de l’émotion.
Le lien qui s’établit entre corps et émotions se confirme au cœur du paradoxe qui les habite tout au long de leur histoire. Tout comme l’affect, le corps fait l’objet de recommandations variables, alternant entre répression et valorisation au fil du Moyen Âge. Jacques Le Goff atteste cette fluctuation : « Le corps médiéval est de part en part traversé par cette tension, ce balancement, cette oscillation entre le refoulement et 119l’exaltation, l’humiliation et la vénération104 ». Or, la condition même de la valorisation du geste, et du corps, réside dans sa codification105. Dominé par la même dialectique entre convenance et inconvenance qui pèse sur la régulation émotionnelle106, le corps s’intègre à une réflexion intense menée sur son usage licite et approprié. L’Église joue un rôle central dans cette imposition d’une police des gestes107 et surtout des gestes émotionnels. Dès la fin du xie siècle, la contenance de la gestuelle s’érige en critère fondamental au sein des ordres religieux108. L’idéal de temperentia qui s’y développe se décline sur le pan corporel autour de la modestia. Elle vient figurer la vertu dédiée au geste, au maintien des manières et des mouvements, selon la présentation qu’en donne Guillaume de Conches en suivant le modèle de Cicéron ou de Sénèque109. Surtout, la théorisation des émotions qui s’opère au xiiie siècle dans l’anthropologie religieuse s’effectue dans une articulation de l’âme et du corps, qui exacerbe encore l’importance de la donnée physiologique110. Les émotions sont pensées à la jonction entre l’âme et le corps, selon cette conception duelle de l’entité humaine, mais aussi selon les théories humorales qui connaissent un essor tout particulier à la même époque. Les régimes de santé qui se vouent à leur diffusion plus large dans la société médiévale témoignent de cette place charnière attribuée aux émotions. L’un des plus célèbres d’entre eux, Le Régime du corps, rédigé par Aldebrandin de Sienne dans la première moitié du xiiie siècle, illustre cette attention portée à la bonne santé à laquelle les émotions sont dites contribuer. L’influence des émotions, appelées « accidens de l’ame »,sur le corps est bien mise en exergue : « saciés certainement qui de ces choses ne set garder, eles destruisent le santé del cors et soudainement le font venir a nient, et por ce, vous en dirons nous le bien et le mal que ele font, et coument eles sont engenrees111 ». Aldebrandin de Sienne souligne 120le lien tissé entre âme et corps par le biais des émotions. Propres à l’âme, les émotions peuvent surtout s’avérer fatales pour le corps. Tout l’impératif de garde de l’instance affective paraît se construire dans ce sens : les émotions doivent être mesurées pour préserver le corps et le corps contrôlé pour qu’il témoigne de cette retenue recommandée. Les normes de garde s’entremêlent ainsi autour des émotions et du corps, dans la relation complexe qu’ils entretiennent. Dans cette logique de rapprochement, le geste mesuré est loué en tant que signe de la maîtrise ferme des passions. Le clerc le valorise en opposition à la gestuelle du jongleur112, critiquée pour son excès sous l’étiquette de gesticulatio113. La condamnation des excès qui porte l’éloge du contrôle émotionnel se conçoit donc aussi à la lumière de son emprise corporelle.
Dans ce contexte, les feeling rules que nous tentons d’approcher se concentrent sur le corps. Dans la société du spectacle qu’est celle du Moyen Âge114, les appels au contrôle des émotions tiennent à l’apparence qui en est offerte par le biais de leurs symptômes physiques. Daniel Lord Smail insiste sur ce paramètre central de l’émotionologie médiévale : « The key lies in the publicity of all somatic reactions, for this publicity commits protagonists to a line of behaviour and helps explain the desmesure or lack of balance suffered by the protagonist115 ». C’est en effet en regard de la révélation offerte par le corps des émotions démesurées qu’on saisit cet appel omniprésent au maintien de soi. Le corps est pensé comme le lieu d’expression et de transmission des émotions par le biais du langage et des gestes qu’il porte116. Il se voit de ce fait entouré de normes régulatrices au même titre que les émotions elles-mêmes. Laurent Smagghe souligne la portée publique du corps qui justifie cette concentration des instances de codification émotionnelle : « Vecteur expressif des affects, gouverné par un faisceau d’injonctions morales, religieuses et 121philosophico-médicales, le corps naturel dialogue avec le monde qui l’entoure, dont il absorbe et transforme les stimuli en autant d’émotions réelles ou représentées117 ». La nuance d’emblée introduite entre émotions réelles ou représentées présente bien sûr un grand intérêt dans notre analyse des manipulations des émotions. Elle témoigne de la place accordée au corps dans cette démarche, place dictée par sa fonction d’extériorisation de la sphère affective. Notons en outre l’entremêlement relevé ici des instances de régulation, philosophiques, morales ou religieuses, auxquelles nous voudrions encore ajouter celle liée à l’amour en regard de l’importance, que nous pourrons démontrer, de l’appel à la mesure dans la sphère amoureuse. Inscrit dans sa naturalité, le corps n’en est pas moins projeté dans le monde, avec tous les risques que cela engendre. Se pose alors avec d’autant plus d’insistance la question de sa retenue. Jan Dumolyn et Élodie Lecuppre-Desjardin exacerbent cette tension inhérente à l’émotion et à son rapport au corps : « Inutile de rappeler que le corps n’est pas seulement le miroir des émotions, mais celui qui, mal gouverné par la raison, ne parvient pas à le maîtriser118 ». Plus encore peut-être que l’émotion, le corps qui la projette doit répondre à l’exercice de la raison. Craint pour la révélation qu’il peut offrir de l’intériorité et pour son potentiel incontrôlable, le corps devient l’objet de prédilection de la mesure toujours recommandée. Peter von Moos s’est consacré à cette dimension essentielle du maintien de soi. Il insiste sur la peur que suscite le corps en tant que lieu d’émission de signes compromettants et involontaires119. C’est dans ce sens qu’il conçoit l’élaboration de manuels de comportement comme un remède à cette tare naturelle120 et que la contenance de soi devient essentiellement une contenance du corps.
Les appels à la maîtrise des émotions se concentrent ainsi volontiers sur leurs indices corporels. Brunet Latin insiste sur ce danger que comporte le corps, en accord avec la théorie de la concordance entre l’homo interior et l’homo exterior121 :
122Dont doit hom curer que raisons soit dame par devant et que li desirriers obeisse ; car, se la volenté, qui naturelment est souzmisse a raison, ne li est obeissant, il fait sovent trobler cors et coraige ; ou l’en puet conoistre les viaires a ceaus qui sont corrociés, ou esmeus par paor, ou qui ont grant volenté d’aucun delit, a ce que il muent et changent vout et color et vois et tout son estat ; car le cuer qui est enflaminé de ire bat fort, le cors tremble, la langue s’enpeeche, la face enflamble, les iauz estancellent, si que il ne puent conoistre lor amis ne lor acointes : la face mostre ce que est dedenz. Por ce dit Juvenaus [Sat, 9-18] : Resgarde les tormenz et les joies dou cuer e[n] la face, qui tozjors mostre en apert son habit122.
Dans une accumulation des détails corporels dévoilant la colère, Brunet Latin met en garde contre la révélation involontaire bien importune de l’émotion. Il atteste ainsi le pouvoir de communication du corps, mais surtout l’impératif de contrôle qui doit peser à son encontre plus encore qu’à celle de l’instance affective. Le lien tissé entre les émotions et leurs symptômes physiques apparaît sans le moindre doute, tout comme la nécessité dès lors de contrôler ceux que l’on laisse percevoir. Bien sûr, la relation entre émotion et corps peut paraître simpliste, puisqu’elle est la condition même de l’extériorisation et souvent de la lisibilité de l’instance affective. Mais il est essentiel de considérer que l’expression émotionnelle ne doit en rien se concevoir comme une traduction de l’interne en externe, mais bien comme un continuum, tel que le rappelle Guillemette Bolens en introduction à son ouvrage consacré au Style des gestes123. Le corps est lui aussi conditionné intrinsèquement par cette codification, car, poursuit-elle, « la réalité physiologique des muscles zygomatiques est perpétuellement hantée par la face de l’autre124 ». La stabilité des codes mis sur pied est d’ailleurs justement assurée par une coïncidence entre l’expression gestuelle et l’émotion à sa source125 qui se doivent toutes deux de refléter l’esprit de retenue qui les dirige. Tout autant que les émotions, l’expression corporelle n’est donc en rien naturelle, mais se voit culturellement codée126.
123S’élabore sur cette base un idéal de maîtrise de l’expressivité corporelle crainte pour le dévoilement de l’intériorité qu’elle peut occasionner. De manière révélatrice de l’importance qui lui est accordée, cette recommandation s’inscrit à la croisée de différents univers normatifs. Tout comme pour les émotions, les enjeux de la discipline corporelle sont multiples. Ils relèvent avant tout de l’idéologie chrétienne, animée de l’esprit de modestie et de retenue. Cette conception extérieure de la contenance des émotions semble en effet bien intégrée dans l’idéologie chrétienne. Outre les réflexions de Thomas d’Aquin ou de Richard de Saint-Victor que nous avons pu citer127, le théologien Raoul Ardent distingue sur cette base la modestia, qu’il conçoit comme la tempérance de l’homme intérieur, de la continentia, centrée sur l’homme extérieur et dès lors attachée au conditionnement du personnage social128. On le voit, la garde de l’émotion, comme du corps, se fait le moteur essentiel de leur considération vertueuse après des siècles de dépréciation. Mais la régulation émotionnelle centrée sur le corps dépasse rapidement les seuls murs du monastère pour s’immiscer jusque dans la sphère mondaine. Hors de toute considération purement chrétienne, on observe une sécularisation politique de l’appartenance sociale et institutionnelle justement basée sur la bienséance du corps, conçue comme le creuset de l’étiquette nobiliaire et des règles de savoir-vivre129. L’apparence du corps prend de la sorte une place centrale sur la scène sociale, signalant la place de l’individu130. C’est dans cette perspective que nous pouvons noter une stylisation des émotions qui se révèle avant tout corporelle131. L’expression émotionnelle se voit balisée par des répertoires de gestes formalisés et esthétisés qu’il convient de performer sur la scène sociale132. Comme le résume Joanna Bourke : « in this way, the body plays a role in 124social agency133 ». Cette composante sociale exerce une influence décisive sur la production, mais surtout sur la codification de l’idéal de maintien de soi. Pierre Pachet, en introduction de la revue Sigilia, insistait notamment sur l’utilité sociale de la rougeur, en tant qu’expression, spontanée, mais aussi performante de la pudeur134. Il témoigne ainsi d’une tension inhérente au pouvoir symbolique des symptômes corporels de l’émotion qui éclaire toute l’importance qu’ils prennent sur la scène sociale. L’époque médiévale ne fait pas exception, bien au contraire. Jutta Eming, par exemple, a défendu l’imprégnation culturelle de l’expression émotionnelle, peut-être moins naturelle que codée135. Elle qualifie les gestes, en tant que fruit de l’expression émotionnelle, de démonstration de la compétence sociale136. Elle pose même l’hypothèse d’un rapprochement entre expression émotionnelle et style du corps :
Die Authentisierung des Gefühlsausdrucks beruht auf der Ostentation der Emotion, der Stilisierung und Ästhetisierung des Körpers, sie ist auf Sichtbarkeit und Wiedererkennbarkeit angelegt, beruht auf Wiederholungen und Ritualisierung. Damit transportiert der Gefühlsausruck auch einen bestimmten Körperstil 137 .
Il est intéressant que le lien soit établi entre cette esthétisation du corps mise en lumière par Jutta Eming et l’authentification de l’expression émotionnelle. Il révèle la place essentielle qu’occupe la manifestation émotionnelle dans les relations sociales et dans l’appréhension de celles-ci. Il témoigne surtout de la tendance à la stylisation développée dans cette optique sociale. Au cœur de l’idéal de contenance se trouve en effet celui de la convenance, comme notre examen lexical le révélait138. Pareil souci stylistique imprègne les enjeux de contrôle émotionnel dans l’univers social. Hantée par la crainte de se révéler, mais aussi de manquer aux exigences courtoises, la société médiévale accorde une importance 125fondamentale à la contenance convenante. Les manuels de comportement illustrent cette tendance au contrôle bienséant. En témoignent les nombreux passages cités de l’œuvre à portée encyclopédique de Brunet Latin autour de la vertu de la garde. Il y insistait sur ses composantes avant tout corporelles, témoins obligés sur la scène sociale d’une intimité parfois encombrante, si ce n’est malséante139. Cela est plus vrai encore pour les miroirs aux princes destinés aux figures éminemment publiques des souverains. Nous pourrons constater combien les œuvres narratives se plaisent à mettre en scène ces feeling rules propres aux rois et autres hautes figures. Mais en rapprochant esthétisation et authentification des émotions, Jutta Eming révèle aussi une tension fondamentale entre la tendance à la stylisation et l’enjeu de la lisibilité des émotions, voire de leur sincérité. Il s’agit là certainement de l’un des enjeux essentiels de notre analyse. L’accès à la vérité des émotions constitue en effet une gageure. Tout le paradoxe de la théorie de l’homo interior et de l’homo exterior tient à cette double considération du corps comme reflet des émotions. Il en est à la fois la vitrine obligée et obligatoirement mesurée, sans que l’une et l’autre de ces injonctions ne puissent bien sûr toujours concorder. À la crainte du dévoilement de l’intériorité correspond ainsi celle de ne pas accéder à celle d’autrui. Souvent considéré – et craint – comme incontrôlable, le corps n’en constitue pas moins un intermédiaire parfois gênant, si ce n’est un obstacle, à l’appréhension de l’émotion. Appelée par la concentration sur l’homo exterior, la réflexion portée sur le corps pousse à interroger le rapport établi, ou manipulé, avec l’homo interior. Elle se conçoit donc au cœur d’une tension entre les appels à la sincérité et ceux à la mesure qui pèsent sur l’instance émotionnelle et en particulier sur sa manifestation.
L’expression émotionnelle se pose ainsi au cœur de dynamiques essentielles, mais paradoxales, de l’authenticité et de la bienséance qui entourent l’entité corporelle, tout autant que les émotions. Le corps n’offre en effet pas seulement une représentation physiologique pérenne de l’émotion, mais plutôt une projection sociale et culturelle140 ; et c’est sûrement cette 126double pression pesant à la fois sur le corps et sur l’émotion qui irrigue la dynamique de contrôle obsédante de la manifestation émotionnelle. C’est ainsi que se noue la tension entre l’apparence incontrôlable et le contrôle obsessionnel du corps. Les efforts de maîtrise ainsi revendiqués ouvrent la voie à une autre compréhension du corps, maîtrisable et donc manipulable. Damien Boquet défend sur cette base l’importance de l’expression physique de l’émotion : « Dans la mesure où désormais corps et émotions forment une même structure, les symptômes corporels peuvent avoir leur propre efficacité émotionnelle. On observe alors un usage émotif du corps141 ». La portée efficace de l’émotion et surtout de sa manifestation corporelle anime la dialectique que nous voyons se bâtir au cœur de notre analyse entre contrainte et jeu des émotions. L’impératif de contrôle dicte la manipulation de la sphère corporelle et permet ainsi de révéler son efficacité comme porte ouverte à d’autres manipulations. On observe ce faisant l’intégration absolue du corps au sein de la dynamique affective. Les enjeux de contrôle, plus encore dans cette optique bienséante voire esthétisante davantage que morale dictée par la scène sociale, posent la question de la mise en scène potentielle de l’émotion. Elle peut d’ailleurs se dédoubler dans l’accès que nous y avons en tant que médiévistes. Laurent Smagghe consacrait dans ce sens sa conclusion à interroger la part de mise en scène induite par les auteurs des chroniques royales envisagées dans son ouvrage. Une part de rituel ou de codage social pourrait également influer plus en amont la manifestation décrite au sein du produit littéraire issu d’un événement émotionnel donné142. Une réflexion plus importante nous semblerait nécessaire pour appréhender cette notion complexe et si pertinente de la manifestation émotionnelle qu’est la performance. Damien Boquet et Piroska Nagy insistent sur la valeur des émotions performées et rejettent une opposition binaire entre rituel et authentique, performé et sincère143. Il n’empêche qu’une rupture peut être envisagée au sein de ce code émotionnel entre émotion ressentie et émotion exprimée. Nous rejoignons à nouveau ici la théorie de l’homo exterior et l’ouverture qu’elle propose, dès le Moyen Âge, sur une potentielle non-concordance de l’intérieur 127et de l’extérieur144. Bien sûr, la question n’est pas tant de juger le degré d’authenticité de l’émotion manifestée que d’envisager son contexte et son fonctionnement. Gary L. Ebersole revient sur ce point : « It is not the role of the historian of religions to judge tears to be real or fake; rather, we must pay careful attention to how and why situated individuals cry145 ». Cela nous semble plus vrai encore quand on s’intéresse aux mises en scène discursives des mises en scène émotionnelles.
La lumière jetée sur les phénomènes de contrôle de l’émotion, et de rupture qu’ils impliquent face à son impératif de sincérité, nous semble dans ce sens des plus intéressantes à interroger. Considérer de plus près l’émotion à l’aune de ses facteurs culturels, selon ses paramètres corporels, tel est l’objectif que nous voudrions poser en amorce de notre réflexion sur le jeu des émotions. Cette introduction aux logiques qui sous-tendent la maîtrise émotionnelle nous paraissait indispensable pour l’appréhender au mieux. Davantage qu’aux manuels de comportement monastiques ou curiaux, c’est aux œuvres narratives auxquelles nous souhaiterions nous consacrer pour en envisager toute l’influence et toutes les nuances. Les règles de bienséance se diffusent en effet tout autant, voire plus encore, dans la littérature de fiction qu’au sein des traités didactiques146. La littérature narrative et particulièrement courtoise s’érige en lieu d’instauration des idéaux de modestie, d’humanité, d’élégance, de retenue, de modération, d’affabilité et de respect147. Elle offre même l’apogée de cet idéal de civilité qui empreint l’ensemble des cours féodales dès la fin du xiie siècle148. Elle se fonde surtout comme un vecteur de transmission incontournable de ce modèle, notamment par le biais du matériel romanesque dont C. Stephen Jaeger vante la fonction pédagogique de diffusion des idéaux courtois149. Il défend par exemple l’intérêt de l’univers arthurien en la matière : « The Arthurian material was supposed in the minds of its clerical authors to operate in the framework of moral instruction, whatever the actual practice may have been150 ». Le médié128viste allemand souligne encore, et à raison selon nous, l’importance des facteurs sociaux parmi les critères de diffusion de ces codes de conduite. Cet absolu de garde, dont nous avons cherché à appréhender les sources et les nuances, se décline diversement selon ses enjeux religieux, sociétaux, mais aussi amoureux, dont nous pourrons également observer la prégnance. Tous trois trouvent un écho retentissant au sein des romans et autres productions littéraires rattachées à l’idéologie chrétienne ou courtoise, qui nous intéresseront en tant que miroirs explicites des règles de retenue et de bienséance que nous voulions circonscrire par le biais du vocabulaire qui sert à les formuler et des traités monastiques ou curiaux qui se consacrent à les théoriser.
Petit manuel de la garde des émotions
et ses dérives dans la littérature médiévale
L’attemprance que célèbre Brunet Latin fait l’objet de nombreux autres éloges chez les auteurs du Moyen Âge. C’est le cas de Christine de Pizan qui vante, dans un registre fort similaire à celui observé dans Le Livre du Trésor, les mérites de la tempérance :
Attrempance estoit aussi appellee deesse ; et pour ce que nostre corps humain est composé de diverses choses et doit estre attrempé selon raison, peut estre figuré a l’orloge qui a plusieurs roes et mesures ; et toutefoiz ne valt rien l’or<lo>ge, s’il n’est attrempé, semblablement non fait nostre corps humain, se attrempance ne l’ordonne151.
On retrouve les mêmes composantes corporelles, l’appel à la raison comme moteur de la mesure recommandée et surtout une valorisation explicite de cette qualité d’attemprance, non plus seulement qualifiée de seingnorie comme chez Brunet Latin152, mais même de deesse. La proximité des conditions de valorisation de l’attemprance en indique l’importance, d’un bout à l’autre du Moyen Âge jusqu’en ce début de xve siècle qui voit paraître l’Epistre Othea. La comparaison qu’introduit Christine de 129Pizan entre corps et horloge s’avère intéressante pour appuyer la nécessité absolue de réglementation de soi. Elle témoigne de l’entremêlement des univers de recommandation dans lesquels s’inscrit l’idéal d’attemprance. Elle paraît en effet faire écho à L’orloge amoureus de Jean Froissart dont Christine de Pizan s’inspire sans aucun doute153. L’impératif de garde se conçoit ainsi à la lueur de logiques diverses, sociétale, amoureuse, ou religieuse avant tout. Elles induisent des traitements variables de cet appel général à la maîtrise des émotions, qu’il nous semble intéressant d’approcher pour mieux cerner toute la richesse de l’appel au contrôle de soi tel qu’il est inscrit dans la littérature narrative médiévale. Nous voudrions envisager les particularités qu’induisent ces trois dynamiques des feeling rules dans l’idéal de garde et les dérives qu’elles peuvent d’emblée entraîner. Nous aborderons de manière plus spécifique le jeu induit autour des émotions dans des œuvres qui se posent en réaction au Roman de la Rose, central dans nos analyses. Mais il nous est assez vite apparu que la norme appelait aussitôt le jeu, et c’est à travers ces premières manipulations que nous souhaitons à présent envisager les particularités qu’induisent ces trois dynamiques des feeling rules dans l’idéal de garde et les dérives qu’elles entraînent d’emblée, bien avant la mise en lumière accrue qu’en offrira Jean de Meun avec la figure de Faux Semblant.
La garde comme vertu religieuse : de l’idéal du repost
à la papelardie
L’historique que nous avons proposé en introduction de cette analyse révèle le rôle essentiel joué par l’idéologie chrétienne dans la mise en place de l’émotionologie médiévale. Avant d’en envisager la mise en scène dans une optique courtoise, essentielle dans les œuvres narratives qui nous intéresseront, nous voudrions insister sur la prégnance du code religieux dans la littérature qui s’en fait l’écho. Il nous paraît d’autant plus indispensable à appréhender que l’idéal courtois s’inspire dans une grande mesure des réflexions monastiques menées autour des émotions : « Similarly, the control of emotions, which became a theme in the handbooks of proper social comportment for the upper strata of lay society in the latter Middle 130Ages, owes much to monastic discipline154 ». Fondé sur le souci de justifier une perception vertueuse de l’émotion, l’objectif de garde se comprend avant tout dans son optique religieuse, quelle que soit sa prégnance dans l’univers social. La notion même de gouvernement, ensuite devenue purement politique, trouve ses racines dans la tradition religieuse. Ainsi que le rappelle Michel Senellart, le regimen est d’abord conçu comme un instrument de discipline en vue du salut155. Bien sûr, il s’agit là de deux univers bien distincts, répondant à des objectifs fort divers, qu’ils relèvent de l’ascèse monastique ou de la prudence stratégique typiquement aristocratique156. La définition qu’offre Michel Senellart du regimen en est significative : c’est la recherche de proximité intérieure avec Dieu qui est visée dans la perspective religieuse, tandis que seul le lien entre hommes, dicté par une logique strictement extérieure, est considéré dans la pensée courtoise157. Martin Aurell offre un excellent résumé de cette divergence entre normes religieuses et courtoises :
D’un côté, la règle recherche explicitement l’harmonie entre la vie intérieure du moine et son comportement extérieur, entre l’esprit et le corps, entre l’être et le paraître. De l’autre côté, le code courtois vous apprend plutôt à cacher vos sentiments, pensées et états d’âme derrière un masque, pour ne pas heurter votre prochain et pour donner une image de soi en accord avec les modèles aristocratiques de comportement au profit de votre bonne réputation158.
Ainsi, si l’ascèse tend au contrôle de soi, c’est essentiellement dans un objectif de salut, d’harmonie nécessaire à l’élévation vers Dieu, tandis que la réglementation courtoise concerne fondamentalement la réputation, l’apparence livrée de soi non pas à Dieu d’ailleurs, mais à l’autre. Dans une autre perspective, Damien Boquet soutient que la recommandation de modération du corps, liée à cette dynamique ascétique, ne vise en rien le bien-être du corps qu’il conviendrait de préserver de l’épuisement provoqué par le déchaînement émotionnel159, mais, bien au-delà, celui 131de l’âme160. Quelles que soient ces nuances, le discours monastique et les manuels courtois convergent autour d’un « idéal commun de maîtrise de soi, de mesure, de transparence et d’harmonie161 ». Il nous paraît dès lors opportun d’éclairer chacune des dynamiques de l’appel à la maîtrise de soi.
Guillaume de Diguleville témoigne, dans son ample Livre du pèlerin de vie humaine162, de l’importance accordée à la vertu de Tempérance dans le cheminement qu’est censé mener le vrai chrétien vers Dieu. Il en vante les bienfaits au gré de la description qu’il livre de l’armure de vertus offerte par Grâce-Dieu au pèlerin. Outre le gambeson de Patience, le haubergeon de Force, l’épée de Justice, le fourreau d’Humilité, le ceinturon de Persévérance et sa boucle de Constance, ou encore la targe de Prudence, le pèlerin se voit accorder le heaume de Tempérance. Il vient servir le combat indispensable contre les défauts des cinq sens, dans une compréhension toute sensorielle et corporelle de la tempérance. Il se montre en ceci tout à fait conforme aux logiques de la notion d’attemprance, selon son étiquette alors en usage163. L’attention qu’il accorde aux actions du heaume révèle son importance. Selon trois zones de force spécifiques, il peut distinctivement lutter contre la folie et la vanité liées aux sens de l’ouïe, de la vue et de l’odorat grâce à la Tempérance à proprement parler ; contre la gloutonnerie par le biais du combat que livre le gorgerin de Sobriété autour du sens du goût ; et par celui des gantelets de Continence à l’égard du toucher164. Le choix du heaume pour symboliser cette vertu en particulier est évidemment symbolique de l’étendue de la protection qu’il se doit d’appliquer pour contrer les excès que peuvent comporter les cinq sens et le corps. Surtout, il fait état du rôle qui lui est accordé dans le parcours d’élévation vers Dieu dépeint au gré du Livre du pèlerin de vie humaine.
132L’intégration de la tempérance parmi les qualités essentielles du bon chrétien ainsi armé contre tous les vices auxquels il doit faire face traverse la littérature médiévale. Elle se retrouve même dans le Lancelot en Prose, œuvre emblématique de l’esprit courtois, mais qui se prête aussi, au fil de la Queste del saint Graal en particulier, à la démonstration des idéaux chrétiens. Le premier volet de cet imposant cycle en prose illustre déjà l’importance conférée aux enjeux religieux de la mesure, au-delà de ceux, plus proprement chevaleresques, dont relève le parcours initiatique mené par Lancelot165. Ils y trouvent une place d’autant plus intéressante qu’ils se voient confrontés à la violence des émotions mises en scène dans les aventures de la cour arthurienne. L’appel au contrôle de soi n’en intègre pas moins les idéaux qui y sont véhiculés : « Et neporquant, trop en porriez vos faire, car l’an doit en totes choses esgarder raison et mesure166 ». Cette recommandation formelle s’adresse à Hélène de Benoïc qui pleure alors la perte de son mari décédé et de son fils disparu. Elle lui est délivrée par un moine qui, sans manquer de compréhension à l’égard de son deuil167, insiste sur la mainmise que raison et mesure doivent conserver sur l’instance affective. La justification que le moine donne à ce besoin de mesure est très éclairante de la portée religieuse de cette prescription : « Et puis que vos iestes partie del siegle et avez pris abit de religion por amor Deu, il n’est pas honeste chose de faire duel en chascun leu, car vos devez plorer et les voz pechiez et les autrui, non mie veiant lo pueple, mais en vostre cloistre et au plus an repost que vos porroiz168 ». C’est dans la sphère religieuse que se construit l’appel à la mesure, qui se définit comme l’expression privée des émotions, du moins hors de toute publicité pour le pueple qui ne peut assister à ce duel. Une répartition des lieux de manifestation émotionnelle se dessine de la sorte, entre la scène publique et l’intimité du cloître, doublée d’une répartition idéologique qui leur correspond. La recommandation du moine semble effectivement dédiée en particulier à ceux qui, comme Hélène 133de Benoïc, ont pris abit de religion. L’écart posé avec le siegle laisse deviner une distinction entre univers monastique et séculier qui se concevrait aussi dans le cadre de la maîtrise émotionnelle. Le terme de repost paraît révélateur d’une dynamique spécifique des prescriptions émotionnelles au cœur du cloître qui exclut tout trouble, tout mouvement excessif. Il pose pour objectif explicite le calme et la stabilité, dans une perspective conforme aux efforts d’ascèse monastique. La tranquillité personnelle connaît peu d’influence dans les logiques émotionnelles de la sphère plus proprement courtoise. La confrontation que sous-entend le moine entre siegle et cloistre trouve écho dans les autres appels à la maîtrise des émotions que met en scène le Lancelot en Prose, nous y reviendrons.
Nous voudrions auparavant nous arrêter sur le personnage de Renart qui témoigne lui aussi de manière exemplaire, mais en creux pourrions-nous dire, de la portée religieuse de la codification émotionnelle. Emblème de la ruse, il démontre l’importance prise par les signes religieux qu’il détourne, ce qui reflète bien leur pouvoir symbolique. Sa si grande aptitude à dissimuler qu’il simule, lors de chacune de ses tromperies, pourrait en soi démontrer la prégnance du précepte de garde. Mais Renart mobilise surtout les enjeux de l’habit monastique, de la confession et de la pénitence, fondamentaux dans le système émotionnel religieux. Il permet ainsi de mettre en lumière la tension qui anime la codification émotionnelle entre contrôle et sincérité et qui peut ainsi faire éclater des signes supposés formels de l’investissement dévotionnel169. Ce chapitre de nos réflexions visant justement à appréhender le basculement de la garde au jeu, il nous paraît pertinent de nous arrêter sur les décalages que nous pouvons déjà observer par le biais de la figure de Renart.
Renart se caractérise à la fois par sa sincérité et par sa facilité à manipuler ses émotions. Il fait montre ce faisant d’une grande capacité de contrôle de ses émotions, mais aussi de ses dérives, plus encore quand elles touchent aux émotions si investies de la dévotion religieuse. En symbole de l’art de papelardie170, Renart figure les limites des signes émotionnels que les préceptes religieux sont supposés encadrer, non sans difficulté d’emblée en ce qui concerne la confession par exemple. Renart vient servir de modèle des confessions animées par la ruse qu’il 134incarne. On a souligné l’importance de l’expression de la confessionRenart, symptomatique de la fausseté qui contamine l’univers religieux171. Concomitante de la montée de la pratique confessionnelle encouragée par le concile de Latran IV, cette expression pose la question de sa sincérité, liée au repentir qu’elle se doit de porter. Bohdana Librová propose un historique de la problématique de la confession hypocrite érigée comme motif littéraire sous cette formule de « confession Renart ». Du De Lupo qui l’introduit déjà dans l’univers de la poésie satirique animalière à la fin du xie siècle au Chevalier au Barisel, l’expression de la confession renart irrigue la littérature. Elle témoigne de l’importance prise par ce personnage dans la dénonciation du vice d’hypocrisie, plus encore dans le cadre d’un rituel dont la sincérité fonde l’efficacité172.
La tradition animalière se veut riche en remises en question des pratiques dévotionnelles instituées avec Latran IV. Les satires de confession de Renart jouent avec tous les codes développés alors. Nous pouvons ainsi l’observer se prêter aux aveux, aux formules d’imploration, voire aux larmes de contrition recommandés, dans une mise en scène qui paraît sur cette base bien plus sincère. L’analyse que Jean Subrenat propose de l’ultime confession introduite dans la branche VIII du Roman de Renart témoigne du poids accordé à l’engagement émotionnel et corporel requis173. Renart y mobilise un grand nombre de signes essentiels à l’efficacité du rituel, des génuflexions aux larmes, symptôme incontournable de la théorie contritionniste. On perçoit ainsi combien le repentir s’avère indispensable au processus de la confession, et plus encore à ses manifestations extérieures. Cette importance accordée aux implications corporelles de la dévotion déborde la seule question confessionnelle. Renart recourt également dans ce sens à une autre pratique spirituelle en plein essor : celle du culte des reliques. Désireux de se libérer de Roenel venu le quérir à la demande du roi Noble, le goupil invente un stratagème qui vise à convaincre son compagnon que le piège tendu dans les vignes devant eux est une relique précieuse, à embrasser pour 135bénéficier de ses bienfaits. Bien sûr, le pauvre berné est pris dans les lacets qui entourent la prétendue relique. C’est par tous les signes de dévotion attendus que Renart parvient à mettre en place sa supercherie :
Savez conment l’a deceü ?
Quant l’enging a apperceü,
Devant le laz qui iert tendus
S’est mis Renart et estenduz
A genoillons et merci crie
Au creatour et si li prie
Qu’il le gart des mains au gaignon
Dant Roenel, son conpaignon174.
La narration n’hésite pas à éclairer le lien qui s’effectue entre la ruse de Renart et son exploitation des signes religieux. L’interrogation qui introduit le passage dénote bien la volonté explicative de cette logique trompeuse. Renart mêle les rituels corporels et verbaux de la dévotion, qui n’est certes pas nommée, mais clairement convoquée au gré de sa prosternation et de ses prières. L’ironie est notable : c’est la prière de Renart aux fausses reliques qui portera ses fruits, quand bien même son engagement dévotionnel n’est que feint. Par contraste, Roenel, qui croit aux mensonges de Renart et donc aux reliques supposées, n’est accompli en rien dans ses demandes de bienfaits. Cet épisode révèle tout le potentiel humoristique instillé autour des pratiques dévotionnelles, à l’efficacité et surtout à l’investissement émotionnel rendus ainsi problématiques.
L’efficacité démontrée ici par Renart caractérise bon nombre de ses stratagèmes et des manipulations émotionnelles qu’ils impliquent. Ce n’est d’ailleurs que dans ce type de visée intéressée que Renart mobilise les signes de dévotion. Ses confessions participent souvent du même souci de préservation : dans la branche I, Renart accepte de se confesser à Grimbert, messager de la sentence que lui adresse le roi Noble, mais essentiellement en raison de sa peur de mourir175. La branche VII offre un épisode plus explicite encore de ce type de confession intéressée. Craignant la noyade, Renart interpelle le milan Hubert pour se confesser à lui, avant de s’irriter de la condamnation de Hersant et de tenter de le 136croquer176. Le milan ne s’y trompe pas et souligne toute la malhonnêteté de sa démarche :
« En qui se fiera l’en mes,
Quant cil qui se fesoit confes
Voloit son provoire manger ?
[…]
Un traïtor qui por un oef
Traïroit uit homes hu noef !
C’est uns leres, uns losengiers
Qui, por moi ores engignier,
Se fist ainsi con beste morte.
La male passïons le torte !
Di di avant, mal es baillis,
Ja n’ieres mes espeneïs177. »
L’accent semble mis sur la volonté de Renart, en accord avec celle qui devrait en effet soutenir la confession178, dans une belle démonstration de la rupture que provoque ce désir de dévorer son confesseur avec le repentir attendu. Le rapprochement entre le fait d’être confes et celui de manger renforce la rupture opérée. Il souligne l’opposition établie entre l’élévation spirituelle de la confession et le bas-ventre, seul souci bassement matériel de Renart, animé uniquement de sa colère à l’encontre du milan et de sa faim, caractéristique tout au long de ses aventures. Le milan dénonce alors la tromperie du goupil en exploitant tous les motifs habituels en la matière : le proverbe du traître dans lequel la rime met en contraste la bassesse du prétexte de trahison avec la portée de celle-ci, l’accusation de voleur, mais surtout de losengier, archétype du trompeur craint et vilipendé dans toute la littérature courtoise. Sa condamnation est à la hauteur de son hypocrisie, que Humbert saisit dans toute son ampleur. L’emphase mise dans cette critique illustre la gravité de la tromperie de Renart en jouant sur les signes religieux et en trahissant le pacte supposé s’établir entre le confés et son provoire. Davantage que cette confession abusive, c’est même la fausse posture de mort qu’il critique, en écho probable à l’une des autres ruses bien 137connues de Renart. L’immobilité de la beste morte que simule Renart peut elle-même faire écho à l’idéal du repost recommandé à Hélène de Benoïc, de manière révélatrice du décalage opéré dans l’émotionologie religieuse. Tous ces épisodes de l’univers renardien illustrent l’importance des recommandations émotionnelles dans l’univers religieux, mais aussi les débordements auxquels elles peuvent conduire, de par le pouvoir symbolique qui leur est accordé. De l’emphase de la garde à la maîtrise de soi symptomatique de la ruse de Renart et à sa mobilisation de nombreux indices dévotionnels, la frontière paraît ténue, selon la mise en scène explicite qu’en donnent les œuvres narratives.
De telles ruptures des codes émotionnels de la dévotion appelaient bien sûr une réaction. Émergent ainsi, en parallèle des démonstrations explicites de la ruse qui peut s’immiscer dans l’émotionologie religieuse, des appels à son respect le plus strict, sans aucune forme d’ambiguïté. Plus encore, la garde émotionnelle se trouve associée à une forme de sincérité. Le roman de la Queste del Saint Graal, représentatif de la portée religieuse instillée dans la littérature narrative, propose ainsi une dénégation totale de l’hypocrisie. Presqu’aucune occurrence de manipulation des apparences n’apparaît au gré de ce long épisode du cycle en prose du Lancelot Graal. Il est d’ailleurs révélateur que l’un des rares recours à la dissimulation des émotions ne puisse se contenter de la maîtrise de l’apparence, visiblement insuffisante à endiguer le flot d’émotions dépeint. Le romannous présente en effet la reine Guenièvre accablée par le chagrin à la nouvelle du départ des chevaliers pour la quête du Graal : « ele comença a fere si grant duel com s’ele veist mort toz ses amis, et por ce que l’en ne s’aperceust coment ele en estoit corrocié, entra ele en sa chambre, si se lessa chooir en [son] lit179 ». Animée par le souci, habituel, de ne laisser percevoir son émotion en public, la reine ne peut cependant retrancher sa tristesse que derrière les murs de sa chambre, là où aurait dans d’autres cas suffi la dissimulation de son état d’âme. Cas isolé lié à la force de l’émotion à contenir ou emblème d’une idéologie refusant la feintise même dans sa dimension de maîtrise courtoise, ce passage correspond à un projet plus vaste dans la Queste del Saint Graal. D’une portée symbolique essentielle, le rêve de Gauvain correspond tout 138à fait à cette logique du refus ou de l’impossibilité de la dissimulation en dépeignant l’incapacité des taureaux tachetés, métaphore des chevaliers de la quête non-élus, à cacher en eux leur vice : « par lor luxure et lor orgoil sont cheoit en pechié mortel si durement que lor pechié ne se puent tapir dedenz els, ainz les covient aparoir par defors, si qu’il en sont tachié et ort et mauvés si com li torel estoient180 ». Péché ou émotion – parfois intimement entremêlés dans la conception médiévale – ne paraissent pouvoir se camoufler au sein de ce roman de la rédemption, mais surtout de l’élection divine. Semble ainsi se réinstaurer, au gré de cette littérature à tendance religieuse, la concordance entre intérieur et extérieur, au nom d’un recentrement vers Dieu duquel l’homme ne peut se cacher.
Les Miracles Nostre Dame de Gautier de Coinci illustrent à merveille toute l’importance accordée aux manifestations émotionnelles au cœur de ce rapport entre intérieur et extérieur à la fois souligné, pour répondre aux enjeux de bonne garde et de repost, et problématisé dans la perspective religieuse. À la croisée de ses objectifs édifiants et narratifs, ce recueil de littérature mariale promeut l’adéquation entre homo interior et homo exterior dans le plaidoyer que Gautier de Coinci livre pour la sincérité de la foi. Il ne manque pas pour autant de louer la dimension affective et même corporelle de la pratique spirituelle. Il répète à l’envi l’importance des gestes dévotionnels, de la génuflexion ou de la prosternation surtout, mais aussi du signe de croix par exemple. Le célèbre Miracle de Théophile joue dans ce sens du motif bien connu de la défense offerte par la foi contre l’ennemi. Il met en scène son héros qui se voit interdire de se signer, tout comme d’appeler à l’aide de Notre Dame, lors de sa rencontre avec le Diable181. En la proscrivant, le Juif témoigne de la force de protection reconnue à la prière. C’est donc déjà en creux que se construit le pouvoir accordé aux manifestations de la dévotion, vantées pour leur efficacité tout au long du recueil.
Gautier de Coinci fonde donc ses recommandations sur ces critères de visibilité de la prière, mais sans se départir du fondement émotionnel. 139La valeur accordée aux apparences des émotions n’a d’égal que les précautions dont elles sont entourées, mais surtout que l’emphase portée avant tout sur la réalité qu’elles doivent refléter. Il s’appesantit autant sur cette exigence que sur celle de l’investissement corporel de la dévotion, comme en témoigne ce passage tiré du miracle D’un clerc :
Nus ne puet faire fin douteuse,
Soit clers, soit lais, soit honz, soit fame,
Qui de fin cuer aint Nostre Dame.
Tuit cil qui l’aimment de cuer fin
De finer de tres fine fin
De Dieu ont chartre et previlege182.
Selon un jeu stylistique qu’il aime déployer, Gautier souligne l’association entre la finesse de l’amour porté à Notre Dame et la bonne fin ainsi promise à celles et ceux qui le ressentent. La collusion sémantique est mise en valeur par l’annominatio en « fin », répété à six reprises sur ces quelques vers. L’enjeu central de la dévotion mariale se situerait ainsi non dans la mise en place des gestes et signes requis, mais bien dans son investissement émotionnel. La reprise de la formule de cuer fin explicite ce critère fondamental de l’authenticité de l’amour, selon une insistance courante sur ce motif du cœur sincère. Gautier de Coinci se distancie ainsi d’un ritualisme strict et prône plutôt une attitude affective de confiance, dans laquelle prévaut l’intention, quelle que soit le rôle qu’il reconnaisse aux gestes183. Sa démarche s’éclaire bien sûr à la lueur des suspicions qui continuent d’entourer les manifestations physiques et de l’insistance dès lors nécessaire sur la sincérité de cette expression. Mais plus encore, elle se conçoit dans le rapport à Dieu que Gautier de Coinci favorise sur tout autre. La définition de la sincérité et son obligation doivent beaucoup à sa compréhension divine. L’homme vrai l’est en effet vis-à-vis du Seigneur avant tout, ce qui renforce bien sûr cet impératif. Le miracle De l’empeeris qui garda sa chasteé contre mout de temptations valorise dans ce sens la sincérité du cœur de l’héroïne. Accusée de se dissimuler et de tromper son monde par un prétendant éconduit et piqué dans son 140orgueil, la jeune femme se défend en soulignant que ses pensées n’ont pas à être connues de quiconque, puisqu’elles le sont de Dieu :
« Sire, fait ele, mes pensez
Seit Diex mout mielz que nus ne face :
Diex voit ou cuer, hons en la face ;
Diex voit le cuer, le vis li hom184. »
La supériorité divine est mise en exergue dans une comparaison explicite, renforcée par la rime, avec la face à laquelle l’homme peut seulement avoir accès en contraste. Le parallélisme, seulement nuancé par la construction du verbe voir, insiste, de manière presque superflue ainsi, sur cette distinction entre Dieu et les hommes. Il permet aussi de mettre en lumière le caractère limité du seul accès possible à l’intériorité pour l’homme, restreint aux apparences. La seule variation entre ces deux vers repose en effet, au-delà du chiasme, sur la qualification du visage, comme pour mieux souligner, par cette diversité tout apparente, l’irréductibilité de tout autre voie d’accès. Il s’agit là d’un argument essentiel de la prudence conservée à l’encontre des émotions, auxquelles l’homme n’a accès que par leur apparence. Et s’il va de soi que l’appréciation de la dévotion manifestée demeure au final dans les mains de Dieu, juge omniscient et seul valable, il n’en demeure pas moins compliqué pour les prêtres de savoir comment évaluer l’engagement affectif requis dans la pratique dévotionnelle. C’est pourquoi, davantage que de souligner l’importance du cœur sincèrement investi, Gautier de Coinci, en écho aux théologiens de son temps, en condamne l’absence, et l’hypocrisie qu’elle suppose185.
La crainte qu’inspire l’irréductibilité de l’accès à l’intériorité cause chez Gautier de Coinci un souci de dénonciation important de la rupture du lien entre cœur et apparence. Tout autant investi dans la promotion du culte marial que dans la critique de ses opposants, il se consacre volontiers à la satire des clercs hypocrites. La portée satirique de ses miracles se concentre en effet avant tout sur les membres du clergé, eux qui se doivent justement d’offrir un exemple à imiter186. Il rejoint 141ainsi la logique de visibilité qui infiltre l’univers religieux et la pratique pastorale en particulier187. Moins que tout autre, les moines ne peuvent mettre en péril l’interprétation des gestes et rituels développés dans la pratique dévotionnelle. Gautier de Coinci condamne l’hypocrisie et la vilenie des « pappelart »au gré d’une longue diatribe dans le miracle D’un archevesque qui fu a Tholete188. Introduite en queue du miracle, cette critique, portée avec l’emphase et la colère coutumières de Gautier de Coinci, met en lumière, selon tout le champ sémantique de la tromperie, le « barat », la « gille » de ceux qui « tout sont faus et bon se font » et s’assurent ainsi que tous soient « deceü189 ». Le chiasme renforce l’opposition entre la bonté prétendue et la fausseté avérée de ces hypocrites. Surtout, leur tort est souligné par le rapprochement entre la gille et « l’Evangille »qui fonctionne comme autorité de leur condamnation190. Plus loin, Gautier de Coinci met encore en exergue cette opposition entre leurs « samblans » et leur « dedens ». La rime vient ainsi marquer le contraste, par sa sonorité même, entre cœur et apparence191. Il dénonce ces samblans d’apparence seulement « esperiteus », en opposant, à la rime, les « faces maigres et amorties » et leur dedens « tout plain d’orties192 ». La manipulation de l’extérieur est bien mise en lumière : la « symple chiere » est « faite »plutôt que simplement affichée, selon une forme d’art de la ruse révélée par le verbe « savoir193 ». La ruse dont Gautier blâme ces hypocrites est explicite : la répétition de l’adjectif esperitel indique l’orientation de cette critique194. L’opposition renforcée au fil de ce passage entre le semblant et le dedans se concentre donc sur l’émotion centrale de la vie religieuse, celle qui relève de l’investissement spirituel requis. L’accusation de pappelart vient 142confirmer cette orientation. Gautier redouble, et même triple, sur cette base le rapport d’opposition déjà introduit entre le semblant et le dedens, cette fois entre le « devant » et le « derriere », repris deux fois sur deux vers, mais aussi entre le « noir » et le « bai195 ». La multiplication des contrastes que cultive Gautier de Coinci permet de mieux mettre en lumière l’importance de la rupture qu’ils impliquent et de la fausseté qu’ils véhiculent. La gravité de cette tromperie est révélée par le terme même de pappelart, et par la concentration religieuse qu’il induit, mais aussi par son ampleur, elle qui touche donc l’ensemble du « monde196 ». Le danger que comporte l’hypocrisie spirituelle ne pourrait être plus explicite, dépeint dans toute sa diversité d’apparences possibles, de couleurs, de gestes ou d’implications corporelles. La diatribe se poursuit contre ces pappelards qui « dyable keuvent quanqu’il ponent », géniteurs de l’« Antecris » et pires « traïteur » même que « Caïm197 ». Cette condamnation explicite joue des débordements de l’émotionologie. Il est en effet intéressant de noter que le tort reproché aux envoyés du Malin est qu’ils « lor grant malice coevrent198 », un impératif souvent répété à l’envi dans les manuels de comportement amoureux ou courtois. Il est également frappant de voir apparaître une référence à la médisance199, nœud des accusations de tromperie dans le registre amoureux, nous le verrons200. Cet entremêlement des atteintes aux sphères émotionnelles religieuses et amoureuses se concentre de manière significative sur 143l’opposition entre cœur et apparence. Dans ce cadre de dénonciation de l’hypocrisie émotionnelle, le cœur ne peut qu’être sombre, par contraste avec le « cler saÿm » qui le dissimule201. La critique se fait plus subtile ainsi, au cœur de ce réseau biblique, mais aussi littéraire courtois. Gautier de Coinci démontre ainsi sa maîtrise parfaite des codes littéraires qu’il s’ingénie à détourner. C’est d’ailleurs aussi en référence à Renart que se construisent ses critiques des « begins » et « pappelars », « qui plus sei[en]t gille que Renards202 ». Gautier de Coinci décrie ainsi le décalage entre apparences et actions, au gré de jeux phonétiques et de parallélismes révélateurs de sa dénonciation. La rime équivoquée entre celui qui « vielt c’on le tiegne por parfait » et le « fait » qu’il ne fait justement pas, puisqu’il se contente de la seule « contenance », en est révélatrice203. Gautier de Coinci s’ingénie à souligner la malignité de telles manipulations aussitôt qu’elles rompent le rapport de concordance avec le cœur. Pour mieux la mettre en exergue, il actualise cette opposition au sein de celle dont il joue aussi entre orgueil et humilité, qui en renforce bien sûr encore le vice. Pour clore son Miracle de Théophile, il insiste autant sur la critique de l’orgueil que sur le conflit entre « cuer » et « face », voire « robe » ou « habit » – dans une belle démonstration de l’importance que prend la problématique vestimentaire dans ce débat autour des apparences –, « dedans » et « semblant », mais même aussi entre « defors » et « cors204 ». Le lien entre habit et orgueil est bien dénoncé, ne serait-ce que par la critique du « si vil habit / ou a la fois orgiuelz n’abit205 », mais aussi dans la dynamique dissimulatrice de l’orgueil, qui « assez sovent se muce206 ». Au fil d’une véritable accumulation de parallélismes, Gautier de Coinci met en lumière, dans la construction 144syntaxique même de sa critique, le contraste entre humilité et orgueil, péché originel et capital des pappelards. Dans ce contexte, seule la face s’avère positive, le cœur étant systématiquement associé à la félonie, à la noirceur aussitôt qu’est révélé son lien avec l’orgueil. Le fondement de cette critique est explicite : « il estevoit par estevoir / humelité de cuer movoir207 » ; l’humilité doit résider dans le cœur, sous peine que ne s’opère cette inversion. Cette qualité religieuse essentielle étant dès lors rangée du côté des seules apparences, le cœur ne peut être que négativement connoté. La dimension religieuse de cette critique est une fois de plus évidente, les références aux habits monastiques sont nombreuses tout au long du passage, de la « chape noire » à la « aspre haire » en passant par le « voile », l’« habitréguler », en-dehors des qualifications de « pappelart » et de « marmite208 ». L’association tissée avec l’orgueil exacerbe le défaut de l’hypocrisie en le combinant au premier des péchés capitaux209. Elle détermine l’intention, indubitablement condamnable, de l’hypocrisie, qui dissimule l’orgueil ainsi logé dans le cœur. Toute l’insistance mise sur l’opposition entre cœur et apparence et entre orgueil et humilité paraît éclairer ce rapprochement entre l’orgueil et le cœur.
Dans une belle démonstration de l’importance de ce critère d’évaluation dans l’émotionologie religieuse, l’intention peut également justifier le jeu émotionnel qui relève de la bonne garde. Si Gautier de Coinci prêche pour la sincérité, il n’oublie pas pour autant l’enjeu de la maîtrise des 145émotions et il reconnaît à l’occasion l’utilité de la dissimulation. Dans le miracle D’un clerc, il n’introduit aucune condamnation du bel semblant du jeune marié qui camoufle sa prise de conscience et sa souffrance :
De la chappele mout tost ist
Et a ses noces s’en revient.
Pour ce que faire li convient,
Biau samblant fait et bele chiere.
D’or en avant n’a il point chiere
Ne la feste ne l’asamblee.
Par bel samblant leur a emblee
La volenté de son corage210.
Dédié à l’amour de la Vierge avant d’oublier sa promesse devant sa belle fiancée, le clerc reçoit la visite de Notre Dame, venue le sermonner pour sa trahison. Sa réaction est immédiate, en symbole de sa dévotion originale saluée par la Vierge qui prend pour cela l’initiative de cette apparition. Ce qui se dessine dans ce miracle, c’est donc l’opposition entre deux types d’amour. Le parallélisme qui s’instaure, dans les deux premiers vers de cette citation, entre la chapelle et les noces souligne le contraste entre les deux univers amoureux et religieux, mais surtout entre ces deux formes d’amour, pour la dame ou pour Notre Dame211. Ici, c’est le vœu à Notre Dame qui est rompu pour la jeune fille, ce qui suscite le souci de garder secrète, du moins discrète, la prise de conscience du jeune clerc. Une fois de plus, on peut observer le jeu mené par Gautier de Coinci sur la tradition littéraire courtoise. Mais la tendance n’est pas tant à la réorientation qu’à l’entremêlement ici. Si Gautier de Coinci tient à valoriser l’amour marial avant tout, ce n’est pas au détriment de toute logique courtoise pour autant. Avec le retour sur la scène sociale des noces se marque le poids des codes qui y sont liés. Ainsi, le clerc se prête à la simulation d’un biau samblant qui vise à camoufler son affliction d’avoir déçu Notre Dame. À trois reprises, Gautier de Coinci insiste sur la manipulation opérée, comme pour mieux la mettre en lumière, mais 146aussi peut-être, par la répétition de l’adjectif bel, pour mieux défendre son caractère acceptable. Bien loin des critiques adressées aux pappelards et autres faux dévots, Gautier de Coinci ne connote que positivement ce jeu d’apparences. Il l’associe en outre à la formule de convenance, tout à fait usuelle dans le cadre courtois, dans une autre démonstration de sa connaissance parfaite de ces codes. Le rapprochement, à la rime, des homophones chiere-chiere est également révélatrice de cette dynamique d’approbation. La chiere manifestée par le clerc se confond de la sorte avec son mépris de la fête et du monde, en amorce de sa décision d’en revenir au seul amour de la Vierge. Si Gautier de Coinci distille donc son accord face à cette simulation, il n’est pas moins question de rupture entre cœur et apparence pour autant. Le vers qui clôture ce passage atteste la place qu’occupent une fois encore le cœur et l’intention, en contraste avec les semblants affichés. Mais au contraire des noirs desseins des hypocrites, la volenté qui anime le jeune homme ne doit pas être blâmée ici puisqu’elle relève de l’amour marial. La nuance esquissée entre ces divers cas de figure s’éclaire donc à l’aune de ce critère intentionnel et de l’objet de la dissimulation, l’orgueil dans un cas, l’amour de la Vierge dans l’autre212. C’est autour de l’axe orgueil-humilité que paraît se fonder l’évaluation des manipulations des apparences et de l’intention qu’il inscrit au cœur de celles-ci. Il éclaire en tout cas le renversement de la condamnation des orgueilleux hypocrites à l’éloge du sacristain qui se dissimule par humilité, selon des nuances de grand intérêt. Les Miracles de Gautier de Coinci témoignent ainsi de la tension entre maîtrise émotionnelle à louer et ruse à dénoncer, et de la diversité des critères qui peuvent justifier, ou non, la manipulation des semblants émotionnels, qui entremêlent toutes les dynamiques des feeling rules.
147La garde comme vertu curiale : crainte de la démesure
et elegentia morum213
Parfois bien loin de ses origines religieuses, l’objectif de maintien de soi connaît une orientation particulière au sein de la littérature courtoise et à la cour qu’elle met en scène. La plupart des occurrences que nous pouvons y trouver d’appels au contrôle et à la mesure s’inscrivent en effet dans une logique profondément extérieure, dont témoignaient déjà dans une certaine mesure les extraits cités pour illustrer l’idéal du repost et ses dérives dans la sphère religieuse. Dans la veine courtoise, le maintien de soi relève d’un souci de la réputation et de l’image de soi renvoyée en société, essentiel dans la société médiévale dite de l’honneur214. En effet, la vie aristocratique favorise grandement cette dynamique de maîtrise de soi et de stylisation émotionnelle215. C. Stephen Jaeger a bien mis en exergue cette caractéristique de la culture de cour, qui tend à l’esthétisation des manières. Il résume son ambition fondamentale comme un raffinement intense centré sur l’émotion216. La courtoisie se définirait ainsi comme le sommaire des qualités sociales rendant les hommes et les femmes agréables, dont l’elegentia morum constitue la clé de voûte217. C’est dans cette optique que se conçoit l’intégration de l’idéal de mesure au sein de l’univers courtois, autour de cet objectif de contenance et de convenance de l’apparence : « The assimilation of curialitasto elegantia morum was, from the perspective of the history of ideas, made possible across the bridge of kalokagathia; external refinements and scrupulousness of manners are insigna virtutum; the refinement of the outer man mirrors the well-ordered inner life218 ». S’élabore, oscillant entre concepts éthiques et sociaux, ce que C. Stephen Jaeger nomme la « poetics of conduct219 ». Elle se fonde sur une discipline purement sociale qui vise la manifestation extérieure de la vertu intérieure220. La maîtrise vient assurer un objectif de cohésion sociale que toute forme d’excès mettrait en péril : 148« la courtoisie se charge de policer tout abandon de la mesure, envisagé comme source potentielle de dérèglement, afin de préserver le groupe de toute transgression de règles qu’elle maintient vaille que vaille221 ». On assiste à une spécification sociale de l’idéal de mesure, jusqu’alors essentiellement éthique. La donnée morale de cet appel au maintien de soi ne disparaît pas pour autant, mais, au-delà du souci du corps relevé dans les régimes de santé ou de celui de la progression vertueuse vers Dieu, on voit émerger celui d’une autre instance essentielle de la vie médiévale : celui de la société et de sa cohésion.
La volonté de stylisation de l’émotion répond aussi le plus souvent à un objectif d’exemplarité en société222, à la source d’un véritable répertoire émotionnel tissé dans les normes sociales et curiales223. Barbara H. Rosenwein résume avec clarté cette composante essentielle de l’émotionologie médiévale : « Emotional schemas are the internal representation of social norms or rules224 ». L’émotion s’incarne ainsi comme la matière même de la relation sociale, voire comme son moyen d’expression en soi225. En parallèle de l’idéal du juste milieu, l’émotion se construit comme un objet à la fois rhétorique et éthique exprimant par essence la place sociale de celui qui la manifeste226. L’énoncé émotionnel ne peut dès lors se concevoir qu’en tant qu’acte social227, ce qui confère une dimension proprement ontologique à cette recommandation de garde qui imprègne les manuels de comportement et les œuvres qui s’en font l’écho. Ce modèle de contrôle de soi trouve donc sa justification directement au sein d’un idéal de paraître social qui dicte le respect des règles de décence établies par la société228.
Le roi Arthur témoigne de cette exigence de retenue bienséante envisagée comme un moyen de préservation de l’espace social. Plus que tout autre, en accord avec les injonctions des miroirs aux princes229,149il doit faire preuve de sa capacité à se gouverner pour manifester celle à gouverner les autres. Au cœur de l’épisode de la fausse Guenièvre, il se voit confronté à la difficulté de maîtriser ses émotions en regard des normes courtoises. Si la disparition de l’usurpatrice ramène l’harmonie à la cour, elle affecte néanmoins son souverain, qui s’y était attaché. Quoique rasséréné par cette stabilité retrouvée, il peine à ne pas y porter lui-même atteinte en manifestant un deuil inconvenant. Il est en effet décrit n’avoir « pas oblié le doel de l’autre, mais il s’efforça de bel semblant faire por ses genz230 ». Particulièrement soumis à la publicité, comme tous les rois231, Arthur ne peut se permettre de laisser apparaître ses émotions, moins encore dans ce cas où il pleure celle qui a failli ravir la place de sa véritable épouse. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce passage, pour envisager le conflit qu’il met en scène entre les normes courtoises et l’intensité de l’émotion amoureuse éprouvée par Arthur232. Mais nous voudrions surtout insister ici sur l’objectif poursuivi par Arthur au gré de ses efforts de maîtrise émotionnelle. Il ne relève pas de la retenue morale absolue, mais de celle qu’il doit assurer por ses genz, conformément aux attentes qui pèsent sur les souverains : « La dimension publique engage le prince dans une action politique forcément maîtrisée, forcément réglée, forcément maquillée233 ». La maîtrise prend volontiers la forme d’un maquillage selon sa tendance avant tout corporelle que nous avons pu souligner. Ainsi, les efforts d’Arthur se concentrent sur son bel semblant pour camoufler son doel. On perçoit l’importance accordée aux apparences dans cet idéal de contrôle, de manière logique quand il touche à la publicité des émotions sur la scène sociale. La précision causale por ses genz témoigne de cet enjeu essentiel pour Arthur. Plus que tout autre, le roi doit faire montre de contrôle et de régulation de soi pour affirmer et confirmer sa prépondérance politique234 et pour préserver l’image de pouvoir qu’il incarne. Gerd Althoff nous rappelle d’ailleurs que l’éthique même du gouvernement se base étymologiquement sur 150un appel à l’autodiscipline235. Dérivée d’une longue tradition, cette nécessité de contrôle de la part des dirigeants remonte au principe stoïcien selon lequel celui qui se régit est apte à gouverner autrui236. L’art de gouverner se conçoit dès lors tout au long du Moyen Âge comme l’art par excellence de la maîtrise de soi et de ses émotions237, comprises comme le lieu d’articulation du rapport à soi et du rapport aux autres238. L’instance affective investie d’une telle importance s’intègre dès lors aux codes mêmes du langage politique239 en tant qu’élément fondamental de la rhétorique du pouvoir240. L’émotion est ainsi érigée au rang d’instrument incontournable du pouvoir241. Cette disciplinarisation de l’émotion implique avant tout sa modération, mais pas seulement. À la manière d’Arthur qui affiche ce bel semblant pour mieux dissimuler son doel, le roi Marc recourt le plus souvent à la simulation d’émotions pour mieux recouvrir celles qu’il souhaite cacher dans le Tristan en Prose. Nous avons déjà eu l’occasion de nous pencher sur ces démonstrations de retenue de la part de Marc et sur la part de jeu qu’elles induisent pour y parvenir242. Submergé par la haine243, la colère244 ou la tristesse245 que lui inspirent les trahisons de Tristan et Yseut, Marc veille à faire semblant de joie voire d’amour. La visée publique de ses efforts de retenue est tout aussi claire que dans le cas d’Arthur. Ses objectifs sont bien mis en lumière : « por ce que nus de leanz ne s’en aperceüst246 ». Il s’agit là d’un paramètre 151qui paraît propre aux démarches des souverains, posés au cœur de l’univers social et soumis plus que tout autre à la visibilité. Il éclaire la dynamique avant tout dissimulatrice de ces efforts de retenue. Certes, Arthur comme Marc ne se contentent pas de cacher leurs émotions jugées inconvenantes, mais les recouvrent sous une apparence plus appropriée, qui peut assurer la cohésion sociale. Ceci tiendrait peut-être à ce besoin de contrôle exacerbé pour les princes, qui se doivent de procéder davantage d’émotions jouées que subies, selon la formule intéressante de Bernard Rimé247. Cela nous paraît en tout cas témoigner d’une forme plus développée du jeu mené pour garantir la garde des émotions. Surtout, cela semble révéler la nature des objectifs poursuivis sur la scène sociale. Ils ne relèvent pas tant de la dissimulation d’émotions considérées excessives que de la simulation d’émotions convenantes. Davantage que d’exclure la haine ou la colère, les normes courtoises paraissent recommander le bel semblant, au cœur des efforts d’Arthur et Marc. Si dans un cas comme dans l’autre, il est question du contrôle posé au cœur de l’émotionologie médiévale de la garde, on perçoit une nuance entre ces deux dynamiques de la maîtrise des émotions. L’exemple d’Hélène de Benoïc ne signalait aucun souci de l’émotion à afficher, mais seulement de celles à réserver à l’intimité. Mais il ne touchait pas tant aux retombées sociales du contrôle qu’à son injonction morale. On observe ainsi les particularités du traitement affectif des souverains mis en scène en littérature, qui démontrent toute l’efficacité de l’émotion au cœur de sa dimension politique248. Quelle que soit cette forme de double jeu qui vient la modeler, Marc et Arthur veillent avant tout à faire preuve de la retenue exigée sur la scène sociale.
Les normes courtoises, endossées de manière exemplaire par les souverains, dictent essentiellement cette attitude de repli. La discrétion se fait l’ingrédient sine qua non de l’interaction courtoise249. Elle fonde le maintien de l’apparence, érigé en obligation dans cette dynamique d’autocontrôle dictée par la dimension publique de cette norme250. La 152contenance recommandée se conçoit ainsi comme la surveillance de soi devant autrui251. Elle prend une dimension proprement sociale ce faisant. Elle devient même une forme de synonyme de la conduite aristocratique, qui cherche, par ces codes, à se distinguer du vulgaire252. C’est ainsi que cette injonction touche avant tout aux puissants, souverains en tête, mais pas seulement. Elle s’impose à tout personnage qui veut témoigner de la courtoisie indispensable à son rang.
Œuvre courtoise par excellence, le Lancelot en Prose est riche en exemples de ce type. Le personnage de Lancelot se prête bien sûr à la perfection à cette valorisation des feeling rules médiévales. En tant que héros de cet univers narratif, il se fait emblème des codes de conduite qui y sont mis en scène. Lui aussi fait montre d’efforts remarquables pour s’en tenir aux règles de maintien de soi. Lors de l’épisode célèbre, et riche en émotions, de la fausse Guenièvre, il veille à camoufler à Arthur sa colère, l’émotion qui appelle le plus au contrôle comme on l’a vu253. Par peur de « vilenie », défaut le plus honni du système de valeurs chevaleresques, Lancelot « çoille » ses émotions, aussi intenses soient-elles, pour faire bonne figure254. Ses efforts le rapprochent ainsi d’Arthur lui-même, toujours soucieux de dissimuler ses émotions jugées malséantes, selon les mêmes enjeux de publicité que ceux qui se trouvent mis en exergue ici. Les mentions de montrer et de cacher, de çoiller et de faire bele chiere, jouent sur cette dialectique du privé et du public qui s’avère centrale au sein du processus de codification, fondamentalement sociale, du comportement émotionnel : « Instance de contrôle, l’espace public – l’oreille publique et le regard public – a la fonction d’un instrument de régulation et de censure255 ». Mais si Lancelot, comme Arthur ou 153Marc, vise la discrétion conforme aux normes courtoises, pour que nus ne s’en aperçoive256, elle ne relève pas des mêmes objectifs. L’attention qu’il accorde à la vilenie à laquelle il craint d’être associé témoigne d’un autre rang de la réflexion courtoise autour des feeling rules. Il touche à une forme de bienséance liée à l’honneur personnel fondamental dans la construction sociale au Moyen Âge.
L’importance qui y est accordée transparaît dans l’éducation qui sous-tend cette forme de sociabilité convenante. On forme en effet le comportement social par ce que Nathalie Nabert présente sous l’intitulé de pédagogie de la modération257. Les traités de savoir-vivre attestaient déjà cette dynamique éducative essentielle de l’appel à la garde258. Le parcours de Lancelot paraît jouer de cette mise en valeur d’un héroïsme fondé également sur la vertu de tempérance. Au cœur du récit initiatique qui se noue en particulier dans le premier tome du Lancelot Graal se pose cet idéal de retenue que doit acquérir le jeune héros. Le portrait qui en est dressé à l’aube de ses aventures révèle déjà toute l’importance conférée à la maîtrise des émotions et en particulier de la colère, cette émotion épique par excellence259, mais non moins problématique260. La critique que sous-tend le non-respect de l’idéal de tempérance touche en effet avant tout à la colère autant dans la littérature narrative que didactique. Dans sa traduction du célèbre miroir aux princes de Gilles de Rome, Henri de Gauchy en expose les raisons avec éloquence :
154La .ii. reson si est, quer ire et courouz desordonez empeësche le jugement de reson, quer en courouz desordonez le cors est trop esmeü et trop eschaufé por quoi li hons est desatempré et mauvesement disposé, et por cen il ne puet parfetement user de reson. Dont tieuz courouz desordone[z] chascun doit eschiver, et plus le[s] doivent eschiver les rois et les princes, quer il doivent du tout ensuivre le commandement de reson261.
C’est toujours au nom du jugement de reson que la colère se voit dépréciée en tant qu’instance de désordre, liée à un échauffement du corps fort mal perçu. Sa condamnation relève de l’idéal de stabilité émotionnelle poursuivi dans l’appel à la garde. La répétition de l’adjectif desordonez, qui qualifie le courouz, ne laisse aucun doute sur la déconsidération vicieuse de l’atteinte portée à cette stabilité. De manière intéressante, elle paraît associer les enjeux religieux et sociaux de la garde dans sa quête du repost de l’esprit ou de la stabilité sociale en elle-même. Une vertu spécifique est d’ailleurs assignée à la maîtrise de la colère, la débonnaireté, dont Henri de Gauchy vante alors les bénéfices :
Et est assavoir qu’e[n] chose la ou li homme peüst fere pou et trop, il covient avoir une vertu par quoi li hons soit reulez si que il ne face pou ne trop en la chose, mes cen que reson enseingne. Et por cen que li hons puet fere mal en soi trop couroucier et en trop punir les maux qu’en li a fet, et puet autresi fere mal en soi pou couroucier et en pou punir les maux qu’en li a fet, il covient avoir une vertu que l’en apele debonereté, par quoi li hons se set couroucer en tens et en lieu et punir ceus que il doit punir selon reson et selon cen que il ont deservi. Dont tout aussi comme largesce oste l’avarice de l’omme et atempre la fole largesce de li, aussi devon nos dire que debonereté est une vertu qui oste l’ire et la felonnie de l’omme par quoi il couveite a fere venjance plus grant que il ne doit, et fet ceste vertu que li hons ne defaut mie a punir cen que il doit punir262.
Définie par Thomas d’Aquin comme un désir de revanche263, la colère est par essence liée à une recherche de justice, voire de punition de ceux qui sont à l’origine de la colère et de sa cause surtout. Ce n’est cependant pas cette recherche de vengeance en soi que Henri de Gauchy condamne, mais son excès, le fait qu’elle soit plus grant que il ne doit. La raison même de la debonereté concerne donc cet idéal de juste milieu qui 155se trouve au cœur de la codification émotionnelle et de son impératif de tempérance264. À deux reprises, la lutte contre le pou ou le trop fonde la vertu. Elle réside ainsi dans un courroux manifesté en tens et en lieu et qui se prête à la vengeance exigée selon reson.
Cette valorisation particulière de la garde des émotions trouve un écho particulier dans le portrait dressé du jeune Lancelot ou, par un jeu de contraste révélateur, de son cousin Lionel, ou encore de Gauvain. Au cœur de leur parcours initiatique se pose l’impératif de mesurer leurs émotions, en particulier la colère, émotion à haute valeur symbolique dans le système chevaleresque, mais non moins problématique. La colère occupe en effet une place particulière dans l’émotionologie chevaleresque et épique. Elle s’avère vecteur d’héroïsation, preuve de la bravoure et de l’énergie nécessaires aux preux combattants, selon le mythe de l’ire guerrière antique, mais se doit de rester modérée, comme en témoignent de nombreux exemples des romans arthuriens comme des chansons de geste, parmi lesquels Beuve de Hamptone, Guillaume d’Orange ou Raoul de Cambrai265.
Au cœur de toutes les nuances qu’ils peuvent présenter, ces épisodes de mise en scène d’une pédagogie émotionnelle illustrent la prégnance de l’idéal de la garde des émotions. En-dehors des rois ou des chevaliers, bien d’autres acteurs de la scène courtoise tentent de répondre à cet appel à la maîtrise émotionnelle. De manière intéressante, l’exigence de retenue bienséante qui pèse sur les héros des récits épiques ou arthuriens concerne tout autant, voire plus encore peut-être, les personnages féminins. Les femmes font elles aussi l’objet de recommandations de retenue. Ainsi en va-t-il de la reine Guenièvre, exhortée par Galehaut à contenir sa tristesse face aux accusations calomnieuses de la fausse Guenièvre : « “Dame, fait Galehoz, or ne vos desconfortez pas, mais segurement vos contenez, car dons sanbleroit il que vos fussiez corpable de la desleiauté dont cele vos apele”266 ». La recommandation de Galehaut s’apparente à celle du moine qui enjoignait à Hélène de Benoïc de réfréner son angoisse. Mais l’objectif visé diffère bien sûr. Il touche ici à l’être social de la reine, 156menacé par l’impression de culpabilité qu’elle pourrait donner en faisant preuve de son desconfort. On est bien loin de la contenance dont doit faire preuve la dame de Benoïc, qui, au-delà de la seule apparence de mesure, vise une modération intérieure totale. Les efforts de Guenièvre se concentrent au contraire sur la sphère sociale. Ils relèvent du souci de la visibilité, comme la mention du verbe sanbler paraît l’attester. C’est ainsi le seul semblant de culpabilité qui est posé au cœur du processus de contrôle, bien évidemment parce que la culpabilité réelle de la reine n’est en rien envisagée par Galehaut. Mais il témoigne aussi de l’importance conférée aux apparences dans la préservation de la réputation ici posée au cœur de la retenue conseillée à Guenièvre. La reine fait donc preuve de soucis similaires à ceux manifestés par Lancelot au fil de son apprentissage, plutôt que par Hélène de Benoïc, pour assurer sa réputation. Elle démontre ainsi l’égalité de l’application des feeling rules courtoises pour hommes et femmes confondues quand elles touchent à la visibilité de figures éminemment publiques.
Mais Guenièvre peut également se rapprocher d’autres logiques de l’idéal de garde émotionnelle qui trouvent ainsi à leur tour leur pendant féminin. La fuite de la reine pour dissimuler sa tristesse, au lancement de la quête du Graal, en offrait un parfait exemple267. Soucieuse de préserver les apparences, Guenièvre souhaite réfréner le grant duel qui l’étreint. Accablée de chagrin, elle ne peut cependant se résoudre qu’à quitter précipitamment la pièce et à se réfugier dans sa chambre où, dans l’intimité, elle peut laisser éclater sa tristesse. En cet instant symbolique où les chevaliers de la Table Ronde décident de mener à terme la quête du Graal qui définit la cour arthurienne, la reine ne peut se permettre de laisser libre cours à sa peine, fort peu convenable en public et moins encore dans ce contexte. De manière significative, les efforts de Guenièvre pour se contenir semblent vains sur le seul plan de la mesure de soi, et c’est dès lors par une dissimulation totale, et non seulement du visage – pourtant la plus fréquente – que la reine se couvre. Incapable de retenir ses larmes, la reine n’a d’autre choix que de s’isoler pour les laisser couler, ce qui illustre bien sûr l’ampleur de cette tristesse, impossible à contrôler, mais aussi les limites de cette obligation de garde. Sans aucune mention de ce code de conduite de contenance bienséante, on assiste ici à sa mise en scène, si 157bien intériorisé qu’il ne nécessite aucune évocation formelle. La retenue de Guenièvre s’inscrit explicitement dans un objectif de discrétion, por ce que l’en ne s’aperceustcoment ele en estoit corrocié. C’est l’apparence que la reine renvoie qui est ici mise en question, le verbe apercevoir le souligne. On retrouve ainsi la composante publique du souci de garde qui animait le roi Marc par exemple. Il est en effet de la même façon question du regard extérieur porté sur sa tristesse, comme sur celle de Marc ou celle d’Arthur, d’où la mention similaire au public de leur émotion. Laurent Smagghe insiste sur l’égalité des genres face au besoin de maîtrise dont la dame, tout autant que le prince, doit faire montre268. Guenièvre poursuit donc le même objectif essentiel que les souverains, celui de la discrétion impérative dans cet idéal de tempérance centrée sur l’apparence. Comme l’affirme Linda Rouillard, « couverture becomes the modus operandi in an environment built on appearances and impressions269 ». Christine de Pizan, à qui est consacrée l’analyse de Linda Rouillard, construit son manuel de comportement sur cette nécessité de préserver la réputation et, pour ce faire, l’apparence270. Son Livre des Trois Vertus offre une preuve formelle de l’absence de spécification masculine autour des normes affectives. Il transpose les idéaux de contenance et de convenance véhiculés par les manuels de gouvernement que nous avons pu citer. Christine de Pizan défend une conception générale et asexuée de la contenance que tout un chacun doit assurer271. Si nous aurons l’occasion d’analyser plus en détails ce riche plaidoyer de l’émotionologie féminine272, il nous semble intéressant de déjà souligner la proximité de ses recommandations avec celles de Gilles de Rome par exemple : « Si gardera bien qu’elle n’ait point la chiere muee en enflammee, ne les yeulx felons quant partira de lui, mais le visage rassis et la maniere asseuree, si comme se d’aultres choses eust parlé, afin que personne ne se peust de ce apercevoir273 ». Cet appel éloquent à la maîtrise de soi et en particulier du visage pourrait 158très bien appartenir à la tradition des miroirs aux princes. Il se voit cette fois appliqué au genre féminin, à un elle auquel Christine de Pizan décide de dédier son traité de savoir-vivre destiné à la seule gent féminine. Les conseils dispensés par la figure allégorique de Prudence Mondaine – une orientation formelle du souci de garde sur la scène sociale – s’avèrent néanmoins fort similaires à ceux que l’on peut lire dans les miroirs aux princes. Ils se concentrent ainsi de la même manière sur des modalités corporelles. De manière assez courante, il est question de la mesure du visage et des yeux notamment, dans l’objectif d’éviter toute mue et, au contraire, d’assurer la stabilité de l’apparence. Christine de Pizan paraît ainsi jouer du continuum, central dans les traités de gouvernement, entre maîtrise de soi et maîtrise des autres, toutes deux fondées sur la stabilité. Le lien tissé entre ces deux sphères du bon gouvernement atteste en outre la place et surtout la problématique de l’émotion dans l’économie du gouvernement. L’instance affective se veut, dans son étymologie même, contraire à pareille stabilité, selon son appellation moderne d’émotion comme selon celle, en usage au Moyen Âge et d’autant plus révélatrice, de mouvements de l’âme. L’importance conférée à l’enjeu de la stabilité témoigne de l’entremêlement des appels au contrôle de soi, que visaient également les recommandations monastiques à cet égard. Le repost d’Hélène de Benoïc touche en effet à un immobilisme que Christine de Pizan paraît elle aussi valoriser, dans une tout autre optique bien sûr. Il semble ici relever de l’asseurance, d’ailleurs abordée dans la définition de la contenance visée par Christine de Pizan274. La dimension publique de l’exigence de contrôle de soi et d’assurance qu’elle doit permettre d’afficher se fonde comme un facteur fort fécond du phénomène de surveillance de l’instance affective. Christine de Pizan insiste sur ce point dans la précision qu’elle donne de l’objectif poursuivi ici. La question de la visibilité peu souhaitable de tels mouvements anime bon nombre des appels au contrôle de soi, on l’a vu. Quant aux adjectifs enflammmee et felons, ils incarnent, étant donné le sémantisme plutôt violent qu’ils induisent, la peur de l’excès que nous présentions à l’origine du principe de contrôle275. La garde conseillée par 159Christine de Pizan se construit ainsi comme une surveillance indispensable du sujet de crainte qui l’inspire, conformément à ses définitions exposées en introduction276 et à tous les exemples observés jusqu’à présent. La tempérance se fonde, de la même manière sous la plume de Christine de Pizan que sous celle de Brunet Latin, sur l’idéal du juste milieu animé de la peur d’excès inconvenants. On peut donc noter qu’aucune distinction entre homme et femme ne semble être posée quant à cette nécessité de contrôle de soi. La reine Guenièvre en offre l’exemple le plus éclatant peut-être, en particulier quand elle fait montre de retenue de son amour pour Lancelot277. En dépit de l’intensité de l’émotion qui l’étreint, la reine s’efforce de la recouvrir, « au plus ke ele poet », au regard de son entourage. La couverture qu’implique la mesure de soi s’avère parfois bien plus complexe à mettre en œuvre, en particulier quand elle touche à la dimension amoureuse qui entoure la peur de Guenièvre. L’univers amoureux constitue un objet d’analyse immanquable quand on aborde la question de la retenue dans la codification émotionnelle du Moyen Âge, et c’est à présent de ce côté que nous aimerions nous diriger pour envisager toute l’importance de ces normes d’inspiration certes morale, mais aussi essentiellement sociale dans ce contexte également. Elles présentent en effet une déclinaison intéressante des idéaux courtois que nous avons souhaité appréhender dans cette analyse de l’elegantia morum et de la peur de la démesure qui la porte.
L’univers social dans lequel évoluent les personnages des romans courtois se fait le terreau des feeling rules médiévales centrées sur l’appel à la garde indispensable à la bienséance requise en public. Les souverains mis en scène en littérature portent haut cet idéal d’élégance et de stabilité sociale. Les héros de ces grandes œuvres démontrent aussi un souci fondamental de bienséance, qui s’oriente cependant dans une optique plus individualiste peut-être et surtout apparente. Il ne s’en avère pas moins essentiel et va jusqu’à infiltrer les enjeux cruciaux de leur éducation et de leur progression dans les valeurs chevaleresques 160aussi animées de l’idéal de tempérance. La démesure se fait même critère d’exclusion pour mieux en souligner toute l’importance, dans l’atteinte qu’elle porte à la cohésion sociale278. À rebours des stéréotypes féminins, les reines veillent elles aussi à éviter tous les excès émotionnels difficilement compatibles avec la discrétion bienséante qui leur est dictée par leur position sociale. La règle de l’elegantia morum se veut absolue dans l’univers courtois qui applique ainsi l’idéal de tempérance monastique dans une logique publique développée en regard de la visibilité et, donc, des retombées inévitables des excès d’émotions qui portent atteinte à la contenance convenante érigée en norme.
La garde comme vertu amoureuse : de l’éloge de la mezura,
du celer et au-delà
La loi d’amour est aussi très propice à la valorisation de la garde. De la même manière que l’idéal de tempérance se couple à celui de la mesure chevaleresque279, il se conjugue à celui de la mezura vantée par les troubadours. Élaboré de pair avec l’ensemble de l’éthique de la fin’amor, le précepte de mezura imprègne la poésie lyrique et se diffuse dès lors dans tous les champs d’expression de l’idéal amoureux au Moyen Âge. La production des troubadours offre une configuration originale et emblématique de la sensibilité affective. Elle se fonde sur cet absolu de mezura, que Damien Boquet et Piroska Nagy définissent comme l’usage harmonieux des émotions, non sans rappeler la notion antique de metriopathia280. La mezura troubadouresque se rapproche ainsi sans aucun doute de la contenance convenante centrale dans le culte de l’elegantia morum. Elle prône elle aussi le juste milieu dans la lutte menée contre les excès des émotions, surtout de celles aussi intenses 161que l’amour. Nulle autre émotion ne semble autant appeler à la retenue et à la discrétion surtout. Hantés par le regard public qui en menace l’intimité, les amants combinent en effet à l’idéal de garde celui du secret. On constate ainsi une véritable particularisation de la recommandation de la garde dans le registre amoureux, qui en présente une version aussi aboutie que singulière. Nous voudrions en observer les spécificités, les lignes d’influence exactes, mais aussi les dérives dans ce contexte de tensions exacerbées entre diverses injonctions.
La prégnance de l’appel au contrôle de soi pour la communauté émotionnelle des amants s’illustre dans les arts d’aimer développés au Moyen Âge sur le modèle de l’Ars amatoria. L’influence ovidienne se ressent dans l’élaboration des codes émotionnels amoureux dispensés par André le Chapelain ou, dans le cadre de la traduction française de son De Amore, par Drouart la Vache. Ce traité, incontournable en la matière, met en exergue l’idéal de la garde. Il se concentre surtout sur ses composantes discrètes et sur l’appel omniprésent au couvrir et au celer281. Outre l’inspiration ovidienne, Isabelle Coumert souligne la richesse des lignes d’influence qui se dessinent au cœur des normes amoureuses. Elle démontre que la littérature amoureuse d’oïl se construit comme un lieu de conciliation des vertus d’ennoblissement aristocratiques et de la morale chrétienne282. La loi du secret amoureux répond en effet à une motivation double, dictée aussi bien par un souci de pudeur, qui vise la préservation de la réputation (et surtout de celle de la dame), que par une revendication d’élitisme amoureux fondé sur un véritable parcours d’élévation. La garde intègre les critères de démonstration de la valeur de l’amant et de la qualité de son amour pour sa dame, en même temps qu’elle en assure la pérennité en le préservant du danger des regards extérieurs. On rejoint ainsi à la fois l’objectif de la progression vers Dieu, poursuivi au sein des monastères, et l’enjeu de la défense de la réputation qui anime la société aristocratique. Damien Boquet et Piroska Nagy insistent sur la préexistence et la collusion des deux types de codification de l’émotion qui relèvent de la sphère religieuse et amoureuse. Ils soutiennent que « l’ordo monasticus au sein de l’église 162est l’avant-garde de cette offensive générale dont la contrepartie laïque a été la fin’amor283 ». Quant à l’influence du code courtois, il se note dans cette obsession de la discrétion. Elle se voit certes orientée dans la dynamique amoureuse, mais elle s’inscrit dans la même crainte de la visibilité d’émotions jugées, pour d’autres raisons peut-être, inconvenantes sur la scène sociale. On découvre aussi les tenants courtois de la mezura amoureuse dans l’appel répété à l’attemprance, tout à fait similaire à celui qui rythmait les manuels de comportement.
La communauté émotionnelle des amants s’imposait donc à notre analyse des manipulations de l’instance affective. Plus que tout autre, elle fonde son existence sur la valeur de l’amour, ou du talent, à la base de l’ensemble des forces de sa grammaire émotionnelle284. La fin’amor développée chez les troubadours connaît un succès tout particulier au xiie siècle, période de glorification de l’amour285. Elle concorde avec l’époque d’élaboration des codifications par l’Église des sentiments et comportements conjugaux286. L’importance prise par les règles de bonne conduite amoureuse n’en est évidemment que plus grande. L’amour courtois repose sur plusieurs critères essentiels : l’exclusivité, la constance, la pureté des intérêts poursuivis, la réciprocité, la spontanéité et le respect, la sincérité, mais aussi la mesure287. Bien sûr, la fin’amor relève avant tout d’une construction littéraire idéalisée288. Si nous interrogeons, ici comme ailleurs, la sincérité des émotions médiévales, il s’agit bien sûr de la sincérité telle qu’elle se trouve représentée dans les textes qui la dépeignent289. L’amour courtois se conçoit en outre autant dans sa dimension affective que dans sa dimension artistique bien évidemment 163centrale. Cela éclaire d’ailleurs, selon Michèle Gally, le caractère peut-être peu émotionnel en soi de la poésie qui s’occupe de le chanter290. Mais surtout, cela permet de révéler toute l’importance de l’émotion dans le processus de construction littéraire. En tant que poésie d’amour, la tradition de la fin’amor réserve une place centrale au sentement. Didier Lechat insiste sur cette composante fondamentale de l’activité poétique : « La présence du sentement au moment de la composition lyrique n’est pas qu’affaire de “matière” poétique, elle est aussi une grâce, un gage de perfection esthétique291 ». Plus encore, les émotions jouent un rôle capital dans l’intrigue, comme indices des qualités morales des personnages292, de leur capacité relationnelle293, des relations sociales de pouvoir294 et surtout de leur prédisposition à l’action qui fait la trame narrative295. Ainsi, les émotions impliquées dans la relation amoureuse se posent d’emblée au cœur et même comme moteur des œuvres qui célèbrent les principes de la fin’amor. Elles sont autant les conditions d’existence de la relation fondée sur l’amour que les garantes de sa narration.
Au-delà du prisme littéraire, qu’il convient de prendre en considération, ces émotions se conçoivent également à la lueur de leur dimension culturelle que nous avons souhaité mettre en exergue. Le traitement réservé à l’émotion amoureuse ne fait pas réellement exception : elle aussi se doit de respecter les recommandations courtoises, tout en s’en détachant inexorablement. Ce double mouvement éclaire sans doute l’ambiguïté des manipulations émotionnelles dont les amants font preuve. Le lien entre éthique courtoise et amour courtois est cependant évident. Martin Aurell remarquait combien l’amour répond à la même 164exigence d’élégance que celle qui pèse sur le fait de parler, de manger ou de s’habiller296. Hantée par le regard d’autrui, la société médiévale exerce également son influence sur l’émotion amoureuse. Le précepte de garde s’y fait obsessionnel, et l’amour fait ainsi l’objet d’un nouveau paradoxe : émotion de l’intimité du cœur, elle est pourtant soumise au danger de sa publicité. Fuie par crainte de révélation, la sphère publique s’immisce ce faisant dans l’intimité de l’émotion. L’amour en vient à jouer un rôle éminemment public, comme geste social indispensable à l’autoreprésentation aristocratique297. Il s’inscrit ainsi dans la performance continuelle dans laquelle Susan Crane conçoit la société médiévale298. Georges Duby défend même la force civilisatrice de la fin’amor299, selon ces règles de raffinement courtois évoquées. Il est vrai que les paramètres de la conquête amoureuse contribuent à n’en pas douter à l’affirmation des principes de mesure et de convenance imposés par la société courtoise. Le fin’amant doit s’y soumettre pour prétendre obtenir l’amour de sa dame, ce qui constitue un impératif plus fort encore que celui qu’impose la société courtoise en elle-même. Mais les codes de la fin’amor ne se conjuguent pas toujours avec ceux de l’éthique courtoise. Le rapport obsessionnel qu’entretient la société courtoise avec la sphère publique vient en effet compliquer l’entremêlement des règles de conduite sociale et amoureuse. Mathilde Grodet analyse dans ce sens l’isolement fréquent des amants en réponse aux heurts de la société300. Jean Batany met lui aussi en lumière cette opposition entre l’amour et la réalité sociale, à la source de stratégies d’évitement, telles que celle, fondamentale, du secret cultivé avec insistance dans la tradition de la fin’amor301. Isolés par leur amour qui doit rester caché, les amants se distancient des normes émotionnelles qui pèsent sur la scène sociale. Ils s’inscrivent ainsi dans une autre dynamique de discrétion que celle qui relève de la convenance pure qui anime souvent les souverains, 165selon des critères que nous voudrions explorer pour mieux en éclairer la dynamique. Cet impératif qui varie semble d’ailleurs induire d’autres logiques dans les jeux émotionnels qu’ils présentent. L’amour courtois ne s’oppose donc pas forcément à l’ordre de la société féodale, dont il reprend et adapte de nombreux codes. Il se présente plutôt comme une structure à la fois antagoniste et complémentaire302.
Interroger l’émotion amoureuse à l’aune des règles qui l’entourent, et des manipulations qui en découlent, nous le verrons, permet en outre de repenser l’opposition surannée entre amour et raison. La littérature médiévale l’exploite d’ailleurs au cœur du motif de la maladie d’amour303, quand elle ne la problématise pas plus largement. Le discours amoureux se plaît à cultiver les contraires, celui de l’amour et de la raison, mais aussi celui de la sincérité et de la fourberie, de la vérité et de la semblance304. Cet entremêlement de problématiques témoigne de l’intérêt, manifesté par les auteurs médiévaux eux-mêmes, de remettre en question les polarités qui pèsent en particulier sur la sphère émotionnelle, dans son opposition fréquente à la raison et dans la difficulté qu’elle présente de discerner le vrai du faux. Cette réflexion centrée sur la fin’amor offre une occasion parfaite de problématiser les carcans qui entourent l’émotion, ceux de la raison et du contrôle qu’elle dicte, mais surtout de la sincérité, dans la tension qu’elle induit avec le culte du secret. Cette question s’impose d’ailleurs d’autant plus que, davantage que la constance et l’exclusivité évoquées par Rüdiger Schnell305, le secret s’érige comme la règle incontournable de la fin’amor : « L’on estime que le secret est l’une des composantes thématiques les plus essentielles de ce mode à la fois de pensée et d’écriture306 ». Frédérique Le Nan en défend la valorisation importante, qui allie mesure, secret et sagesse : « Il va de soi que seul l’amant plein de sagesse, patient et modéré quand il n’est pas inexpérimenté ou stupide, pourra contrôler son désir et préserver la loi du secret307 ». Nous pourrions dès lors le faire 166relever de la notion d’intelligence émotionnelle308. Répétée à l’envi dans des passages clés comme les prologues ou les épilogues309, l’injonction du secret s’érige comme ressort dramatique majeur310, dont le non-respect entraîne des conséquences catastrophiques311. Son étymologie312 éclaire la dynamique de repli qui caractérise dès lors le couple des fin’amants, selon une association entre secret et isolement faite garantie du bonheur amoureux313. L’impératif du secret émerge dans la littérature occitane, avant de se voir concilié aux vertus anoblissantes de la morale aristocratique et chrétienne314, dans une belle démonstration du rapprochement de l’éthique amoureuse avec celle, à la fois, de la religion et de la courtoisie. Il est fixé dans les arts d’aimer, qui associent ainsi pudeur et élitisme amoureux315. Le regard que l’homme médiéval porte sur le secret n’est cependant pas uniquement positif. Il fonctionne également comme un symbole de la Chute, le lieu où se love le péché dans l’oubli de l’omniscience divine. Une critique ferme peut donc également naître à son encontre, quand elle ne se voit pas atténuée par l’accord tacite donné dans le cadre fictionnel316. La tradition de la fin’amor offre certainement la plus éclatante des justifications apportées au secret, dans un entremêlement d’impératifs d’ordres divers qui contribuent tous à sa sacralisation dans la sphère amoureuse.
Le secret porte tout d’abord la trace de la geis de l’héritage celtique qui marque bon nombre des romans courtois317. C’est elle qui ouvre la porte à une version non condamnable du secret, posé comme condition de l’amour. La dimension volontiers adultère de la fin’amor renforce cette exigence de discrétion. Elle impose en effet de manière logique le secret face à l’obstacle que figure l’époux trompé318. Sa jalousie constitue 167d’ailleurs, par la crise qu’elle incarne dans l’univers courtois, un indice révélateur du dévoilement, mais surtout de la nécessité qu’il ne survienne pas. Damien Boquet et Piroska Nagy insistent sur la connotation essentiellement négative de cette émotion qui témoigne d’un manque criant de la mezura indispensable dans l’univers courtois319. S’établit ainsi une ligne de conduite réciproque pour les amants comme pour leurs opposants, fondée sur la mesure et le contrôle, de l’amour d’une part, du ressentiment de l’autre. Le spectre exercé par le regard extérieur et l’idéal de convenance qu’il induit ne pourraient être plus explicites. La garde constitue donc à la fois la conséquence de la transgression que représente cet amour interdit et sa condition sine qua non320. Notons au passage la répartition de genre qu’impliquerait la tradition de la fin’amor : la jalousie se rangerait essentiellement du côté masculin321, tandis que l’adultère est condamné comme un péché avant tout féminin322. On en cherchera l’influence sur les jeux émotionnels mis en scène, selon les efforts respectivement requis pour les hommes et pour les femmes de préserver le secret de leur cœur ou de leur désir de vengeance. Il semblerait intéressant de repenser la polarité entre masculin et féminin autour des manipulations d’émotions. Les avis sur la question divergent souvent beaucoup, preuve de la nécessité de nuancer les constats dressés autour de la maîtrise émotionnelle. On évoque à la fois la plus grande capacité de contrôle des hommes, moins extrêmes et plus rationnels face à leurs émotions323, et la nature plus policée du comportement féminin face à celle plus sauvage et impétueuse des hommes324. Quant au désir sexuel, lui aussi est tour à tour prêté plutôt à l’impétuosité masculine ou à l’appétit insatiable des femmes. Nombreux sont les exemples qui mettent en scène leur dépit de se voir repoussées, construit sur le modèle de l’aventure 168de Joseph et de la femme de Putiphar325. S’opposent ainsi les constats d’une part du besoin d’extériorisation plus fort chez les hommes, par contraste avec l’attitude féminine plus discrète et efficace326, et d’autre part de leur tendance plus grande à la dissimulation327, voire même de la politisation de leurs émotions, de tristesse par exemple328. Mais ces efforts de contrôle sont également notés chez les dames, sur lesquelles pèse une contrainte sociale très forte. Une véritable école de maintien de soi s’érige ainsi dans l’éthique amoureuse de la dame329, en belle démonstration du secret indispensable dans la tradition de la fin’amor. Nous veillerons donc à la répartition des efforts de contrôle et des jeux déployés sur cette base chez les amants comme chez leurs dames, dans la volonté d’éclairer ces réflexions peut-être contradictoires, mais surtout révélatrices du poids des règles qui conditionnent l’expression amoureuse. L’orientation courtoise de la fin’amor et sa tendance à l’ennoblissement que nous avons pu noter redessine la logique du recours au secret, en y intégrant une part de culpabilité. Isabelle Coumert souligne à ce sujet comment les amants « se découvrent alors à l’occasion une autre raison de taire leur amour : la pudor, la honte330 ». Ce rapprochement du secret de l’amour adultère et de la honte est très intéressant dans la ligne de réflexion émotionnelle que nous souhaitons mener. On identifie ainsi un moteur lui-même émotionnel des manipulations de la sphère affective. On touche pleinement ce faisant à l’influence qu’exerce l’éthique courtoise sur la fin’amor. La pudor qui anime les amants répond aux logiques qui imprègnent la société médiévale fondée sur un sens de l’honneur essentiel331. Son importance littéraire fait bien sûr écho aux scripts émo169tionnels mis en lumière par les historiens332. C’est sur l’amour plus que sur tout autre émotion que se concentre la pudeur, selon la conviction qu’il s’agit là de l’intimité la plus profonde. La garde prend ainsi la forme d’un moyen de défense légitime, que l’on peut rapprocher de la théorie du face-work d’Erving Goffman333. Notons que, comme le souligne d’ailleurs Erving Goffman, la défense ne vise pas seulement sa propre « face », mais aussi celle d’autrui et en particulier celle de la dame, dont l’honneur s’avère primordial dans la logique de la fin’amor. La vergogne exerce bien souvent son influence sur les personnages eux-mêmes et redouble ainsi l’opposition entre raison et affect d’une hésitation entre honneur et cœur, comme le souligne Jutta Eming dans son analyse des romans tristaniens334. Cette émotion centrale au sein de l’émotionologie médiévale joue ainsi un rôle fondamental dans l’établissement de la loi du secret qui encadre la fin’amor, au même titre que la loi de la geis, ou, plus pragmatiquement, la nature adultère de la relation amoureuse, mais aussi la peur qui vient se coupler à la honte335. Son importance n’a cependant d’égal que sa complexité, elle aussi mise en valeur dans les textes médiévaux. Les manipulations émotionnelles qui y sont mises en scène insistent sur les difficultés qu’elles comportent. Sif Ríkharðsdóttir lit dans ce sens les insistances notées autour des excès d’émotion ou des réactions physiques involontaires336. Ce sont d’ailleurs souvent les émotions amoureuses qui s’avèrent les plus complexes à contenir337. La difficulté de cette entreprise tient principalement au potentiel révélateur du corps, comme fenêtre parfois bien trop transparente des émotions, surtout des plus intenses comme l’amour. Certes, le plus grand danger de révélation de l’intériorité touche à la parole338, surtout celle qui médit 170et dénonce – nous aurons l’occasion d’y revenir –, mais le corps s’avère tout aussi, voire d’autant plus problématique dans cette optique339. Les conséquences désastreuses du dévoilement du secret reposent ainsi parfois directement sur les indices qu’en délivre le corps, selon le principe de conversion somatique des émotions mis en lumière par Nira Pancer340.
Nous avons déjà pu insister sur le rôle du corps dans l’énonciation des émotions. En accord avec les théories physiognomonistes341, le corps se comprend comme le reflet d’un état intérieur. Il permet ce faisant d’actualiser les rapports de forces induits par les émotions dans leur expression corporelle autant que verbale342. Les symptômes de l’amour s’avèrent dans ce sens essentiels, comme garants de l’implication affective requise343. Surtout, le corps s’incarne comme lieu même de l’amour344, frappé dès ses premières manifestations par des indices aussi intenses que les tressaillements ou les changements de température subits souvent dépeints dans la tradition de la fin’amor345. Mais ce faisant, le corps s’érige comme le terrain du conflit entre l’individu en soi et l’individu socialement construit346, entre son intériorité et son extériorité obligatoirement modulée par la loi courtoise. Les efforts de contrôle inscrits dans l’optique du maintien du secret se concentrent donc sur les gestes émotionnels. Tant les traités moraux que les œuvres 171narratives insistent sur une discipline du corps qui assurerait les vertus de l’âme347. La tempérance requise dans la sphère affective se décline ainsi en techniques essentiellement corporelles, telles que la dissimulation du visage ou la fuite348, mais aussi le réfrènement des manifestations émotionnelles.
Dans notre volonté de mettre en lumière les feeling rules propres à la communauté émotionnelle des amants, nous voudrions en revenir aux manuels qui les théorisent sur le modèle ovidien avant d’en envisager l’influence sur les œuvres qui démontrent l’importance prise par ce système de jeux émotionnels, ensuite éclairé et détourné par Jean de Meun. La lumière jetée par les traités amoureux mérite d’être mise en relation avec la posture prise par les auteurs de certains des grands romans courtois qui marquent l’époque médiévale. Des tensions ont été notées entre les univers didactique et narratif, les uns se montrant sceptiques quant à la concordance des arts d’aimer avec la poésie amoureuse349, les autres soulignant au contraire la volonté de systématisation dont ceux-ci peuvent témoigner, sur la base des dynamiques attestées dans les œuvres de fiction350. Nous voudrions chercher à nuancer ces constats, explorer la mise en scène des jeux émotionnels inscrits dans une optique amoureuse telle que Drouart la Vache tend à la synthétiser. Nous pourrions ainsi comparer les résultats obtenus, chercher à percevoir les différences de points de vue portés sur les manipulations, garde ou davantage, du fait de l’amant ou de la dame, de la protection envers les losengiers ou de la mise à l’épreuve de l’aimé lui-même. Surtout, nous pourrons ainsi mieux comprendre comment la loi du secret déborde vers la tromperie, la dissimulation amoureuse vers la simulation plus ou moins rusée, toujours dans cette perspective de préservation de l’amour 172qui justifie de prime abord les manipulations du semblant amoureux. Ce faisant, nous tracerons inéluctablement notre voie vers l’exploration du faux semblant, tel que le personnage de Jean de Meun le personnifie et le problématise de manière emblématique.
Dans ce contexte dense de recommandations de mezura, de secret animé par la peur et la honte, la garde se fonde avant tout dans une logique de discrétion, dictée en particulier par la crainte de la révélation que font peser les losengiers. Pour d’autres raisons bien sûr que celles qui animaient les souverains par exemple, les amants doivent garder leurs émotions secrètes, seule réponse possible à la menace de la médisance. L’efficacité de cette garde discrète est vantée dans les arts d’aimer comme celui de Drouart la Vache et, à leur suite, dans toute la tradition littéraire de la fin’amor. Le modèle ovidien s’avère en effet essentiel à ce chapitre351. L’Ars Amatoria rencontre un franc succès dès le xie siècle, avec la montée des écoles cathédrales et la lecture des auteurs classiques qui s’y développe. Ce mouvement culmine aux xiie et xiiie siècles avec les adaptations qui en sont alors proposées. C’est également l’époque du développement de l’intérêt porté aux femmes, au mariage et à la sexualité, qui s’avère fort propice à la réception de l’art d’aimer ovidien352. Son influence est multiple et variée, par sa combinaison tout à fait particulière de poésie amoureuse et didactique353, par l’insertion de cet enseignement amoureux dans une fiction faite conventionnelle354 ou par la place qu’il laisse au lecteur dans la compréhension d’un idéal teinté d’ironie355, mais aussi par 173sa portée misogyne356. Le mouvement de reprise et de refonte de l’œuvre d’Ovide se caractérise par une grande diversité des postures endossées357, selon une tendance entre critique et glorification358. Si l’ironie ovidienne semble constituer un terreau fertile de cette adaptation, les difficultés qu’elle pose peuvent aussi pousser les auteurs médiévaux à la dépasser. Mathilde Grodet insiste sur les libertés prises à l’époque médiévale face au modèle ovidien et surtout sur la tendance à gommer la dynamique mensongère qui le caractérise359. Les réflexions sur la sincérité amoureuse se développent ainsi, dans une belle démonstration de la problématique qu’elle constitue pour les auteurs des artes amandi médiévaux, quelle que soit la prégnance de l’appel à la garde qui y est renouvelée. Les ruptures marquées face à l’Ars amatoria touchent également à l’esprit libertin qu’il instille, peu conciliable avec la morale chrétienne360. La première et plus emblématique des adaptations est celle d’André le Chapelain. Son De Amore, rédigé aux alentours de 1180-1185, a été qualifié par Michel Zink d’« art d’aimer comme il faut361 ». Il témoigne d’une volonté de théorisation exemplaire des lois de la fin’amor chantée par les poètes362. Il réalise ce faisant une synthèse des motifs et figures de la poésie lyrique et du roman chevaleresque363 et offre ainsi un objet d’étude d’autant plus intéressant pour interroger plus largement les scripts émotionnels qu’il véhicule, comme lieu de configuration originale et emblématique de la sensibilité médiévale364. Sa diffusion symbolise l’apogée de la glorification amoureuse après une longue dépréciation inscrite par la morale chrétienne365. La traduction française qu’en offre Drouart la Vache à la 174fin du xiiie siècle marque une nouvelle étape de l’adaptation ovidienne et contribue beaucoup à son développement366. Drouart la Vache a à cœur de réorienter cet art d’aimer pour en faire émerger un amour pur, compatible avec la vocation religieuse du clerc367. Son Livre d’Amours s’inscrit dans un réseau révélateur des dynamiques qui imprègnent la codification amoureuse, à la croisée des influences ovidiennes et chrétiennes et dans ce souci de diffusion des normes émotionnelles qui y sont développées. Il nous intéressera au premier plan pour la traduction française, qui s’intègre ainsi au corpus que nous avons cherché à établir, qu’il offre de ce mouvement de réflexion et de mise en fiction des feeling rules amoureuses. Dans une belle démonstration de l’importance prise par l’attemprance dans la veine amoureuse, Drouart la Vache vante l’utilité du secret comme une prudence nécessaire à la préservation de l’amour. La nature didactique de son Livre d’Amours confère plus de poids encore à cette stratégie de mesure discrète, directement associée à la sagesse :
Dont, se li dui amant sont saige,
Bien celeront en lor coraige
L’amour, touz les jors de lor vie368.
La rime entre saige et coraige, en liant la sagesse et le cœur dans lequel doit se fondre le secret de l’amour, participe de cette valorisation qui s’intègre ainsi à une forme d’élitisme amoureux369. À plusieurs reprises, Drouart la Vache réitère cette recommandation pour souligner le caractère privé que doit revêtir l’expression émotionnelle dans une perspective de sage prudence :
S’aucuns domques a garder bee
L’amour aquise longement,
Il se doit garder saigement
De li, plus qu’il ne doit, ouvrir,
Et doit chascuns l’amour covrir.
Car, puis que l’amours est seüe
Et de plusours aperceüe,
175Ses acroissemens prent defaut
Et ses premiers estas defaut370.
Se martèle ainsi l’impératif de garde qui conditionne l’expression émotionnelle. Ses paramètres amoureux sont explicites, liés à la discrétion indispensable à la relation. Les jeux de rimes viennent renforcer cette leçon, dans l’association qu’ils entraînent entre la durée de la relation et la sagesse du secret. Ils mettent aussi en lumière l’opposition topique entre l’ouverture et la couverture, mais surtout insistent sur le defaut de la révélation. Ses modalités sont bien précisées : l’amour est alors su et aperçu, les apparences prenant dans ce cadre toute leur importance. Le caractère révélateur des apparences amoureuses sert donc de socle à la loi du secret, érigée de manière absolue. Drouart la Vache renverse sur cette base le mythe de l’amour de loin, arguant qu’il est inutile à l’amour sagement couvert371. Le savoir amoureux, à la fois sage et bel – selon l’association qu’implique la mise à la rime de ces deux adverbes – se définit uniquement selon la discrétion, le savoir se conjuguant, à la rime également, à l’absence d’apparences. Ce qui émerge dès lors de cet art d’aimer est une véritable grammaire des signes amoureux. Drouart la Vache poursuit dans ce sens :
Bien se gart que il ne la guingne
Et qu’il ne li face autre signe,
Ne por li son mestier ne change,
Ains l’ait ausi com une estrange,
Que mesdisant cause ne truissent,
Par quoi d’iaus .II. mesdire puissent.
Quant il seront priveement,
Si se guingnent hardiement
Et tieus signes comme il vorront,
Em prive lieu faire porront372.
S’esquisse ici une répartition nette des signes à maîtriser, en public ou en privé. La reprise en fin de passage des signes, qu’il convient dans un cas qu’il ne face pas ou qu’il peut se permettre dans l’autre, rythme cette distinction essentielle dans la tradition des arts d’aimer. Elle éclaire ce 176recours à la discrétion et surtout le caractère néfaste de son non-respect, cause de médisance de la part des losengiers qui motivent et justifient ce recours à la dissimulation. Ce passage est, à l’image de l’œuvre dans laquelle il s’insère, révélateur d’une conception largement partagée dans la tradition courtoise : le contrôle de soi et de son apparence a avant tout pour objectif de déjouer les pièges des opposants aux amants. Une défense morale est ainsi incluse dans ce phénomène de manipulation de l’expression émotionnelle. Le maintien de la relation amoureuse requiert une dynamique de protection qui légitime la dissimulation, mais aussi la simulation qu’elle implique. Plus que de camoufler les signes de l’amour, il est question de feindre l’indifférence, de se conduire envers la dame comme si elle n’était qu’une estrange. La fiction semble ainsi s’instiller dans le jeu émotionnel recommandé par Drouart la Vache qui ne se contente pas seulement de la dissimulation discrète. Il s’agit là d’une stratégie déjà observée de renforcement de la dissimulation par la simulation de l’émotion opposée, de l’amour par l’indifférence dans ce cas. Mais les jeux émotionnels recommandés dans Li Livres d’Amours dépassent parfois largement la garde à seule fin de protection.
Drouart la Vache ne traite pas seulement des astuces nécessaires pour préserver l’amour des losengiers, mais aussi de celles qui visent à s’en assurer, voire à mettre l’aimée à l’épreuve. Il témoigne ainsi de la multitude d’objectifs poursuivis dans la manipulation du semblant amoureux, et de son potentiel rusé. Plus que de dissimuler l’amour, il conseille de simuler pour manipuler la dame : « Apres, s’il vieut avoir enseigne / qu’il soit amez, iriez se faigne / et le dedaignex vers lui face373 ». Le vocabulaire employé atteste le débordement de la seule dynamique de contrôle. Davantage que de faire des signes d’amour, il est ici question de faire le dedaignex ou de se feindre iriez. Loin de la joie convenante souvent affichée ou de l’indifférence manifestée dans le seul objectif de mieux camoufler la douleur typique de l’émoi amoureux ou l’amour lui-même, la simulation d’émotions que l’on peut qualifier de négatives témoigne d’une volonté plus rusée. Elle s’écarte en tout cas de l’appel à la garde, pour les souverains en particulier qui veillent à afficher des émotions positives conformes à la bienséance requise sur la scène sociale374. De manière 177intéressante, la tromperie touche au nucléon du couple lui-même, et non à ses opposants. Mais elle relève tout autant de la sagesse que le secret dans l’enseignement dispensé par Drouart la Vache :
Tel doctrine devez avoir
Que, se li amans vieut savoir
S’il est amez certainement,
Il doit faindre tout sagement
Que l’amour d’un autre l’argüe
Et souvent aler en sa rue375.
Un pont semble ainsi relier le garde et la tromperie plus explicite par cette qualification similaire de sagesse. Drouart la Vache conseille de la même manière d’aimer sagement, secrètement376, que de faindre tout sagement. Le renversement est notable : il n’est plus question de dissimuler l’amour, mais de le simuler. Si le verbe faindre peut relever de l’ambiguïté habituelle du jeu des émotions et qualifier aussi bien la dissimulation que la simulation377, l’amourd’un autre qui fait l’objet de sa feintise laisse peu de doute sur la nature du jeu recommandé. La place accordée à ce conseil est tout aussi soulignée que celle du secret. Drouart la Vache le qualifie de doctrine, un terme révélateur de son importance, encore renforcée par son caractère impératif : les amants doivent la respecter. Une fois de plus, la rime des adverbes garantit la logique du jeu. Pour s’assurer l’amour de sa dame, l’amant doit s’y prêter, la certitude s’associant directement à la sagesse d’une telle manipulation. La dimension fictionnelle du code amoureux courtois s’impose ainsi : pour susciter l’amour, on doit soi-même paraître le ressentir et s’engager ainsi dans une forme de fiction propre à la fin’amor. On trouve ici, de manière détournée bien sûr par la part de feintise qu’elle véhicule, une version performée de l’appel à aimer l’amour de saint Augustin. Le jeu établi avec cet idéal de mise en scène de l’amour se poursuit et se pose au cœur même de l’émotionologie amoureuse. Plus encore que de doctrine, Drouart la Vache fait même relever l’hypocrisie ainsi conseillée de « d’Amour droite nature378 ». Il est notable, dans cette réflexion critique, qu’il soit question de « grant 178desir » feint plutôt que d’amour. Certes, le désir s’avère bien moins louable que l’amour, mais peut-être constitue-t-il justement un objet moins problématique à feindre que l’amour lui-même. Couplé à l’objectif répété une fois encore d’« esprouver » l’aimée, ce facteur paraît justifier la tromperie, présentée comme inhérente au maintien du couple de par sa qualification de nature d’Amour. La ruse s’érige ainsi en stratégie tout aussi indispensable que le secret à la conquête et à la préservation de l’amour. Le rattachement de l’une comme de l’autre à la sagesse et à la définition de l’amour renforce le rapprochement et rythme la transition du secret à la ruse parmi les astuces nécessaires à la fin’amor. Le ton n’est cependant pas toujours aussi complaisant. Les manipulations du semblant amoureux peuvent être traitées de manière bien plus critique. C’est surtout le cas lorsque Drouart la Vache met en garde contre l’amour feint des femmes cupides :
S’il avient qu’elle, par boidie,
Te moustre d’amour aucun signe,
Por ce que te regarde ou guigne,
Saches qu’elle te vieut deçoivre
Et qu’elle te vieut bastir tel poivre
Qu’a lui donner soies meüs379.
Ce passage illustre la condamnation que peuvent sous-tendre les pratiques de simulation hors de tout enjeu de contrôle bienséant ou amoureux surtout. Les expressions par boidie ou bastir tel poivre dénotent une mise en lumière plus problématique de la ruse380. L’objectif visé, de deçoivre et plus encore de pousser son amant à lui donner, contribue bien sûr à la dénonciation. Comme toujours, l’intention poursuivie éclaire l’évaluation morale. Cette hypocrisie mal intentionnée, motivée par la cupidité, pourrait dans ce sens difficilement se justifier comme celle des amants cherchant à s’assurer de l’amour de leur dame. Ces allusions dénotent les nuances perceptibles dans les jeux du semblant. Au-delà de l’intention, la nuance tiendrait aussi à la dynamique de jeu insufflée, qu’elle soit de l’ordre de la dissimulation ou de la simulation, de la seule garde discrète 179ou de la ruse. Le renversement est remarquable : il est question des signes d’amour, des regards et des guignes démontrés, tout comme dans le cas des amants qui devaient alors chercher à les dissimuler381. Notons par ailleurs que cette tonalité critique concerne le jeu émotionnel de la dame, là où aucune ne semblait entourer celui démontré par l’amant, même quand il était question de manipuler son aimée. Bien sûr, la nuance tient avant tout à l’objectif poursuivi, mais il est intéressant que cette seule exception à la légitimation des jeux du semblant amoureux concerne les dames. Il pourrait s’agir d’un reliquat de la misogynie bien ancrée dans l’esprit clérical médiéval, quelle que soit la volonté de Drouart la Vache de s’en affranchir382. Il peut s’avérer d’autant plus évident dans le cadre d’un art d’aimer destiné avant tout aux amants et non aux dames383, selon le modèle offert par Ovide à ce niveau aussi. Ce passage offre ainsi un exemple parfait des dynamiques diverses qui peuvent entourer la manipulation émotionnelle, selon son orientation, son intention, son auteur et son public. Soulignons une fois encore que la simulation semble concerner davantage les amants, là où seule la dissimulation est requise face au reste de la société, aux opposants des amants en particulier, de manière somme toute logique dans cet univers régi par la loi du secret. Néanmoins, la ruse semble donc s’immiscer au sein même du couple, une tendance pour le moins problématique dans l’esprit de la fin’amor animé tout autant par l’impératif de la sincérité que par celui du secret. Drouart la Vache signale déjà les jeux de l’expression émotionnelle qui anime la communauté émotionnelle des amants hors des seuls enjeux de contrôle bienséant. Jean-Pierre Cavaillé soulignait leur importance, qu’ils relèvent de la dissimulation ou de la simulation, « envisagé[e]s comme d’efficaces techniques de gouvernement, mais aussi de réussite sociale ou simplement de protection individuelle, ou encore comme les instruments ordinaires des relations amoureuses384 ». En reconnaissant l’efficacité de ces stratégies, Jean-Pierre Cavaillé exacerbe le rôle joué par 180cette dynamique de l’apparence aussi bien dans la société du Moyen Âge que dans celle du siècle des Lumières à laquelle il consacre son étude. Il témoigne surtout de l’entremêlement des univers dans lesquels transparaît cette efficacité reconnue aux émotions. Quelle que soit sa dynamique avant tout privée, la sphère amoureuse se révèle tout autant concernée par ce règne des apparences, l’intimité des amants se voyant en permanence confrontée à la publicité inhérente à la société médiévale.
Cet appel obsédant à la mesure de soi de la part des amants, dans toutes ses nuances, irrigue la littérature narrative. L’enjeu de la bonne garde amoureuse transparaît en particulier dans l’œuvre de Jean Froissart, L’orloge amoureus, représentative elle aussi de la volonté codificatrice de la fin’amor. La comparaison du fin’amant à une horloge s’avère fort intéressante pour appréhender la place accordée à la mesure. Elle permet de fonder la recommandation du gouvernement même de l’amant :
Ensi Amours me fait considerer
Et m’a donné matere de penser
A un orloge, et comment il est fes.
Et quant j’ai bien consideré ses fes,
Il me samble, en imagination,
Qu’il est de grant signification,
Mes qu’il soit bien a son droit gouvrenés385.
Au fil d’une mise en scène aussi conventionnelle qu’accomplie des codes amoureux386, Jean Froissart adapte le commandement incontournable qu’est celui du gouvernement de soi à l’imaginaire horloger. Cette association se voit justifiée par l’autorité d’Amour même, présenté à l’origine de cette matere de penser. Jean Froissart introduit ainsi une métaphore qui connaîtra à sa suite un succès important. Julie Singer souligne en particulier l’intérêt, et la postérité qui l’atteste, du rapprochement opéré entre la mesure mécanique et la mesure comme vertu387. Christine de Pizan en témoigne dans le portrait qu’elle dresse, dans son Epistre Othea, de la déesse Attemprance388. Jean Froissart offre en effet un tableau saisissant 181de la vertu d’attemprance, qu’il associe, « par droit », à la deuxième roue de son horloge389. La fonction de cette roue de rencontre est significative : elle a pour rôle de retarder et d’actionner le mouvement à la mesure du foliot qui lui permet de conserver sa régularité390 :
Car mon desir, qui est tres bien parés,
De la roe premiere de l’orloge,
Est attemprés, et tant bien dire en o ge,
Par la vertu de la seconde roe,
Qui nommee est Attemprance, et qui roe
Sagement, car le foliot le garde
Qui de Paour monstre la droite garde391.
Jean Froissart vante l’utilité, la vertu même, de cette seconde roe qui permet que soit bien parés la première roue du desir. Toute son action semble résumée à sa sagesse : la roue paraît se déterminer par le fait qu’elle roesagement. L’enjambement met en exergue cette qualité essentielle de la roue d’Attemprance. La répétition de la garde qu’elle assure joue de la valorisation. Elle permet de mettre en lumière, à la rime en outre, le rôle du foliot qui permet cette régulation de la seconde roue. Elle éclaire surtout son rattachement à la personnification de Peur, à la source de ce souci de maintien de soi392. La garde que mène Peur se voit encore qualifiée de droite, un critère essentiel du mouvement ordonné de la roue d’Attemprance, mais aussi significatif de sa portée élogieuse. Elle constitue ainsi un outil indispensable à l’amant pour assurer sa bonne conduite en symbole de la crainte de la médisance et du dévoilement de l’amour. L’orloge amoureus revient à plusieurs reprises sur le lien ainsi établi entre peur et mesure393 et sur l’appel à la discrétion qu’il induit :
Et pour ce qu’il aussi ne passe point
La mesure de raison, fors a point,
Il li couvient, par bonne entention,
Mettre en son coer toute discretion,
182Par quoi il puist faire par rieule aler
Seürement l’oevre de Doulç Parler.
Sans ce ne poet sagement descouvrir
Ce qu’il li fault, ne sagement ouvrir
Ensi qu’il apertient et que requiert
L’estat d’amours tout tel que l’amant quiert394.
Outre l’association retrouvée entre mesure et raison, on note la valorisation de la sagesse du processus de révélation s’il est soumis à la discrétion recommandée. De manière intéressante, elle se concentre sur le cœur, siège des émotions. Davantage que sur le visage, c’est dans le cœur même qu’il faut insuffler la mesure nécessaire à l’estat d’amours. L’aveu amoureux s’avère bien sûr essentiel, mais toute descouverture doit répondre à cet impératif de discrétion.
C’est ainsi que se comprend l’idéal de sagesse amoureuse qui traverse le Moyen Âge. À l’instar de Jean Froissart qui en fait une pièce maîtresse de la mécanique amoureuse, Évrart de Conty accorde à l’attemprance une place centrale dans son Livre des Eschez amoureux moralisés. Dans une belle démonstration de l’association entre émotions et idéal de tempérance, il enchaîne la présentation des « .xij. manieres de passions ou affections d’ame395 » et celles des douze vertus qui servent à en contrer les effets qui défieraient la raison396. Il y intègre les quatre vertus cardinales, valorisées selon l’autorité aristotélicienne397. Il joue ainsi de toute la tradition laudative de la mesure de soi pour intégrer à sa leçon d’amour la vertu d’attemprance :
Atrempance est aussi as amans neccessere pour amoderer leurs desirs et leurs passions toutes ramener a mesure, a la fin que deliz, qui avugle raison, et qui cause mesmez est et peut estre souvent de l’amour amendrir ou defaillir du tout, quant il est pris trop excessivement, come il a esté dit, ne les puist decevoir ; car tout excés nuit, ce dit Aristote, ou il ne peut par raison profiter398.
Sa définition ainsi orientée dans une logique amoureuse se veut dans la droite lignée de celle que proposait Brunet Latin. On y retrouve tout 183le champ lexical de la garde : la force modératrice, l’objectif de mesure et l’évocation de la raison comme principe-maître et garde-fou de la chute d’Amour, la dimension d’excès présentée comme cause de tous ces maux, l’autorité antique pour la souligner. Évrart de Conty témoigne aussi de la portée corporelle des enjeux de la maîtrise des émotions. Il se concentre sur les passions et les desirs, à la manière de la roue de Jean Froissart dont l’action porte sur celle de Désir. Surtout, l’attemprance vantée par Évrart de Conty vise à empêcher le deliz d’aveugler la raison et de defaillir l’amour. Telle est l’utilité fondamentale de cette vertu qui permet de remplir les conditions des émotions vertueuses, qui doivent « bien maintenir es corporelles delectacions sanz les du tout fuir et les trop enssuire, maiz par bonne mesure et ainsy que raison le consent et ensaigne399 ». La dynamique du juste milieu, défendue sur le modèle aristotélicien, imprègne ainsi tout autant la forme d’art d’aimer d’Évrart de Conty que l’encyclopédie de Brunet Latin, dans la même logique corporelle d’ailleurs. La condamnation des excès qui sous-tend l’éloge de la mesure dans le Livre des Eschez amoureux moralisés transparaît aussi clairement dans sa définition de l’attemprance par l’accumulation des termes d’aveuglement, d’amoindrissement, de défaillance, de déception et de nuisance. Jacqueline Cerquiglini met en lumière, dans son analyse de la poésie de Guillaume de Machaut, l’importance que prend l’idéal du juste milieu : « L’idéal du moyen subsume tous les aspects de la vie amoureuse. Il détermine la bonne conduite […]. Il définit les bonnes manières400 ». Des troubadours et de la théorisation qu’André le Chapelain offre de leur fin’amor à Guillaume de Machaut, la littérature amoureuse courtoise vante l’attemprance d’un bout à l’autre de son histoire à succès401. Le très 184célèbre Roman de la Rose participe de cette valorisation, surtout sous la plume de Guillaume de Lorris qui fait l’éloge de la mesure et même de la discrétion dans les commandements d’Amour402. Il exerce une influence durable au Moyen Âge, par l’exemple marquant qu’il offre d’un souci de codification de l’aventure amoureuse, mais peut-être plus encore par la mise en lumière des ambiguïtés que Jean de Meun y introduira. Le continuateur du Roman de la Rose s’efforce en effet de lever le voile sur les ambiguïtés liées à cet appel à la mesure et à la discrétion émotionnelle par le biais de Faux Semblant403. Ses révélations des dérives possibles de la garde émotionnelle suscitent des réactions diverses dans le tableau alors dressé des feeling rules amoureuses404. L’emphase mise par Évrart de Conty sur la vertu d’attemprance en est une, même si nous aurons l’occasion de revenir au Livre des Eschez amoureux moralisés pour l’ambiguïté qu’il sait instiller. Le Champion des Dames de Martin le Franc en est une autre. Il reprend lui aussi l’exposé des commandements d’Amour, qu’il inscrit dans un respect rigoureux de l’exigence de contenance convenante405, mais aussi de sincérité de l’amant. Le nom même du Champion des Dames, Franc Vouloir, est révélateur de ce mouvement qui vise la correction des leçons malintentionnées de Faux Semblant, nous le verrons406. Il réoriente ainsi l’ensemble des préceptes de l’attemprance amoureuse dans une optique univoque et honnête. Il témoigne ce faisant de la constance de sa valorisation, tout à fait conforme à la tradition en la matière :
Amours, Amours, vraye prudence,
Justice en bon pois mesuree,
Force puissant en excellence,
Attrempance bien moderee407.
185L’attemprance s’associe, selon le modèle des vertus cardinales, à la prudence, à la justice et à la force, au courage408. La redondance de la formule attrempance bien moderee met encore en exergue la qualité de retenue qu’incarne en premier lieu le dieu Amour lui-même. Le rôle accordé à la tempérance dans l’univers amoureux s’inscrit lui aussi dans une logique éprouvée. Martin le Franc l’intègre en effet parmi les armes de Franc Vouloir pour contenir et freiner son cheval, Ardant Desir. Dame Raison justifie cette fonction, en critiquant ce cheval qui perd la vue à force de courir :
Tant fort s’en cueurt, si fort s’en ride
Qu’il en pert la veue et la voye.
Si lui fault mettre bonne bride
Qui le conduise et le convoye.
Pour quoy convient qu’on y pourvoye
Ainchois que plus avant alez,
Et qu’Atemprance vous envoye
Ung bon mors car vous le valez409.
La vertu d’attemprance vise donc, comme chez Froissart410, le désir, qualifié d’ardant, dans cette dynamique d’excès qu’Atemprance est supposée venir contrer. Raison ne laisse aucun doute sur la question, elle insiste à plusieurs reprises sur la « trop oultrageuse maniere411 » d’Ardant Desir. L’aveuglement que causent les excès d’Ardant Desir fait aussi écho à celui qu’Évrart de Conty reprochait au deliz de causer quant à la voie de raison412. Le bon mors qu’Atemprance permet de poser au destrier de Franc Vouloir est encore vanté à l’occasion de la bataille menée par le Champion des Dames contre Malebouche. Atemprance s’y avère fort utile en équipant Ardant Desir « d’ung frain doré413 »qui le rend « tres asseuré414 » et contribue à gérer sa « fureur415 ». Martin le Franc loue 186ainsi le rôle essentiel joué par Attemprance dans la lutte contre l’ennemi premier de Franc Vouloir qu’est Malebouche. Il s’agit là d’un paramètre fondamental de l’éloge que la fin’amor fait de la vertu de tempérance. Bâtie sur le modèle du personnage du Roman de la Rose, la figure de Malebouche incarne la médisance qui menace l’honneur de la dame et ainsi l’amour des amants. On touche à nouveau à l’enjeu crucial de l’honneur, décliné, dans la logique amoureuse, sur le versant féminin. C’est dans ce cadre que la bonne garde des émotions connaît toute son importance chez les fin’amants : « Rien ne préserve en fait de la médisance, si ce n’est peut-être une pratique assidue de la mesure416 ». Elle se pose au cœur des qualités des fin’amants, comme un signe de la bonne éducation nécessaire pour mener à bien leur parcours vers la dame. L’attemprance amoureuse se construit dans un appareillage complexe qui fait à la fois écho au savoir-vivre courtois417 et à la progression vers Dieu418.
Nous voudrions étayer et nuancer cette analyse de la garde particulière des fin’amants par les portraits dressés des plus célèbres d’entre eux. Lancelot et Guenièvre ou Tristan et Yseut portent à un degré de raffinement tout particulier l’impératif du celer dans les destins tragiques qui sont les leurs. Nous avons déjà pu évoquer les épisodes particuliers de maîtrise, et de manipulation, émotionnelle de la part de Tristan et Yseut419. Pour illustrer toute l’importance de la garde, mais aussi la tension que cet impératif instille face à l’intensité des émotions amoureuses et aux objectifs particuliers qui sont prêtés aux amants, il nous semblait pertinent de nous arrêter plus en détails sur les exemples foisonnants qu’offre la littérature arthurienne, des romans de Chrétien de Troyes au Lancelot Graal. Nous pourrons ainsi démontrer la place cruciale de l’idéal de mesure émotionnelle, conjuguée à un impératif de discrétion propre à l’amour bien sûr, mais aussi à des enjeux qui mènent souvent les amants à dépasser la simple modération de leurs émotions.
La place que Chrétien de Troyes occupe dans le développement de la littérature narrative en ancien français nous semble sans peine justifier ce parcours, mais c’est surtout l’importance qu’il accorde à 187la sphère affective et aux jeux dont il l’entoure qui légitiment bien plus encore l’analyse que nous souhaitons lui consacrer. Les émotions n’y sont jamais de simples ornements de la trame narrative, elles deviennent des signifiants fonctionnels pour l’interprétation textuelle et se chargent d’un sens précieux420. Les manipulations dont elles font l’objet sous sa plume prennent dans ce cadre toute leur importance à leur tour. Chrétien de Troyes se fait ainsi porte-voix du regard porté sur les émotions et sur leur nécessaire maîtrise421. Il souligne en particulier l’influence exercée par les codes courtois, chevaleresques surtout, par exemple sur les manifestations de chagrin, largement réprimées dans nombre de ses romans422. On y observe aussi de manière exemplaire le règne du secret qui marque l’éthique de la fin’amor en belle démonstration de cet idéal de contrôle émotionnel. Son second roman, Cligès, en est révélateur. Les deux couples qui en occupent le récit font preuve de la garde recommandée aux amants. De leurs premiers émois aux émotions trop manifestes de leur attachement, ils se caractérisent par un contrôle de soi qui se veut infaillible, même face à la violence de leur amour difficilement maîtrisable. Les premiers symptômes amoureux de Soredamor et d’Alexandre révèlent ces enjeux topiques de discrétion amoureuse :
Adés croist lor amors et monte ;
Mes li uns a de l’autre honte,
Si se cele et cuevre chascuns,
Quë il n’i pert flame ne funs
Del charbon qui est soz la çandre.
Por ce n’est pas la chalors mandre,
Einçois dure la chalors plus
Dessoz la çandre que dessus.
188Mout sont andui an grant angoisse,
Que por ce que l’an ne conoisse
Lor conplainte në aparçoive,
Estuet chascun quë il deçoive
Par Faux sanblan totes les janz ;
Mes la nuit est la plainte granz,
Que chascuns fet a lui meïmes423.
Notons tout d’abord que la montée de l’amour est concomitante au souci de dissimulation. La réciprocité se conjugue ainsi aussi bien à leurs émotions qu’à leurs efforts pour les camoufler. Le dédoublement des verbes de dissimulation atteste la difficulté de l’entreprise. La métaphore amoureuse bien connue du feu renforce encore cette impression. Surtout, elle participe de la mise en lumière de l’intensité de ces émotions dissimulées. La chaleur présentée plus forte sous la cendre qu’au-dessus joue de l’opposition, topique dans les jeux d’émotions, entre dedans et dehors ainsi que de l’image, tout aussi représentative de cette dynamique, de la couverture. Le souci de contrôle, jugé bienséant, de l’amour se révèle ainsi de manière explicite dans sa dynamique manipulatrice par cette image d’un conflit, entre dessous et dessus, entre dedans et dehors. Les derniers vers du passage s’inscrivent dans cette optique, tout en soulignant encore la mutualisation de la rupture opérée chez les amants entre leurs émotions et leurs apparences. Leur angoisse est mise en lien direct, à la rime, avec le souci de ne pas rendre public leur amour, et cette discrétion avec la tromperie qu’ils mettent ainsi sur pied. La rime aparçoive-deçoive souligne le lien de cause à effet qu’inclut ce jeu d’apparences et même de ruse finalement dicté par la crainte de la révélation. La tromperie est d’autant plus claire qu’il est question de faux semblant plutôt que du bel semblant souvent recommandé dans l’émotionologie fondée sur la bonne garde. La manipulation est explicite, tout comme la rupture opérée entre les janz et eux-mêmes, entre leurs faux semblant et leur plainte granz. La référence au public redouté de leurs émotions témoigne de l’impératif du secret amoureux, en lien surtout avec la figure du losengier, comme nous le soulignions en introduction. Nous constatons ainsi la tension oxymorique entre bel et faux semblant, entremêlés au nom de la discrétion indispensable de l’amour, bien avant le rapprochement qu’en 189proposera Jean de Meun. Elle s’avère d’autant plus intéressante qu’il n’y a ici aucune raison sociale à cette dissimulation. Rien n’oppose Alexandre et Soredamor. Seule la tradition amoureuse courtoise du secret semble dicter leurs efforts. Ils relèvent ainsi d’une forme d’ironie à l’égard de l’inexpérience des amants, mais aussi de l’ensemble de ces feeling rules obsessionnels de contrôle et de discrétion. Mais ils permettent aussi de mettre en lumière l’intensité de leur attirance à l’aube de leur relation. La loi du secret amoureux ainsi mise en exergue pèse sur l’ensemble du roman. Hors de toute ironie, elle en vient à éclairer toutes sortes de manipulations émotionnelles. La première d’entre elles touche bien sûr, comme ici, à l’émotion amoureuse. Cligès est frappé du même impératif de maîtrise et veille à camoufler son amour immédiat pour Fénice lors de leur première rencontre, au nom de cette même association entre une attitude sage et couverte, dictée par amour même dans la crainte du jugement extérieur424. La crainte du regard d’autrui éclaire la plupart des manipulations du semblant amoureux, de la dissimulation de l’amour avant tout, mais pas seulement. Il convient en effet que les amants camouflent toute trace de leur attachement l’un à l’autre, désolations des séparations ou extases offertes par l’aimé. Ainsi en va-t-il d’Alexandre qui dissimule son plaisir de recevoir une chemise brodée d’un cheveu de Soredamor, qui exacerbe autant l’intensité du bonheur que celle de la garde qui doit l’entourer425. Elle justifie cette rupture entre dedans et dehors, apert et couvert, comme ici lors de la mort d’Alexandre que Soredamor peine à ne pas pleurer ouvertement :
Or cuide et croit que mar fust nee
Soredamors qui ot le cri
Et la plainte de son ami.
De l’angoisse et de la dolor
Pert le memoire et la color,
Et ce la grieve mout et blesce
Qu’ele n’ose de sa destresce
Demostrer sanblant an apert ;
An son cuer a son duel covert.
Et se nus garde s’an preïst,
A sa contenance veïst
190Que grant destresce avoit el cors
Au sanblant qui paroit defors426
Les effets ravageurs de sa tristesse sont bien présentés, dans toute leur intensité : ils sont, à chaque vers, dédoublés pour mieux les souligner, l’angoisse se liant à la douleur, la perte de mémoire à celle de couleur. Mais Soredamor est surtout grievee et blescee – dans un doublet révélateur – de ne pouvoir manifester son deuil. Il est intéressant qu’à la douleur déjà extrême de la disparition de son amant s’ajoute donc celle de ne pouvoir le pleurer an apert. La difficulté de la garde est ainsi manifeste. Elle l’est d’autant plus que ses efforts semblent voués à l’échec : la destresce dont elle cherche à ne demostrer sanblant en apert se révèle en réalité bien au sanblant qui paroit defors. Le jeu de reprise qui marque la présentation de ses efforts de manipulation et la réalité des apparences qu’elle laisse transparaître contribue encore à souligner la difficulté du jeu qu’elle souhaitait mettre sur pied. Il se fonde, comme cela est souvent le cas, sur une opposition entre sanblant et cuer, redoublée ici de celle entre apert et couvert. La rupture entre cœur et apparence est évidemment intéressante, elle témoigne de la manipulation opérée, a fortiori quand elle touche à un cœur si plein d’émotions comme l’est celui de Soredamor. La tristesse constitue l’un des objets essentiels des jeux émotionnels des amants, soucieux de dissimuler la douleur de leur séparation par exemple, plus ou moins définitive. Cligès et Fénice font preuve des mêmes efforts et des mêmes difficultés, avec la même insistance sur la cause de leur dissimulation et l’acuité de l’observation du public craint de leur amour427.
De manière compréhensible au vu des souffrances endurées par les amants pour vivre leur amour interdit, la discrétion indispensable à l’amour courtois adultère dicte le plus souvent la dissimulation de la tristesse, révélatrice de sentiments plus profonds. Mais force est de constater que Chrétien de Troyes semble se détacher de cette tendance bien attestée par ailleurs. Ainsi, les occurrences de dissimulation de tristesse qu’il met en scène ne concernent que dans moins de la moitié des cas ce souci de 191discrétion amoureux. Souvent perçu comme contraire à l’éthique de la fin’amor428, Chrétien de Troyes préfère faire relever les efforts de maîtrise émotionnelle de la bienséance chère à la société courtoise. Toujours dans le roman Cligès, il représente Fénice en proie à la difficulté de contenir sa douleur de se voir promise « parforce429 » à « celui qui pleisir ne li peut430 » à une fin bien plus courtoise qu’amoureuse431. Dans le Chevalier au Lion, le même type de dynamique entoure la dissimulation d’Yvain, désolé d’avoir dépassé le délai que lui avait accordé son épouse et probablement perdu ainsi son affection : « A grant painne tenoit ses lermes, / mes honte li feisoit tenir432 ». La répétition du verbe tenir met en lumière la difficulté éprouvée par Yvain pour contenir sa tristesse, déjà convoquée par la formule explicite a grant painne433. Cette répétition du verbe tenir permet de signaler la rupture opérée entre ses deux occurrences : ce n’est donc pas Yvain qui parvient à tenir ses lermes, mais sa honte. Yvain devient ainsi simple objet de ses émotions, de la tristesse qu’il ne peut contrôler et de la honte qui lui permet finalement d’y parvenir. Comme dans le cas de Cligès par amor conduit434, on observe la force motrice des émotions, pas seulement comme agent perturbateur, tel que la sphère affective en est souvent accusée, mais au contraire comme instance de régulation. Sa honte relève sans doute de ce sens de la bienséance qui imprègne la société courtoise et que Chrétien de Troyes met bien plus volontiers en scène. Sa résistance à la tradition de la fin’amor tient surtout, comme nous le savons, à sa plus grande adhésion à l’amour marital. Il 192démontre son attachement à ce modèle dans le roman du Chevalier au Lion, mais aussi de manière exemplaire dans celui d’Érec et Énide. Les jeux de dissimulation qui y sont intégrés touchent avant tout à l’amour que se portent les conjoints, et surtout au souci qui anime Énide de préserver son époux. Ainsi décide-t-elle de dissimuler sa souffrance à l’écoute des critiques émises à l’encontre de la « récréantise » d’Érec435. Elle refuse de manifester sa tristesse, animée par la peur, bien mise en exergue, de blesser son époux, dans un jeu de cause à effet tout à fait explicite du risque que cela comporte à ses yeux. Mais ce souci de préservation de son époux ne conduit pas seulement Énide à la bonne garde de ses émotions. Pour mieux les contenir, elle s’efforce même d’apparaître joyeuse devant Érec436. Cette forme d’altruisme dont Énide fait preuve est entourée de tous les paramètres habituels de mise en valeur de la garde émotionnelle : elle se voit qualifiée de « sage » et bénéficie de tous les efforts requis pour assurer cette contenance joyeuse, en regard de l’intensité des émotions éprouvées et d’une rupture marquée entre celles-ci et la manifestation qui en est offerte. Dans le contexte de ce couple marié, nulle raison de dissimuler l’amour bien sûr, mais plutôt de ménager l’être aimé437. La même dynamique de protection de l’amant gouverne ainsi ces jeux émotionnels, par le secret nécessaire à son honneur ou par ce souci de veiller à ses propres émotions. La reine Guenièvre veille elle aussi à maîtriser ses émotions pour ménager ses proches, si non son époux. Dans le Chevalier de la Charrette, elle camoufle ses émotions sous un semblant plus jovial lorsqu’elle apprend la disparition de Lancelot :
N’est pas la novele cortoise
Qui la reïne cest duel porte,
Neporquant ele s’an deporte
Au plus belemant qu’ele puet.
Por mon seignor Gauvain l’estuet
Auques esjoïr, si fet ele,
Et neporquant mie ne cele
Son duel que auques n’i apeire,
193Et joie et duel li estuet feire.
Por Lancelot a le cuer vain,
Et contre mon seignor Gauvain
Mostre sanblant de passe joie438.
L’insistance mise sur le public devant lequel elle tente de dissimuler son émoi – le chevalier Gauvain – paraît dénoter une forme d’altruisme à son égard également. L’entremêlement émotionnel est manifeste, joie et duel finissant par se fondre dans un même vers. L’une et l’autre se rattachent respectivement à Gauvain ou à Lancelot, destinataire ou source de l’émotion impliquée. Gauvain offre évidemment un avatar parfait de la cour à laquelle Guenièvre ne peut faire montre de ses émotions. Neveu du roi, incarnation des mœurs courtoises, il symbolise l’ensemble des règles d’élégance et de maintien de soi que la reine s’efforce de respecter. La rime entre le cœur vain qu’elle a por Lancelot et le prénom de Gauvain participe de cette rupture, selon l’opposition habituelle des jeux émotionnels entre cœur et semblant439. Le décalage, voire l’oxymore, entre le duel qu’elle porte et ses efforts pour qu’elle s’an deporte met bien en lumière la manipulation émotionnelle, la transition de la douleur à la joie qu’elle se contraint d’afficher. Le verbe porter apparaît souvent pour qualifier ces émotions qui chargent le protagoniste, tandis que le verbe deporter exprime de manière évidente le contraire. Peut-être pourrait-on d’ailleurs le lire selon une re-sémantisation de deporter par l’intermédiaire de la rime. De-porter deviendrait ainsi ne plus porter, avec un préfixe à valeur négative, révélateur de l’annulation, du moins l’invisibilisation souhaitée de l’émotion440. La joie feinte tenterait d’annuler l’effet de la tristesse, en vain comme on le voit. On note cette fois aussi l’effort dont Guenièvre fait preuve avec la formule de comparaison au plus qu’ele puet, renforcée encore par l’adverbe belemant, révélateur de la dynamique bienséante qui l’anime. Son effort de paraître joyeuse paraît ainsi encore 194souligner sa tristesse. Bien sûr, ce sanblant de joie vise avant tout la garde du duel qui étreint Guenièvre à la nouvelle de la capture de Lancelot, et donc de l’amour qu’elle lui porte. Exception notable à la résistance de Chrétien de Troyes à la tradition de la fin’amor, Le Chevalier de la Charrette offre le récit d’un amour adultère devenu aussi mythique que celui de Tristan et Yseut.
Il inspire dès lors le cycle romanesque long et imposant du Lancelot Graal qui en détaille et développe les conditions. Ce n’est pas pour autant qu’il évite les questionnements liés aux jeux de pouvoir, et notamment aux conséquences de leur amour441. Le Lancelot Graal contribue ainsi à valoriser la maîtrise émotionnelle, et les manipulations qu’elle induit en particulier dans la sphère amoureuse, en se concentrant sur cet amour interdit, que ses héros veillent tant à garder caché, avec l’insuccès que l’on connaît pourtant. La chute du royaume arthurien dépeinte dans le dernier volume de La Mort le roi Arthur tient en effet dans une grande mesure à la rupture opérée entre Arthur et Lancelot suite à la révélation de la relation adultère de la reine. La règle du secret gagne en importance avec cet exemple éclatant des effets désastreux de son non-respect. Les amants s’ingénient pourtant longtemps à le préserver, au gré de ruses diverses et variées. Un très grand nombre des jeux émotionnels mis en scène dans le Lancelot Graal concerne ainsi la communauté spécifique des amants et ses objectifs de garde fondée sur la discrétion. Ils ne se départissent pas pour autant de l’esprit de bienséance qui empreint la société médiévale, à l’instar de Guenièvre dans le roman de Chrétien de Troyes. Ainsi, la reine fait aussi montre de retenue dans cet objectif multiple de bienséance, de discrétion amoureuse, mais aussi d’attention pour Gauvain toujours : « et plus li grieve pour chou ke elle n’ose s’angousse descouvrir pour mon segneur Gauwain, et nepourquant tant en fait ke li pluisour s’en poeent apiercevoir442 ». On retrouve à n’en pas douter l’objectif de discrétion typique de la préservation amoureuse, appliquée ici à l’angoisse qui étreint la reine face au danger qu’encourt alors Lancelot. Celle-ci se voit encore aggravée par la nécessité justement de la dissimuler, comme dans le cas de Soredamor qui souffrait d’autant plus de l’agonie de son amant qu’elle n’osait démontrer sa 195détresse443. La conjonction adversative ne rythme cette fois pas la rupture entre émotion ressentie et émotion manifestée, mais entre ce souci de dissimulation et son échec. C’est comme si l’ampleur de sa peur, due justement à son désir de la contrôler, la rendait finalement impossible à dissimuler. Son angoisse paraît ainsi trop forte à contenir, et elle se fait, s’exprime malgré ses efforts. Elle se manifeste d’ailleurs à bien d’autres que Gauvain, sur qui se concentraient ses efforts, puisque plusieurs peuvent s’en apercevoir. Les apparences servent ainsi de socle à la connaissance des émotions, les qualificatifs aperçu et su s’alliant dans le processus de révélation, dans une belle démonstration des enjeux de la garde. Cet objectif particulier de maîtrise émotionnelle de la part de la reine afin de préserver son entourage se manifeste surtout à l’égard de son amant bien sûr : « Mais elle se garde bien de faire duel quant elle voit Lancelot, por ce qu’elle siet bien qu’il est si angoissous que par poi qu’il n’esrage444 ». La dynamique de garde est explicite dans les efforts de discrétion de Guenièvre de ne pas faire le deuil. Elle agit ici par égard pour son amant, dans un mouvement de compassion pure, dénuée de tout intérêt pour son propre sort ou son image, tout comme Énide qui s’efforçait de camoufler ou même également de feindre ses émotions afin de préserver son époux445. Le Lancelot Graal sort de cette logique essentiellement féminine. Il est en effet une relation qui, plus que tout autre, cultive l’obsession du bien-être de l’autre : celle qui unit Lancelot et Galehaut. Elle constitue un bel exemple de ces amitiés masculines que la littérature des xiie et xiiie siècles se plaît à mettre en scène en leur prêtant davantage d’intensité que celle démontrée envers l’aimée elle-même446. Le lien étroit de ces deux compagnons est également à l’origine d’émotions intenses, mais souvent préférées cachées, dans un effort de garde remarquable de ces efforts de préservation de l’aimé447. Lancelot en vient à dissimuler ses émotions à son ami non seulement pour le préserver, mais aussi pour lui cacher son amour pour la reine. On retrouve à cette occasion la logique d’opposition entre privé et public qui 196empreint toutes les relations sociales, même les plus intimes448 comme celle de Lancelot et Galehaut :
Ce disoit de Lancelot dont il le voloit prier, car il n’estoit mie a cele assamblee del roi et de la roine, ainçois estoit a l’ostel, enserrez en une chambre maz et pensis, si ne voit riens qui le puist confort[er], car il li est avis qu’il a sa dame perdue, et neporquant il s’est mult bien celez vers Galehot meesmes449.
Dans une nouvelle mise en exergue de la force de ses émotions par le dédoublement de leurs qualificatifs, Lancelot s’enserre pour éviter de révéler qu’il est maz et pensis, incapable de se conforter lui-même. Néanmoins, neporquant – selon ce retournement que les textes introduisent volontiers –, il s’efforce de dissimuler sa tristesse. Son souci de garder secrète sa désolation, et l’amour qui en est à la source, concerne même son plus proche ami, Galehaut. Ceci témoigne de la séparation nette qui marque l’expression amoureuse entre celle permise dans l’entité du couple et toute celle qui en ressort. Ce passage démontre ainsi les efforts consentis non seulement par Guenièvre pour camoufler cet amour essentiel à la trame du Lancelot Graal. Même si Lancelot s’avère en proportion moins touché par cet impératif du secret amoureux, il fait lui aussi montre de retenue à cet égard à plusieurs occasions. Lionel en fait d’ailleurs le récit à la reine et à la dame de Malehaut dont leurs amants déplorent l’absence de la manière la plus couverte possible en regard de la « gent en lor conpaignie », quel que soit ce que « li cuer ne lor aportent450 ». La proportion des manipulations émotionnelles qui relèvent de cette dynamique dans le Lancelot en Prose tend à révéler la solitude radicale de ses héros. L’importance conférée autant à leurs relations amoureuses contrariées qu’aux normes sociales de garde éclaire une tension indissoluble qui ne peut conduire qu’à cet isolement prescrit par l’idéal de discrétion451. Au contraire des citations précédentes où seule une personne était ciblée par le jeu mis sur pied, c’est ici la multitude qui est justement soulignée pour justifier celui de Lancelot et Galehaut. Toute une série des manipulations d’émotions mobilisées visent moins 197le secret propre à l’amour que ce souci de convenance toujours requis sur la scène publique. En chevalier accompli, Lancelot se plie aux règles, profondément courtoises, de maîtrise de soi, quelles que soient les difficultés qu’il rencontre surtout dans les derniers épisodes du cycle. Il veille ainsi à garder un dehors favorable en dépit de l’angoisse croissante qu’il éprouve face à la dégradation de ses relations avec la cour arthurienne : « si s’asiet entre ses chevaliers et fet greignor semblant de joie que ses cuers ne li aporte452 ». Aucune mention explicite n’est faite aux émotions de Lancelot, mais on devine sans difficulté sa douleur sous ce semblant de joie. Il est présenté de manière intéressante dans une perspective comparative, rendue explicite par l’adjectif greignor, avec l’état réel de son cuers. Le recours à l’opposition entre dedans et dehors permet de souligner le caractère subi des émotions ressenties, par contraste avec celles qu’il choisit de manifester. C’est le cuers qui lui apporte la tristesse, tandis que c’est Lancelot lui-même qui fet – un verbe représentatif de la dynamique active de la manipulation – le semblant de joie. On perçoit ainsi une tension entre le caractère subi de ses émotions et son initiative pour les manipuler. C’est pour ses chevaliers que Lancelot veille à afficher ce qui peut aussi être qualifié de bel semblant. Le déterminant possessif permet de rappeler la position de Lancelot qui, en tant que chef de son clan, se doit d’assurer ses apparences. On retrouve ainsi l’esprit de convenance qui anime, de manière générale, la société courtoise et, en particulier, ses souverains.
Cet objectif de bienséance face à la cour réunie conditionne d’ailleurs toujours avant tout Arthur, même dans ses relations amoureuses. Ses sentiments à l’égard de la fausse Guenièvre portent la trace de ces efforts de convenance. Ses émotions sont ainsi systématiquement contrebalancés par le bel semblant qu’Arthur veille à afficher en public : « Més il se penoit de lui conforter a plus qu’il pooit et de faire bel semblant devant le pople453 ». Comme dans le cas de Lancelot, la peine qu’éprouve Arthur à la disparition de l’usurpatrice est effacée au profit d’une émotion plus appropriée. Le jeu émotionnel développé fonctionne ainsi comme si l’émotion jugée irrecevable en public ne pouvait être exprimée que par son opposé, de la tristesse à la joie. Cela semble garantir l’efficacité de la 198discrétion recherchée, mais relève aussi de l’idéal de bienséance dicté sur la scène sociale que nous avons observée, chez Arthur en particulier. La difficulté de la garde émotionnelle se fait plus grande dans ce contexte, avec ce renversement complet de l’émotion en son contraire, mais aussi les formules superlatives ou d’efforts introduites pour le qualifier. On retrouve dans tout cet épisode plusieurs mentions des larmes auxquelles Arthur se laisse aller une fois isolé, dans une belle démonstration de la distinction qui s’opère entre sphère privée et sphère publique. Plutôt que de la sphère privée, difficile, si ce n’est impossible, à circonscrire dans la culture courtoise, c’est même de l’intimité du roi dont doit relever sa tristesse. Elle s’oppose de manière évidente à la publicité à laquelle il est soumis sur la scène sociale qu’il préside. Le bel semblant que manifeste Arthur caractérise en réalité l’ensemble des manipulations émotionnelles qu’il met sur pied. Les émotions deviennent ainsi le lieu où se noue la nature indéchiffrable de la vérité du roi, tout comme de chaque individu. La narration s’attarde d’ailleurs sur cette vérité, tout autant mise en exergue que les efforts démontrés pour la camoufler. Ils ne diminuent en rien la douleur qu’il ressent à la perte de la fausse Guenièvre, soulignée à plusieurs reprises encore454.
Cette loi du secret tant amoureuse que bienséante touche, sans surprise, avant tout la reine, posée au cœur elle aussi de l’univers social et animée d’un amour bien plus soumis à la discrétion encore. Hors de toute considération d’empathie dont nous l’avons vue si bien dotée455, Guenièvre se trouve contrainte de contenir ses émotions, de taire sa tristesse au départ de Lancelot pour la mission périlleuse qu’il entreprend en allant combattre le cousin de Méléagant : « si em pleure la royne mout tenrement, mais chef u si celeement ke nus fors euls deus ne le sot456 ». L’enjeu est de ne pas faire savoir sa tristesse et l’amour qu’elle implique, par le biais des larmes qu’elle veille à maîtriser, mais qu’elle ne peut s’empêcher de verser. Elle s’efforce cependant de les celer de sorte à ce que 199nul n’en ait connaissance hormis eux deux. Si l’opposition entre dedans et dehors n’est pas convoquée de manière explicite, elle transparaît dans cette évocation de l’intimité du couple placée en contraste avec le reste du monde. En belle démonstration de l’intensité et de la multitude des émotions que l’amour à la fois impose et dicte de contrôler, la reine se doit tout autant de paraître plus joyeuse qu’elle ne l’est que de camoufler sa joie, bien trop éloquente, quand elle apprend le retour de Lancelot après une longue absence dans le Chevalier de la Charrette :
Et se Reisons ne li tolsist
Ce fol panser et cele rage,
Si veïssent tot son corage,
Lors si fust trop granz la folie.
Por ce Reisons anferme et lie
Son fol cuer et son fol pansé,
Si l’a un petit racenssé
Et a mis la chose an respit
Jusque tant que voie et espit
Un boen leu et un plus privé
Ou il soient mialz arivé
Que il or ne sont a ceste ore457.
Plutôt qu’Amour – comme dans le cas de Cligès458 –, c’est ici Raison qui dicte à Guenièvre ses efforts de garde. Le renversement est intéressant et révélateur de la tension entre amour et raison qui rythme d’ailleurs toujours la conception des émotions. Le caractère irrépressible – et donc largement irrationnel – de l’amour fait partie des critères essentiels de la fin’amor459. En l’appliquant à la reine Guenièvre, Chrétien de Troyes semble ainsi révéler son point de vue sur cette forme d’amour adultère qui la lie à Lancelot, mais surtout sur la rupture des règles courtoises de bienséance et donc de discrétion qu’elle induit. En effet, ce fol penser et cele rage semblent davantage qualifier la possibilité qu’ils veïssent tot son corage, c’est-à-dire la visibilité de l’amour, que son amour en soi. La trop granz folie paraît ainsi désigner sa révélation plutôt que l’amour lui-même. La fermeté de Raison est bien soulignée pour compenser l’ampleur des 200sentiments de Guenièvre et le risque de divulgation qu’ils impliquent. Son action se dédouble dans la présentation qui en est donnée, comme en parallèle de la redondance des qualificatifs de folie. En confirmation de l’objet exact de son influence, Chrétien de Troyes précise bien le dessein de Raison : Guenièvre ne peut manifester que discrètement sa joie. Le respit imposé par Raison vise ainsi un lieu boen et surtout plus privé, dans une belle mise en lumière de cet objectif tout à fait usuel du contrôle émotionnel sur la scène sociale. La rime privé-arrivé révèle la connotation positive de la modération bienséante, le privé s’alliant à la bonne considération d’émotions jusqu’alors qualifiées de fol. La réorientation de la dynamique habituelle de la folie, qui empreint les théories amoureuses en vue de disqualifier non pas l’émotion en elle-même mais sa manifestation, est intéressante. Il est d’ailleurs notable que seule Guenièvre soit présentée, dans ce roman, dissimuler ainsi ses émotions, dans une démonstration très claire de la pression sociale qui pèse sur les femmes et en particulier sur une souveraine. Le roman d’Érec et Énide témoignait de la même tendance à la manipulation émotionnelle féminine460, bien que ces deux occurrences du Chevalier de la Charrette ne relèvent pas que du souci de préserver l’aimé. Les jeux émotionnels auxquels se prête Guenièvre s’inscrivent dans une tout autre optique, bien plus représentative de cette loi du secret érigée au cœur de la relation amoureuse médiévale. Ils relèvent néanmoins toujours d’une dynamique bienséante, presque davantage courtoise qu’amoureuse. Ceci éclaire de manière intéressante la répartition des rôles masculins et féminins, mais aussi sociaux dans les manipulations émotionnelles. Loin des stéréotypes de femmes rusées, Chrétien de Troyes met en scène ses héroïnes animées des meilleures intentions de jouer de leurs émotions, pour préserver leur aimé, pour dissimuler leur amour non par intérêt personnel, mais par souci de protéger leur entourage.
Un autre exemple est révélateur de la pression mise sur la gent féminine pour contrôler ses émotions. Il s’agit de l’épisode lors duquel la dame de Malehaut entraîne une demoiselle éplorée loin de la cour où elle ne peut laisser libre cours à sa tristesse : « Et la pucelle qui s’amie est fait tel duel que riens ne la puet conforter. Si l’a la dame de Malohaut enserree an une chambre que li communs des genz ne veïst lo duel que 201ele faisoit461 ». Au contraire d’Arthur qui essayait de se conforter au plus qu’il pooit, la jeune fille ne peut se conforter. Le renversement paraît mis en lumière par l’usage différent du verbe faire. Il ne sert en effet plus à désigner la manipulation émotionnelle, mais bien l’émotion subie, avec tant d’intensité qu’elle ne peut être retenue et se voit manifestée librement, trop librement. De manière intéressante, la dissimulation ne prend plus la forme d’un réfrènement des manifestations physiques de l’émotion, mais celle, plus extrême, d’un camouflage complet. Face à l’impossibilité pour la jeune fille de contenir sa douleur, la dame de Malehaut ne peut que l’éloigner du public tant craint de ses émotions, à l’instar de Lancelot qui cachait ainsi sa peine à Galehaut. Elle élève ce faisant la discrétion, requise sur la scène sociale, à un véritable processus d’apprentissage462. On comprend une fois de plus l’importance conférée à la maîtrise des émotions qui se fait critère essentiel de l’éducation donnée aux jeunes héros mis en scène dans les romans arthuriens. D’ailleurs, pour s’en assurer, davantage même que de l’éloigner, la dame de Malehaut l’enserre dans la chambre, une formule significative de la force de cette loi du secret amoureux, dans une nouvelle version de l’opposition entre dedans et dehors qui détermine toujours la manipulation émotionnelle. L’objectif est cependant le même : que li communs des genz ne veïst lo duel. Au-delà de l’objectif évident de bienséance que remplit cet effort de contrôle d’une douleur si manifeste, il s’agit bien sûr ici aussi de préserver la discrétion indispensable à l’expression amoureuse. La position d’amie de la jeune fille fait allusion à la nature de sa souffrance, d’ordre amoureux. Elle permet ainsi d’établir un parallèle avec l’enjeu le plus important de la garde émotionnelle pour la communauté des amants, celui du secret de l’amour bien évidemment.
Sans surprise, l’amour de Lancelot et Guenièvre est le plus riche en occasions de tels efforts de garde. La reine surtout se prête à de nombreuses reprises aux manipulations émotionnelles nécessaires au secret de sa relation avec Lancelot, parfois bien loin de la seule garde. Comme chez Drouart la Vache, ses efforts sont valorisés comme relevant de la sagesse 202de la reine : « Et la roine li respont non pas come fame esbaie mes come sage et aparcevant, car ele crient que li rois ne se soit aparceus des amors de lui et de Lancelot463 ». Le renversement est une fois encore souligné par la conjonction adversative et renforcé par le dédoublement des qualificatifs de sagesse, par contraste avec l’esbahissement qui ne peut ainsi lui être reproché. Le parallèle qu’instaure la reprise du verbe apercevoir signale le lien de cause à effet entre la lucidité de Guenièvre et celle redoutée de son époux. De manière somme toute logique mais non moins intéressante, c’est la peur de la reine qui semble à la source de ses efforts de contenance. Tout comme dans le cas d’Yvain qui camouflait sa tristesse par honte, c’est ici par crainte de la révélation que Guenièvre dissimule son amour. Cet exemple trouvera un écho tout particulier chez Jean Froissart qui pose la peur comme moteur même des appels à l’attemprance464. Comme souvent, une formule causale apparaît pour justifier le jeu émotionnel introduit, mais qui ne relève cette fois pas tant du souci de la publicité en soi, mais juste de celle offerte au roi. Cette concentration atteste le décalage d’une manipulation purement bienséante à celle qui touche au secret indispensable à la relation amoureuse. Mais davantage que cette stratégie aux allures défensives à laquelle Guenièvre recourait déjà sous la plume de Chrétien de Troyes465, le cycle en prose étend volontiers le recours à la garde émotionnelle qui prend ce faisant des allures plus rusées pour assurer le secret amoureux. C’est ainsi que la reine est dépeinte feindre, non plus la joie, émotion par essence bienséante, mais la surprise pour mieux camoufler ses sentiments pour Lancelot : « Et qant ele l’ot, si fait sanblant que a grant merveilles li viegne, et se seigne trop sovant466 ». Plutôt que l’émotion éprouvée, c’est ici l’émotion manifestée qui se trouve renforcée, par l’adjectif grand qui qualifie la prétendue merveille qui touche Guenièvre et par les manifestations physiques qu’elle en livre. Le signe de croix fonctionne comme un indice courant de l’ébahissement, il est frappant de le voir intégré ainsi aux processus de manipulation de cette émotion. Dans une belle démonstration du débordement du seul registre de la garde, la dimension potentiellement démesurée est soulignée : elle se 203signe trop souvent467, comme pour signaler l’hypocrisie de son geste. Cet épisode témoigne de la manière dont la feintise aussi peut se fondre parmi les stratégies de discrétion recommandée aux amants, sans se départir pour autant d’une connotation plus proprement trompeuse. Celle-ci est d’emblée convoquée par la formule, de moins en moins équivoque, fait sanblant, révélatrice dans tous les cas de la dimension proactive de ce signe émotionnel qu’elle cherche à faire paraître.
De manière intéressante, quand bien même elles toucheraient à une forme de ruse qui s’annonce dans les traités amoureux comme nécessaire à la préservation de l’amour, les manipulations émotionnelles ne sont en rien dénoncées comme hypocrites quand elles sont mises sur pied par les amants. Le Lancelot Graal ne met ainsi qu’une fois en scène la dimension trompeuse du jeu émotionnel relaté, toutes occurrences confondues de la part de cette communauté ainsi formée par les amants. Il s’agit de manière significative de la fausse désolation de Mordred : « Quant Mordred, qui toute ceste traïson ot fete, si que nus n’en sot mot fors lui et le vaslet qui les letres avoit aportees, oï ces noveles, si fist semblant qu’il en fust mout courrouciez et se lessa chaoir entre les barons ausi come touz pasmez468 ». Ce passage s’insère au cœur d’un événement crucial au récit de La Mort le Roi Arthur : celui de la trahison de Mordred, le neveu/fils du roi qui, pour conquérir Guenièvre, répand la fausse nouvelle de la mort d’Arthur et de sa prétendue volonté de le voir lui succéder sur le trône et auprès de la reine. La félonie de Mordred ne laisse aucun doute, sa traïson étant clairement affirmée dès le départ. Mais ce qui nous intéresse, bien au-delà de la ruse générale, c’est la ruse émotionnelle qui vient y contribuer. Pour assurer la véracité de cette fausse lettre tout en se forgeant l’image d’un neveu aimant et accablé par la mort de son roi, Mordred feint la tristesse en apprenant la nouvelle. Entouré de tous ses barons, dans cette perspective de visibilité, de spectacle même, Mordred va jusqu’à mimer la pâmoison. On perçoit ainsi le jeu auquel peut mener cette considération des émotions et plus encore de leurs manifestations physiques comme indubitablement honnêtes. C’est d’ailleurs l’évanouissement que choisit de jouer Mordred, sûrement conçu comme une manifestation plus forte et spontanée encore 204de l’accablement, mais aussi plus aisément feinte que les larmes. Le vocabulaire usité pour qualifier ce jeu émotionnel est à la fois révélateur de cette violence de l’émotion mise en scène et de la mise en scène à proprement parler. Plutôt que dolent, l’adjectif associé au substantif si fréquent duel déjà illustré dans le passage précédent, Mordred est ici dépeint comme courroucié, un terme éloquent de l’intensité émotionnelle mimée469. De leur côté, les formules come touz pasmez ou se lessa cheoir mettent en lumière la dimension trompeuse de la pâmoison, tandis que l’expression faire semblant ne laisse ici encore aucun doute sur la fausseté du courrous. On est bien loin des manipulations émotionnelles valorisées comme relevant de la sagesse, même quand il était semblablement question de feindre une émotion afin de tromper son auditoire. L’intention est tout autre et jette ainsi une lumière fort différente sur le jeu que Mordred met sur pied dans cet épisode capital dans la chute du monde arthurien. Elle joue de la nuance, que nous voyons s’esquisser, entre une forme de jeu digne qui relève de la garde en camouflant la peine sous la joie, et une autre qui, en dissimulant la joie sous des larmes feintes, relève de la trahison et de l’hypocrisie. Elle révèle avant tout la sombre intention de Mordred de tromper l’ensemble de la cour et Guenièvre au premier plan. Davantage que de se connoter ainsi, sa manipulation en éclaire une autre qui en découle directement, celle de Guenièvre qui camoufle sa tristesse de devoir épouser Mordred : « Et quant la reine entent ceste parole, si est tant dolente que il li est avis que li cuers li doie partir del ventre, mes semblant n’en osa fere, por ce que cil qui devant lui estoient ne s’en aperceüssent, car ele s’en bee a delivrer tout en autre maniere qu’il ne cuident470 ». La narration semble même mimer le rapprochement entre ces deux jeux émotionnels de Mordred et de la reine qui tous deux veillent à l’apparence offerte de leurs émotions à l’écoute de nouvelles capitales dans la trame du roman. Mais, autant la douleur affichée par Mordred paraît facile à mettre en scène, autant celle de Guenièvre s’avère difficile à réfréner471. La rupture entre cœur 205et corps qu’elle manifeste se remodule pour signifier la difficulté pour le cœur de supporter la souffrance qui lui est ainsi imposée, plutôt que le décalage introduit entre son ressenti et les indices physiques qu’il en offre. La rupture est néanmoins amorcée juste ensuite, au gré de la formule habituelle de faire semblant, employée ici pour noter la crainte de ces apparences. Le jeu repose donc lui-même sur une émotion, celle de la peur de révéler l’intériorité. Comme si souvent, la raison en est donnée, en lien avec la visibilité que Guenièvre craint d’offrir de sa désolation, loin de tout souci de pure convenance ou même de secret amoureux. Au contraire, la discrétion de Guenièvre s’inscrit ici dans une visée plus globale, marquée par le verbe beer qui met en lumière l’importance du désir auquel se prête la dissimulation. L’intention paraît aussitôt moins pure, elle relève d’un stratagème de tromperie explicite. Le verbe cuider offre une allusion certaine à cette démarche rusée, qui tend à induire en erreur le public de ce jeu émotionnel. Guenièvre espère en effet se sortir de cette situation délicate et préfère pour cela camoufler son ressentiment, à la source même de son souhait de liberté. La ruse transparaît donc de cette mise en lumière des objectifs poursuivis par Guenièvre, ainsi que d’un lexique plus connoté. Aucune déconsidération n’accompagne pour autant cette mise en place de la stratégie déployée par la reine pour se débarrasser de son prétendant malhonnête. Et c’est justement la propre malhonnêteté de Mordred qui paraît justifier celle de Guenièvre. De la même manière que la loi du secret amoureux légitime les manipulations émotionnelles, la défense à opposer aux véritables hypocrites, portés par de mauvaises intentions que le récit a à cœur de souligner, échappe à toute critique. Le roman Floriant et Florete présente un cas de figure fort similaire. La mère du héros, épouse d’un souverain juste et apprécié, se voit poursuivie des avances de son sénéchal pernicieux. Maragot a pour sa part véritablement tué son seigneur pour pouvoir demander sa dame en mariage, à la grande désolation de la pauvre reine de Sicile. Sa peine n’a cependant d’égal que la retenue dont elle veille à l’entourer, dans un effort mûrement réfléchi « en son cuer » même472. Le cœur devient ainsi davantage qu’un objet d’opposition, avec le semblant qu’elle choisit de ne pas montrer, mais aussi la source du conflit, comme pour démontrer 206peut-être le bienfondé de ce stratagème émotionnel. Quand il est mal intentionné et trop peu caché d’ailleurs, dans le cas de Mordred ou de Maragot, l’amour devient, plutôt qu’une invitation à la maîtrise émotionnelle, la porte d’entrée d’une manipulation plus conséquente des semblants émotionnels intégrée à la ruse indispensable pour la protection des pauvres victimes de cet amour malvenu. On touche ainsi, plutôt qu’à la garde, aux ruses émotionnelles, mais surtout à celles acceptables, légitimées par la propre vilenie du public qui en est la cible, des faux ou mauvais amants ou des losengiers bien sûr.
L’appel à la garde des émotions se montre aussi obsédant que nuancé dans l’univers amoureux. Il est évident que cet impératif se décline diversement pour la communauté des amants. On célèbre pour eux une forme particulière de secret, vantée pour la protection qu’elle leur offre. Sa valorisation n’a d’égal que les difficultés qu’elle pose, tout en en démontrant mieux encore la nécessité. C’est ainsi que la simulation peut s’immiscer parmi les logiques de discrétion, pour assurer une couverture d’autant plus complexe à assurer qu’elle touche à des émotions d’une grande intensité. Dans ce sens, de nombreux épisodes mettent en lumière les efforts consentis – dans des formules superlatives par exemple –, voire les stratégies de dissimulation complète indispensables pour y parvenir473. La part trompeuse que pourraient comporter ces jeux de simulation de l’émotion reste néanmoins sous silence. Tous les moyens semblent bons pour préserver la loi du contrôle émotionnel conjugué au secret amoureux. Les justifications qui y sont apportées sont révélatrices de la peur de la révélation. C’est au cœur des relations des amants avec le monde extérieur que se pose la question de la légitimité ou du moins de l’acceptabilité des manipulations émotionnelles. Là réside la frontière, souvent infime et fort variable comme on l’a vu, entre discrétion et ruse, à la lueur du paramètre intentionnel. Les amants eux-mêmes la brouillent au gré de simulations qui se veulent indubitablement vertueuses ou de dissimulations qui relèvent plus de l’hypocrisie que de la discrétion. Une réflexion s’impose également quant à la répartition des manipulations internes ou externes au couple, et 207surtout à leur connotation. Nous avons noté que les recommandations du Livre d’Amours incluaient le nucléon du couple lui-même. Dans les romans courtois, il semble en aller tout autrement, surtout si l’on se fie au roman de Thomas analysé au chapitre précédent : la ruse qui s’immisce entre Tristan et Yseut aux Blanches Mains descelle bien plus qu’elle ne supporte leur relation. On ne peut manquer de repenser à cette aune la relation entre Arthur et Guenièvre qui se cachent aussi tous deux leurs émotions dans le Lancelot Graal, dans un autre facteur de désunion du couple qu’ils forment. On ne retrouve d’ailleurs aucune forme de mise à l’épreuve telle que la conseillait Drouart la Vache. Bien au contraire, ces grandes figures des fin’amants font preuve plutôt d’un souci de préserver leur aimé que de l’éprouver. Ce sont en outre surtout les dames qui se prêtent à de tels jeux si bien intentionnés, loin des femmes cupides et trompeuses dépeintes dans son Livre d’Amours. On constate ainsi, dans la fiction romanesque animée de fin’amor,une rupture avec l’esprit misogyne et plus volontiers astucieux des arts d’aimer construits sur le modèle ovidien. La loi du secret y prend en revanche tout autant d’importance et permet de justifier toutes sortes de manipulations animées par le souci de protéger l’amour de la menace des médisants. C’est dans le rapport qu’entretiennent les amants avec leurs opposants que se comprend le regard porté sur les stratagèmes qu’ils mettent sur pied. On touche ainsi au rapprochement que nous souhaiterions éclairer avec la dynamique particulière du jeu des émotions mis en scène dans le Roman de la Rose. Tout comme la menace de Malebouche appellera à l’intervention de Faux Semblant, c’est la ruse des médisants et autres opposants des amants qui appelle à la ruse des amants. Les exemples de la tristesse refoulée par Guenièvre ou par la reine de Sicile jouent de cette orientation du jeu émotionnel des amants hors du seul impératif du secret. Ils constituent des cas limites à une émotionologie par ailleurs bien en place parmi la communauté des amants, régie par l’idéal de discrétion vantée dans les arts d’aimer, avec toutes les nuances de stratégies que celui-ci peut impliquer. La garde amoureuse connaît ainsi des déclinaisons révélatrices de toutes ses limites et dérives potentielles, avec toutes les nuances voire même l’ironie qu’elles peuvent impliquer – les exemples du roman de Béroul en sont révélateurs. Sans la nier pour autant, les arts d’aimer et les romans courtois jouent de la frontière ténue entre ces jeux émotionnels, bienséants ou rusés.
208Le contrôle des émotions revêt le plus souvent la forme d’une dissimulation, plus ou moins malaisée selon les cas et qui s’accompagne à l’occasion d’un jeu plus spécifique qui semble mis au service de l’efficacité de cet enjeu de modération. Bien sûr, toutes les occurrences de jeu émotionnel ne s’en tiennent pas à la seule sphère du contrôle de soi vertueux, nous pourrons le vérifier dans la suite de nos analyses. Mais le débat quant à la licité d’une telle manipulation des émotions apparaît bien avant qu’il ne soit question de ruse à proprement parler. La sincérité émotionnelle demeure un enjeu primordial dans la pensée médiévale, indépendamment du poids accordé aux recommandations de contrôle, de retenue et de contenance. Il s’agit là d’un autre point commun aux trois instances émotionnelles considérées au gré de cette analyse que sont les univers de prescriptions religieuses, courtoises et amoureuses. S’ils déclinent cet impératif de garde selon des objectifs monastiques, sociétaux ou amoureux, touchant aux ambitions de l’élévation vers Dieu, de la préservation de la cohésion sociale ou de la réputation personnelle, si ce n’est de celle de la dame et de la relation amoureuse, ces trois univers semblent poursuivre un même objectif de stabilité, révélateur d’une tension inhérente à la sphère affective, par essence mouvante, qui se doit donc d’être canalisée. La garde des émotions s’intègre ainsi à un courant, vaste et obsessionnel, de dénonciation des excès, qu’ils relèvent d’une atteinte à l’exemplarité ou aux règles morales. Elle se conçoit au cœur d’un véritable réseau de prescriptions, qui porte un souci pédagogique remarquable de l’importance qui y est accordée. L’efficacité ainsi reconnue des émotions forcément contenues pour ne pas risquer les dangers de leur visibilité conduit à considérer le jeu qui en vient à se créer autour des émotions. On touche ainsi à l’ambiguïté des prescriptions émotionnelles induites par la crainte que suscite le rapport de concordance entre homo interior et homo exterior, mais aussi, une fois mise en exergue la possibilité de le rompre, par la crainte de la non-lisibilité des émotions dont on manipule les apparences offertes. L’idéal de garde se comprend à la fois comme la condition de la considération vertueuse de l’émotion et comme la porte d’entrée des dérives, à la source du vice d’hypocrisie que peuvent receler les émotions manipulées.
Cette analyse centrée sur le précepte moral de la garde nous permet ainsi d’éclairer toute la richesse des émotionologies médiévales et des intentions qui leur sont prêtées, selon un critère tout aussi essentiel 209aux émotions qu’à leur contrôle et à leur manipulation. Mais elle nous semble aussi démontrer la place laissée à l’authenticité parmi la masse de règles de savoir-vivre qui rythment la société du Moyen Âge. L’appel au contrôle des émotions, obsessionnel dans toutes les sphères de la société, pose la question des limites des manipulations qu’il induit autour de la sphère affective. C’est en effet à la coexistence possible de ces deux régimes épistémologiques de la mesure et de la vérité des émotions que nous voudrions nous consacrer au fil de cette analyse du jeu des émotions et des nuances des manipulations qu’il induit.
Des limites des prescriptions
de mesure émotionnelle
Quand la mesure n’est plus tout à fait vertu
Notre parcours au fil des appels au contrôle émotionnel intégrés aux champs religieux, sociétal et amoureux aura mis en lumière la spécification qui s’opère au fil du Moyen Âge de la garde vers la contenance. Fondée dans la réflexion chrétienne autour de la vertu cardinale de la tempérance, cette qualité morale gagne en importance en se déclinant sur un pan social. L’idéal de mesure s’imprègne d’enjeux qui relèvent de la publicité des émotions à modérer. Les miroirsaux princes et autres manuels de comportement attestent cette orientation. C’est ainsi que l’appel au contrôle des émotions de Gilles de Rome ne se conçoit pas sous l’étiquette de garde ou de mesure, mais bien de contenance474. Surtout, ils se concentrent sur la vertu d’attemprance, qui atteste une logique extérieure dictée par le souci posé par la publicité si risquée des émotions. L’exhortation à la mesure relève ainsi avant tout du maintien de soi et des apparences. La dimension corporelle prend une place prépondérante dans l’ensemble des systèmes émotionologiques médiévaux. Brunet Latin témoigne de cette composante extérieure essentielle à la réflexion autour de la maîtrise des émotions475. Bien sûr, elle prend sens dans 210la compréhension même des émotions, pensées comme le lieu d’une articulation entre âme et corps476. Les efforts de contrôle auxquels est soumise l’instance affective pèsent avant tout sur ses apparences. En tant qu’indices formels de l’intériorité, les signes corporels des émotions concentrent les appels à la vertu detempérance477. Hantée par la crainte de révéler ce moi intime qu’elle préfère caché et dissimulé, la noblesse médiévale érige en règle première la modération du semblant qui est offert des émotions. Elle fonde ainsi l’impératif, plus encore que de la temperentia, de l’elegentia morum. L’enjeu essentiel de la garde des émotions touche dès lors à leur bienséance. Dans le cadre de la théorie de la concordance entre l’homo interior et l’homo exterior478, le bon maintien de l’apparence équivaut à celui de l’émotion et de l’âme elle-même. Mais, en veillant à la mesure de l’homo exterior, il faut considérer la manipulation qu’elle induit. L’étymologie même de l’idéal de tempérance signale d’emblée la dimension manipulatrice qu’elle implique479. L’attemprance des émotions dicte ainsi de creuser un fossé entre l’homo exterior et l’homo interior. Plusieurs passages cités illustrent cette tendance à mettre en exergue cet écart dessiné entre cœur et apparence480. Si de telles formules permettent de mettre l’accent sur l’émotion ressentie au moment de la camoufler, elles témoignent aussi d’une rupture peu compatible avec le principe d’harmonie qui sous-tend la théorie de la concordance. Elles poussent dans tous les cas à considérer l’ampleur de la manipulation prescrite. Les appels au contrôle émotionnel éclairent la possibilité de manipuler les indices émotionnels et ouvrent ainsi la porte à d’autres formes de manipulations que celles qui relèvent de la discrétion bienséante. On touche aux limites de l’éloge de la contenance et aux interrogations qu’il suscite quant à la véracité de l’expression émotionnelle, pas moins essentielle que sa bonne garde. Elle se veut garante 211d’une forme de communication, fondée sur la lisibilité des émotions posées au cœur des rapports sociaux. On perçoit ainsi le paradoxe qui marque la théorie de la concordance entre intérieur et extérieur. Elle conduit à l’impératif de contrôle de l’homo exterior, mais aussi à celui de la sincérité, selon une double injonction parfois peu compatible.
Peter von Moos témoigne de l’entremêlement de ces deux questions en envisageant, à la suite de la réflexion qu’il mène autour du contrôle de soi, la place tout aussi importante de l’expressivité et de la sincérité émotionnelle dans l’émotionologie médiévale481. Les feeling rules semblent ainsi construites sur une forme de hiatus entre les appels à la garde et à la véracité, qui s’avère complexe à appréhender. La difficulté croît encore quand on considère l’inaccessibilité intrinsèque de l’émotion vraie, d’autant plus dans le contexte de la construction discursive des émotions médiévales dont nous avons gardé trace. Cela a conduit des chercheurs aussi aguerris que Damien Boquet et Piroska Nagy à évacuer cette question de la sincérité, arguant qu’aucune dissociation n’est possible entre sensation et valeur morale dans la compréhension forcément culturellement codée des émotions482 et moins encore entre émotion ressentie et émotion exprimée483. Les historiens défendent à raison le caractère inaccessible de l’émotion médiévale en-dehors de ses modalités écrites qui constituent une barrière infranchissable entre le médiéviste et l’émotion réelle de l’homme médiéval. Mais, s’il va de soi que nous nous rangeons entièrement à cette opinion en ce qui concerne l’objet historique de l’émotion, notre approche des émotions centrée sur leur construction en littérature nous paraît offrir une voie de sortie à cette impasse. La sincérité que nous voudrions interroger est celle que les auteurs mettent eux-mêmes en scène. Plutôt que la manipulation, ils soulignent à l’occasion son échec, ou du moins ses difficultés, témoins formels de la force de l’émotion ainsi rendue irrépressible. Les occurrences qui soulignent l’écart entre émotion ressentie et affichée participent aussi de cette mise en lumière de l’émotion vraie, telle que le texte lui-même la construit. Nous pouvons ainsi dépasser l’opposition, par trop stricte, entre sincérité et fausseté de l’émotion, souvent comprise dans la manipulation requise à son endroit.
212La question n’en reste pas moins complexe, justement en raison des feeling rules qui en viennent à la poser. Dans une compréhension culturellement codée des émotions, il devient difficile de situer leur authenticité. L’impératif de contrôle qui rythme tout le système de codification de l’émotion, et du corps qui en est le reflet, laisse peu de place à sa naturalité. On a pu souligner son impossibilité dans la spiritualité médiévale qui vante le renoncement de la chair et déconsidère pour cela le corps et sa libre expression484. Hors de l’univers monastique, l’idéal de bonne conduite courtoise pose la même question de la spontanéité et de la vérité du geste, « à laquelle il est bien difficile de répondre cependant dans la mesure où celui-ci procède, plus encore pour le prince que pour le commun des mortels, d’un mouvement empreint de volontarisme485 ». De manière intéressante, la question semble donc relever de la volonté qui anime l’émotion et sa manifestation. Elle se fait ainsi critère essentiel aussi bien pour l’évaluation morale de l’émotion que pour celle de sa modération et de sa sincérité. Si les codes émotionnels en compliquent eux-mêmes la compréhension, la sincérité de l’émotion ne se pose pas moins au cœur des réflexions menées dans ces efforts de codification. On observe, en parallèle des manuels de comportement religieux, courtois ou amoureux, autant d’appels à l’honnêteté, mais aussi à la méfiance à l’égard des manipulations possibles autour des émotions. Les recommandations de garde émotionnelle se déclinent selon les autorités qui les énoncent, autant que l’emphase mise sur la véracité de l’émotion varie selon l’univers qui en est à la source.
L’idéal de l’authenticité se marque avant tout dans le système de valeurs chrétiennes. La régulation émotionnelle qui empreint l’univers monastique se conçoit d’abord dans son rapport à Dieu. Si la modération des émotions n’en est pas moins essentielle, elle se voit relativisée par l’accès dont dispose de toutes façons le Seigneur à l’instance affective. Surtout, la vertu de tempérance ne doit pas pousser à omettre celle de la sincérité justement dictée par la relation tissée entre Dieu et l’homme486. L’écart qu’elle peut induire entre l’homo exterior et l’homo interior pose alors question :
213Doit-on renoncer à la sincérité pour ne pas froisser ? Dans ce domaine, les scrupules sont de mise dans une vision des manières qu’on pourrait qualifier de monastique, prônant l’harmonie entre l’homme intérieur et l’homme extérieur, entre la pensée et la réalité, entre l’être et le paraître487.
Nombre de théologiens et de penseurs issus des communautés monastiques se lèvent donc contre la pratique de l’attemprance et l’impératif de bienséance davantage que de sincérité qu’elle implique, comme chez Jean de Limoges488. Un mouvement de dénonciation de la rupture entre cœur et apparence, parallèle à une exaltation tout aussi importante des émotions dans toute leur intensité489, voit ainsi le jour dans l’univers monastique. On verra l’influence d’une telle réflexion dans la littérature qui s’en fait l’écho et cherche à donner corps à cet appel, davantage qu’à la retenue, à la sincérité de l’émotion490. Elle témoigne d’un souci pertinent de nuances dans les jeux recommandés autour des émotions, selon le rapport qui se maintient ou non avec leur vérité. Il s’agit là d’un critère tout aussi influent dans la sphère courtoise, nous le verrons.
La méfiance marquée à l’égard des manifestations émotionnelles infiltre également l’univers social, quelle que soit l’importance accordée au principe de contenance. En parallèle de l’éloge de l’attemprance que véhiculent la plupart des manuels de comportement point donc également une condamnation de l’équivoque qu’elle peut provoquer491. C’est surtout la tromperie des faux amants ou des flatteurs qui est concernée par les critiques acerbes qui peuvent entourer les jeux émotionnels. La dénonciation des amants trompeurs irrigue la littérature médiévale, à 214l’égal de celle du losengier qui inspirait dans une grande mesure l’idéal de contrôle. Apparaît ainsi un second objet de crainte pour les vrais amants, qui conduit à mêler à l’injonction de la discrétion celle de la sincérité. L’orloge amoureus fait aussi place à cette qualité tout aussi indispensable que celle de l’attemprance. Jean Froissart présente sans doute dans ce sens l’amant contenant, par le moteur de la peur, ses émotions face à sa dame, mais aussi s’en excusant pour le péché que cela implique :
Pour ce qu’ignoramment, ce me sambloit,
Mon coer, qui de paour trestous trambloit,
S’ert contenus vers vous ains mon depart,
Et de mon fait pas la centime part
N’avoie dit, dont, en moi recordant,
Je m’en tenoie assés a ignorant.
Or ai mon coer de ce moult entechié,
Dont, se g’i ai aucunement pechié,
Certes, ce n’est ne pour mal ne pour visce
Qui soit en moi par recreant servisce492.
La mention de la paour sert ici surtout à souligner l’intensité de l’émotion qui frappe l’amant et insister ainsi sur sa véracité. Animé par la crainte de se révéler, le coer est dissimulé, mais ainsi entechié. La répétition du cœur, sujet des efforts de contrôle, mais objet du péché qui pourrait être reproché à l’amant, témoigne de la tension entre l’impératif de retenue et celui de l’honnêteté. La restriction émotionnelle vient ainsi à inquiéter, à susciter confusion et méfiance, dans l’univers amoureux, mais aussi plus largement sur la scène sociale. Dans ce sens, il devient tout aussi critiquable de ne faire preuve d’aucune manifestation émotionnelle que d’y laisser excessivement libre cours493. Les héros épiques en offrent un parfait exemple : ils sont tout autant admirés pour leur capacité à éprouver et exprimer leurs émotions qu’à les réfréner. La corrélation entre noblesse et expressivité modérée s’accompagne d’une association inverse où le manque de réaction somatique équivaudrait au manque de noblesse494. On peut lire dans ce sens les mentions de l’écart entre cœur et apparence dans les cas d’Arthur ou de Marc. Elles témoignent 215de la réalité de leurs émotions, signal de leur qualité tout autant que leur souci de les camoufler sous un dehors plus adéquat.
Ces exemples présentaient en effet un cas de figure particulier des efforts de contrôle de l’émotion, non seulement dissimulée, mais cachée sous une autre émotion simulée. Ils mettent ainsi en lumière la diversité des manipulations possibles des émotions, contrôlées ou jouées. Cela induit bien sûr des nuances importantes dans la nature du jeu mené, mais aussi de la considération de la sincérité émotionnelle sous-jacente. Les seuls cas de Marc et Arthur, parmi les autres cités chez les amants, l’attestent495 : simulation ne rime pas forcément avec fausseté, l’emphase mise sur l’intensité des émotions qu’ils cherchent ainsi à camoufler en témoigne. Mais la simulation ne revêt pas toujours le même objectif. Et si manquer au principe de contrôle qui s’impose dans tous les univers normatifs de l’émotionologie médiévale est décrié comme un vice, les manipulations auxquelles la retenue ouvre la voie peuvent tout autant poser question. Au terme de notre réflexion sur les modalités de la codification émotionnelle, nous voudrions souligner le rapport de causalité qui nous semble unir la recommandation de garde et le jeu plus vaste qui peut entourer les émotions.
En route vers le jeu
Les normes qui pèsent sur les émotions semblent en effet appeler, outre leur seul contrôle, une véritable mise en scène des émotions. La culture de cour impliquerait ainsi autant la maîtrise que la stylisation des émotions496. Les exemples de rois sur lesquels nous revenions à l’instant le démontrent : il n’est pas tant question de cacher leurs émotions que d’afficher un bel semblant conforme aux règles de la bienséance. Ceci semble valoir avant tout pour les souverains, mais aussi pour toute personne amenée à évoluer sur la scène sociale. Hautement consciente de sa dimension publique, la société médiévale vise la performance de ses émotions au même titre que leur dissimulation. Pour citer Michel Senellart, « la publicité, en d’autres termes, est le mode de contrôle gouvernemental d’une société qui, selon l’expression remarquable de 216Rémusat, “se fait spectacle d’elle-même”497 ». De la sorte, aux côtés de l’injonction à la contenance apparaît l’obligation d’exprimer ses émotions, rendues justement efficaces par leur réglementation498. Selon l’exemple des chevaliers ou des héros épiques dont les réactions somatiques sont tout autant célébrées que leur mesure comme démonstration de leur héroïsme499, l’ostentation émotionnelle prend valeur nobiliaire et chevaleresque500. La colère offre un excellent exemple de la dynamique particulière qui s’instaure autour de la codification émotionnelle, entre exigence de retenue et d’expression : « Loin cependant de l’oubli de soi-même, elle est objet de publicité et de contrôle, ne pouvant en conséquence s’exprimer que selon des modalités et dans un cadre déterminés. Plus que d’autres émotions peut-être, la colère évolue en effet aux limites de la transgression501 ». La théorie du juste milieu s’immisce en effet également dans l’appréhension de l’idéal de mesure. Henri de Gauchy insistait sur la question dans son exposé sur la vertu dédiée au contrôle de la colère502. Richard de Saint-Victor définissait dans le même sens la vertu comme relevant de l’émotion ordinatus et moderatus « quando tantus est quantus esse debet503 ». En recommandant leur contrôle, on met en lumière le pouvoir communicatif des émotions. L’efficacité qui leur est ainsi reconnue conduit à envisager leur utilité potentielle et donc leur instrumentalisation à des fins diverses504. On voit surgir une forme de double jeu de l’émotion, à la fois dissimulée et simulée, le second jeu servant souvent à assurer l’efficacité du premier. Dans bien des cas, la manipulation continue à répondre au souci de contrôle et de discrétion, comme nous l’avons vu avec Arthur, Marc ou Lancelot une fois encore505. 217Ces exemples attestaient l’intensité des émotions à camoufler et justifiaient ainsi peut-être la simulation nécessaire pour y parvenir. L’épisode lors duquel Pharien tente de faire face à la colère que lui inspirent les reproches du jeune, et colérique506, Lionel en est tout aussi révélateur : « Et de tant com il en avoit dit en fu Phariens mout iriez et esbaubiz. Mais neporqant, cortoisement en respondié plus qu’il n’avoit el cuer escrit507 ». Furieux face à tant d’accusations injustes, Pharien n’en fait pas moins preuve de contrôle. La critique de la propre démesure de Lionel croît ainsi par ce contraste avec Pharien qui, lui, parvient à recouvrir sa colère du voile de courtoisie indispensable sur la scène sociale. L’écart qui se marque entre sa réponse bienveillante et ce qu’il n’avoit el cuer escrit révèle cependant l’état d’esprit véritable de Pharien. Tout comme dans les exemples de ce type déjà cités, le décalage atteste le processus de manipulation mis en œuvre, mais aussi ses conditions et les émotions qui le sous-tendent. Bien qu’elle se voie ainsi dissimulée, l’émotion qui fait l’objet de tels efforts de contrôle paraît mise en valeur. Son intensité s’expose dans l’ampleur des démarches nécessaires à la camoufler. La réalité émotionnelle semble autant soulignée que la manipulation dont elle fait l’objet. Ainsi mise en exergue, elle prendrait même valeur d’indice. Comme dans le cas de la Dame du Lac dont la fausse colère venait camoufler le contentement face aux bravades et à la bravoure de Lancelot, la colère de Pharien vient indiquer le jugement, tu, mais ainsi sous-entendu, face aux excès de Lionel. L’adverbe cortoisement indique explicitement dans quelle optique s’intègre cet effort de retenue. Ainsi, si Pharien simule – cette autre forme de jeu que l’on pourrait penser fort éloignée des enjeux de contrôle –, ce n’en est pas moins pour se plier aux règles de bienséance de la société courtoise.
Les exigences de convenance semblent donc impliquer autant de stylisation que de mesure de l’émotion. Comme le défend Jutta Eming, la frontière peut s’avérer fort ténue entre ces deux modalités de la manipulation émotionnelle, nous l’avons déjà souligné en introduction : « Vom bewussten zum strategischen Einsatz des Körpers oder von der Selbstkontrolle zur Verstellung ist es nur ein kleiner Schritt508 ». Une précision s’impose à 218la lecture du rapprochement opéré par Jutta Eming entre contrôle et développement stratégique de l’émotion. Notre objectif est bien sûr d’approcher les jeux mis en scène et exposés comme tels dans les œuvres littéraires. Mais force est de constater que toute extériorisation est déjà jeu et implique une manipulation des signes manifestés, par le seul fait qu’il ait été décidé de les manifester. Mais c’est l’usage stratégique du corps mis en lumière par la linguiste allemande qui indique le jeu à proprement parler. Il relève de ce souci de la publicité sur lequel nous insistions dans nos analyses et que Linda Rouillard en vient à nommer « politique de la visibilité509 ». Dicté par la pression sociale qui érige l’impératif de la bienséance, il vise, davantage que la répression d’émotions jugées inconvenantes, la manifestation d’émotions conformes aux codes courtois. L’enjeu de la visibilité transparaît de chacun des passages que nous avons pu citer en lien avec cette dynamique courtoise qui imprègne la codification émotionnelle et qui semble appeler au jeu au-delà du seul contrôle. Les conseils fournis encore dans Le Livre de la Cité des Dames sont révélateurs du souci obsessionnel de la visibilité offerte des émotions et du contrôle de leur apparence : « Et gardés bien que ne monstriez nul semblant de avoir de ceste chose nulle pesance, et que on ne vous voye triste, mais tres joyeulx comme celluy qui moult en est comptent510 ». La recommandation se dédouble, elle touche à la fois à la dissimulation de la tristesse éprouvée et à la simulation de la joie à afficher. Elle met ce faisant d’autant mieux en lumière l’importance conférée à la visibilité des émotions, à celles dont il ne faut monstrer nul semblant ou qu’on ne peut pas voyr.De manière intéressante, ce conseil est introduit par le verbe garder qui paraît ainsi le faire relever de l’idéal de retenue que nous avons cherché à circonscrire. Il en constitue une déclinaison intéressante, qui ouvre la voie, toute justification possible mise à part511, au jeu à proprement parler. Toutes sortes de nuances viennent parer ces jeux, de la même manière qu’elles teintaient ces appels au contrôle des émotions et 219de leurs apparences. L’enjeu essentiel en reste le même : il s’agit d’assurer la cohésion sociale et la réputation. Mais ce pouvoir ainsi conféré aux émotions mène aussi à d’autres logiques autour de leur manipulation. Significative et signifiante, l’instance affective s’intègre à toutes sortes de stratégies communicatives, voire tout à fait trompeuses. Outre les usages de la colère rituelle, des manifestations d’amitié indispensables aux échanges de paix, on note par exemple l’apparition de la « pratique du pleur » comme démonstration du jeu également possible autour des émotions512. Il arrive a fortiori que les codes soient eux-mêmes objets de jeux, de reprises et de déviances, de réélaborations plus ou moins ludiques513. Le personnage de Faux Semblant constitue un excellent exemple des réinterprétations possibles des logiques émotionnelles, mais aussi des variables d’intentions qui les entourent. Ce curieux personnage de la narration de Jean de Meun joue sur la plupart des enjeux de la codification émotionnelle : la dimension de visibilité des apparences, la lutte contre la médisance incarnée par Malebouche, l’efficacité amoureuse fondée sur la discrétion, mais non sans les détourner. Cette reprise singulière que Jean de Meun propose avec Faux Semblant pare les feeling rules tant religieuses qu’amoureuses de nuances d’intérêt quant aux modalités du jeu, mais surtout quant aux objectifs qu’il poursuit. Elle nous semblait donc offrir un point de départ tout indiqué de l’analyse que nous voudrions conduire autour du jeu des émotions, une fois son fondement dans l’émotionologie médiévale mis en lumière. Mais le personnage de Faux Semblant témoigne également d’une composante fondamentale de la codification émotionnelle qu’il nous semble intéressant de rappeler : sa construction littéraire et, avant cela même, linguistique.
Enjeux linguistiques et littéraires
de la codification émotionnelle
Aux normes émotionnelles et aux réglementations de son expression se superposent les normes de représentation de l’émotion. Nous le soulignions, toute manifestation émotionnelle est déjà jeu. Mais c’est plus encore le cas quand on considère son inscription linguistique et 220littéraire. Jan Dumolyn et Élodie Lecuppre-Desjardin insistent sur cette double construction de l’émotion pour en défendre la dimension culturelle essentielle : « D’ailleurs, si les spécialistes d’aujourd’hui s’accordent pour reconnaître leur caractère biologiquement défini, un consensus existe pour admettre l’importance de la construction sociale et surtout linguistique des émotions514 ». Jutta Eming s’est beaucoup consacrée à cette question de la modélisation linguistique de l’émotion pour signaler l’influence non-négligeable des signes langagiers et écrits des émotions515. Il convient en effet de considérer le filtre que la langue elle-même induit dans notre compréhension des émotions, sans parler bien sûr du filtre incommensurable de l’esthétisation des émotions mises en scène dans les textes littéraires. Bien sûr, ces textes reflètent avant tout les standards émotionnels attendus par la société à laquelle ils se dédient dans la perspective bien évidente d’assurer la bonne réception et compréhension du message qu’ils véhiculent516. Mais il s’agit déjà là d’un medium de représentation, induisant toute une série de normes plus spécifiques à la production littéraire et aux paramètres de son élaboration517. Dans ce sens, on remarque une construction moralisée voire moralisatrice des émotions au sein d’une littérature qui ne peut se démunir d’une volonté pédagogique, voire pastorale. C’est dans ce sens que s’observeraient, dans la plupart des romans médiévaux, des émotions typiquement sociales liées à la régulation de soi en public, dictées par une volonté d’exemplarité au-delà des données esthétiques518. Damien Boquet et Piroska Nagy soulignent également cet entremêlement des logiques de représentation de l’émotion : « la mécanique des émotions et des évènements répond à des scénarios relevant aussi bien du rite et des codes que de la singularité de chaque auteur519 ». La voix auctoriale exerce bien sûr elle aussi son poids dans ce système de représentation qui entoure l’émotion et peut grandement en influer la mise en scène et notre réception. La représentation littéraire des émotions ne conditionne ainsi pas seulement notre lecture et notre compréhension du système 221affectif médiéval, elle l’oriente même : « The representation of emotion in literature thus reflects and is determined by the ambient emotionology as well as purveying and shaping it; the representation of emotions plays with and on–but also according to the rules of–that emotionology520 ». Tel est d’ailleurs sûrement le cas de Jean de Meun qui offre des codes émotionnels, amoureux notamment, une lecture singulière. Les lignes d’influence sont multiples, et interdépendantes, notre approche des sphères religieuses, courtoises et amoureuses de l’idéal de garde l’aura déjà démontré.
C’est donc au sein d’une véritable grammaire de représentation que s’encodent les règles émotionnelles521. Il nous semblait important de conclure sur cette part tout aussi essentielle de l’émotionologie médiévale qu’est celle de sa mise en forme, elle-même codée, au-delà de ses paramètres historiques, corporels, religieux, sociaux ou amoureux. Tout l’intérêt de ce réseau dense et complexe de normes se conçoit bien sûr à la lumière des jeux auxquels il ouvre la porte. C’est au personnage de Faux Semblant que nous voudrions confronter ce constat de l’influence exercée par les codes émotionnels, non seulement sur l’impératif de contrôle, mais surtout sur les dérives qu’ils peuvent impliquer. Il porte à un degré tout particulier la crainte de la visibilité et le souhait de discrétion, voire de brouillage de piste qu’il devient. Dans une démonstration éclatante de toute la richesse du jeu des émotions, il mène cette réflexion sur tous les paramètres d’expression de l’émotion, de ses sphères d’influence diverses aux canaux verbaux comme corporels. Il confère ainsi une importance capitale à la manifestation et à la manipulation de l’émotion, qui éclaire la pratique religieuse, amoureuse, corporelle et discursive même, nous le verrons. L’étude du jeu des émotions permet ainsi de confirmer la place essentielle à rendre à l’instance affective dans l’approche des textes médiévaux, dans leur dynamique linguistique et littéraire même.
1 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge. Une histoire des émotions dans l’Occident médiéval, Paris, Seuil, 2015, p. 11.
2 Ibid., p. 88.
3 M. Aurell, Le chevalier lettré. Savoir et conduite de l’aristocratie au xiie et xiiie siècle, Paris, Fayard, 2011, p. 43.
4 J. Dumolyn et É. Lecuppre-Desjardin, « Propagande et sensibilité : la fibre émotionnelle au cœur des luttes politiques et sociales dans les villes des anciens Pays-Bas bourguignons. L’exemple de la révolte brugeoise de 1436-1438 », dans Emotions in the Heart of the City (14th–16th century), dir. É. Lecuppre-Desjardin et A.-L. Van Bruaene, Turnhout, Brepols, 2005, p. 41-62, ici p. 50.
5 Une formule intéressante employée notamment chez Damien Boquet : D. Boquet, L’ordre de l’affect au Moyen Âge. Autour de l’anthropologie affective d’Aelred de Rievaulx, Caen, Crahm, 2005, p. 15.
6 Selon une notion porteuse développée par Arlie Russel Hochschild et enrichie par Barbara H. Rosenwein : A. R. Hochschild, « Emotion Work, Feeling Rules and Social Structure », The American Journal of Sociology, no 85/3, 1979, p. 551-575 et B. H. Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle Ages, Ithaca / New York, Cornell University Press, 2006, p. 15.
7 D. Boquet, op. cit., p. 316-317.
8 R. Schnell, « Wer sieht das Unsichtbare ? Homo exterior und homo interior in monastichen und laikalenn Erziehungsschriften », dans Anima und sêle. Darstellungen und Systematisierungen von Seele im Mittelalter, dir. K. Philipowski et A. Prior, Berlin, Eric Schmidt Verlag, 2006, p. 83-112, particulièrement p. 93-96.
9 P. von Moos, « Occulta cordis. Contrôle de soi et confession au Moyen Âge », Médiévales, no 29, 1995, p. 131-140, ici p. 135.
10 R. Schnell, op. cit., p. 93-96.
11 J. Rider, « The Inner Life of Women in Medieval Romance Literature », dans The Inner Life of Women in Medieval Romance Literature. Grief, Guilt, and Hypocrisy, dir. J. Friedman et J. Rider, New York, Palgrave Macmillan, 2011, p. 1-25, ici p. 3.
12 M. Aurell, op. cit., p. 359.
13 D. Barbu, P. Borgeaud et P. Matthey, Exercices d’histoire des religions. Comparaison, rites, mythes et émotions, Leiden, Brill, 2016, p. 243.
14 Nous avons eu à cœur tout au long de notre exposé de préserver dans la mesure du possible une certaine cohérence linguistique pour soutenir notre logique d’analyse lexicale. Nous avons dans ce sens favorisé, quand elles existaient, les traductions données en ancien ou moyen français d’œuvres incontournables de la tradition latine, mais nous avons aussi intégré l’une ou l’autre référence latine à des textes par trop immanquables pour les exclure en regard de ces considérations linguistiques. Sur le plan temporel, il convient de préciser aussi d’emblée que nous citerons donc comme modèles de ces feeling rules des ouvrages parfois postérieurs aux œuvres narratives considérées dans la suite de nos analyses. Ils nous semblaient en effet offrir un exemple des normes émotionnelles au long cours.
15 J. Dumolyn et É. Lecuppre-Desjardin, op. cit., p. 55.
16 Richard de Saint-Victor, Les Douze Patriarches (Benjamin Minor), éd. et trad. J. Châtillon et M. Duchet-Suchaux, Paris, Éditions du Cerf, 1997, chap. 7, l. 6-9.
17 Le Trésor de la Langue française nous enseigne en effet que la signification figurée du contrôle comme « surveillance » n’est attestée qu’en 1580 chez Montaigne, tandis que le Moyen Âge ne connaît que ses acceptations plus matérielles, à savoir : « registre tenu en double pour vérification », apparue en 1367, et, en dérivant, de « vérification » plus largement, dès 1419. Trésor de la Langue Française, version en ligne consultée le 6 janvier 2018. Les mêmes définitions sont fournies par le Dictionnaire de Godefroy (uniquement la première d’entre elles) et par le Dictionnaire du Moyen Français, versions en ligne consultées le 6 janvier 2018.
18 Brunetto Latini, Tresor, éd. P. G. Beltrami, P. Squillacioti, P. Torri et S. Vatteroni, Turin, Giulio Einaudi, 2007, L. II, 61, 1-2, p. 464.
19 Ibid.
20 Ibid., L. II, 62, 1, p. 466. L’ensemble de la section qu’il consacre à cette émotion est révélateur de son importance dans les enjeux de maîtrise émotionnelle ainsi mise en lumière : « Aprés garde se tu es en ton bon sens, paissiblement, sens ire et sens torblement dou coraige, car autrement dois tu taire et constraindre ton courrous. Tulles dit que il est grant vertu a constraindre les movemenz dou cuer ki sont troblés et faire tant que ses des[irrier]s soient a raison. Senequa dit : ‘Quant l’ome est plains d’ire il ne voit riens se de crime non’. Caton dit : ‘Ire empeeche le coraige que il ne puisse trier la verité’. Por ce dit un saige : ‘La loi voit bien home qui est sorpris de ire, mes il ne voit pas la loi’. Ovide dit : ‘Veinque ton coraige et ta ire, tu qui veinques toutes choses. Ire soit loins de nos ; car ou lui nulle chose puet estre bien faite ne bien pensee, et ce que l’en fait par aucun torblement ne puet estre parmanable ne plaire a ceaus qui i sont’. Pierres Anfox dit : ‘Ce est en la humaine nature que quant le coraige est comeu par aucun torblement il pert les iauz de la conoissance entre voir et faus’. » Ibid., L. II, 62, 1-2, p. 466-468.
21 Trésor de la Langue Française, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
22 Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
23 Dictionnaire du Moyen Français, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
24 A. Paternoster, « Mesure », dans Dictionnaire raisonné de la politesse et du savoir-vivre du Moyen Âge à nos jours, dir. A. Montandon, Paris, Seuil, 1995, p. 587-605, ici p. 587.
25 Brunetto Latini, op. cit., L. II, 74, 1, p. 496.
26 Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
27 Trésor de la Langue Française, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
28 Dictionnaire du Moyen Français, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
29 J. Cerquiglini, « Un engin si soutil ». Guillaume de Machaut et l’écriture au xive siècle, Genève/Paris, Slaktine, 1985, p. 181.
30 Le Dictionnaire illustré latin-français de Félix Gaffiot, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
31 Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
32 Le Dictionnaire illustré latin-français de Félix Gaffiot, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
33 Dictionnaire du Moyen Français, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
34 Selon l’étymologie mise en exergue par Jean-Claude Schmitt et les définitions liées : J.-C. Schmitt, « La morale des gestes », Communications. Parure, pudeur, étiquette, no 46, 1987, p. 31-47, ici p. 33 ; Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 6 janvier 2018 ; Trésor de la Langue Française, version en ligne consultée le 6 janvier 2018 ; Dictionnaire du Moyen Français, version en ligne consultée le 6 janvier 2018 et Le Dictionnaire illustré latin-français de Félix Gaffiot, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
35 J.-C. Schmitt, op. cit., p. 33.
36 Le Dictionnaire illustré latin-français de Félix Gaffiot, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
37 Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
38 Trésor de la Langue Française, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
39 Inscrit en particulier aussi dans son étymologie latine, liée au verbe attemperare : Trésor de la Langue Française, version en ligne consultée le 6 janvier 2018 et Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
40 Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 6 janvier 2018 et Dictionnaire du Moyen Français, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
41 Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
42 Dictionnaire du Moyen Français, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
43 Trésor de la Langue Française, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
44 Dictionnaire du Moyen Français, selon la référence déjà citée ci-dessus.
45 M. Aurell, op. cit., p. 328.
46 D. Barbu, P. Borgeaud et P. Matthey, op. cit., p. 228-229.
47 A. Pons, « Les fondements rhétorico-philosophiques des traités de savoir-vivre italiens du xvie siècle », dans Traités de savoir-vivre en Italie. I trattati di saper vivere in Italia, dir. A. Montandon, Clermont-Ferrand, Association des Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Clermont-Ferrand, 1993, p. 173-189, ici p. 175.
48 Ibid., p. 187.
49 A. Paternoster, op. cit., p. 587.
50 D. Boquet, op. cit., p. 39.
51 J.-C. Schmitt, op. cit., p. 33.
52 Pour rappel, voir l’exposé consacré aux différents jugements portés sur l’instance affective par les premiers penseurs chrétiens dans la section introductive qui leur était dédiée : p. 37-41.
53 R. Sorabji, Emotion and Peace of Mind. From Stoic Agitation to Christian Temptation, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 343.
54 S. E. Young, « Avarice, Emotions, and the Family in Thirteenth-Century Moral Discourse », dans Ordering Emotions in Europe, 1100-1800, dir. S. Broomhall, Leiden/Boston, Brill, 2015, p. 69-84, ici p. 69.
55 D. Boquet et P. Nagy, op. cit., p. 37.
56 D. Boquet, op. cit., p. 90.
57 D. Boquet et P. Nagy, op. cit., p. 42-43.
58 Ibid., p. 69.
59 D. Boquet, op. cit., p. 74-77.
60 D. Boquet et P. Nagy, op. cit., p. 61.
61 A. Paternoster, , op. cit., p. 587.
62 D. Boquet et P. Nagy, op. cit., p. 69.
63 D. Boquet, Penser et vivre les émotions au Moyen Âge. Texte de la conférence donnée à la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris, La Villette), le 25 avril 2017.
64 Ibid.
65 Par exemple au sein de la relation matrimoniale. Voir M. Guay, « Les émotions du couple princier au xve siècle : entre usages politiques et affectio conjugalis », dans Politiques des émotions au Moyen Âge, dir. D. Boquet et P. Nagy, Florence, Sismel, 2010, p. 93-111, ici p. 93.
66 C. Roussel, « Le legs de la rose : modèles et préceptes de la sociabilité médiévale », dans Pour une histoire des traités de savoir-vivre en Europe, dir. A. Montandon, Clermont-Ferrand, Association des Publications des Lettres et Sciences Humaines de Clermont-Ferrand, 1994, p. 1-90, ici p. 3.
67 Ibid., p. 9-10.
68 Ibid., p. 11-12.
69 M. Aurell, op. cit., p. 329.
70 D. Boquet, L’ordre de l’affect au Moyen Âge, op. cit., p. 112.
71 Pour rappel : voir la défense de Richard de Saint-Victor, citée p. 102-103.
72 D. Boquet, L’ordre de l’affect au Moyen Âge, op. cit., p. 243.
73 D. Boquet et P. Nagy, op. cit., p. 221.
74 C. Casagrande, citée par Damien Boquet et Piroska Nagy : ibid., p. 331.
75 Ibid.
76 L. White, « The Iconography of Temperantia and the Virtuousness of Technology », dans Action and Conviction in Early Modern Europe : Essays in Memory of E. H. Harbinson, dir. T. Rabb et J. E. Seigel, Princeton, Princeton University Press, 1969, p. 181-204.
77 J.-C. Schmitt, op. cit., p. 40-42.
78 A. Paternoster, op. cit., p. 590.
79 Christine de Pizan, Epistre Othea, éd. G. Parussa, Genève, Droz, 1999, 2, l. 32-41, p. 203.
80 P. von Moos, op. cit., p. 133.
81 M. Senellart, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995, p. 47.
82 Ibid., p. 180.
83 C. Roussel, op. cit., p. 29.
84 Li livres du gouvernement des rois : a XIIth century French version of Egidio Colonna ’ s treatise de Regimine principum, éd. S. P. Molenaer, Londres, MacMillan & Co., 1899, II, v, p. 35, l. 31 – p. 36, l. 5.
85 Ibid., III, x, l. 2-5, p. 118.
86 Dictionnaire du Moyen Français, version en ligne consultée le 6 janvier 2018.
87 Li livres du gouvernement des rois, op. cit., III, ii, l. 22-31, p. 97.
88 C. Roussel, op. cit., p. 25-27.
89 Martin Aurell et Claude Roussel insistent tous deux sur la question : M. Aurell, op. cit., p. 328-332 et C. Roussel, op. cit., p. 1-2.
90 L. Smagghe, Les Émotions du prince, op. cit., p. 179.
91 C. S. Jaeger, The origins of courtliness. Civilizing trends and the formation of courtly ideals 939-1210, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1985, p. 129-130.
92 R. Schnell, op. cit., p. 96.
93 Ibid., p. 86.
94 Brunetto Latini, op. cit., L. II, 72, 1-2, p. 494.
95 Ibid.
96 Comme le souligne Lynn White : L. White, op. cit., p. 189.
97 Voir la section consacrée à ce critère essentiel de l’émotion au Moyen Âge dans notre introduction, p. 38-48.
98 J.-C. Schmitt, op. cit., p. 31.
99 Ibid.
100 L. Smagghe, op. cit., p. 143.
101 D. Boquet et P. Nagy, op. cit., p. 16-17.
102 L. J. Friedman, « La Mesnie Faux Semblant : Homo interior =/= Homo exterior », French Forum, no 14, 1989, p. 435-445, ici p. 435 ; P. von Moos, op. cit., p. 136-137.
103 Thomas d’Aquin, Somme théologique, Paris/Tournai/Rome, Desclée et Cie, 1949, 1ae, 22, 3.
104 J. Le Goff et N. Truong, Une histoire du corps au Moyen Âge, Paris, Liana Levi, 2003, p. 13.
105 Ibid., p. 162.
106 C. Roussel, op. cit., p. 42.
107 J. Le Goff et N. Truong, op. cit., p. 39.
108 M. Porret, « Le corps et ses enjeux », dans Le corps violenté. Du geste à la parole, dir. M. Porret, Genève, Droz, 1998, p. 7-38, ici p. 15.
109 J.-C. Schmitt, op. cit., p. 40-42.
110 D. Boquet, « Corps et genre des émotions dans l’hagiographie féminine au xiiie siècle », Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, no 13, 2014, p. 2-10, ici p. 2.
111 Aldebrandin de Sienne, Le régime du corps, éd. L. Landouzy et R. Pépin, Paris, Champion, 1911, l. 1-14, p. 31.
112 C. Casagrande et S. Vecchio, « Clercs et jongleurs dans la société médiévale (xiie et xiiie siècles) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, no 34/5, 1979, p. 913-928, ici p. 916.
113 Voir en particulier les analyses de Jean-Claude Schmitt à ce sujet : J.-C. Schmitt, La raison des gestes dans l’Occident médiéval, Paris, Gallimard, 1990.
114 Pour rappel : D. Boquet et P. Nagy, op. cit., p. 153, cité p. 91.
115 D. L. Smail, « Emotions and Narrative Gestures in Medieval Narratives. The case of Raoul de Cambrai », Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, no 138, 2005, p. 34-38, ici p. 36.
116 B. H. Rosenwein, « Pouvoir et passion. Communautés émotionnelles en Francie au viie siècle », Annales. Histoire, Sciences sociales, no 6, 2003, p. 1271-1292, ici p. 1277.
117 L. Smagghe, op. cit., p. 38.
118 J. Dumolyn et É. Lecuppre-Desjardin, op. cit., p. 47.
119 P. von Moos, op. cit., p. 137.
120 Ibid., p. 137-138.
121 Voir les exposés de Lionel J. Friedman et de Rüdiger Schnell : L. J. Friedman, op. cit. et R. Schnell, op. cit.
122 Brunetto Latini, op. cit., L. II, 74, 3, p. 498.
123 G. Bolens, Le Style des gestes. Corporéité et kinésie dans le récit littéraire, Lausanne, BHMS, 2008, p. 30.
124 Ibid., p. 31.
125 Ibid., p. 108.
126 J. Eming, « Affektüberwältigung als Körperstil im höfischen Roman », dans Anima und sêle, op. cit., p. 249-262, ici p. 252.
127 Pour rappel : Thomas d’Aquin, op. cit., 1ae, 22, 3, cité p. 118 et Richard de Saint-Victor, op. cit., chap. 7, l. 6-9, cité p. 103.
128 D. Demartini, « “Quant je ouÿ la voix courir…”. Mesdire dans le Livre du duc des vrais amants de Christine de Pizan », dans Aimer, haïr, menacer, flatter… en moyen français, dir. J. Härmä et E. Suomela-Härmä, Paris, Champion, 2017, p. 41-52, ici p. 48-49.
129 M. Porret, op. cit., p. 15.
130 Ibid., p. 16.
131 J. Eming, Emotion und Expression. Untersuchungen zu deutschen und französischen Liebes- und Abenteuerromanen des 12. bis 16. Jahrhunderts, Berlin, De Gruyter, 2007, p. 92.
132 J. Eming, « On Stage. Ritualized Emotions and Theatrically in Isolde’s Trial », MLN, no 124/3, 2009, p. 555-571, ici p. 564.
133 J. Bourke, « Fear and Anxiety : Writing about Emotion in Modern History », History Workshop Journal, no 55, 2003, p. 111-133, ici p. 123.
134 P. Pachet, « La honte, la rougeur », Sigilia, no 14, 2004.
135 J. Eming, « Affektüberwältigung als Körperstil im höfischen Roman », op. cit., p. 252.
136 J. Eming, Emotion und Expression, op. cit., p. 255.
137 Ibid., p. 259. Cette conception de l’expression émotionnelle fait écho aux théories développées par Guillemette Bolens autour du style des gestes, auquel elle s’est particulièrement consacrée dans son ouvrage de 2008 : G. Bolens, op. cit.
138 Pour rappel : Le Dictionnaire illustré latin-français de Félix Gaffiot, version en ligne consultée le 6 janvier 2018, cité p. 106.
139 Pour rappel : Brunetto Latini, op. cit., L. II, 61, 1-2, p. 464, cité p. 104 ou L. II, 74, 3, p. 498, cité p. 122.
140 Nous adaptons ici les constatations de Hervé Martin : H. Martin, Mentalités médiévales II. Représentations collectives du xie au xve siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, p. 45-90.
141 D. Boquet, « Corps et genre des émotions dans l’hagiographie féminine au xiiie siècle », op. cit., p. 5.
142 L. Smagghe, op. cit., p. 411-413.
143 D. Boquet et P. Nagy, op. cit., p. 16-17.
144 Voir L. J. Friedman, op. cit., p. 435 ou P. von Moos, op. cit.
145 G. L. Ebersole, « The function of ritual weeping revisited : affective expressio and morale discourse », History of religions, no 39/3, 2000, p. 221-246, ici p. 224.
146 C. Roussel, op. cit., p. 1-2.
147 C. S. Jaeger, op. cit., p. 3.
148 C. Roussel, op. cit., p. 1-2.
149 C. S. Jaeger, op. cit., p. 14.
150 Ibid., p. 233.
151 Christine de Pizan, op. cit., 2, l. 1-7, p. 202.
152 Pour rappel : Brunetto Latini, op. cit., L. II, 72, 1-2, p. 494, cité p. 116.
153 Nous reviendrons sur cette œuvre révélatrice du mouvement de mise en scène de la codification amoureuse.
154 L. K. Little, « Anger in monastic curses », dans Anger’s past. The social uses of an emotion in the Middle Ages, dir. B. H. Rosenwein, Ithaca/Londres, Cornell University Press, 1998, p. 9-35, ici p. 33.
155 M. Senellart, op. cit., p. 84.
156 P. von Moos, op. cit., p. 131.
157 R. Schnell, op. cit., p. 103.
158 M. Aurell, op. cit., p. 329.
159 Pour rappel, par exemple : Aldebrandin de Sienne, op. cit., l. 1-14, p. 31, cité p. 119.
160 D. Boquet, L’ordre de l’affect au Moyen Âge, op. cit., p. 230.
161 C. Roussel, op. cit., p. 6-7.
162 Nous aurons l’occasion de l’étudier de bien plus près dans la suite de nos analyses consacrées au corpus qui suit le texte, pivot dans notre compréhension du jeu des émotions, du Roman de la Rose, mais nous souhaitions déjà citer ce passage si significatif de l’idéal de garde.
163 Pour rappel : Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 6 janvier 2018 et Dictionnaire du Moyen Français, version en ligne consultée le 6 janvier 2018, cités p. 107.
164 Guillaume de Diguleville, Le Livre du pèlerin de vie humaine, éd. et trad. G. R. Edwards et P. Maupeu, Paris, Le Livre de Poche, 2015, v. 5 203-5 726 et particulièrement v. 5 379-5 520.
165 Nous y reviendrons d’ailleurs dans le courant de notre analyse des composantes courtoises de la garde, p. 155.
166 Lancelot du Lac, éd. E. Kennedy et trad. F. Mosès, Paris, Le Livre de Poche, 1991 (2e édition), chap. 10, f. 17d, p. 166.
167 Ibid., juste auparavant : « “Dame, dame, fait li preuzdom, certes, il a assez raison en vostre duel, car assez et trop avez perdu, et non mie vos seulement, mais maintes autres genz qui i avront de granz dommages.” »
168 Ibid.
169 Nous aurons l’occasion de revenir sur l’importance des rituels religieux, dans lesquels peut aussi s’immiscer le jeu des émotions, tel qu’en témoigne Renart.
170 Une fois encore, voir au chapitre précédent : Le Roman de Renart, op. cit., cité p. 66.
171 B. Librová, « Une contribution à la description lexicologique des locutions françaises médiévales : Confession Renart », Études Romanes de Brno, no 26, 2005, p. 61-75.
172 Voir notamment le conte très éloquent de cette pratique dans le Chevalier au Barisel, qui cite d’ailleurs lui-même la formule de « confession Regnart ». Le Chevalier au Barisel. Conte pieux du xiiie siècle, éd. F. Lecoy, Paris, Champion, 1955, v. 134.
173 Ibid.
174 Le Roman de Renart, éd. J. Dufournet et A. Méline, Paris, Flammarion, 1985, t. 2, branche X, v. 389-396, p. 212.
175 Ibid., t. 1, branche I, v. 1 017-1 104, p. 94.
176 Ibid., t. 2, branche VII, v. 309-798, p. 24-48.
177 Ibid., t. 2, branche VII, v. 777-798, p. 48.
178 Nous aurons l’occasion d’examiner plus en détails les critères et impératifs de la confession dans la suite de nos analyses.
179 La Queste del Saint Graal, éd. F. Bogdanow et trad. A. Berrie, Paris, Le Livre de Poche, 2006, 27, l. 19-22.
180 Ibid., 191, l. 19-23.
181 « “N’aiez doutance ne peeur, / Fait li gïux, por choze qu’oiez / Ne por merveille que tu voiez. / Ne te saingne por nule rien, / Car te commant et deffen bien, / Ne por rien nule qui t’apere / Ne reclaimme Dieu ne sa mere.” » Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre Dame, éd. F. Koenig, Genève, Droz, 1970, t. 1, I, M. 10, v. 304-310.
182 Ibid., t. 4, II, M. 29, v. 520-525.
183 J.-L. Benoit, « La bonne mort dans les Miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci et Le Gracial d’Adgar », dans La mort dans la littérature française du Moyen Âge, dir. J.-F. Kosta-Théfaine, Villers-Cotterêts, Ressouvenances, 2013, p. 193-217, ici p. 207-208.
184 Gautier de Coinci, op. cit., t. 3, II, ch. 9, v. 1 478-1 481.
185 Le Chevalier au Barisel déjà évoqué offre un exemple éclatant de l’importance conférée à l’investissement émotionnel au sein du rituel de pénitence. Voir par exemple Le Chevalier au Barisel, op. cit., v. 780-782.
186 J.-L. Benoit, Introduction à Cinq miracles de Notre-Dame, Paris, Champion, 2007, p. 37.
187 D. G. Denery II, Seeing and Being Seen in the Late Medieval World : Optics, Theology and Religious Life, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 28.
188 Gautier de Coinci, op. cit., t. 2, I, M. 11, v. 1 157-1 200, surtout v. 1 198.
189 Ibid., v. 1 158-1 162.
190 Ibid., v. 1 159-1 160.
191 Ibid., v. 1 182-1 184.
192 Ibid.
193 L’emphase mise sur le verbe faire pourrait rapprocher la réflexion de Gautier de Coinci de celle que formalisera Thomas d’Aquin sur le mensonge. Sa définition élargie dénonce en effet autant la rupture entre pensée et parole qu’entre pensée et acte, mis en lumière ici par ce verbe d’action. Voir Thomas d’Aquin, op. cit., q. 110, a. 1, s. 2, que nous citerons p. 441.
194 Gautier de Coinci, op. cit., t. 2, I, M. 11.
195 Ibid., v. 1 198-1 200. Jean de Meun jouera lui aussi de ce contraste entre intérieur et extérieur fondé sur une opposition de couleurs dans la description de Faux Semblant (« Et li lierres enz en la place / qui de traÿson ot la face, / blanche dehors, dedenz nercie, ». Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman de la Rose, éd. et trad. A. Strubel, Paris, Le Livre de Poche, 1992, v. 12 015-12 017, que nous citerons p. 306). La simplicité affichée semble elle aussi offrir un canon de la dénonciation de la papelardie, elle revient dans le portrait qu’en dresse Guillaume de Lorris (ibid., v. 407-417, voir p. 257), mais aussi dans la justification que donne Faux Semblant de sa dissimulation sous l’habit religieux (ibid., v. 11 010-11 026, cité p. 260).
196 Gautier de Coinci, op. cit., t. 2, I, M. 11, v. 1 198.
197 Ibid., v. 1 290, v. 1 291 et v. 1 301. Jean de Meun associera aussi ainsi Faux Semblant à l’Antéchrist dans un passage marquant de la critique portée contre les Frères Mendiants : « Je sui des vallez antecrist ».Guillaume de Lorris et Jean de Meun, op. cit., v. 11 717, cité p. 250.
198 Gautier de Coinci, op. cit., t. 2, I, M. 11, v. 1 306.
199 Ibid., v. 1 298 et v. 1 303.
200 Nous avons vu et verrons encore l’insistance portée sur leur menace dans la justification donnée des propres manipulations émotionnelles des amants.
201 Gautier de Coinci, op. cit., t. 2, I, M. 11, v. 1 302.
202 Ibid., v. 1 403-1 404. Jean de Meun se servira d’ailleurs aussi de cette association entre Renart et les pappelards au gré d’une rime célèbre : Guillaume de Lorris et Jean de Meun, op. cit., v. 11 527-11 528, cité p. 254.
203 Ibid., v. 1 405-1 406. La collusion avec les réflexions que Thomas d’Aquin mettra ensuite en exergue paraît explicite à ce niveau : la manipulation des actions, celle des gestes qui sont seulement affichés, en contradiction avec les actions réelles, semble dès lors aussi critiquée que celle des paroles (voir Thomas d’Aquin, op. cit., q. 110, a. 1, s. 2, que nous citerons p. 441).
204 Gautier de Coinci, op. cit., t. 1, I, M. 10, v. 1 849-1 884, en particulier v. 1 859-1 860, v. 1 863-1 864, v. 1 873-1 874, v. 1 867-1 868 et v. 1 853-1 854.
205 Ibid., v. 1 883-1 884.
206 Ibid., v. 1 875.
207 Ibid., v. 1 851-1 852.
208 Ibid., v. 1 866, v. 1 861, v. 1 878, v. 1 873, v. 1 876 et v. 1 869. La place accordée à l’habit dans cette dénonciation des pratiques dissimulatrices se révèle dans l’accumulation des références qu’y propose Gautier de Coinci. Elle gagnera tout autant en importance, la plupart de ces références irriguant les épisodes de dénonciation de l’hypocrisie. Le voile se retrouve au cœur de la définition même de Fauvel (Le Roman de Fauvel, éd. et trad. A. Strubel, Paris, Le Livre de Poche, 2012, v. 229-242, que nous citerons p. 454), la haire dans l’opposition aux actions vides du sens que serait censé investir cet habit dans le Liber Fortunae (Liber Fortunae, éd. J. L. Grigsby, Berkeley / Los Angeles, University of California Press, 1967, v. 794-828, que nous citerons p. 477). Quant au vice de papelardie et aux apparences de marmite, elles se trouveront incarnées dans l’Image de Guillaume de Lorris (Guillaume de Lorris et Jean de Meun, op. cit., v. 407-417, déjà évoqué ci-dessus p. 142).
209 Pareille association, si elle s’avère fort significative et influente, ne va pas pour autant de soi. Hélinand de Froidmont, certes inscrit dans une dynamique satirique autre que celle de Gautier de Coinci, mais à la même époque environ, se concentre davantage sur les vices d’orgueil et d’avarice que d’hypocrisie. Cela nous paraît justifier l’intérêt que nous avons trouvé à interroger l’œuvre de Gautier de Coinci, révélatrice d’une concentration sur la critique hypocrite avant même que ne survienne l’ombre de Faux Semblant.
210 Gautier de Coinci, op. cit., t. 4, II, M. 29, v. 326-333.
211 Pareille tension entre amour et chapelle peut faire écho à celle que dessinait aussi le Lai de Désiré. Le même schéma s’y trouvait inversé : le jeune homme trahissait le serment fait à sa dame en dévoilant le secret de leur amour à un moine. Voir Lai de Désiré, dans Lais Bretons (xiie-xiiie siècles) : Marie de France et ses contemporains, éd. et trad. N. Koble et M. Séguy, Paris, Champion, 2011, p. 638-695.
212 Le miracle Du secrestain que Nostre Dame visita est lui aussi représentatif de cette dynamique du justification. Gautier de Coinci y oppose, dans un univers uniquement religieux ici, les chants hauts du couvent et les larmes discrètes, et tendres, du sacristain, jouant ainsi de la valorisation de la tendresse dans l’investissement dévotionnel. Voir Gautier de Coinci, op. cit., t. 3, I, M. 31, v. 189-191.
213 La formule est de C. Stephen Jaeger : C. S. Jaeger, op. cit., p. 174, que nous citons plus bas.
214 Pour rappel : D. Boquet et P. Nagy, op. cit., p. 11 ou p. 48 par exemple, cité p. 71.
215 B. H. Rosenwein, « Pouvoir et passion », op. cit., p. 1285-1286.
216 C. S. Jaeger, op. cit., p. 13.
217 Ibid., p. 158.
218 Ibid., p. 174.
219 Ibid., p. 14.
220 Ibid., p. 127.
221 D. Largogette, « Mots doux et insultes en moyen français, de la politesse à la transgression », dans Aimer, haïr, menacer, flatter, op. cit., p. 113-139, ici p. 113.
222 M. Guay, op. cit., p. 98.
223 Ibid., p. 111.
224 B. H. Rosenwein, « Controlling Paradigms », dans Anger’s past, op. cit., p. 233-247, ici p. 233.
225 D. Boquet et P. Nagy, op. cit., p. 77.
226 Ibid.
227 D. Boquet et P. Nagy, « L’historien et les émotions en politique : entre science et citoyenneté », dans Politiques des émotions au Moyen Âge, op. cit., p. 5-30, ici p. 14.
228 P. von Moos, op. cit., p. 139.
229 Pour rappel : Li livres du gouvernement des rois, op. cit., III, ii, l. 22-31, p. 97, cité p. 115.
230 Lancelot du Lac III. La fausse Guenièvre, éd. et trad. F. Mosès et L. Le Guay, Paris, Le Livre de Poche, 1998, chap. 10, f. 59vb, p. 326.
231 L. Smagghe, op. cit., p. 22.
232 Voir les épisodes de garde plus proprement amoureuse dont fait aussi preuve Arthur. Voir p. 197-198.
233 J. Dumolyn et É. Lecuppre-Desjardin, op. cit., p. 56.
234 M. Aurell, op. cit., p. 39.
235 G. Althoff, « Ira regis : prolegomena to a history of royal anger », dans Anger’s past, op. cit., p. 59-74, ici p. 60-61.
236 J. Dumolyn et É. Lecuppre-Desjardin, op. cit., p. 55 et P. Nash, « Reality and Ritual in the Medieval King’s Emotions of Ira and Clementia », dans Understanding Emotions in Early Europe, dir. M. Champion et A. Lynch, Turnhout, Brepols, 2015, p. 251-272, ici p. 256.
237 D. Boquet et P. Nagy, « L’historien et les émotions en politique », op. cit., p. 3-4.
238 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 229-230.
239 Ibid., p. 251.
240 Ibid., p. 309.
241 Ibid., p. 152.
242 Voir l’analyse dédiée au corpus tristanien dans le chapitre précédent, p. 77-91.
243 Pour rappel : Le Roman de Tristan en Prose, éd. R. Curtis, t. 2, Leiden, Brill, 1976, p. 135, cité p. 89.
244 Pour rappel : La grant ystoire de Monsignor Tristan Li Bret, the First Part of the Prose Romance of Tristan, from Ashb. ms. 19, 1, 3 in the National Library of Scotland, éd. F. C. Johnson, Édimbourg, Oliver & Boyd, 1942, 35, p. 47, cité p. 89.
245 Pour rappel : Le Roman de Tristan en Prose, éd. R. Curtis, t. 2, Leiden, Brill, 1976, p. 91, cité p. 89.
246 Ibid.
247 B. Rimé, « Les émotions médiévales : réflexions psychologiques », dans Politiques des émotions au Moyen Âge, op. cit., p. 309-332, ici p. 320.
248 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 153.
249 B. Grigoriu, Actes d’émotion, pactes d’initiation : le spectre des fabliaux, Craiova, Editura universitaria, 2015, p. 94.
250 M. Aurell, op. cit., p. 320.
251 Ibid., p. 319. Nous nous plaisons à lire ici une forme de justification de l’étiquette de garde que nous avons choisie d’accoler à l’ensemble de l’émotionologie médiévale. Le sémantisme même du terme garde touchait en effet déjà à cet enjeu de surveillance. Pour rappel : Le Trésor de la Langue Française, version en ligne consultée le 6 janvier 2018, cité p. 105.
252 M. Aurell, op. cit., p. 319.
253 Pour rappel : Brunetto Latini, L. II, 62, 1-2, p. 466-468, cité en note de bas de page p. 104-105.
254 Lancelot du Lac II, éd. E. Kennedy et trad. M.-L. Chênerie, Paris, Le Livre de Poche, 1993, chap. 70, f. 181c, p. 646.
255 D. Regnier-Bohler, « L’honneur des femmes et le regard public : l’accusé et son juge. Une étude de cas : Le livre du Chevalier de la Tour Landry (1371) », dans Das Öffentliche und Private in der Vormoderne, dir. G. Melville et P. von Moos, Cologne/Weimar/Vienne, Böhlau, 1998, p. 411-433, ici p. 415.
256 La même formule apparaissait pour Marc. Pour rappel : Le Roman de Tristan en Prose, op. cit., t. 2, p. 91, cité p. 89.
257 N. Nabert, « Christine de Pizan, Jean Gerson et le gouvernement des âmes », dans « Au champ des escriptures ». IIIe colloque international sur Christine de Pizan (Lausanne, 18-22 juillet 1998), dir. É. Hicks, D. Gonzalez et P. Simon, Paris, Champion, 2000, p. 251-268, ici p. 260.
258 C. Stephen Jaeger insiste en particulier sur cette composante importante de l’émotionologie médiévale. Pour rappel : C. S. Jaeger, op. cit., p. 129-130, cité p. 116.
259 Selon la célébration faite par Homère de la furor guerrière notamment.
260 Selon l’épisode célèbre de la colère violente de Lancelot, corrigée par celle, feinte, de la Dame du Lac pour l’inciter à mieux la contenir : Lancelot du Lac, op. cit., p. 154-156. Nous nous permettons de renvoyer à l’article que nous avions consacré notamment à cet exemple révélateur de la pédagogie émotionnelle fondée sur la garde : C. Carnaille, « Du contrôle des émotions : entre préservation du corps, moralité et enjeux chevaleresques », dans « Entre le cœur et le diaphragme ». (D)écrire les émotions dans la littérature narrative et scientifique du Moyen Âge, dir. C. Baker, M. Cavagna et G. Clesse, Louvain-la-Neuve, Presses de l’Université catholique de Louvain, 2018, p. 153-168.
261 Li livres du gouvernement des rois, op. cit., III, vii, l. 18-28, p. 111.
262 Ibid., II, xxviii, p. 83 l. 33-p. 84 l. 11.
263 Thomas d’Aquin, op. cit., 1ae-2ae, q. 46, 7.
264 Une fois encore, pour rappel : Le Dictionnaire illustré latin-français de Félix Gaffiot, version en ligne consultée le 6 janvier 2018, cité p. 106. Son étymologie renvoie d’ailleurs à la tempérance de la noblesse, de manière significative dans ce code de conduite émotionnel.
265 Nous nous permettons de renvoyer ici aussi à l’article que nous avons consacré à tous ces épisodes démonstratifs de l’importance de la garde émotionnelle, dans la veine tant chevaleresque qu’épique : C. Carnaille, op. cit.
266 Lancelot du Lac II, op. cit., chap. 70, f. 181a, p. 642-644.
267 Pour rappel : La Queste del Saint Graal, op. cit., 27, l. 19-22, p. 12, déjà cité p. 137.
268 L. Smagghe, op. cit., p. 143.
269 L. Rouillard, « “Faux semblant ou faire semblant ?” Christine de Pizan and virtuous artifice », Forum for Modern Language Studies, no 46/1, 2009, p. 16-28, ici p. 18.
270 Ibid., p. 17.
271 Comme le souligne également Dominique Demartini : D. Demartini, op. cit., p. 48.
272 Nous nous y arrêterons surtout dans le dernier chapitre de nos analyses, dédié au traitement du jeu des émotions par Christine de Pizan.
273 Christine de Pizan, Le Livre des trois Vertus, éd. É. Hicks et C. C. Williard, Paris, Champion, 1989, I, chap. 25, l. 124-128.
274 Pour rappel : Dictionnaire du Moyen Français, version en ligne consultée le 6 janvier 2018, cité p. 106.
275 Pour rappel, voir les appels à la mesure de Brunetto Latini, mais aussi la définition donnée par le Dictionnaire du Moyen Français de la modération que semble viser Christine de Pizan : Brunetto Latini, op. cit., L. II, 61, 1-2, p. 464 et L. II, 62, 1-2, p. 466-468, cités p. 104 et p. 104-105 ; Dictionnaire du Moyen Français, version en ligne consultée le 6 janvier 2018, cité p. 106.
276 Pour rappel : Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 6 janvier 2018, cité p. 106.
277 Lancelot du Lac IV. Le val des amants infidèles, éd. Y. Lepage et trad. M.-L. Ollier, Paris, Le Livre de Poche, 2002, chap. 33, f. 50a, p. 396.
278 Dans les cas exemplaires de Lionel (Lancelot du Lac, op. cit., p. 192, f. 19c), de Gauvain dans les derniers épisodes du Lancelot Graal (La Mort le Roi Arthur, éd. et trad. D. Hult, Paris, Le Livre de Poche, 2009, dès la page 528 qui marque le deuil de Gauvain jusqu’à la page 788 qui relate sa mort, avec une exacerbation particulière dans le passage décrivant la préparation au duel que réclame et mène Gauvain contre Lancelot (p. 686-744)), ou encore de Raoul de Cambrai (Raoul de Cambrai, éd. S. Kay et trad. W. Kibler, Paris, Le Livre de Poche, 1996, par exemple CIV, v. 1 924 ; CIX, v. 2 033 ; XXIV, v. 320-323 ; LVII, v. 1 012-1 026). Nous renvoyons une fois encore à l’article dans lequel nous nous sommes dédiée à l’analyse de ces épisodes : C. Carnaille, op. cit.
279 En particulier chez Brunet Latin, pour rappel : Brunetto Latini, op. cit., L. II, 72, 1-2, p. 494, cité p. 104, selon la remarque de Lynn White : L. White, op. cit., p. 189, cité p. 117.
280 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 161.
281 C. Roussel, op. cit., p. 66. On le trouve d’ailleurs dans le passage évoqué de Drouart la Vache, en particulier v. 4 578.
282 I. Coumert, « “Si ceste amur esteit seüe…”. L’obligation du secret dans la fin’amor (xiie-xiiie siècles) », Questes, no 16, 2009, p. 51-63, ici p. 56.
283 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 11.
284 B. Grigoriu, Talent/Maltalent. Émotionologies liminaires de la littérature française, Craiova, Editura universitaria, 2012, p. 18.
285 J. Batany, Approches du Roman de la Rose, Paris/Bruxelles/Montréal, Bordas, 1973, p. 15.
286 M. Guay, op. cit., p. 93.
287 R. Schnell, « L’amour courtois en tant que discours courtois sur l’amour (I) », Romania, no 110/437-438, 1989, p. 72-126, ici p. 80.
288 Comme le rappelle Peter L. Allen, la littérature médiévale ne se veut pas le reflet d’une réalité historique, mais celui des idéaux et des désirs de son temps. Voir P. L. Allen, The Art of Love : Amatory Fiction from Ovid to the Romance of the Rose, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1992, p. 49.
289 Comme le souligne en particulier Gérard Le Gros, cité en introduction à ce sujet. Pour rappel : G. Le Vot, « Réalités et figures : la plainte, la joie et la colère dans le chant aux xiie et xiiie siècles », Cahiers de civilisation médiévale, no 184, 2003, p. 353-380, ici p. 366, cité p. 51.
290 M. Gally, L’intelligence de l’amour d’Ovide à Dante. Arts d’aimer et poésie au Moyen Âge, Paris, CNRS, 2005, p. 8.
291 D. Lechat, « La place du sentement dans l’expérience lyrique aux xive et xve siècles », PerspectivesMédiévales, no 28, 2002, p. 193-207, ici p. 206.
292 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 181.
293 J. Cerquiglini, « Une parole muette : le rire amoureux au Moyen Âge », dans Miscellanea Mediaevalia. Mélanges offerts à Philippe Ménard, dir. C. Faucon, A. Labbé et D. Quéruel, Paris, Champion, 1998, p. 325-336, ici p. 326.
294 A. Lynch, « Guinevere as “Social Person” : Emotion and Community in Chrétien de Troyes », dans Understanding Emotions in Early Europe, dir. M. Champion et A. Lynch, Turnhout, Brepols, 2015, p. 151-170, ici p. 154.
295 Comme le soulignent encore Damien Boquet et Piroska Nagy, mais aussi Sif Ríkharðsdóttir : D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 181 et S. Ríkharðsdóttir, Emotion in Old Norse Literature. Translations, Voices, Contexts, Cambridge, D. S. Brewer, 2017, p. 177.
296 M. Aurell, op. cit., p. 365.
297 C. S. Jaeger et J.-F. Sené, « L’amour des rois : structure sociale d’une forme de sensibilité aristocratique », Annales. Histoire, Sciences Sociales, no 46/3, 1991, p. 547-571, ici p. 550-552.
298 S. Crane, The Performance of Self. Ritual, Clothing, and Identity during the Hundred Years War, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2002, p. 3.
299 G. Duby, Mâle Moyen Âge. De l’amour et autres essais, Paris, Flammarion, 1988, p. 47.
300 M. Grodet, « “Par bel mentir”. Mensonges et vérités ambigües en amour dans les récits courtois des xiie et xiiie siècles », Perspectives médiévales, no 35, 2014, p. 1-7, ici p. 5.
301 J. Batany, op. cit., p. 101.
302 C. Marchello-Nizia, « Amour courtois, société masculine et figures du pouvoir », Annales. Économies, sociétés, civilisations, no 36/6, 1981, p. 969-982, ici p. 981.
303 C. Saunders, « Mind, body and affect in Medieval English Arthurian romance », dans Emotions in medieval Arthurian literature, op. cit., p. 31-46, ici p. 36.
304 M. Gally, op. cit., p. 13.
305 Pour rappel : R. Schnell, op. cit., p. 80, cité p. 162.
306 F. Le Nan, Le secret dans la littérature narrative arthurienne (1150-1250). « Du lexique au motif », Paris, Champion, 2002, p. 395.
307 Ibid., p. 399.
308 Pour rappel : notion définie par P. Salovey et J. Mayer, cités par Brînduşa Grigoriu : B. Grigoriu, Actes d’émotion, pactes d’initiation, op. cit., p. 100, cité p. 23.
309 T. Hunt, « The Art of Concealment : La Châtelaine de Vergi », French Studies, no XLVII/2, 1993, p. 129-141, ici p. 129.
310 I. Coumert, « “Si ceste amur esteit seüe…”. L’obligation du secret dans la fin’amor (xiie-xiiie siècles) », Questes, no 16, 2009, p. 51-63, ici p. 51.
311 T. Hunt, op. cit., p. 131.
312 « Secret » vient du latin secretum : lieu écarté, pensée ou fait à ne pas révéler, comme le rappelle Frédérique Le Nan : F. Le Nan, op. cit., p. 21.
313 I. Coumert, op. cit., p. 55-61.
314 Ibid., p. 56.
315 Ibid., p. 61.
316 F. Le Nan, op. cit., p. 61.
317 Ibid., p. 395.
318 Ibid., p. 397.
319 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 182-185.
320 F. Le Nan, op. cit., p. 69.
321 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 183.
322 L. Verdon, « La course des amants adultères. Honte, pudeur et justice dans l’Europe méridionale du xiiie siècle », Rives méditerranéennes, no 31, 2008, p. 57-72, ici p. 60.
323 A. M. Rasmussen, « Emotions, Gender, and Lordship in Medieval Literature : Clovis’s Grief, Tristan’s Anger, and Kriemhild’s Restless Corpse », dans Codierung von Emotionen im Mittelalter, dir. C. S. Jaeger et I. Kasten, Berlin, De Gruyter, 2003, p. 174-189, ici p. 185-186.
324 Selon l’analyse de W. Frenzen, citée par Elke Koch : E. Koch, « Inzenierungen von Trauer, Körper und Geschlecht im Parzival Wolframs von Eschenbach », dans Codierung von Emotionen im Mittelalter, op. cit., p. 143-158, ici p. 145.
325 Nous remercions notre directrice de thèse, la professeure Yasmina Foehr-Janssens, pour cette remarque très juste pour nuancer encore la répartition de genre dans les codes émotionnels amoureux.
326 K. Dybel, Être heureux au Moyen Âge d’après le roman arthurien en prose du xiiie siècle, Louvain, Peeters, 2004, p. 117.
327 S. Ríkharðsdóttir, op. cit., p. 126.
328 A. M. Rasmussen, op. cit., p. 186.
329 Y. Foehr-Janssens, « Le genre du désir dans le Lancelot en prose », dans Sens, Rhétorique et Musique. Études réunies en hommage à Jacqueline Cerquiglini-Toulet, dir. S. Albert, M. Demaules, E. Doudet, S. Lefèvre, C. Lucken et A. Sultan, Paris, Champion, 2015, p. 587-601, ici p. 590.
330 I. Coumert, op. cit., p. 57.
331 Sif Ríkharðsdóttir souligne le rôle capital endossé par l’honneur comme force motrice du comportement émotionnel, dans toute la diversité du corpus qu’elle interroge : S. Ríkharðsdóttir, op. cit., p. 62-63.
332 Voir notamment D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 184.
333 Comme le démontre Brînduşa Grigoriu : B. Grigoriu, Amor sans desonor : une pragmatique pour Tristan et Yseut, Craiova, Editura universitaria, 2013, p. 26 et p. 77.
334 J. Eming, Emotionen im « Tristan ». Untersuchungen zu ihrer Paradigmatik, Göttingen, V&R Unipress, 2015, p. 75-80.
335 Nous pourrons en trouver un exemple remarquable dans l’Orloge amoureus de Jean Froissart.
336 S. Ríkharðsdóttir, op. cit., p. 60 et p. 77.
337 J. Eming, « On Stage. Ritualized Emotions and Theatrically in Isolde’s Trial », MLN, no 124/3, 2009, p. 555-571, ici p. 558.
338 Comme le souligne notamment Danielle Bohler : D. Bohler, « Civilités langagières : le bon taire ou le parler hastif. Brèves réflexions sur la fonction sociale et symbolique du langage », dans Norm und Krise von Kommunikation. Inszenierungen literarischer und sozialer Interaktion im Mittelalter. Für Peter Moos, dir. A. Hahn, G. Melville et W. Röcke, Berlin, Lit, 2006, p. 115-133, ici p. 121.
339 Ceci en raison de cette impression d’authenticité que laisse le corps, voir p. 125, ou encore p. 211.
340 N. Pancer, « Entre lapsus corporis et performance : fonctions des gestes somatiques dans l’expression des émotions dans la littérature altimédiévale », Médiévales, no 61, 2011, p. 39-54, ici p. 44.
341 Comme le rappelle en particulier Thomas H. Bestul : T. H. Bestul, « True and false cheere in Chaucer’s Clerk’s Tale », Journal of English and German Philology, no 82/4, 1983, p. 500-514.
342 G. Bolens, « La narration des émotions et la réactivité du destinataire dans Les Contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer », Médiévales, no 61, 2011, p. 97-118, ici p. 97.
343 Selon une observation consacrée aux déclarations politiques qui nous paraît aisément pouvoir être extrapolée et dédiée à la sphère amoureuse. C. S. Jaeger et J.-F. Sené, op. cit., p. 552.
344 S. G. Nichols, « Deflections of the body in the Old French lay », Stanford French Review, no 14, 1990, p. 27-50, ici p. 39.
345 N. Kremer, « Tout feu, tout flammes : le désir du corps féminin », dans Le Corps romanesque. Images et usages topiques sous l’Ancien Régime, dir. L. Desjardins, M. Moser-Verrey et C. Turbide, Québec, Les Presses Universitaires de Laval, 2009, p. 267-284, ici p. 267.
346 S. G. Nichols, op. cit., p. 39.
347 C. Bouillot, « Aux antipodes du beau geste : le geste laid et inconvenant dans la littérature des xiie et xiiie siècles », dans Le beau et le laid au Moyen Âge, Aix-en-Provence, CUERMA, 2000, p. 45-56, ici p. 45.
348 Comme le souligne Jutta Eming, dans une prise en compte intéressante des stratégies qui peuvent entourer la manifestation émotionnelle, mais cependant de manière encore fort partielle seulement puisque la manipulation de l’expression émotionnelle elle-même n’y est pas intégrée : J. Eming, Emotion und Expression. Untersuchungen zu deutschen und französischen Liebes- und Abenteuerromanen des 12. bis 16. Jahrhunderts, Berlin, De Gruyter, 2007, p. 284.
349 C’est encore le cas de Rüdiger Schnell : R. Schnell, op. cit., p. 78.
350 Armand Strubel insiste en particulier sur la volonté d’apprentissage qu’ils cristallisent par ce biais : A. Strubel, op. cit., p. 129.
351 M. Gally, op. cit., p. 7.
352 P. L. Allen, op. cit., p. 48.
353 A. Farber, Ethical Reading and the Medieval Artes Amandi : the Rise of the Didactic in Andreas Capellanus, Jean de Meun, and John Gower, thèse de doctorat, Philadelphie, Université de Pennsylvannie, 2011, p. 23.
354 Peter L. Allen souligne tout l’intérêt de sa démonstration de l’illusion d’amour, ou du moins de la nature conventionnalisée de la sincérité qui y est prescrite : P. L. Allen, op. cit., p. 4. Ceci éclaire bien sûr la tension que nous pourrons constater entre la tromperie mise en lumière dans les traités d’amour et les conventions de sincérité qui marquent au contraire la poésie et la fiction amoureuse.
355 Ibid., p. 11. Ceci rapprocherait en effet la démarche de Jean de Meun de celle d’Ovide lui-même. Ils livrent en outre tous deux un art d’aimer teinté d’ironie quant à l’idéalisation qui y est proposée. Armand Strubel note d’ailleurs que la réception médiévale d’Ovide ne fait pas l’impasse sur les aspects les plus cyniques de l’Ars amatoria, longtemps ignorés par la critique. Voir A. Strubel, « L’apprentissage de la passion », dans L’Art d’aimer au Moyen Âge, dir. M. Cazenave, D. Poirion, A. Strubel et M. Zink, Paris, Philippe Lebaud, 1997, p. 125-184, ici p. 133. De manière intéressante, l’ironie devient elle-même stratégie pour résoudre les contradictions perçues dans l’éthique amoureuse ovidienne dans les adaptations médiévales qui en sont données. Voir à ce sujet A. Farber, op. cit., p. 23.
356 Qu’il convient d’ailleurs d’éclairer, dans une certaine mesure, à l’aune de l’adresse purement masculine d’Ovide et des critiques à l’encontre des femmes qu’elle induit.
357 M. Gally, op. cit., p. 50.
358 K. Dybel, op. cit., p. 108.
359 M. Grodet, op. cit., p. 4.
360 M. Gally, op. cit., p. 43. Peter L. Allen souligne également que les efforts de christianisation concentrent dans une large mesure la volonté d’adaptation des arts d’aimer médiévaux. Voir P. L. Allen, op. cit., p. 59.
361 M. Zink, « Un nouvel art d’aimer », dans L’Art d’aimer au Moyen Âge, op. cit., p. 7-70, ici p. 22.
362 A. Strubel, op. cit., p. 133.
363 M. Gally, op. cit., p. 42.
364 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 159.
365 J. Batany, op. cit., p. 15.
366 A. Strubel, op. cit., p. 136.
367 Comme l’a bien démontré Lucas Wood : L. Wood, « The Art of Clerkly Love : Drouart la Vache Translates Andreas Capellanus », Medievalia et Humanistica, no 40, 2015, p. 113-149.
368 Drouart La Vache, Li Livres d’Amours, éd. R. Bossuat, Paris, Champion, 1926, v. 657-659.
369 Comme le défendait Isabelle Coumert. Pour rappel : I. Coumert, op. cit., p. 61, cité p. 166.
370 Drouart La Vache, op. cit.,v. 4 574-4 582.
371 Ibid., v. 3 413-3 420.
372 Ibid., v. 4 617-4 626.
373 Ibid.,v. 4 999-5 001.
374 Pour rappel, voir l’analyse dédiée à l’impératif de bienséance dans notre analyse de la garde : p. 147-170.
375 Drouart La Vache, op. cit., v. 4 983-4 988.
376 Pour rappel : ibid., v. 3 417, cité p. 175.
377 Complément au Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 8 octobre 2020.
378 Drouart La Vache, op. cit., v. 5 670-5 677.
379 Ibid., v. 4 314-4 319.
380 Cet esprit rusé prêté aux femmes dans des termes aussi familiers, et pour les mêmes motifs intéressés, se retrouve également dans les conseils de la Vieille du Roman de la Rose. Voir Guillaume de Lorris et Jean de Meun, op. cit., v. 13 799-13 803 ou v. 13 827-13 828, cités au chapitre suivant p. 321.
381 Pour rappel : Drouart La Vache, op. cit., v. 4 617-4 626, cité p. 175.
382 L. Wood, op. cit., p. 115.
383 Cela nous semble conférer plus d’intérêt encore à l’analyse que nous dédierons aux manuels de comportement destinés aux femmes dans le chapitre que nous consacrerons à l’œuvre de Christine de Pizan.
384 J.-P. Cavaillé, Dis/simulations : Jules-César Vanini, François La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, Louis Machon et Torquato Accetto. Religion, morale et politique au xviie siècle, Paris, Champion, 2008, p. 22.
385 Jean Froissart, L’orloge amoureus, éd. P. F. Dembowski, Genève, Droz, 1986, v. 19-25.
386 Julie Singer souligne en effet le caractère tout à fait traditionnel de Froissart dans sa représentation des conventions allégoriques amoureuses : J. Singer, « L’horlogerie et la mécanique de l’allégorie chez Jean Froissart », Médiévales, no 49, 2005, p. 155-172, ici p. 159.
387 Ibid., p. 160.
388 Pour rappel : Christine de Pizan, Epistre Othea, op. cit., 2, l. 32-41, p. 203, cité p. 113.
389 Jean Froissart, op. cit., v. 223.
390 Ibid., v. 212-220.
391 Ibid., v. 340-346.
392 Cette association était révélée déjà par la définition donnée par le Dictionnaire de Godefroy du concept de garde. Pour rappel : Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 6 janvier 2018, cité p. 106.
393 Voir encore ibid., v. 978 et v. 1 042-1 046.
394 Ibid., v. 649-658.
395 Évrart de Conty, Le Livre des Eschez amoureux moralisés, éd. F. Guichard-Tesson et B. Roy, Montréal, CERES, 1993, f. 165v42, p. 441.
396 Ibid., f. 166r8, p. 442.
397 Ibid., f. 166r6-f. 166r8, p. 442.
398 Ibid., f. 223v30-f. 223v36, p. 607.
399 Ibid., f. 166r28-f. 166r30, p. 442.
400 J. Cerquiglini, op. cit., p. 182-184.
401 À titre d’exemple, peut-être plus anecdotique, mais qui nous semble révélateur de la portée de cette recommandation émotionnelle, on retrouve aussi cet appel à la sage discrétion des amants dans le corpus des Cent Nouvelles Nouvelles, pourtant plus propices à une forme d’esprit facétieux qu’à celui de la fin’amor. Voir la N81 qui met en scène un jeune homme éploré d’avoir été éconduit par son amie et qui s’attache cependant à dissimuler cette tristesse (« Comme sachant et gentil chevalier, il ne monstra pas ce que son pouvre cueur portoit » Les Cent Nouvelles Nouvelles, éd. F. Sweetser, Genève, Droz, 1996, N81, l. 109-111, p. 476) et insiste ainsi sur la sagesse et la bonne conduite d’une telle maîtrise émotionnelle, d’autant plus forte qu’elle opère une rupture avec le pouvre cueur du jeune homme qui endosse lui-même ces efforts ; ou encore la N26 (« Au fort, a l’heure qu’il se faillit monstrer, chacun s’efforça de faire aultre chere de semblant et de bouche que le desolé cueur ne faisoit » ibid., N26, l. 176-179, p. 168) qui laisse transparaître autant la force des émotions que de la garde, dans un nouveau jeu de contraste entre le cœur et le semblant, offrant ainsi accès par la mise en scène même de la manipulation des émotions à leur sincérité, inextinguible, quels que soient les dehors qui les recouvrent.
402 Guillaume de Lorris et Jean de Meun, op. cit., v. 2 267-2 274, que nous citons p. 282-283.
403 Voir l’ensemble du chapitre qui suit qui sera dédié à cette figure.
404 Nous pourrons nous y consacrer en particulier dans le chapitre dédié aux logiques amoureuses du jeu des émotions.
405 Voir par exemple : Martin le Franc, Le Champion des Dames, éd. R. Deschaux, Paris, Champion, 1999, III, mdcclxxv, v. 14 193-14 200, que nous citerons p. 424.
406 Une fois de plus, nous renvoyons pour cela au chapitre que nous consacrerons aux logiques amoureuses.
407 Martin le Franc, op. cit., I, cdlxviii, v. 3 737-3 740.
408 On peut noter la proximité en particulier avec la présentation donnée par Henri de Gauchy. Pour rappel : Li livres du gouvernement des rois, op. cit., II, v, p. 35 l. 31 – p. 36 l. 5, cité p. 114.
409 Martin le Franc, op. cit., I, lxxxiii, v. 657-664.
410 Pour rappel : Jean Froissart, op. cit., v. 340-346, cité p. 181.
411 Martin le Franc, op. cit., I, lxxviii, v. 618.
412 Pour rappel : Évrart de Conty, op. cit., f. 223v30-f. 223v36, p. 607, cité p. 182.
413 Martin le Franc, op. cit., I, ciii, v. 817.
414 Ibid., I, ciii, v. 821.
415 Ibid., I, ciii, v. 822.
416 C. Roussel, op. cit., p. 56.
417 Ibid., p. 60-66.
418 Damien Boquet et Piroska Nagy insistaient dans ce sens sur le lien tissé entre ordo monastique et fin’amor. Pour rappel : D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 11, cité p. 162.
419 Pour rappel, voir les analyses que nous y dédiions en préambule.
420 S. Ríkharðsdóttir, « Medieval Emotionality : The Feeling Subject in Medieval Literature », Comparative Literature, no 69/1, 2017, p. 74-90, ici p. 74.
421 Brigitte Burrichter a notamment démontré son utilisation, tout à fait particulière, des larmes comme technique narrative déployée dans des perspectives diverses : les larmes deviennent par son biais énigmatiques, ambigües, réprimées, traîtresses. Voir B. Burrichter, « Die Sprache der Tränen. Das narrative Potential des Weinens bei Chrétien de Troyes », dans Körperkonzepte im arthurischen Roman, dir. F. Wolfzettel, Tübingen, Niemeyer, 2007, p. 231-245, ici p. 231.
422 Anne Baden-Daintree et Andrew Lynch notent tous deux cette tendance du refus d’exprimer le chagrin dans Érec et Énide : A. Baden-Daintree, « Kingship and the Intimacy of Grief in the alliterative Morte Arthure », dans Emotions in medieval Arthurian Literature, op. cit., p. 87-104, ici p. 87 et A. Lynch, op. cit., p. 155.
423 Chrétien de Troyes, Cligès, éd. W. Foerster et trad. M. Rousse, Paris, Flammarion, 2006, v. 601-615.
424 « Mes Cligés par amor conduit / Vers li ses iauz covertemant / Et ramainne si sagemant / Quë a l’aler në au venir / Ne l’an puet an por fol tenir » Ibid., v. 2 800-2 804.
425 « Mout an fet tote nuit grant joie ; / Mes bien se garde qu’an nel voie » Ibid., v. 1 635-1 636.
426 Ibid., v. 2 114-2 126.
427 « Mout ot fet sospirs et sangloz / Au partir celez et coverz, / Qu’ains nus n’ot tant les iauz overz / Ne tant n’i oï cleremant / Qu’aparecevoir certainnemant / D’oïr ne de veoir seüst / Quë antre aus deus amor eüst » Ibid., v. 4 328-4 334.
428 Et particulièrement à sa composante volontiers adultère, si propice au culte du secret comme nous le soulignions en introduction. Cela a été mis en lumière par Gaston Paris (Romania, no 12, 1883, p. 459-534) et par Wendelin Foerster en introduction de l’édition qu’il offre du Chevalier de la Charrette (Halle, Niemeyer, 1899, p. lxviii).
429 Chrétien de Troyes, Cligès, op. cit., v. 2 988.
430 Ibid., v. 2 989.
431 « Et cez deux choses si l’ataingnent / Que mout la palissent et taingnent, / Si qu’an le voit tot an apert, / A la color quë ele pert, / Qu’ele n’a pas quanqu’ele viaut ; / Que mains jeue qu’ele ne siaut / Et mains rit et mains s’esbanoie. / Mes bien le cele et bien le noie / Se nus li demande qu’ele a. » Ibid., v. 2 993-3 001.
432 Chrétien de Troyes, Le Chevalier au Lion, éd. W. Foerster et trad. M. Rousse, Paris, Flammarion, 1990, v. 2 702-2 703.
433 Notons par ailleurs que cette expression fournit une troisième occurrence émotionnelle sur ces deux vers, dans un véritable fourmillement affectif. La peine ressentie est ainsi contrôlée avec peine par la honte de la laisser apparaître. Le jeu construit autour des émotions d’Yvain paraît presque saturé, pour mieux en souligner l’intensité.
434 Pour rappel : Chrétien de Troyes, Cligès, op. cit., v. 2 800, cité p. 189.
435 « De ceste chose li pesa, / Mais semblant faire n’en osa, / Car ses sire en mal le preïst / Assez tost, s’ele li deïst. » Chrétien de Troyes, Érec et Énide, éd. et trad. J.-M. Fritz, Paris, Le Livre de Poche, 1992, v. 2 465-2 468.
436 Ibid., v. 2 676-2 680.
437 Dans une inversion notable face au portrait dressé par Drouart la Vache des manipulations au sein du couple.
438 Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charrette ou le Roman de Lancelot, éd. et trad. C. Méla, Paris, Le Livre de Poche, 1992, v. 5 190-5 201.
439 La nuance entre Lancelot et Gauvain s’inscrit d’ailleurs dans un parallélisme constant entre ces deux personnages, qui conduit tout le récit en jeu ici. Il témoigne d’une réflexion obsessionnelle de la part de Chrétien de Troyes sur l’homosocialité, que révèlent ainsi également les jeux émotionnels de Guenièvre.
440 Nous profitons de cette analyse pour exprimer l’immensité de notre gratitude à notre collègue et amie chère, Prunelle Deleville, pour nous avoir suggéré cette belle hypothèse, en plus d’avoir tant contribué à l’avancement de ce travail.
441 Y. Foehr-Janssens, « Le genre du désir dans le Lancelot en prose », op. cit., p. 590.
442 Lancelot du Lac V. L ’ enlèvement de Guenièvre, éd. Y. Lepage et trad. M.-L. Ollier, Paris, Le Livre de Poche, 1999, 14, f. 82a, p. 218.
443 Pour rappel : Chrétien de Troyes, Cligès, op. cit., v. 2 114-2 126, cité p. 190.
444 Lancelot du Lac III, op. cit., VII, f. 42vb, p. 226.
445 Pour rappel : Chrétien de Troyes, Érec et Énide, op. cit., v. 2 465-2 468 et v. 2 676-2 680, cités p. 192.
446 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 166-167.
447 Lancelot du Lac III, op. cit., I, f. 7b, p. 74 ou I, f. 5b, p. 62.
448 Comme entre Guenièvre et Gauvain. Pour rappel par exemple : Lancelot du Lac V, op. cit., 14, f. 82a, p. 218, cité p. 194.
449 Lancelot du Lac III, op. cit., X, f. 60a, p. 328.
450 Lancelot du Lac II, op. cit., LXIX, f. 176a, p. 600.
451 Conformément au constat dressé par Mathilde Grodet : M. Grodet, op. cit., p. 5, cité p. 164.
452 La Mort le Roi Arthur, op. cit., § 115, l. 2-3.
453 Lancelot du Lac III, op. cit., X, f. 59a, p. 322.
454 Citons par exemple encore l’épisode des retrouvailles d’Arthur avec la véritable Guenièvre, marquées par les mêmes efforts de retenue et de manifestation émotionnelle bienséante de la part du roi : « Quant li rois les encontra, si fu grant la joie que il fist de Galehot et de la roine meesme, et neporquant si n’avoit il pas oblié le doel de l’autre, mais il s’efforça de bel semblant faire por ses genz » Ibid., X, f. 59b, p. 326.
455 Pour rappel, voir par exemple les épisodes de considération de Gauvain, cités p. 192-193 et p. 194.
456 Lancelot du Lac V, op. cit., 22, f. 89d, p. 268.
457 Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charrette, op. cit., v. 6 842-6 853.
458 Pour rappel, voir l’extrait cité p. 189.
459 Le débat avec Raison fait lui aussi partie des classiques de la tradition de l’amour courtois, comme l’illustrera avec éclat le Roman de la Rose.
460 Pour rappel, voir les extraits cités p. 192.
461 Lancelot du Lac, op. cit., LVII, p. 160-162.
462 On pourrait dans ce sens comparer le rôle de la dame de Malehaut à celui de la Dame du Lac à l’égard de Lancelot au tout début de ses aventures. Nous avons évoqué cet épisode analysé dans un article dédié à la pédagogie de la garde comme condition à l’héroïsation, cité p. 153.
463 Lancelot du Lac III, op. cit., IX, f. 53vb, p. 292.
464 Voir les passages que nous citerons de cette œuvre, p. 395-397.
465 Pour rappel : Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charrette, op. cit., v. 5 190-5 201, cité p. 193.
466 Lancelot du Lac II, op. cit., LXIX, f. 173a, p. 576.
467 C’est-à-dire très souvent, voire plus qu’il ne le faut. Voir le Dictionnaire et Complément au Dictionnaire de Godefroy, versions en ligne consultées le 7 octobre 2020.
468 La Mort le Roi Arthur, op. cit., § 145, l. 3-4.
469 Dictionnaire de Godefroy, version en ligne consultée le 5 juin 2020.
470 La Mort le Roi Arthur, op. cit., § 148, l. 9-12.
471 Le contraste entre ces deux types de jeux émotionnels fait écho à celui que l’on pouvait trouver dans le Roman de Renart entre celui de Brunmatin et celui de Renart, animé des mêmes viles intentions et des mêmes facilités à simuler ses émotions que Mordred. Pour rappel, voir l’analyse que nous réservions à ces deux épisodes p. 66-67.
472 Floriant et Florete, éd. et trad. A. Combes et R. Trachsler, Paris, Champion, 2003, v. 451-453.
473 On trouve ainsi confirmation, dans la mise en lumière des jeux eux-mêmes, des réflexions portées sur l’intensité émotionnelle par Jutta Eming et par Sif Ríkharðsdóttir. Pour rappel : J. Eming, « On Stage », op. cit., p. 558 et S. Ríkharðsdóttir, op. cit., p. 60 et p. 77, cités p. 169.
474 Pour rappel : Li livres du gouvernement des rois, op. cit., III, x, l. 2-5, p. 118, cité p. 115.
475 Pour rappel : Brunetto Latini, op. cit., L. II, 72, 1-2, p. 494, cité p. 116.
476 Pour rappel : D. Boquet, « Corps et genre des émotions dans l’hagiographie féminine au xiiie siècle », op. cit., p. 2, cité p. 119.
477 Ce qu’atteste également la définition que donne le Franzözisches Etymologisches Wörterbuch du terme ancien français temperaunce, version en ligne consultée le 12 janvier 2018.
478 Pour rappel : P. von Moos, « Occulta cordis », op. cit., p. 135, cité p. 101.
479 Sa racine latine, attemperare, se définit en effet comme le fait d’« ajuster, adapter ». Pour rappel : Trésor de la Langue Française, version en ligne consultée le 6 janvier 2018, cité p. 106.
480 Pour rappel : Lancelot du Lac II, op. cit., chap. 70, f. 181c, p. 646, cité p. 152 et Les Cent Nouvelles Nouvelles, op. cit., N81, l. 109-111, p. 476, et N26, l. 176-179, p. 168, cités p. 183.
481 P. von Moos, « Occulta cordis », op. cit., p. 131 et surtout P. von Moos, « Occulta cordis. Contrôle de soi et confession au Moyen Âge (suite) », Médiévales, no 30, 1996, p. 117-137.
482 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 137.
483 Ibid., p. 305.
484 J. Le Goff et N. Truong, op. cit., p. 152-153.
485 L. Smagghe, op. cit., p. 78.
486 P. von Moos, « Occulta cordis. Contrôle de soi et confession au Moyen Âge (suite) », op. cit., p. 117.
487 M. Aurell, op. cit., p. 358.
488 Ibid., p. 359.
489 Nous assumons ainsi un effet de corpus certain dans nos analyses : pour étudier l’importance des appels à la garde des émotions et le jeu qu’ils induisent ce faisant aussi, nous avons au passage exclu des textes passionnants pour l’étude de l’expression émotionnelle dans de tout autres paramètres que ceux que nous mettrons en lumière ici.
490 Nous dédierons un chapitre au corpus religieux que nous avons pu construire autour du jeu des émotions. Outre l’exemple éloquent de Gautier de Coinci analysé ici (Gautier de Coincy, op. cit., t. 2, I, M. 11, v. 1 157-1 200, cité p. 141), nous pourrons y envisager encore celui de Guillaume de Diguleville : Guillaume de Diguleville, op. cit., v. 7 887-7 902 ou v. 3 245-3 270, que nous citerons p. 486 et p. 502. Mais ce courant critique inspire bien sûr aussi le personnage de Faux Semblant, fait symbole des objets de dénonciation autant que porte-voix des critiques de l’hypocrisie religieuse. Nous le soulignerons dans la première partie de notre analyse du personnage de Jean de Meun.
491 L. Rouillard, op. cit., p. 21.
492 Jean Froissart, op. cit., v. 878-886.
493 D. L. Smail, op. cit., p. 43.
494 Ibid., p. 44.
495 Pour rappel : Lancelot du Lac III, op. cit., chap. 10, f. 59vb, p. 326, cité p. 149 et Le Roman de Tristan en Prose, op. cit., t. 2, p. 135 ; t. 1, p. 47 ; t. 2, p. 91, cités p. 89.
496 Pour rappel : B. H. Rosenwein, « Pouvoir et passion », op. cit., p. 1285-1286, cité p. 147.
497 M. Senellart, op. cit., p. 283.
498 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 320.
499 Rappelons l’exemple de Guillaume dont la colère finalement manifestée signe la victoire ou celui du jeune Lancelot qui se voit rappelé à l’ordre, mais aussi valorisé, pour son accès de colère. Pour rappel : Lancelot du Lac, op. cit., p. 156, f. 16c-f. 16d, ou Le Charroi de Nîmes, éd. et trad. C. Lachet, Paris, Gallimard, 1999,LIII, v. 1 352-1 357, analysés dans l’article que nous avions consacré à ce corpus : C. Carnaille, op. cit.
500 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 323.
501 L. Smagghe, op. cit., p. 167.
502 Pour rappel : Li livres du gouvernement des rois, op. cit., II, xxviii, p. 83 l. 33-p. 84 l. 11, cité p. 154.
503 Pour rappel : Richard de Saint-Victor, op. cit., chap. 7, l. 6-9, cité p. 103.
504 P. Nash, op. cit., p. 256.
505 Pour rappel, une fois encore : Lancelot du Lac III, op. cit., chap. 10, f. 59vb, p. 326, cité p. 149 ; Le Roman de Tristan en Prose, t. 2, p. 135 ; t. 1, p. 47 ; t. 2, p. 91, cités p. 89 ; Lancelot du Lac II, op. cit., chap. 70, f. 181c, p. 646, cité p. 152.
506 Pour rappel : Lancelot du Lac, op. cit., p. 192, f. 19c, mentionné p. 160.
507 Lancelot du Lac, op. cit., chap. 17, f. 44a, p. 370.
508 Pour rappel : J. Eming, Emotion und Expression, op. cit., p. 90, cité en introduction p. 51.
509 L. Rouillard, op. cit., p. 22.
510 Christine de Pizan, Le Livre de la Cité des dames, éd. M. C. Curnow, Michigan, Ann Arbor, 1975, II, xxix, 173a, p. 853.
511 Nous aurons l’occasion de constater, au gré des nuances dont ce jeu des émotions se pare ainsi, la justification qu’en apporte notamment Christine de Pizan en faisant relever la simulation, indubitablement trompeuse alors pourtant, de « justifiable hypocrisy » comme le résume Linda Rouillard (op. cit., p. 22). Nous y reviendrons au cœur de notre analyse de l’œuvre de Christine de Pizan et du tableau ambigu qu’elle dresse du jeu émotionnel.
512 Laurent Smagghe évoque dans son analyse des émotions princières toutes ces pratiques révélatrices des intérêts de manipuler les émotions : L. Smagghe, op. cit., p. 388.
513 T. Adams, « Faus Semblant and the Psychology of Clerical Masculinity », Exemplaria, no 23/2, 2011, p. 171-193, ici p. 171.
514 J. Dumolyn et É. Lecuppre-Desjardin, op. cit., p. 50.
515 J. Eming, Emotion und Expression, op. cit., p. 57.
516 J. Rider, op. cit., p. 5.
517 J. Eming, Emotion und Expression, op. cit., p. 70-76.
518 Ibid., p. 255.
519 D. Boquet et P. Nagy, Sensible Moyen Âge, op. cit., p. 267.
520 J. Rider, op. cit., p. 5.
521 J. Bourke, op. cit., p. 113.