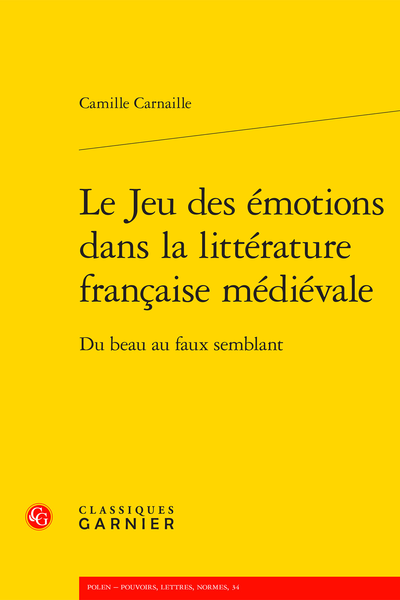
Conclusion Du bel, du faux ou du juste : regards croisés sur le jeu des émotions
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Le Jeu des émotions dans la littérature française médiévale. Du beau au faux semblant
- Pages : 623 à 649
- Collection : POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n° 34
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406151616
- ISBN : 978-2-406-15161-6
- ISSN : 2492-0150
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15161-6.p.0623
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/11/2023
- Langue : Français
Conclusion
Du bel, du faux ou du juste :
regards croisés sur le jeu des émotions
De l’émotion à son jeu
Au fil de ces chapitres, nous avons cherché à envisager toutes les polarités des manipulations émotionnelles. Le parcours en a certes été sinueux, mais il voulait avant tout refléter la subtilité du jeu des émotions par l’entremêlement des dynamiques qui l’animent. Nous avons, de la sorte, voulu révéler tous les enjeux auxquels les émotions peuvent répondre dans leur inscription littéraire. Nous avons pu nous confronter à toute une série de paramètres déjà bien attestés dans la prise en compte de l’instance affective au Moyen Âge, comme sa dimension corporelle et sa portée publique, ainsi que la morale qui l’entoure, sa dynamique évaluative essentielle et les exigences dont elle se pare dans l’idéologie médiévale. Notre analyse s’inscrit dans ce sens dans la mouvance des études développées autour de l’objet émotionnel. Considérer les jeux dont il peut faire l’objet offre de mieux saisir encore tout le réseau de réflexions qu’il mobilise. Ceux-ci permettent de repenser la nature spontanée des expressions corporelles, souvent conçues comme le reflet immédiat de la réalité émotionnelle et pourtant souvent premier objet du jeu des émotions. La tension entre exigences de contrôle et de sincérité dans la morale émotionnelle s’y mesure aussi. Les jeux émotionnels éclairent toute l’ambiguïté du rapport entre homo interior et homo exterior qui sous-tend les enjeux de maîtrise et d’authenticité de la manifestation des émotions à la frontière de ces deux instances. Notre analyse affrontait ainsi plusieurs problématiques centrales pour la compréhension et l’évaluation des émotions, dans toute l’ambivalence des prescriptions qui pèsent sur elles et du rapport à la vérité comme à la morale qu’elles impliquent. 624Nous avons pu constater toutes les difficultés qu’elles posent dans ce contexte et toute la diversité des solutions qui émergent pour y faire face, en fonction des perspectives adoptées. Nous avons surtout pu noter la portée littéraire du jeu des émotions, intégré dans la trame narrative pour en révéler des enjeux cruciaux. Nos réflexions nous semblent ainsi dénoter un investissement certain des émotions dans le récit, mais aussi dans les ambitions auctoriales qui l’animent. La diversité du corpus que nous avons considéré nous paraît renforcer ce constat, valable dans de nombreuses œuvres, selon des logiques variables en ce qui concerne la représentation et la manipulation des émotions, à l’aune de facteurs tant culturels que narratifs. Nous espérons de la sorte contribuer à démontrer le caractère fécond d’une analyse littéraire dans le champ d’étude vaste et prolifique des émotions médiévales.
De la ruse à la garde, de la garde à la ruse :
logiques du jeu des émotions
Le parcours que nous avons mené visait à répondre à cet objectif de valorisation d’un champ d’étude en pleine expansion, révélateur de points de tension d’un grand intérêt dans une optique littéraire. Nous l’avons donc déterminé en regard du souhait qui nous animait de penser les polarités qui entourent les manipulations émotionnelles dans la dialectique entre respect des codes et ruse. Nous avons tenu à mettre en évidence toute la diversité des dynamiques émotionnelles et à mesurer au mieux le rapport complexe et ambigu des émotions au vrai, comme à la codification dont elles font l’objet.
La confrontation à la problématique de la ruse associée aux jeux des émotions nous a permis, outre d’envisager toute l’influence des conditions génériques et narratives des œuvres considérées, de déconstruire les idées reçues en ce qui concerne la fausseté et les viles intentions à la source des manipulations d’émotions. En abordant un corpus réputé pour la propension rusée de ses héros, nous avons pu redessiner les contours des jeux des émotions dans leur rapport à l’hypocrisie. Là où la ruse de Renart, des personnages des fabliaux ou du couple de Tristan et Yseut 625peut prendre des allures proverbiales, elle ne se vérifie en rien ou presque dans leur attitude émotionnelle. Au contraire, leurs réactions affectives sont marquées par une intensité significative de la vérité de leurs émotions. Cette intensité se manifeste avant tout sur le corps et le visage des personnages. On touche ainsi à toute l’importance des apparences et aux enjeux du rapport, problématique et débattu, entre corps et âme. Nous avons également pu nuancer les dynamiques propres à chaque forme du jeu des émotions. La répartition entre dissimulation et simulation doit en effet être repensée à la lumière du rapport que l’une et l’autre entretiennent avec la ruse. Dans ce corpus supposé révélateur, la simulation relève bien plus souvent du renforcement de la dissimulation et d’un souci de conformité aux règles émotionnelles que de la volonté de tromper. Pareilles connotations témoignent de critères essentiels dans la considération du jeu des émotions, comme celui de l’intention qui l’anime. Mais elles éclairent surtout la ligne directrice essentielle des manipulations émotionnelles, non pas dans leur composante rusée, mais normée. À l’issue de cette réflexion centrée sur les ruses attendues de la part de véritables stéréotypes en la matière, force est de constater que, non contents de répondre avant tout à une sincérité irrépressible dans la manifestation de leurs émotions, les héros de ces récits jouent avant tout de leurs émotions dans le respect de codes attendus. Ils révèlent toute une série de lignes d’influence, dans toute leur diversité selon la situation, l’âge, le genre ou le statut qui est le leur. Ils témoignent ainsi aussi de la portée éducative dont les jeux des émotions se parent. Ils imposent donc de considérer les logiques des feeling rules qui, bien davantage que des enjeux de ruse, paraissent éclairer les manipulations émotionnelles. Cette première réflexion, construite comme un préambule à la suite de nos analyses, a comporté de grands intérêts dans l’appropriation de notre problématique de recherche. Elle a surtout enrichi notre approche méthodologique. Nous avons pu y éprouver nos décisions de construire nos analyses sur une base lexicale. Celle-ci s’est avérée porteuse pour distinguer des formules pertinentes à notre analyse. Nous avons aussi pu y déceler des schémas révélateurs dans l’étude des manipulations dont les émotions peuvent faire l’objet. Surtout, nous avons pu découvrir toute la richesse de la mise en scène qui en est faite dans la narration. L’enquête lexicale, avec toutes les limites qu’elle implique face à l’ampleur et à la subtilité du vocabulaire émotionnel, témoigne avant tout d’un 626souci de nuances et de justifications, de lignes de tension d’une grande finesse dans la mise en place des codes auxquels les émotions viennent répondre. Les qualifications employées et les objectifs qui en sont donnés attestent une prise en charge explicite des émotions dans la narration, bien loin des détails narratifs auxquels on avait pu les cantonner. Ainsi, ce préambule annonçait de manière évidente le parcours à suivre autant que la subtilité des jeux qu’il vise à appréhender.
Il appelait surtout à l’exploration des prescriptions qui pèsent sur les émotions. Bien davantage que l’esprit de ruse que nous avions pensé observer, les feeling rules paraissent dicter les jeux portés sur les émotions. Leur intégration dans ces efforts de codification témoigne d’emblée de la force et de l’importance de l’émotion. Nous avons cherché à cerner l’ensemble des dynamiques de l’émotionologie médiévale pour en révéler toutes les nuances. Nous y avons vite constaté la place centrale occupée par l’impératif de tempérance dans le processus de codification de l’émotion. Il se décline dans toutes les sphères que nous avons pu détecter de l’émotionologie. De son inspiration monastique, prêchant le contrôle indispensable au repost et à l’élévation vers Dieu, il imprègne aussi l’univers social et apparaît également dans la veine amoureuse. Il se construit dans un rapport obsédant à la publicité qui anime la société médiévale. Le principe de garde qui émerge au cœur de l’émotionologie médiévale connaît ainsi une orientation essentielle sur la contenance qu’il implique. Il éclaire l’importance conférée à la composante corporelle et apparente des émotions, aussi incontournable que crainte dans le système de représentation médiéval. C’est face à ce constat que s’est imposée la ligne directrice de cette étude, fondée sur les semblants émotionnels qui induisent autant l’évaluation des émotions que le jeu qui en découle. Nous avons ainsi souhaité circonscrire le rapport aux émotions dans le cadre de celui entre intérieur et extérieur, débattu tout au long du Moyen Âge dans les réflexions menées sur le lien entre corps et âme. Nous avons de la sorte voulu contribuer à repenser, par ce nouvel éclairage sur les dynamiques de considération et de jeu des émotions, l’opposition qu’elles induisent entre vrai et faux comme entre bien et mal. L’exigence de garde, qui conditionne la valorisation de l’émotion, se confronte en effet à celle de sincérité qui empreint également l’expression émotionnelle. Elle côtoie toujours les appels au contrôle et à la discrétion des émotions, qu’elles relèvent de la dévotion, de l’amour ou des émotions bienséantes 627à manifester sur la scène sociale. L’importance conférée aux paramètres visibles des émotions rend compte en effet d’un enjeu avant tout de convenance dans la manifestation des émotions. Il contribue à nuancer cette tension entre contrôle et sincérité, mais aussi la nature des jeux mis sur pied pour l’assurer. Le souci d’exemplarité tant des religieux que des souverains, mais aussi la crainte que suscite chez les amants la révélation de leur amour donnent lieu à un code émotionnel favorisant la visibilité d’émotions jugées bienséantes. Sous l’étiquette de bel semblant, ces émotions servent à en recouvrir d’autres plus inappropriées dans la sphère religieuse comme sociale ou à dissimuler l’amour à préserver de la menace de ses observateurs. À la liste des émotions préférées tues et discrètes se sont ajoutées, dans cette première analyse, celles de la colère ou de la haine surtout, mais aussi les joies plus inconvenantes, elles-mêmes révélatrices d’un manque d’amour ou de dévotion, mais surtout de mauvaises intentions. On a ainsi observé la prégnance, dans cette optique de contrôle, d’un double jeu qui favorise une dissimulation qui opère par la simulation de ces émotions bienséantes. La simulation peut donc avant tout servir les efforts de contrôle, mais elle ouvre aussi, dans la conscience qu’elle manifeste de la possibilité de manipuler les apparences livrées des émotions, au jeu à proprement parler, si ce n’est à la ruse, les exemples de Renart ou d’amants plus audacieux en sont révélateurs. Elle témoigne en tous cas d’un souci de publicité tout aussi essentiel que celui de la retenue des émotions. On touche ici à l’enjeu, crucial dans l’idéologie médiévale, du juste milieu qui permet de légitimer cet appel autant à contenir qu’à manifester les émotions, si ce n’est leur manipulation mesurée. Cette accumulation des manipulations nécessaires pour assurer la discrétion requise se veut significative de l’importance des émotions, comme de leur jeu. L’insistance mise sur l’impératif de contrôle ou sur ses difficultés est éloquente. Ce jeu dédoublé se construit le plus souvent sur le renversement entre l’émotion ressentie et celle manifestée, qui assure son efficacité, mais exacerbe aussi la rupture entre cœur et apparence que le jeu vient susciter. Tout en se détachant des idées préconçues de la simulation associée à la ruse, il renforce donc l’ambiguïté qui imprègne les exigences autour des émotions entre garde et sincérité. Cette tension s’inscrit dans le texte lui-même qui cherche à la mettre en exergue par des formules oppositives, mais aussi, dans ce contexte d’appel à la mesure, à la justifier par des propositions finales 628ou causales qui émaillent la mise en scène des jeux émotionnels. Notre analyse s’est montrée ainsi attentive aux paramètres linguistiques et discursifs de la codification des émotions. Les décisions prises selon la trame du récit ou les ambitions de son auteur éclairent les objectifs poursuivis dans chacune des situations et œuvres considérées et ainsi les dynamiques particulières des efforts de contrôle requis. La répartition des grandes lignes d’influence des feeling rules s’est vite imposée à notre lecture et trouve écho directement dans les enjeux mêmes des textes, qu’ils relèvent de l’idéal de repost et de l’élévation vers Dieu, de la bienséance cruciale sur la scène sociale au cœur de laquelle se posent les souverains, ou de la peur de la médisance qui hante les amants. Il n’est ainsi plus seulement question de codes culturels, mais aussi, si ce n’est surtout, de l’écho qu’ils ont trouvé dans l’univers littéraire qui les investit au cœur de genres essentiels à la production poétique médiévale comme celui de la poésie amoureuse. Dans chacune de ces sphères particulières transparaît la tension entre le contrôle recommandé dans la manifestation des émotions et sa sincérité obligatoire. Cette injonction parallèle, et parfois peu compatible, donne lieu à toute une tradition de dénonciation de l’hypocrisie à laquelle peut mener le jeu des émotions, dans la satire religieuse comme dans la condamnation des faux amants qui se développe tôt dans la poésie de la fin’amor. Mais elle conduit surtout à une ambiguïté inhérente des prescriptions émotionnelles, cultivées dans chacun des textes que nous avons observés. Il faudra la mise en lumière éclatante de la fausseté potentielle du bel semblant sous la plume de Jean de Meun pour qu’une telle ambivalence doive être revue ou, du moins, prise en charge.
L’analyse du Roman de la Rose s’imposait ainsi autant en regard de l’importance qui y est conférée aux apparences dans l’expression émotionnelle que du désir qui paraît animer son continuateur de lever le voile sur les tensions du jeu des émotions. Cette concentration sur les données visibles de l’émotion répond aux constats dressés dans les deux chapitres précédents quant à l’investissement corporel de l’instance affective. Elle se comprend aussi à la lueur de la problématique induite par l’obsession pour la publicité des émotions placées au cœur du lien tissé entre intérieur et extérieur. Le pouvoir significatif qui est accordé aux apparences se révèle de manière éclatante dans l’œuvre de Jean de Meun qui le détourne comme pour mieux le célébrer. On observe ainsi comment 629peuvent s’allier les dynamiques normées et rusées qui imprègnent la manipulation des émotions. La transformation du bel semblant, qui fonde une bonne part des feeling rules médiévales comme on l’a vu, en faux jette une lumière accrue sur les ambiguïtés que recèlent les appels à la discrétion des émotions. Elle invite à réenvisager l’ensemble de la morale des codes émotionnels, mais surtout à considérer l’éclatement total du lien entre intérieur et extérieur qu’est supposée assurer l’expression des émotions. Le personnage de Faux Semblant vient ainsi symboliser la tension indissoluble qu’impliquent les apparences émotionnelles dans la théorie de l’homo interior et de l’homo exterior. Dans le rapport de concordance qu’elle dicte avant tout, elle provoque la crainte de révélation de l’intériorité et de ses débordements, qui alimente le souci de retenue des émotions. Mais elle révèle aussi la possibilité de rompre l’état de transparence attendu entre ces deux instances. Elle ouvre ainsi la voie à la manipulation et à toutes les dérives qu’elle peut comporter. Cette nouvelle manière de qualifier les manipulations des apparences émotionnelles rompt également le lien attendu entre beau et bon construit dans ce même cadre. En rattachant le semblant ainsi manipulé non plus au bel, mais au faux, Jean de Meun pousse à reconsidérer la morale du jeu des émotions. Il permet de mettre en lumière un véritable système du jeu des émotions, sans détour ni compromis, en-dehors de l’ambiguïté que continue de cultiver son personnage. Faux Semblant révèle en effet la nature exacte du jeu des émotions à la fois en la condamnant et en la louant pour son efficacité indubitable à l’issue du roman. Il vient brouiller les logiques des feeling rules et signaler autant leur utilité que leur malignité potentielle. Et ainsi, plutôt que de se dédoubler, le jeu se triple même en assurant la discrétion de la simulation déployée d’émotions jugées pures pour mieux dissimuler les mauvaises intentions de Faux Semblant. La manifestation d’émotions bienséantes peut se parer du pire des vices quand elle camoufle l’absence totale de ces émotions. Telle est la leçon qui peut être tirée des discours et interventions de Faux Semblant, qui n’est animé par la moindre once de la dévotion ou de l’amour que sont censés refléter son habit de moine et sa fonction d’adjuvant de l’Amant. La démonstration qu’il fournit tant de l’utilité que du vice que recèle une telle manipulation se fonde avant tout sur les intentions poursuivies. De manière intéressante, le carré sémiotique qui vient reconfigurer le lien du vrai et du faux au bon et au mauvais sous l’impulsion de Faux 630Semblant trouve confirmation chez tous les personnages qui s’allient à la leçon du faux moine fait rois des ribaus d’Amour. C’est dans ce cadre que nous avons souhaité étendre nos analyses des faux semblants à tous ceux que mobilisent bien d’autres personnages du Roman de la Rose, pour mettre en lumière toute la subtilité du jeu des émotions qui y est mis en scène. S’imposent ainsi son omniprésence et toutes ses nuances, dans la multitude de regards portés sur ce sujet ou de contextes dans lesquels il peut s’inscrire, des personnages de l’Ami et la Vieille aux points de vue défendus par les figures d’autorité incontestables de Raison ou de Nature. La centralité des faux semblants instillés dans le roman témoigne de l’importance conférée à la problématique des apparences émotionnelles, à leur lecture indispensable, mais à leur détournement toujours possible aussi. Jean de Meun vient figurer, sous les traits de Faux Semblant, l’incertitude viscérale de l’accès à l’intériorité portée à son paroxysme dans le paradoxe qu’il incarne. Il investit dans ce sens son personnage au cœur de la réflexion qu’il mène tout au long de son récit sur la problématique de la connaissance, centrale dans la description qu’il offre de la quête de la Rose. Le personnage de Faux Semblant offre ce faisant une démonstration éclatante des enjeux narratifs essentiels du jeu des émotions, puisqu’il permet la résolution de la quête amoureuse qui est mise en scène hors des impasses qu’elle comportait avant son intervention. Mais il témoigne aussi de leur investissement dans le projet auctorial même. Faux Semblant vient répondre de manière éloquente à l’ambition de Jean de Meun de lever le voile sur la réalité qui se cache derrière les apparences, celles de l’allégorie comme des émotions. Il interroge leur valeur comme la portée de leur message en les associant à des problématiques essentielles comme celle de l’intention. La dynamique émotionnelle gagne une importance significative en s’intégrant dans les desseins de l’auteur lui-même. Jean de Meun peut ainsi révéler le pouvoir communicatif crucial, mais aussi dangereux, des apparences et souligner la nécessité de chercher à atteindre la vérité qu’il brouille dans tout l’épisode dédié à Faux Semblant. Il cultive jusqu’au tournis le paradoxe de Faux Semblant, pour révéler toute l’ambiguïté de l’expression émotionnelle, des codes qui l’entourent, des nuances qui la parent, des justifications qui peuvent en être données. Il entremêle dans ce sens les atteintes de Faux Semblant tant à la communauté émotionnelle religieuse qu’amoureuse. Il parvient ainsi, selon sa tendance bien attestée à jouer 631des traditions établies pour mieux les détourner, à révéler la malignité de l’une par celle de l’autre. Il démontre également la proximité de ces codes émotionnels, qui portent en eux les mêmes impératifs, mais aussi la même ambivalence. Pareille richesse de construction, fondée sur un décalage subtil des dynamiques émotionologiques envisagées dans le chapitre précédent, invitait à explorer plus avant toutes les nuances instillées dans ces différents univers émotionnels, mais aussi dans la sphère sociale contaminée à son tour par la portée du personnage de Faux Semblant, dans le Roman de la Rose et surtout dans la réception qu’il connaît ensuite.
Nous avons dans ce sens dédié les trois chapitres suivants à ces différentes dynamiques du jeu émotionnel. L’intervention de Faux Semblant dans l’armée d’Amour et dans les dernières étapes de la progression de l’Amant vers la Rose, ainsi que les résonances présentées avec les discours de l’Ami et de la Vieille témoignent d’une subversion de l’éthique amoureuse courtoise fondée sur ce retournement du bel au faux semblant nécessaire pour vaincre les médisants et mener à bien la conquête amoureuse. Son discours éloquent à l’encontre des Frères Mendiants et de la communauté religieuse de manière plus globale reflète une préoccupation importante quant à l’hypocrisie dévotionnelle. Enfin, de par l’omniprésence mise en exergue des faux semblants, le personnage de Jean de Meun paraît induire une corruption généralisée des apparences émotionnelles, au-delà encore des communautés religieuses et amoureuses. Nous avons interrogé tour à tour ces trois sphères du jeu des émotions, à la lueur des logiques des codes que nous avions pu détecter, mais aussi des dérives démontrées par Faux Semblant pour étayer le débordement possible du code émotionnel dans la ruse. La mise en lumière par Faux Semblant des tensions propres aux feeling rules imposait de les repenser et, avec elles, l’ensemble de la leçon qu’il délivrait. Celle-ci a donné lieu à toutes sortes de réorientations, selon une double tendance à l’adhésion, tout aussi ironique que celle de Jean de Meun, ou à une condamnation ferme, jamais dénuée pour autant de nuances. Tout en souhaitant évacuer l’ambiguïté révélée par Faux Semblant dans la pratique émotionnelle, les œuvres qui se proposent de la reconsidérer témoignent en réalité d’autres logiques encore des jeux émotionnels, tout aussi connotés, mais présentés comme acceptables. Elles dénotent une réflexion nouvelle sur le lien entre intérieur et 632extérieur, rebâti après avoir été éclaté sous le manteau de Faux Semblant. Elles le restaurent donc, avec une parfaite conscience, imposée par Jean de Meun, de ses ambiguïtés, qui se trouvent ainsi elles aussi réorientées. Ces ambiguïtés sont cette fois mises au profit d’un bien, ainsi associé à une forme de faux, mais valorisé par opposition au mal indubitable instillé par Faux Semblant dans la prise brutale de la Rose. On constate la grande subtilité de l’entremêlement possible entre faux et bien, loin des polarités strictes entre vrai et bien ou faux et mal posées au cœur de la morale des émotions. Cette réinscription des logiques émotionnelles s’est donc fondée sur toute la richesse et sur toute la complexité de l’émotionologie médiévale. Elle accorde toujours une place essentielle à la publicité, dans la restauration du lien entre intérieur et extérieur qui réactive la crainte, tout autant que l’importance, de la visibilité des émotions, avec des nuances propres à chaque communauté émotionnelle envisagée. Le critère de l’intention gagne lui aussi en importance dans ces efforts de revalorisation d’un jeu des émotions louable, avec toutes les connotations induites selon les objectifs poursuivis dans la sphère amoureuse, religieuse ou sociale.
L’effet de loupe que Jean de Meun vient porter sur les pratiques plus ambigües de la fin’amor se veut trop scandaleux pour être ignoré. La leçon aussi ironique que trompeuse de Faux Semblant connaît une réception tout en ambivalence, révélatrice tant de la condamnation qu’elle induit déjà que de la démonstration éclatante de son utilité. On a observé une tendance double dans la réponse fournie au Roman de la Rose. Elle peut poursuivre la célébration de l’efficacité indéniable du combat mené par Faux Semblant contre Malebouche et cultiver les justifications induites dans les codes mêmes de la fin’amor à cet endroit. Les ruses du Châtelain de Coucy et de la Dame de Fayel attestent cette tendance à la valorisation de la lutte des amants contre leurs ennemis dédoublés ici avec la dame médisante et l’époux, lui-même fait scrutateur jaloux de leur amour, pour mieux les condamner. Le Livre des Eschez amoureux moralisés livre lui aussi un vif plaidoyer en faveur des faux semblants intégrés directement au sein des pratiques du bien celer et de la sage feintise recommandées déjà dans les arts d’aimer. Ces œuvres témoignent du jeu mené sur la tradition émotionologique en légitimant les manipulations trompeuses au nom du secret à préserver autour de l’amour. L’entremêlement des stratégies dissimulatrices et 633des faux semblants à proprement parler participe d’une subtilité empreinte d’ironie qui n’est pas sans rappeler celle de Jean de Meun. Selon le modèle qu’il offre en la matière, l’appréciation se fonde alors sur l’utilité du jeu des émotions, qui révèle toute sa modernité bien sûr, en annonce de l’adage machiavélien de la fin qui justifie les moyens. Pareil paramètre connaît un développement exemplaire dans une optique de conquête induite par l’univers amoureux. Mais il s’est révélé valable pour toutes les dynamiques du jeu émotionnel, la contamination de Faux Semblant l’a bien attesté, et nous en avons trouvé confirmation dans ce triptyque d’analyses de la réception du Roman de la Rose. Mais la tendance à la célébration des faux semblants amoureux peut s’inverser. L’héritage de Faux Semblant s’inscrit également dans un souci de réorientation stricte, ainsi épurée, des codes amoureux. Les œuvres d’Antoine de la Sale et de Martin le Franc portent, en cette toute fin de Moyen Âge, à un haut degré de raffinement cette remobilisation de l’émotionologie. Elles restaurent ses objectifs avant tout bienséants, mais aussi sa portée éducative. Elles louent pour cela les personnages féminins, de manière éclatante dans le Champion des Dames bien sûr, mais aussi dans le roman de Jehan de Saintré. Non sans cultiver une forme d’ambiguïté sur le sujet qui paraît mieux encore en révéler la richesse, Antoine de la Sale met en scène le personnage de Belle Cousine avec toute la finesse du jeu des émotions manifesté et recommandé par les dames. Pareil constat ne peut manquer de faire écho à celui que nous avions pu dresser des œuvres à composante amoureuse en amont du Roman de la Rose. Ce rapprochement se comprend en réalité au sein d’une tradition narrative, et émotionnelle, très homogène, dans toutes ses ambiguïtés déjà. On a pu observer, dans le chapitre sur la garde, combien le celer amoureux pouvait rapidement se connoter face à la menace des médisants, mais aussi, dans ce contexte, le rôle essentiel des femmes pour préserver la relation amoureuse, mais aussi leur entourage. De même que dans le Lancelot Graal, l’amante se fait maîtresse à tous les niveaux dans le Jehan de Saintré. Elle en vient ainsi à rehausser l’importance du jeu émotionnel tant dans ses propres efforts de contrôle que dans ceux dont elle fait preuve pour initier son protégé à l’univers amoureux. Elle témoigne de l’impératif absolu du secret de l’amour dans les difficultés qu’elle éprouve à l’assurer, confrontée à la vivacité de ses émotions ainsi démontrée. Elle accorde aussi une place cruciale à la maîtrise 634émotionnelle du jeune Saintré parmi les leçons chevaleresques et courtoises qu’elle lui inculque. L’émotion occupe ainsi une fonction essentielle dans le parcours d’initiation typique des fin’amants et se fait même moteur pédagogique. Le succès à ce niveau de Saintré vient se confronter à l’échec de sa relation avec Belle Cousine. L’initiation est assurée, quelle que soit l’issue du couple, ce qui jette bien sûr une tout autre lumière sur les enjeux de l’amour courtois. L’émotion se veut essentielle non pas dans l’accomplissement amoureux en soi, mais dans le modèle qu’elle offre de codes de raffinement crucial dans l’univers courtois. Avec une ironie qui reste très similaire à celle de Jean de Meun, Antoine de la Sale propose une nouvelle version de la conquête amoureuse, dont il redessine l’ensemble des objectifs et des moyens mobilisés pour y parvenir. Le jeu émotionnel ne peut plus y être malintentionné, puisqu’il s’inscrit dans une visée bienséante qui se fait indépendante du secret amoureux lui-même. Martin le Franc se montre on ne peut plus explicite dans le combat qu’il mène contre Faux Semblant. Il dénonce la menace qu’il représente pour les femmes dans la lutte que mène son héros, Franc Vouloir, contre Malebouche. L’association du médisant et de son meurtrier dans le Roman de la Rose atteste une réorientation formelle des lignes justificatrices sur lesquelles se fondait la transition du bel au faux semblant chez Jean de Meun. Si le danger que représente Malebouche pouvait servir d’outil de légitimation aux viles manipulations des émotions, tel n’est plus le cas chez Martin le Franc. Non content de s’opposer à la nécessité du faux semblant en raison de l’insuffisance du bel semblant, il allie les dangers de la médisance comme de la fausseté des amants pour signaler la perfidie d’une telle forme de défense. Il en révèle le caractère dommageable avant tout pour l’honneur féminin, en écho au combat mené contre les dérives misogynes de la fin’amor par Christine de Pizan. Soucieux de repenser le rôle masculin dans la relation amoureuse après ses dénonciations, Martin le Franc en restaure les codes émotionnels dans une version épurée. Le déplacement du Faux Semblant du côté de Malebouche participe de ce projet. Le nom de son héros signale également son ambition de considérer le jeu émotionnel nécessaire dans l’univers amoureux sous le seul signe de la pureté des intentions, inscrites dans le service dû à la dame pour l’amant véritable. Ce faisant, Martin le Franc marque également sa volonté de revoir la leçon épistémologique du Roman de la Rose. Il redonne tout son éclat 635au pouvoir symbolique des signes, du nom notamment et de la construction allégorique dans son ensemble, mis à mal chez Jean de Meun. L’héritage de Faux Semblant se montre ainsi d’autant plus riche qu’il joue sur l’ensemble des problématiques qu’il vient figurer dans le Roman de la Rose, comme celle de la valeur du signe ou du décodage allégorique. Le roman d’Évrart de Conty offrait un autre exemple révélateur du succès de la lecture allégorique du personnage de Faux Semblant, placé au cœur d’une forme pervertie des codes de l’émotion amoureuse comme de l’écriture. Mais l’œuvre de Martin le Franc laisse aussi transparaître, de ce réseau de références qu’induit le faux moine fait ribaus d’Amour, un souci de mêler les ressorts amoureux et religieux de Faux Semblant. Elle révèle ainsi l’importance de la dénonciation des atteintes à l’émotion religieuse, pensée plus pure encore peut-être que l’amour. En accord avec une tradition intense en la matière, celle-ci se revêt d’une valeur exemplaire d’autant plus incompatible avec une telle manipulation des semblants des émotions qui sont supposés en offrir des indices formels. Ainsi, si Jean de Meun pouvait signaler la manipulation des semblants amoureux par la mise en lumière éclatante de celle qui relevait de l’investissement religieux de Faux Semblant, Martin le Franc rejoue cette association pour mieux condamner l’une par l’autre. Il évacue tout ambiguïté cultivée dans le Roman de la Rose, ou presque. Dans son souci de réorienter les lignes de l’émotionologie amoureuse, il veille à renouer avec l’impératif du secret, s’il cherche à assurer l’honneur de la dame aimée. Le jeu des émotions ne disparaît donc pas pour autant de ce nouvel art d’aimer esquissé par Martin le Franc. Mais il doit être habité de ce franc vouloir que personnifie son héros, qui devient le moteur de justification de la seule forme de jeu jugée acceptable. Le critère de l’intention prend ainsi une importance capitale dans la nouvelle morale du jeu des émotions, dans une association d’autant plus marquante en regard des efforts consentis d’un type de faux et du bon, association éclairée avec le paradoxe qu’elle recelait alors chez Faux Semblant. Cette nouvelle morale du jeu des émotions, dans toute l’ambivalence de l’héritage de Faux Semblant, réapparaît dans toutes les sphères émotionnelles qu’il a pu mettre à mal. L’entremêlement des dynamiques amoureuses et religieuses témoigne de l’intérêt de continuer à penser ensemble les deux pans des atteintes de Faux Semblant aux codes émotionnels.
636Si la critique des faux amants trompeurs imposait de nuancer la leçon de Faux Semblant dans l’univers amoureux, c’est peut-être plus encore le cas dans la veine religieuse, dont la tradition satirique donne un éclat particulier à la dénonciation de l’hypocrisie. Ici, comme dans l’univers amoureux, il est intéressant de considérer les racines du personnage de Faux Semblant, qui s’inscrit déjà sous la plume de Jean de Meun dans une histoire littéraire importante. Son implication dans la querelle de l’Université de Paris à l’encontre des Frères Mendiants s’éclaire ainsi à son origine dans les poèmes satiriques de Rutebeuf, rédigés pour défendre la cause du maître Guillaume de Saint-Amour. Mais la tradition dans laquelle Faux Semblant s’intègre dénote aussi d’emblée la portée plus large de la critique qu’il sous-tend. On a pu remarquer sa proximité avec Renart, autant dans sa tendance trompeuse que dans le jeu qu’elle recèle sur les apparences dévotionnelles ainsi détournées. Le réseau dans lequel Faux Semblant vient se greffer témoigne de l’importance conférée au signe dévotionnel et à la perfidie de ses détournements, inscrite dans une optique de célébration ironique qui traverse le Moyen Âge, de Renart à Faux Semblant, mais aussi ensuite à Renart le Contrefait ou à Fauvel. Le cheval fauve offre un autre avatar de l’hypocrisie incarnée, intégrée dans un entremêlement de vices significatif de toute sa malignité. À l’instar de Faux Semblant, le nom de Fauvel se veut l’indice de sa nature trompeuse, réactivé à plusieurs reprises comme pour mieux jouer de ce pouvoir révélateur, mais ambigu, du signe qu’il constitue. Fauvel vient lui aussi combiner la mise à mal des logiques religieuses et amoureuses d’ailleurs. Il détourne à son tour les codes de la déclaration amoureuse, ce qui démontre à la fois la force de l’héritage de Faux Semblant et, dans sa lignée, le vice des jeux émotionnels de Fauvel. Le Roman de Fauvel vient aussi attester l’intérêt de la construction allégorique de la réception que connaît le personnage de Faux Semblant dans une perspective religieuse également. Nous l’avons confirmé dans l’analyse des textes qui ne s’attachent plus seulement à glorifier la tendance critique tout en ironie de Faux Semblant, mais à nuancer le regard qui peut être porté sur les manipulations émotionnelles. Pour mieux éclairer les condamnations sous-entendues dans la mise en scène humoristique, si ce n’est satirique, de la fausse dévotion de Renart et de Fauvel, nous avons souhaité précéder leur analyse d’un exposé consacré à la problématique du mensonge. Nous l’avons d’emblée orienté pour peser le lien qui peut s’y tisser avec 637celle des apparences, incluse dans les réflexions et débats menés tout au long du Moyen Âge sur le mensonge. Il nous semblait nécessaire de mesurer la faute représentée par Faux Semblant et les personnages qui viennent s’y assimiler à l’aune des critères de dénonciation qu’il implique. Considérer le faux semblant dans son rapport au mensonge, selon toutes les nuances instillées dans sa définition, permet de mieux percevoir les logiques du détournement des codes et de la morale des émotions qu’il opère. Nous avons aussi pu remarquer dans ce cadre l’importance prise par le signe particulier de l’habit dans cette optique religieuse. Les exemples de Renart et plus encore de Fauvel viennent encadrer celui qu’en donnait déjà Faux Semblant. Ils témoignent de l’intégration des enjeux que revêtent les apparences dans les définitions du mensonge. Elles gagnent encore en importance dans l’univers dévotionnel, dans lequel elles se font indices de la condition religieuse et de l’émotion qui devrait la sous-tendre, supposée d’autant plus pure en regard de son destinataire, Dieu. Ces considérations éclairent toute la vilenie figurée par Faux Semblant et ses avatars dans leur usage trompeur de l’habit religieux pour servir leurs viles intentions. Cette réflexion sur la codification du mensonge a en outre fait émerger l’importance ici aussi du critère de l’intention. Nous avons pu ainsi constater la prégnance de cette question essentielle du système idéologique médiéval, autant dans sa définition de l’œuvre, que de l’émotion ou du mensonge. De manière intéressante, il ne conditionne pas seulement la célébration, tout en ironie, des faux semblants manifestés par Renart et Fauvel, mais aussi leur condamnation et surtout les nuances introduites à cet égard. L’enjeu que constituent les apparences émotionnelles dans leur rapport au mensonge se veut plus grand encore quand on envisage l’importance conférée aux émotions dans la pratique dévotionnelle. Au fil du Moyen Âge, elles se font essentielles, tant dans leur manifestation que dans la réalité que celle-ci doit toujours refléter. Nous avions déjà mis en exergue le rôle de la pensée chrétienne dans la prise en compte du phénomène affectif au Moyen Âge, mais il nous paraissait pertinent de mieux considérer ses logiques de valorisation dans la vie spirituelle. Nous avons cherché à appréhender les évolutions et particularités des pratiques religieuses et la place croissante de l’affect en leur sein. Nous avons confirmé ainsi aussi la place gagnée par le corps dans l’investissement dévotionnel et, ce faisant, l’intérêt de concevoir les émotions et leur manipulation par 638leurs symptômes physiques. La valorisation du corps dans le processus d’élévation vers Dieu ne se conçoit cependant que dans sa représentation comme reflet d’une intériorité inviolable. Si le corps concentre les efforts de contrôle, dans la sphère religieuse elle aussi soucieuse des apparences dans le rapport de publicité omniprésent dans l’univers médiéval, il ne peut donc pour autant rompre le rapport de concordance obligatoire entre intérieur et extérieur. Aux appels à la mesure des émotions, indispensable à leur valorisation, se superposent ainsi des appels à la sincérité du cœur que le corps vient refléter. Le Livre du Pèlerinage de vie humaine offre un exemple révélateur de la réception du Roman de la Rose, tout en souci de réorientation, mais aussi en nuances. Il relève d’un souhait explicite de revoir la leçon de Faux Semblant pour s’opposer au vice de l’hypocrisie dans le cheminement vers Dieu figuré dans le pèlerinage spirituel, ainsi rétabli, entrepris par son héros. Tout comme dans la sphère amoureuse, l’éclat de la mise en scène de Faux Semblant répond à des logiques antérieures, perceptibles dans le rapprochement possible avec l’œuvre de Gautier de Coinci par exemple, mais appelle surtout à des réactions révélatrices des dérives qu’il vient manifester. Le Liber Fortunae cité également à cette occasion révèle les efforts de condamnation de la leçon de Faux Semblant par une démonstration implacable de son vice. Il atteste la place gagnée par Faux Semblant comme symbole de l’hypocrisie honnie dans l’univers religieux, en permutant par exemple le rapport entre les figures d’Hypocrisie et de Faux Semblant pour mieux le dénoncer. Guillaume de Diguleville s’inscrit dans la même volonté de condamnation de toute forme d’hypocrisie, par le biais de figures symboliques comme celle de Satan. Mais il apporte des nuances d’intérêt à sa critique du jeu des émotions en acceptant, et en célébrant, une autre forme de manipulation émotionnelle. Le tableau tout en finesse qu’il en livre témoigne ainsi plutôt d’un souci de réorientation que de condamnation formelle. Tout comme le fera Martin le Franc, Guillaume de Diguleville s’oppose à l’héritage de Faux Semblant, mais renoue avec les codes sur lesquels il jouait. Il veille ce faisant à les restaurer dans toute leur pureté, mise en exergue autant que leur bienfondé. À ses critiques des apparences trompeuses de Satan succèdent les louanges du heaume de Tempérance ou, surtout, du trésor dissimulé dans le pain de Sapience. La morale du jeu des émotions se trouve ainsi affinée dans la communauté religieuse également, pourtant plus engagée encore dans la dénonciation de 639l’hypocrisie. Guillaume de Diguleville ne fait cependant que confirmer le carré sémiotique mis en lumière dans notre analyse de Faux Semblant. Le jeu qu’il valorise relève d’une forme de dissimulation animée des meilleures intentions puisqu’elle touche à la vertu éminente de l’humilité déjà célébrée par Gautier de Coinci. Les jeux émotionnels se trouvent donc remobilisés en regard des critères essentiels identifiés de l’émotion qui fait l’objet de la manipulation, de la logique du jeu mené à son égard et surtout des objectifs qui l’animent. Chacun de ces paramètres est reconfiguré dans la volonté de combattre le modèle perverti de Faux Semblant, mais aussi de défendre ainsi la vertu possible du jeu des émotions. Pareille réorientation s’inscrit bien sûr dans la même optique que celle que nous avons notée dans l’œuvre de Martin le Franc.
Le rapprochement des émotionologies amoureuses et religieuses comporte un grand intérêt. Il s’impose par l’emphase similaire portée sur la sincérité du cœur en opposition aux faux amants comme aux pappelards. Mais il met aussi en exergue ce critère de l’intention louée au nom de l’honneur féminin ou de l’élévation vers Dieu que le jeu émotionnel peut venir soutenir, au contraire des exemples du Roman de la Rose. Si la communauté religieuse n’induit pas de réflexion genrée dans le jeu des émotions ainsi vilipendé ou recommandé, comme l’atteste de manière évidente la communauté amoureuse, elle témoigne de lignes d’influence communes très enrichissantes pour donner toute sa force à l’héritage de Faux Semblant, ainsi qu’à la problématique du jeu des émotions. Son importance se conçoit peut-être mieux encore, à la lueur de ces critères fondamentaux ainsi identifiés, dans l’œuvre de Christine de Pizan. Elle vient signaler une volonté de considérer le jeu émotionnel dans sa globalité, dans une dynamique cette fois presque politique. Elle renoue en outre avec le prisme du genre qui nous avait tant intéressée dans nos analyses dédiées à la sphère amoureuse, dont elle ne manque pas de s’emparer également dans sa propre démarche de connotation du jeu des émotions. Nous avions en effet pu observer le rôle prépondérant des dames dans la préservation du secret amoureux dans notre prise en compte des paramètres amoureux de la garde. Les exemples de Guenièvre, de Soredamor ou d’Yseut témoignaient d’une responsabilité accrue pour les femmes, puisque c’est leur honneur qui était mis en péril par la révélation de leur amour. Ces femmes se montraient très respectueuses des impératifs de bienséance qui animent les jeux émotionnels auxquels 640elles doivent se prêter. Le cas d’Énide, tout comme celui de Guenièvre, sont révélateurs de ce souci de convenance, et même d’altruisme dont il se pare quand il vise le bien-être de l’époux, de l’amant, des amis qui pourraient être confrontés à leurs émotions. Ces épisodes signalent la place essentielle des femmes dans l’émotionologie amoureuse, mais aussi celle qu’elles occupent sur la scène sociale bien loin des clivages de genre les plus diffusés. L’importance des femmes dans la mise en place des feeling rules se veut plus nette encore lorsqu’elle se fait la condition même du respect de ces codes émotionnels chez leurs amants. Bien loin de l’optique didactique des arts d’aimer dans lesquels les femmes n’ont aucun rôle à jouer, les romans amoureux courtois soulignent la position centrale des dames dans l’initiation amoureuse, mais aussi ainsi émotionnelle de leurs amants, une position défendue également par Martin le Franc ou Antoine de la Sale, on l’a vu. Le point de vue de Christine de Pizan sur la question est plus éloquent encore bien sûr.
Le dernier chapitre dédié à l’œuvre de Christine de Pizan visait donc à élargir le regard que nous avions porté sur l’héritage de Faux Semblant dans la mise en scène du jeu des émotions au sein de la sphère amoureuse puis religieuse. Il s’inscrit dans une perspective qui se veut politique, induite par la réflexion menée par Christine de Pizan sur la place de la femme dans la société qu’elle cherche à mettre sur pied dès son projet de la Cité des Dames. Le manuel de comportement qu’elle intègre dans ce projet de défense de la cause féminine relève d’une dynamique presque sociologique dans l’exposé qu’il offre des conditions de l’ensemble de l’université des femmes. Mais il n’évacue pas pour autant les questions que pose le jeu des émotions dans une logique amoureuse ou religieuse. Cet entremêlement s’est avéré très intéressant, a fortiori dans l’élaboration d’un code de conduite complet offert par une femme à des femmes. Son Livre des Trois Vertus s’inscrit dans une tradition bien attestée de manuels de comportement construits, dans la lignée des miroirs aux princes, dans une optique féminine, à l’importante nuance près qu’elle le place sous une autorité elle-même féminine. Soucieuse de légitimer la condition des femmes, Christine de Pizan veille à renouer avec tous les enjeux émotionologiques de la garde qui animent le genre des miroirs. Le bon gouvernement qui y est prescrit se conçoit en effet fondé avant tout sur celui de soi qui permet celui des autres. Conformément aux codes émotionnels observés en amorce de nos analyses, pareille incitation 641à la maîtrise de soi se construit dans un idéal de contenance. Elle se concentre donc avant tout sur les apparences qui en sont livrées. Christine de Pizan exacerbe cette donnée des feeling rules. Dans une réaction assez évidente à la rupture opérée par Faux Semblant, elle s’efforce de restaurer le lien entre homo interior et homo exterior. Mais elle restaure ainsi également les ambiguïtés qu’il recèle, dans les prescriptions duelles qu’il implique de contrôle au risque de l’insincérité ou de transparence au risque de la révélation. Dans l’attention qu’elle porte aux apparences, Christine de Pizan pose le choix de repenser ce rapport de concordance entre intérieur et extérieur en faveur de l’extérieur. Elle le place ainsi au cœur d’une véritable politique de la visibilité, qu’elle décide de construire non plus comme une source de risques de dévoilement pour les femmes, plus concernées encore par ce danger selon la description qu’en donne Christine de Pizan, mais comme arme pour les défendre justement. Elle élargit dans ce sens la portée publique des relations des dames pour mieux en légitimer le pouvoir. Dans ce cadre, elle accorde une importance cruciale aux manifestations émotionnelles, indices qui priment dès lors sur l’intériorité qu’ils sont supposés refléter. Pareille réorientation de l’expression émotionnelle dote notre analyse d’un grand intérêt. Elle met en lumière la tension cruciale dans laquelle l’expression émotionnelle peut se comprendre, les dérives qu’elle peut induire, mais surtout la force que recèle sa manipulation. Dans le système politique mis sur pied par Christine de Pizan, seule l’extériorisation compte, sans que n’importe réellement l’émotion qu’elle devrait sous-entendre. Christine de Pizan signale le pouvoir communicatif des émotions, et les enjeux fondamentaux qu’elles représentent, ainsi mobilisées dans la défense féminine qu’elle livre. Le jeu sur la lecture des signes émotionnels mise à mal chez Jean de Meun est manifeste. Christine de Pizan insiste sur la valeur des apparences émotionnelles, au contraire de Jean de Meun qui en démontrait et dénonçait l’efficacité, mais aussi la menace. Sa réaction à la leçon dispensée par Faux Semblant se veut donc ambigüe, d’autant plus en regard des nuances dont elle se pare aussi. Christine de Pizan veille à revenir aux règles émotionnelles les plus strictes de juste mesure. Mais l’importance qu’elle accorde aux apparences émotionnelles vient contrebalancer son refus absolu des faux semblants. Elle finit en réalité par s’accorder aux enseignements de Faux Semblant en vantant l’utilité, et même le bienfondé, d’une juste ypocrisie. 642Le renversement est patent, du faux semblant à la juste ypocrisie, et sa légitimation aussi. Comme Martin le Franc et Guillaume de Diguleville qui attestent l’héritage de Faux Semblant dans une veine amoureuse ou religieuse, Christine de Pizan entremêle donc sa condamnation des manipulations émotionnelles trompeuses de Faux Semblant et sa défense d’une forme de jeu devenu acceptable. Cette réorientation du jeu des émotions frise le paradoxe. Elle témoigne en tous cas d’une réflexion poussée sur la tension qui traverse les émotionologies médiévales, entre leurs impératifs de contrôle et de sincérité. Dans cette politique de la visibilité qu’elle expose dans toutes ses facettes comme une menace, mais surtout comme un outil pour les femmes, Christine de Pizan favorise le contrôle plutôt que la sincérité des émotions. Elle intensifie et résout ainsi du même mouvement les tensions inhérentes à la morale des émotions. Elle joue en effet de l’importance des normes de mesure, ainsi remobilisées pour défendre également l’expression des émotions. Le juste milieu prêché dans la manifestation émotionnelle touche autant à l’excès d’expression qu’à son manque. Pareille orientation de la codification des émotions leur donne un éclat tout particulier en les assurant comme indispensables sur la scène sociale que Christine de Pizan s’ingénie à décrire. Dans une considération avant tout sociale, les émotions opèrent donc par le biais de leur manifestation, dans une restauration complète, dans ses ambiguïtés aussi, du lien entre intérieur et extérieur. Mais à le travailler davantage selon l’importance que revêt l’homo exterior que l’homo interior, Christine de Pizan sous-entend un certain relâchement en ce qui concerne l’exigence de sincérité. Soucieuse de nuancer et d’affirmer sa position, elle se jette dans les réflexions développées autour de la notion de vérité, théologique ou morale, ainsi qu’autour du pouvoir signifiant des apparences. C’est dans ce sens que nous avons souhaité livrer une analyse au long cours sur la problématique du mensonge et des apparences, dès le préambule de nos réflexions, mais aussi au cœur de notre étude du Roman de la Rose, dans celle que nous avons dédiée aux logiques religieuses du jeu des émotions et une nouvelle fois dans ce dernier chapitre. La question du vrai s’avère fondamentale dans son rapport ambigu, mais obsédant, au bien dans la morale des émotions. Nous avons ainsi cherché à offrir la démonstration la plus complète et nuancée possible des arguments avancés pour légitimer toutes les polarités du jeu des émotions selon la tendance embrassée 643dans l’œuvre considérée. Les justifications de Christine de Pizan fournissent un exemple éclatant de l’orientation du propos selon l’objectif qu’il vise. La vérité qu’elle esquisse s’inscrit dans une logique politique qui prévaut sur sa définition ontologique dans le règne des apparences qu’elle dépeint. C’est dans cette optique qu’elle peut revoir la leçon du Roman de la Rose, au nom d’ambitions qui dépassent les enjeux peu scrupuleux de la prise brutale de la Rose. Elle fonde ainsi une véritable morale de l’intention, éclairée dans cette perspective politique qui vise le bien commun et se fait moteur des nuances et justifications qu’elle offre au jeu des émotions. Elle procède à une manipulation intéressante de la vérité du jeu des émotions, dans cette récupération pour le moins connotée de Faux Semblant dans la juste ypocrisie. Dans ce sens, elle se distingue des solutions proposées dans les sphères amoureuse et religieuse interrogées auparavant. Si Martin le Franc et Guillaume de Diguleville veillent pour leur part à insister sur la sincérité qui doit animer le cœur du vrai amant comme du vrai chrétien, tel n’est pas le cas de Christine de Pizan. Transparaît ainsi une répartition particulière des justifications apportées dans chacune de ces dynamiques émotionologiques. Si elles présentent des lignes directrices similaires dans cette volonté de nuancer la mise en lumière trop éclatante de Faux Semblant, elles recourent à des arguments variables, surtout dans cette perspective sociale globale. Cette tension entre les divers codes du jeu des émotions est d’ailleurs confirmée par Christine de Pizan elle-même. Elle semble avoir tout à fait conscience de ces nuances et en jouer elle-même dans ses efforts de justification. Elle veille en effet à intégrer les univers amoureux et religieux dans la réflexion qu’elle mène sur la validité des manipulations émotionnelles. Ainsi, ses explications éloquentes concernent celle de la dévotion à afficher dans la pratique de la charité directement incluse dans sa politique de visibilité tendancieuse. Mais surtout, elle ne manque pas de s’arrêter aussi au cas spécifique des manipulations amoureuses, hautement problématiques selon le modèle offert par Faux Semblant aux amants. En regard de la perversion illustrée par le Roman de la Rose, Christine de Pizan condamne en bloc la tradition amoureuse courtoise et prône un refus absolu non plus du contrôle ou du mensonge, mais de l’amour qui devrait se prêter à de telles manipulations. Elle en vient à démontrer le danger plus grand encore incarné par les amants que par les médisants, ce que fera à son 644tour Martin le Franc, pour exposer les effets néfastes de l’amour pour l’honneur féminin. À ce niveau, sa réception du Roman de la Rose est on ne peut plus univoque. Elle dédie une bonne part de ses œuvres à décrier les conseils trompeurs qui y sont délivrés. Mais elle nuance son propos quand il ne relève plus de la réflexion amoureuse, mais se pare d’autres ambitions bien plus élevées. Alors, ce n’est plus la vérité du cœur qui prime, celle que célèbrent Guillaume de Diguleville comme Martin le Franc, même si elle se trouve contrebalancée par les enjeux d’humilité ou de secret amoureux à préserver, mais la manifestation à offrir des émotions au nom du profit pour la dame comme pour la société à laquelle elle peut servir d’exemple. Cette légitimation est d’une grande modernité bien sûr, elle revendique la primauté du bien commun, ou de celui des dames dans ce contexte de défense féminine. L’intégration du jeu des émotions dans les logiques narratives et auctoriales ne pourrait être plus explicite ce faisant. Christine de Pizan le pose au cœur de son projet de fondation d’une cité des dames et des qualités qu’elles doivent cultiver pour l’habiter. Sa défense de la cause féminine doit beaucoup à cette justification de jeux émotionnels connotés, mais acceptables et nécessaires, tout comme à la modernité de son œuvre bien sûr. C’est dans ce sens que Christine de Pizan construit sa réaction ambigüe au Roman de la Rose. Elle intègre la leçon de Faux Semblant de tromper pour ne pas l’être dans une réorientation ingénieuse de la tension entre intérieur et extérieur restaurée après avoir été éclatée par le faux moine. Mais au contraire de Jean de Meun, elle ne cherche plus à lever le voile sur la vérité, mais plutôt à le laisser couvrir et protéger la dame de la menace de ses ennemis. Elle fait ainsi preuve de toute la subtilité de composition possible du jeu des émotions, de son pouvoir de signification, de ses nuances, de la véritable morale dans lequel il s’intègre, mais surtout des ambitions dont il peut se parer.
645Le jeu des émotions
et l’étude des émotions
En croisant les efforts de réorientation de la leçon de Faux Semblant dans une optique amoureuse ou religieuse, en croisant toutes les émotions à investir dans toutes les relations et communautés émotionnelles possibles, Christine de Pizan vient témoigner de l’importance de l’émotion, de sa manifestation et de sa manipulation dans le système de représentation, mais aussi dans les logiques discursives médiévales. L’émotion s’y fait enjeu central, au cœur de projets éducatifs, narratifs, auctoriaux. La portée didactique de l’instance affective s’impose de manière révélatrice de la force symbolique que revêt l’émotion. On l’a constatée dans les efforts de codification observés dans notre analyse des logiques de la garde médiévale, dans la leçon paradoxale de Faux Semblant, dans les arts d’aimer ou dans les parcours initiatiques des jeunes amants comme des chrétiens sur leur chemin vers Dieu, dans les manuels de comportement que nous avons aussi choisi d’interroger. Elle éclaire aussi bien les enjeux de contrôle en soi de l’émotion que les dynamiques de jeu instillées, condamnées ou favorisées. On l’a vu, la codification des émotions dicte d’emblée leur manipulation, qui fait elle-même ainsi l’objet d’une codification minutieuse, mais non dénuée d’ambiguïtés. Cette ambivalence de prescriptions mène à toutes sortes de dérives et de lignes de tensions qui permettent finalement de mettre à jour un véritable système du jeu des émotions. Sur la base des enjeux de contrôle bienséant, on observe différentes dynamiques de jeu, qu’elles relèvent de la dissimulation discrète ou de la simulation. Leur opposition ne se fait pas aussi nette que nous aurions pu l’attendre, la seule analyse du corpus de la ruse le révélait déjà en préambule de nos réflexions. Au contraire, elles s’entremêlent pour se renforcer l’une l’autre, dans une optique discrète bienséante ou d’autant plus rusée qu’elle est camouflée. Cette polarité du jeu des émotions se complexifie encore selon les émotions mobilisées, le personnage de Faux Semblant l’a bien mis en lumière. Ce paramètre d’appréciation du jeu mis sur pied était déjà perceptible dans la répartition que laissaient deviner les occurrences de contrôle bienséant. Il y était alors avant tout question d’effacer une émotion jugée négative sous 646une autre plus appropriée à la publicité incontournable des émotions dans la société médiévale. Pareille forme de manipulation attestait l’absence de ruse inhérente à la démarche de simuler pour mieux dissimuler, plutôt animée d’un souci de bienséance que de tromperie. Faux Semblant vient éclater et complexifier cette distinction. Il mêle les attitudes convenantes et la ruse. Il affiche l’ambiguïté du bel semblant en le proclamant faux. À rebours de la simulation d’émotions bienséantes pour dissimuler celles qui le sont moins, il simule des émotions certes bienséantes, mais pour dissimuler l’absence totale d’émotions qu’il éprouve et la ruse qui l’anime. Le lien entre intérieur et extérieur décortiqué, quelque peu mis à mal, au gré des appels à assurer les apparences convenantes des émotions se trouve alors tout à fait rompu. Faux Semblant symbolise le cas extrême du jeu des émotions et en éclaire ainsi toutes les catégories possibles selon des degrés d’acceptation devenus évidents, ou, du moins, dès lors évidents à définir. Le pire cas de figure relève donc de la simulation d’émotions en réalité absentes et supposées pures, surtout la dévotion et l’amour, qui viennent recouvrir la seule ruse qui habite le cœur de Faux Semblant. Cette dépréciation formelle se comprend aussi en regard des viles intentions poursuivies. Il s’agit là du facteur crucial de l’évaluation du jeu des émotions, comme des émotions elles-mêmes d’ailleurs, nous l’avons noté. Il gagne encore en importance dans les efforts de réorientation de la leçon du Roman de la Rose. Il devient alors moteur non plus seulement de condamnation, mais aussi de justification et même de réhabilitation de formes de jeu. Les auteurs qui s’efforcent de repenser la place des manipulations émotionnelles exacerbent ce critère jusqu’à fonder une véritable morale de l’intention, qui éclaire ainsi chaque pan de la réflexion nécessaire pour appréhender l’entité affective, mais aussi ses manipulations. Christine de Pizan en a offert un exemple révélateur. En érigeant l’intention comme la base de la morale qu’elle instille, elle révèle l’importance accordée aux jeux émotionnels dans le système idéologique médiéval, puisque l’intention s’y fait paramètre commun à l’évaluation de l’émotion, de son jeu, tout comme de l’œuvre qui les met en scène. Mais Christine de Pizan révèle aussi les tensions qui continuent de traverser la morale du jeu des émotions en cette fin de Moyen Âge. En cherchant à les justifier, elle les met mieux en lumière encore. Bien sûr, après la démonstration éclatante de Faux Semblant, il convenait de prendre en charge l’ambiguïté inhérente 647du jeu des émotions. C’est ainsi que Christine de Pizan en vient à qualifier la manipulation émotionnelle qu’elle recommande de juste ypocrisie, significative de sa portée tendancieuse, mais surtout des intentions louables qu’elle poursuit. La tension subsiste surtout en ce qui concerne le rapport entre intérieur et extérieur et sa rupture imposée aussitôt qu’apparaît l’exigence de contrôle, avec toutes les problématiques qu’elle véhicule. Il éclaire toute la diversité des solutions apportées au problème posé par Faux Semblant, des préférences pour la réalité intérieure manifestées par Guillaume de Diguleville ou par Martin le Franc par exemple, même ni non sans nuances, ou pour la réalité extérieure qui conditionne celle des relations sociales dans la réflexion de Christine de Pizan. Cette polarité subsistante témoigne d’une incompatibilité insoluble entre les exigences de contrôle et de sincérité, révélée par Faux Semblant, traitée dans toutes ses nuances après lui. La réponse fournie par Christine de Pizan signale un parti pris d’une grande honnêteté, justifié en tant que tel loin des ambiguïtés préservées jusqu’alors. La réfutation des leçons trompeuses de Faux Semblant n’est donc jamais totale. Les nuances restent cultivées dans la réorientation des codes et des jeux émotionnels, entre le bien et le vrai des émotions manifestées. La tension entre vrai et faux s’avère cruciale dans la prise en compte de l’émotionologie médiévale. Elle a éclairé toutes nos réflexions et le parcours choisi pour les mener, des injonctions de garde aux débordements rusés, dans un entremêlement obsédant entre les exigences de contrôle et de sincérité qui n’est jamais évacué. Pareil constat témoigne bien sûr d’un impératif d’expression autant que de répression des émotions. Il participe de la mise en lumière de la force de l’investissement émotionnel, aussi démontré en creux souvent. Obligatoirement cachée ou montrée, l’émotion est à la source d’un véritable jeu révélateur de son importance. Elle se place au cœur d’enjeux essentiels, variables selon les univers considérés qui participent tous d’une véritable pédagogie affective, qui nous semblerait mériter d’être davantage prise en compte et analysée. Elle relève d’orientations diverses, selon les objectifs poursuivis dans ces perspectives éducatives variées et selon les publics différents qu’elles visent. Les enjeux des arts d’aimer ou des mises en scène de pèlerinage spirituel se distinguent bien sûr en regard de leurs destinataires. Le manuel de savoir-vivre de Christine de Pizan illustre aussi cette tendance, dans une orientation spécifique de genre alors, qui présente un contraste intéressant 648avec celle des arts d’aimer d’ailleurs. Celle-ci invite encore à revoir les distinctions du jeu des émotions de la communauté masculine ou féminine. On trouve une confirmation significative des aptitudes des femmes à jouer de leurs émotions, tout aussi bien voire mieux encore que les hommes, et des intentions louables dans lesquelles elles peuvent s’y prêter. L’analyse du jeu des émotions parvient ainsi même à relativiser la puissance du courant misogyne dans la pensée médiévale. Les descriptions émotionnelles intégrées dans la défense obsédante de la cause féminine que livre Christine de Pizan concordent en effet avec celles de grandes héroïnes des romans d’amour courtois, telle que la reine Guenièvre, soucieuse avant tout du regard public porté sur elle, de son honneur et du bien commun. Cette compréhension des émotions comme relevant d’enjeux didactiques trouve un éclat plus grand encore dans sa mise en récit. Elle se fait le support de tensions essentielles de par les impératifs présentés des manipulations émotionnelles, des conséquences de leur non-respect ou des critères d’appréciation qui y sont sous-entendus. Les contextes narratifs variables que nous avons envisagés attestent tous l’inscription des jeux émotionnels dans leur trame. L’émotion peut ainsi révéler des lignes narratives cruciales, mais aussi des ambitions plus profondes encore fondées dans le projet d’écriture même. Cela s’est avéré très explicite dans le cas du Roman de la Rose, ou du Livre des Trois Vertus, mais aussi dans la mise en lumière de la qualité première de la mesure émotionnelle dans le processus d’héroïsation des chansons de geste, du message marial de Gautier de Coinci, de la leçon tout en nuances de la loi du secret amoureux dans les romans tristaniens ou du raffinement des mœurs dans les œuvres de Chrétien de Troyes ou dans le Lancelot Graal. Les réponses données à la mise en lumière trop éclatante de la fausseté de Faux Semblant témoignent elles aussi de l’investissement de la question émotionnelle, plus que jamais débattue et nuancée dans des efforts de réorientation, condamnation et justification. Le jeu des émotions en vient ainsi à refléter l’idéologie médiévale et la théorie littéraire qui s’y développe. Christine de Pizan, dans sa volonté de revoir ou d’affiner la leçon de Jean de Meun, démontre la centralité de la morale des émotions en la faisant concorder avec celle de l’œuvre littéraire elle-même, fondée sur l’intention à affirmer dans ces deux cadres. L’une comme l’autre répondent à des enjeux similaires, qui se trouvent ainsi relever, tant dans l’émotionologie, dans les jeux 649qu’elle implique que dans l’acte de création littéraire, de la volonté. Au cœur de difficultés, ambiguïtés et ambitions parallèles, l’intention peut servir à légitimer la manipulation de l’émotion comme l’orientation de l’œuvre, confrontées l’une comme l’autre au défi de lever le voile de la connaissance, de peser l’exercice de lecture des signes ambivalents. On a pu remarquer à ce niveau la collusion tout à fait porteuse du décodage des émotions comme de l’écriture allégorique. Sans l’avoir cherché de prime abord, ce rapprochement s’est imposé dans nos lectures et dans le corpus que nous avons choisi d’établir et s’est avéré très éloquent de toute la symbolique du jeu des émotions. Il révèle mieux encore l’importance du jeu des émotions, ainsi mis en parallèle d’une pratique littéraire essentielle au Moyen Âge. Les dynamiques du jeu des émotions, dans tous leurs contextes d’intégration, participent d’une modernité saisissante, dans la prise en compte des nuances autant que du pouvoir significatif des émotions, à rebours des stéréotypes persistants dans l’analyse des émotions et des codes de comportement, mais aussi de genre, selon un paramètre qui s’est montré très pertinent et mériterait d’être encore mieux pris en compte. Notre étude paraît au contraire illustrer la prégnance au Moyen Âge, dans toute sa diachronie, des enjeux de contrôle et même de manipulation des émotions dans la mise en scène qui en est faite, la parfaite conscience de l’importance de leurs apparences, dans une grande subtilité de points de vue portés sur la question, au cœur de problématiques cruciales comme celle de la vérité et du mensonge, du lien tissé entre corps et âme, des distinctions de genre ou de critères d’évaluation essentiels comme celui de l’intention.