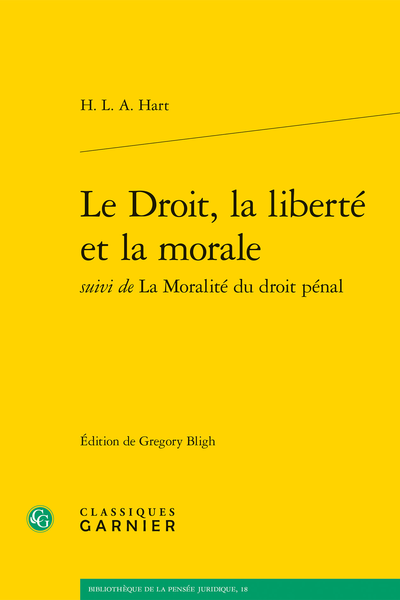
Préface
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Le Droit, la liberté et la morale suivi de La Moralité du droit pénal
- Pages : 7 à 9
- Collection : Bibliothèque de la pensée juridique, n° 18
- Thème CLIL : 3126 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie
- EAN : 9782406113010
- ISBN : 978-2-406-11301-0
- ISSN : 2261-0731
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11301-0.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/09/2021
- Langue : Français
Préface
Le présent ouvrage comprend deux cycles de conférences, Law, Liberty, and Morality (1962, Université de Stanford) et The Morality of the Criminal Law (1964, Université hébraïque de Jérusalem) que Hart avait prononcées au lendemain de la parution de son grand ouvrage The Concept of Law (1961). Leur traduction est le fruit d’un travail initialement achevé durant l’année universitaire 2012–2013. Le projet, alors prêt à paraître, a connu des contretemps éditoriaux. Lorsque j’ai pu me pencher de nouveau sur le manuscrit au printemps 2017, j’avais rédigé entre-temps ma thèse de doctorat consacrée aux fondements ontologiques de la pensée de Hart. La nécessité de réaliser un nouveau travail s’est imposée. D’une part, quelques traductions consacrées au débat Hart–Devlin étaient parues en 2014 dans la revue Droit & Philosophie (vol. 6) dont il fallait désormais tenir compte. D’autre part, le premier jet, réalisé en tant que doctorant enthousiaste, cherchait trop à résoudre les ambiguïtés soulevées par l’acte de traduction. Le présent texte vise dans la mesure du possible à n’être qu’une transmission. Cela implique de laisser l’auteur, par moments, face à ses obscurités. Je souhaiterais dire un mot à ce sujet.
Nous avons eu la chance de recevoir à Paris Michel van de Kerchove, traducteur du Concept de droit (Bruxelles, Facultés Universitaires Saint Louis, 2e éd. 2005) – traduction autorisée par l’auteur ! –, dans le cadre d’un colloque organisé à l’Université Panthéon-Assas pour le cinquantième anniversaire des conférences de Stanford (printemps 2013). Il avait eu la gentillesse de nous relater ses propres expériences de traducteur. Hart aurait été tout d’abord réticent à certaines suggestions, mais une fois rappelé à l’édition originale il aurait concédé, avec la bonne grâce qui le caractérisait, que c’était bien ce qu’il avait écrit – en manquant par endroits de clarté. Cette anecdote illustre un problème. Je ne suis pas d’avis que traduire revienne nécessairement à « trahir », une fois déminé le terrain des possibles malentendus culturels et sémantiques. Deux autres difficultés peuvent toutefois se présenter. La reformulation 8d’un texte dans une langue étrangère impose des choix qui peuvent révéler un sens latent d’une pensée que l’auteur n’a pas eu à préciser. De manière tout aussi surprenante, le passage à une langue nouvelle soulève des possibilités qui peuvent ne pas exister dans la langue d’origine. Ici, l’auteur n’a pas pu prendre position sur la question. Le travail de traduction, s’il parvient à ne pas dénaturer l’œuvre, peut être un révélateur d’ambiguïtés comme de potentialités.
Il faut par ailleurs dire un mot sur le registre de langue employé. Tout d’abord, il s’agit bien de cycles de conférences. Hart emploie par endroits une langue « orale ». Qui plus est, il s’exprime plus généralement, à travers son œuvre, dans un langage courant en évitant tout vocabulaire technique superflu. Cela soulève la difficulté suivante. Le juriste d’Oxford s’inscrit dans une tradition en philosophie du droit faiblement influencée par le juspositivisme de Hans Kelsen dont les concepts et l’approche imprègnent le vocabulaire français de la théorie du droit. Il ne s’agit donc pas simplement de se demander comment formuler les thèses de Hart « en français ». Cela reviendrait parfois à plaquer sur ses idées un vocabulaire technique issu d’une tradition qu’il rejette en partie, avec la déformation inévitable que cela entrainerait. Ainsi, c’est à dessein que j’ai cherché à privilégier un langage courant sans jargonnage.
Quelques notes expliquent les choix cruciaux de traduction lorsqu’ils soulèvent une question importante de théorie juridique ou de culture juridique comparée. Elles cherchent à apporter des précisions qui paraîtront parfois élémentaires, mais qui semblaient utiles étant donné la diversité disciplinaire du lectorat de Hart. En revanche, la résolution des ambiguïtés de la position de Hart est réservée à la présentation critique que le lecteur pourra consulter s’il le souhaite. Elle propose une grille de lecture qui permet de montrer la place et la cohérence de ces conférences dans le corpus hartien. Il s’agit notamment d’articuler le libéralisme du juriste d’Oxford avec sa critique – parfois fuyante – de la philosophie des droits moraux naturels. Cette présentation, centrée sur sa philosophie politique et sociale, n’a pas été incluse dans ma thèse de doctorat1.
9Ce projet aboutit grâce à l ’ aide précieuse de nombreuses personnes : Delphine Moraldo a collaboré à la tâche pénible de la révision du texte final de la traduction ; Nicolas Nayfeld et Ariane Brigenwald ont pris le temps de me faire parvenir des observations critiques éclairantes ; Robyn Bligh m ’ a aidé à défricher un premier jet de « Changing Conceptions of Responsibilty ». Je les en remercie très sincèrement.
Gregory Bligh
Lyon, juillet 2020
1 Certaines conclusions de cette étude sont présentées dans l’introduction de l’ouvrage de thèse Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart, Paris, Varenne-LGDJ, 2017, p. 13-15 et p. 18 sq.