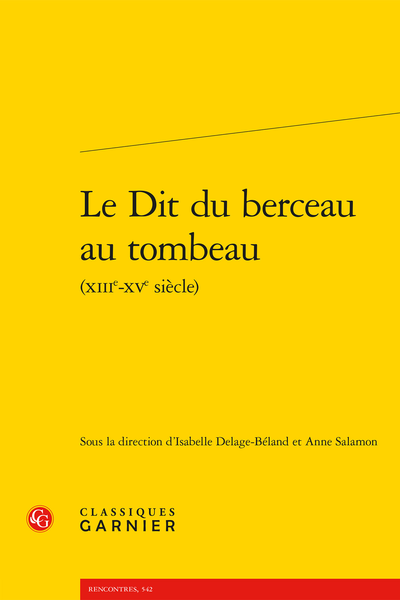
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Le Dit du berceau au tombeau (xiiie-xve siècle)
- Pages : 173 à 175
- Collection : Rencontres, n° 542
- Série : Civilisation médiévale, n° 47
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406128960
- ISBN : 978-2-406-12896-0
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12896-0.p.0173
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 06/04/2022
- Langue : Français
Résumés
Isabelle Delage-Béland, « Introduction. Le dit, une énigme de la littérature médiévale et ses solutions »
Véritable énigme de la littérature médiévale, tant par son omniprésence dans le paysage littéraire que par son caractère insaisissable, le dit a reçu peu d’attention critique au cours des vingt ou vingt-cinq dernières années. Cette introduction revient sur le sentiment d’échec qui se dégage à la lecture de nombre de travaux sur le dit avant d’explorer des pistes susceptibles d’améliorer notre compréhension de ce genre et, au-delà, d’enjeux fondamentaux pour l’étude de la littérature médiévale.
Patrick Moran, « Le genre du dit dans le débat sur la généricité médiévale. Que faire des plus anciens textes ? »
L’article examine l’émergence d’une conscience générique du dit en privilégiant des textes précoces, écrits avant que la dénomination générique dit ait pleinement émergé chez les auteurs, mais identifiés comme des dits dans au moins un de leurs manuscrits : les Vers de la mort d’Hélinand de Froidmont (vers 1195), les Congés de Jean Bodel (vers 1202) et trois textes de Raoul de Houdenc (le Roman des ailes, le Songe d’Enfer et le Dit, tous trois vers 1200).
Francis Gingras, « Façons de dire. Le cas du Ci nous dit »
L’analyse de la formule Ci nous dit, qui donne son titre à un recueil de textes didactiques (ca. 1313-1330), fait ressortir ses rapports avec l’exemplum et sa fonction démonstrative. La dimension orale y reste importante, en lien notamment avec la prédication. Or cette mission édifiante peut aussi passer par la fiction. La définition des modalités du dire dans une forme narrative du début du xive siècle permet de mieux cerner la définition du genre qui se développe parallèlement sous le nom de dit.
174Madeleine Jeay, « Le Dit et son énonciateur. Le métadiscours de Baudouin et Jean de Condé »
Dans les énoncés introductifs et conclusifs de leurs dits, Baudouin et Jean de Condé élaborent une terminologie diversifiée pour désigner leurs pièces et l’accompagnent d’une réflexion sur leur pratique de ménestrels. Celle-ci trouve sa légitimité dans la portée exemplaire de textes destinés à un public que l’on souhaiterait digne d’en apprécier la teneur. Il se dégage de ce métadiscours une conception du dit qui découle de cette terminologie et de leur conception de leur métier de ménestrels.
Yasmina Foehr-Janssens, « La génération du dit. Baudouin et Jean de Condé au prisme de la généalogie poétique »
Les œuvres de Baudouin et Jean de Condé ont été rassemblées dans deux importants manuscrits : Paris, BnF, fr. 1446 et Paris, Arsenal, 3524. Ce dernier comporte une rubrique qui fait de Jean le fils de Baudouin. La présente étude s’intéresse à la manière dont cette affirmation de parenté affecte la tradition manuscrite des deux auteurs. Dans un second temps, elle compare les pratiques poétiques du père et du fils du point de vue de leurs usages respectifs de la métaphore de la génération.
Gabriel Cholette, « Par cest essample doit entendre… Le statut du récit dans la définition médiévale du dit »
Les dits qui donnent à lire des récits sont rares. Si l’on retire de la liste de Monique Léonard les textes qui se désignent comme fable, fabliau, lai ou miracle dans le corps du texte ou dans le paratexte, il reste 34 textes narratifs. Leur examen révèle plusieurs caractéristiques communes, dont le dispositif énonciatif. Il sera alors question d’observer cette modulation de la voix dans son processus, c’est-à-dire d’examiner les moments pivots du discours et de l’enchaînement je : il : nous.
Mathias Sieffert, « Le dit comme écriture de la contingence amoureuse. Sur le Remède de Fortune de Guillaume de Machaut »
Ars amandi et ars poetica, le Remède de Fortune de Guillaume de Machaut pose une question : la poésie permet-elle de remédier à l’inquiétude du 175désir ? Les insertions lyriques qui rythment le dit illustrent une évolution allant d’une poésie de contingence, soumise à la loi du désir, à une poésie de mémoire, portée par Espérance. Mais si la poésie permet à l’amant de vaincre son angoisse, peut-elle suffire à conjurer la contingence, plus menaçante encore, du désir de la dame ?
Jacqueline Cerquiglini-Toulet, « L’invention du dit. Quand le dit devient un écrit »
À partir des sens premiers du mot, l’article explore les critères qui permettent de caractériser le dit comme genre, critères qui ne fonctionnent qu’en combinaison. Il interroge la question de la longueur de cette forme, en particulier à travers l’exemple des dits en quatrains d’alexandrins monorimes. Il examine enfin la concurrence des mots dit et livre à partir du xive siècle en tant que désignation générique. Il y a bien eu un moule mental du dit qui s’estompe quand la prose et le genre qui la soutient, le livre, l’emportent.