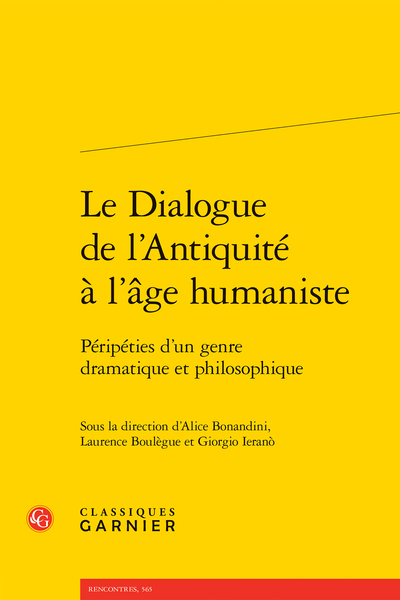
Résumés des articles
- Publication type: Article from a collective work
- Collective work: Le Dialogue de l’Antiquité à l’âge humaniste. Péripéties d’un genre dramatique et philosophique
- Pages: 497 to 503
- Collection: Encounters, n° 565
- Series: Readings from the Latin Renaissance, n° 18
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406143406
- ISBN: 978-2-406-14340-6
- ISSN: 2261-1851
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-14340-6.p.0497
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 04-05-2023
- Language: French
Résumés des articles
Alice Bonandini, Laurence Boulègue et Giorgio Ieranò, « Introduction »
L’introduction, tout en rappelant la complexité du genre dialogique dès l’Antiquité grecque et romaine, présente les grandes thématiques posées par le dialogue dramatique et philosophique jusqu’à la Renaissance humaniste : elle met ainsi en lumière, dans une perspective diachronique, l’apport des différentes contributions du volume.
Mauro Tulli, « Platone, il dialogo e la raffigurazione della realtà ideale »
La contribution étudie la cohérence entre l’interdiction de l’épopée et du drame dans la République et la production littéraire que Platon propose avec le dialogue. L’enquête s’appuie sur l’analyse de la μίμησις dans la République et de la relation entre la διήγησις et la représentation de Socrate dans le discours d’Euclide dans le Théétète. Enfin, la comparaison avec la μίμησις du Timée montre que Platon, dans ce dialogue, offre un reflet fidèle de la réalité idéale bien plus que de la réalité.
Andrea Rodighiero, «“Te, allora: te, che chini a terra il capo”. Intonazione dialogica e ‘accusativo aggressivo’ nel dramma attico »
Dans certains passages de la tragédie grecque, un personnage entame un dialogue en s’adressant à son interlocuteur par l’accusatif, livrant ainsi un indice du ton général du discours. On peut qualifier cette forme d’« accusatif agressif ». Cet article vise à analyser la structure de tels extraits, en essayant tout d’abord de définir leur statut dramaturgique et en les envisageant ensuite comme un point de départ à l’étude de l’utilisation de la langue du quotidien dans les dialogues tragiques.
498Olimpia Imperio, « Detti e non detti nei dialoghi finali delle Rane di Aristofane »
Dans le final des Grenouilles, les dialogues entre les antagonistes de l’agôn – Eschyle et Euripide – et le juge Dionysos posent de nombreux problèmes dont découlent non seulement l’interprétation controversée de la conclusion, mais aussi la compréhension du sens ultime du drame. Cet article propose de revenir sur ces questions par le biais d’une analyse de la technique dialogique (affirmations, contradictions, réticences et omissions) qui caractérise la fin, très sérieuse, de cette comédie.
Donatella Izzo, « Les interprétations d’Aristophane, Nuées, v. 489-491, à l’épreuve des mécanismes du dialogue comique »
Dans les v. 489-491 des Nuées d’Aristophane, les scholiastes ont suggéré une allusion aux cyniques à cause de l’expression « κυνηδὸν[…]σιτήσομαι ». Récemment, Marie-Odile Goulet-Cazé a pensé à une allusion spécifique à Antisthène. Cet article propose de revenir sur ces hypothèses en s’appuyant en particulier sur l’analyse du mécanisme comique présent tout au long de ce dialogue.
Salvatore Monda, « Il dialogo tra senex e servo nella commedia nuova e nella palliata »
S’il est généralement admis que la part prédominante réservée à l’esclave dans la comédie de Plaute est une nouveauté par rapport à ses prédécesseurs grecs, cette étude propose de revenir sur les scènes de dialogue entre l’esclave et son maître, au cours duquel l’un des deux interlocuteurs doit tromper l’autre. La comparaison avec des scènes similaires de la nouvelle comédie et du théâtre de Térence semble montrer que le rôle de l’esclave pouvait déjà être prédominant dans les modèles grecs.
Monique Crampon, « La prolifération du dialogue chez Plaute »
La vivacité intrinsèque du dialogue plautinien, notamment quand les mots se renvoient comme des balles, est aussi liée à la variété des interlocuteurs, ceux de la fabula elle-même et ceux que se crée le personnage bavard, qui s’adresse au public et parfois s’interroge dramatiquement lui-même, contribuant ainsi à la uis comica de Plaute, différent de Térence, sur ce point-là également.
499Gianna Petrone, « Due modelli di dialogo drammatico. Il comico Plauto e il tragico Seneca »
Souvent le dialogue dramatique prend la forme d’un combat, l’agôn tragique ou la querelle comique. Chez Plaute, qui garde l’ethos des types scéniques, le conflit entre les différents points de vue se fait par correspondances et symétries (Most. v. 1-50 ; Persa v. 405-426), jusque dans la musicalité des cantica (Pseud. v. 243-264). Dans les dialogues de Sénèque s’affrontent deux vérités incompatibles, entre finesses intellectuelles et sentences contradictoires (Troades v. 327-336 ; Oed. v. 518-527).
Alice Bonandini, « Un figlio degenere per un nobile padre. Dialogo filosofico e dialogo menippeo »
À partir des dialogues Bis accusatus et Piscator de Lucien de Samosate, dans lesquels la personnification du dialogue agit comme personnage en acquérant une fonction métalittéraire, l’étude vise à reconstruire la relation entre le dialogue philosophique et la tradition diatribique et la ménipée grecque et latine. Cette relation est fondée sur la référence au modèle socratique (incarné par Menippe) et sur l’esprit du spoudogeloion, déjà présent dans le Banquet de Platon.
Carlos Lévy, « Des Partitions aux Tusculanes.Le dialogue cicéronien en mutation »
Les dialogues philosophiques que Cicéron a écrits à la fin de sa vie présentent des éléments théoriques récurrents, mais aussi des différences considérables en ce qui concerne l’identité et le rôle des personnages. Le but de cette recherche sera de comprendre l’itinéraire auctorial qui conduit Cicéron à mettre en scène dans les Tusculanes un personnage quasiment muet, dont la mystérieuse présence incite à mettre en doute la nature dialogique de ces disputationes.
Sophie Van der Meeren, « Silence et transcendance dans les dialogues de l’Antiquité tardive. Étude comparée d’un motif philosophique et littéraire chez Proclus, Augustin et Boèce »
L’article explore les procédés littéraires par lesquels se manifeste le silence dans le Commentaire de Proclus au Premier Alcibiade de Platon, les Dialogues de Cassiciacum d’Augustin et la Consolation de Philosophie de Boèce. Ce silence 500est celui, caractéristique, du retrait en soi-même et de l’accueil de la transcendance. Nous voyons dans cette mise en scène du silence intérieur un motif spécifique du dialogue philosophique de l’Antiquité tardive gréco-romaine.
Giuseppe Noto, « Note sur le théâtre médiéval et la philologie romane »
Parmi les éléments dont le phénomène théâtral est une synthèse dans la tradition culturelle occidentale, c’est souvent le texte dramaturgique qui a attiré l’attention des chercheurs. Aujourd’hui (comme l’a écrit Marzia Pieri), « all’idea bizzarra e radicata che il “teatro” […] sia uno scomparto della letteratura si contrappone specularmente la risentita asserzione che le sia totalmente estraneo ». Ce fait a produit une fracture entre la philologie et l’histoire du théâtre qui doit être recomposée.
Gabriella Parussa, « L’art du dialogue ou les stratégies d’une mise à l’écrit. L’exemple du théâtre médiéval français »
En se fondant sur l’analyse de textes dramatiques français des xive et xve siècles pour étudier la manière dont sont construits les échanges dialogués, cet article vise à définir les stratégies de mise à l’écrit d’échanges oraux. Ainsi, par une approche de type pragmatico-historique, des caractéristiques propres à l’oral sont mises au jour, comme la réduction phonétique (élision, troncation), l’agglutination, ou des structures syntaxiques particulières (dislocations, répétitions, overlapping).
Alice Lamy, « Partager les merveilles de la nature et les mystères cosmologiques. Le dialogue encyclopédique aux xiie et xiiie siècles, l’exemple d’Adélard de Bath (Questions naturelles) et de Placides et Timeo (xiiie siècle) »
Les Questions naturelles d’Adélard de Bath (1120), qui traitent des êtres naturels, et le dialogue anonyme (xiiie siècle) entre Placides, un disciple fils de prince, et Timeo, son maître, sont caractéristiques d’une écriture qui met en scène d’importants aspects du mouvement noétique et cognitif de la raison humaine. La mise en regard de ces deux œuvres dialogiques offre ainsi une lecture nouvelle du sens de la production et de l’activité encyclopédiques.
501Laure Hermand-Schebat, « Mecum loquor, le dialogue intérieur chez Pétrarque. Lettres et Secretum »
Partant du syntagme mecum loquor, attesté chez Cicéron, Sénèque et Horace, nous situons Pétrarque dans cette tradition du dialogue intérieur dont un des jalons essentiels est les Soliloques d’Augustin. Le dialogue du poète avec lui-même et la structure du soliloque apparaissent tant dans le Secretum que dans l’Épître Métrique I, 14 et la canzone 264. Le dialogue apparaît alors chez Pétrarque comme une mise en scène de la contradiction inhérente à l’humain.
Véronique Dominguez-Guillaume, « Débat ou prophétie ? Le dialogue de Jésus avec les docteurs dans le théâtre religieux français des xve et xvie siècles »
L’article s’interroge sur la nature de l’échange dialogique à l’œuvre dans la scène théâtrale de Jésus et des Docteurs. Entre théories pragmatiques et communicationnelles (Austin, Jakobson) et disputatio scolastique, le dialogue autour de la naissance et de la venue du Messie est-il connaissance en construction ou duplication de la parole rituelle pour une adhésion sans médiation ? Par le dialogue, c’est l’objectif même du théâtre médiéval sacré qui est soumis à la réflexion.
Laurence Boulègue, « L’évolution et les paradoxes du dialogue philosophique au Quattrocento et au Cinquecento »
Présente de façon sporadique avant le De dialogo de Sigonio (1562), la question du statut du dialogue philosophique est néanmoins posée dès le xve siècle, avec la redécouverte de Platon, puis au xvie siècle, avec celle de la Poétique d’Aristote. L’articulation de la mimèsis et de la démonstration philosophique est problématique. C’est en revenant sur ce point précis que cette communication propose d’éclairer à nouveau les différents états du genre dialogique dans la philosophie humaniste.
Hélène Casanova-Robin, « Réminiscences plautiniennes dans le dialogue Asinus de Giovanni Pontano »
L’étude vise à montrer la présence de la comédie de Plaute dans le dialogue latin Asinus composé par Giovanni Pontano à la fin du xve siècle, avec ses 502implications esthétiques et éthiques. L’imprégnation plautinienne, inattendue dans un genre inspiré le plus souvent par la tradition philosophique antique et par Lucien, s’avère ici un outil notable de renouvellement littéraire et riche d’une réflexion parfois très acerbe sur l’époque contemporaine.
Lucie Claire, « Formes et fonctions du dialogue dans l’Ergastus et le Philotimus de Francesco Benci »
Composés par le jésuite Benci pour la cérémonie annuelle des prix du Collège romain, l’Ergastus (1587) et le Philotimus (1589) sont des drames statiques, soutenus par une écriture dialogique protéiforme. L’article propose d’en étudier la variété et les enjeux, et de comprendre comment ces pièces témoignent de l’une des deux voies empruntées par le théâtre des jésuites : loin de la tragédie de martyre à grand spectacle, elles illustrent l’ambition plus modeste des débuts de la Compagnie.
Giovanna Di Martino, « Tradurre il teatro per il teatro. Presenza e assenza di dialoghi in due adattamenti cinquecenteschi del Prometeo incatenato di Eschilo »
Cet article analyse le concept de traduction et l’usage du dialogue dans deux versions du Prométhée Enchaîné d’Eschyle datées du xvie siècle. La première a été écrite en langue vernaculaire par l’homme de lettres siennois Marcantonio Cinuzzi et elle est restée sous forme de manuscrit jusqu’à sa publication en 2006. La seconde a été écrite en latin par l’évêque de Calabre Coriolano Martirano et publiée en 1556 par son neveu avec d’autres traductions de pièces antiques.
Nathalie Catellani, « Traces de Sénèque dans la Médée de George Buchanan »
Les dramaturges du xvie siècle prirent pour modèle Sénèque, mais George Buchanan privilégia l’esthétique euridipéenne, dans ses traductions d’Euripide comme dans ses tragédies bibliques. L’article montre que, malgré une traduction fidèle au texte grec, les dialogues de la Médée de Buchanan comportent des traces des tragédies de Sénèque qui, mises en réseau, infléchissent la représentation des personnages de Médée et de Jason et contribuent à rendre la tragédie plus spectaculaire.
503Carine Ferradou, « Polémique politique, forme dialogique et traités de philosophie politique à la fin du xvie siècle. Le De iure regni apud Scotos de George Buchanan (1579) et le De regno et regali potestate de William Barclay (1600) »
Les deux premiers livres du traité de l’absolutiste écossais William Barclay, De regno et regali potestate (1600), se présentent comme une réfutation des idées tyrannicides de son défunt compatriote George Buchanan (Dialogus de iure regni apud Scotos, 1579). Comme pour mieux faire ressusciter l’opposant à sa thèse, Barclay écrit un dialogue dont l’étude des enjeux souligne leurs points communs et leurs divergences concernant la forme littéraire, la rhétorique argumentative, le contenu philosophique.
Alfredo Casamento, « “Come on, mother!” La scena della dichiarazione d’amore nella Fedra di Seneca e le sue fortune moderne »
La célèbre scène centrale de Phèdre de Sénèque (v. 591-714) prévoit la rencontre rapprochée entre les deux protagonistes de la tragédie : d’une part, Phèdre, reine d’Athènes, épouse de Thésée, follement amoureuse de son beau-fils, d’autre part, Hippolyte. C’est une solution dramaturgique d’un impact particulier sur le théâtre moderne que cette étude propose de montrer à travers l’analyse d’un certain nombre de passages.